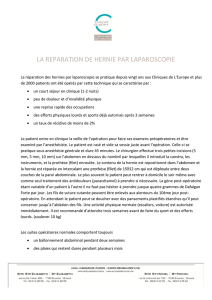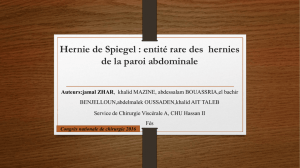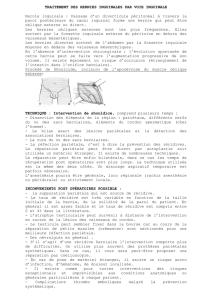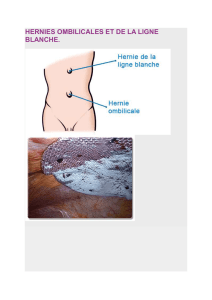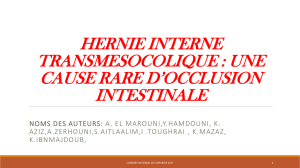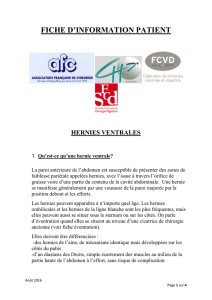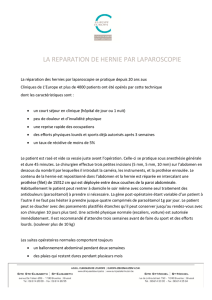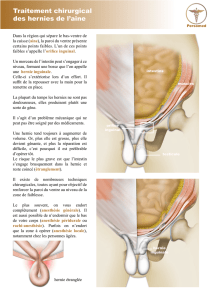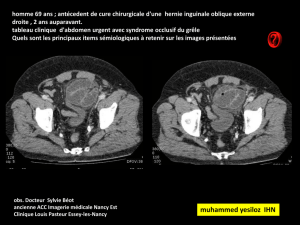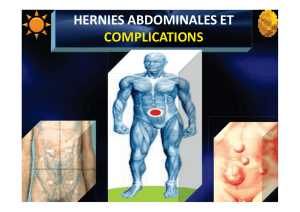Hernies de la paroi abdominale - ceil@univ

Hernies de la paroi abdominale
Pr. Meziane HABAREK
Objectifs :
Diagnostiquer une hernie de la paroi abdominale.
Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
Les hernies pariétales constituent la grande majorité des hernies abdominales, regroupant les
hernies de la ligne blanche (ombilicales, épigastriques et hypogastriques), incisionnelles,
inguinales, crurales, lombaires et de Spiegel, auxquelles il faut ajouter les exceptionnelles
hernies obturatrices et sciatiques.
Définition d’une hernie de la paroi abdominale
Une hernie se définit comme étant l’issue de viscères abdominaux entourés d’un sac
péritonéal à travers un orifice de la paroi abdominale. Le sac péritonéal est constitué de
péritoine faisant issue sous la peau. Il est toujours en communication avec l’abdomen et
contient un ou plusieurs viscères. Il comporte habituellement une zone rétrécie à l’endroit de
la traversée de la paroi (collet du sac herniaire). Tous les viscères abdominaux intra
péritonéaux peuvent migrer dans un sac herniaire. Un viscère extra péritonéal ne peut être
contenu dans un sac herniaire, mais peut toutefois être attiré par lui et être une composante de
la hernie. (Exemple : la corne vésicale). Une hernie se situe toujours au niveau d’un orifice
naturel de la paroi abdominale. Lorsque cet orifice se situe au niveau d’une cicatrice
opératoire, il s’agit d’une éventration et non d’une hernie. Les hernies de l’aine se situent au
niveau de l’orifice musculo-pectinéal de la région inguinale. Les hernies ombilicales se situent
au niveau d’une zone de faiblesse lié à la présence de l’ombilic.
Ce chapitre s’attardera sur les hernies de l’aine (inguinale et crurale), les hernies ombilicales
et les hernies de spiegel.

Hernie inguinale de l’adulte
Introduction:
La hernie inguinale est très fréquente. Elle peut être congénitale ou acquise. Elle peut se
compliquer d'une augmentation de volume, peu grave en soit, mais surtout d'un étranglement,
qui peut alors mettre en jeu le pronostic vital. L'indication opératoire est pour cela quasi
systématique, d'autant que le geste peut être réalisé sous anesthésie locale.
Anatomie chirurgicale de la région de l’aine:
L’orifice myo-pectinéal de Fruchaud [1] est limité en bas par la crête pectinéale de l’os
iliaque, en dedans par le muscle grand droit, en dehors par le fascia iliaca recouvrant le psoas
et en haut par le bord inférieur du petit oblique. La bandelette ilio-pubienne, simple
épaississement du fascia transversalis, tendue de l’épine iliaque antéro-supérieure à l’épine du
pubis, le divise en deux parties. Le fascia transversalis obture la partie supérieure, comme un
rideau plus ou moins tendu et solide et se continue par la gaine vasculaire au dessous de la
bandelette. Cette zone supérieure est un point faible de la paroi, dénommé par Fruchaud «
zone faible inguinale », alors que la zone sous-jacente est comblée en dehors par les vaisseaux
ilio-fémoraux et en dedans par le ligament de Gimbernat. L’orifice crural situé entre les deux
est petit. La grande majorité des hernies de l’aine sont extériorisées au niveau de la zone
faible inguinale.
Les dimensions ont été précisées par Trabucco E. et Trabucco A. [2]. Les distances moyennes
de l’épine iliaque antéro-supérieure à l’épine du pubis, de l’épine iliaque à l’orifice inguinal
profond et de ce dernier à l’épine du pubis sont respectivement de 12 cm, 7 cm et 5 cm. La
largeur moyenne est de 4,5 cm.
La région de l’aine, selon Fruchaud, est une région de passage entre l’abdomen et le membre
inferieur, siège d’une fragilité architecturale qui explique la fréquence des hernies à son
niveau.
Par dissection classique d’avant en arrière de la paroi abdominale de cette région inguino-
fémorale, 3 faits apparaissent dans sa structure laminaire :
l’absence de fibres musculaires striées volontaires (la paroi de l’aine a un rôle de
sustentation)
la superposition de 2 structures inégales : l’oblique externe, superficiel et sans valeur
chirurgicale, et le plan musculo-fascial profond formé de l’oblique interne et du
transverse (tendon « conjoint ») de grand intérêt chirurgical.

Enfin, le passage obligé de 2 pédicules volumineux : le cordon spermatique dans le
canal inguinal et les vaisseaux fémoraux dans le canal fémoral.
La dissection complémentaire de la région d’arrière en avant, permet 3 observations :
Le fascia transversalis est un plan d’étanchéité, sinon de résistance à la pression intra-
abdominale.
L’entonnoir fascial abdomino-crural de Fruchaud transforme la région en voie de
communication entre l’abdomen et la cuisse.
Le trou musculo-pectinéal de Fruchaud est une large zone faible dans le plan profond,
où seul le tympan du fascia transversalis s’oppose à la pression intra-abdominale.
Intérêt chirurgical :
Les structures inguinales composent une architecture faible. Les hernies de l’aine sont
donc soit une maladie congénitale, soit une maladie sur amorce congénitale. Les
accidents. Les accidents du travail sont exceptionnellement en cause en raison de la
prédisposition constitutionnelle.
Il existe une certaine unité anatomo-chirurgicale des hernies de l’aine : toutes
franchissent le fascia transversalis dans l’aire du trou musculo-pectinéal de Fruchaud ;
leurs émergences superficielles n’ont qu’un intérêt de nomenclature clinique.
Les espaces clivables rétro-péritonéaux représentent de nos jours une extension en
profondeur nécessaire de l’étude de la paroi abdominale à l’espace médian de Retzius
et à l’espace de Bogros. Ces espaces sont une voie d’abord postérieure excellente de
l’orifice herniaire et un site idéal de placement des prothèses extra péritonéales.
Le canal inguinal laisse le passage au cordon spermatique chez l'homme et au ligament rond
chez la femme.
Le cordon spermatique
Le cordon spermatique est constitué du canal déférent (venant du testicule et se rendant à
l'urètre), du ligament de Cloquet (vestige du canal péritonéo-vaginal qui se sclérose), et de
multiples artères, veines et nerfs. Il est entouré de quelques fibres musculaires issues des
muscles de la paroi abdominale, les faisceaux crémastériens (dont le seul "intérêt" est de
remonter le testicule plus ou moins haut dans le scrotum…).
Structures nerveuses
Les racines T7 à T11 émergent du bord costal pour s’inscrire rapidement entre muscle oblique
interne et transverse entre la ligne médiane et la ligne axillaire antérieure. Elles donnent des
branches antérieures et latérales, elles-mêmes se divisant en branches antérieures et

postérieures traversant alors les muscles oblique interne puis oblique externe. La 12e racine
thoracique qui chemine aussi entre muscles transverse et oblique interne, est plus
volumineuse, donne une anastomose avec la première racine lombaire. Sa branche terminale
traverse le muscle oblique interne puis l’oblique externe pour se prolonger devant le nerf
iliohypogastrique et innerver la peau sous l’ombilic, sur la crête iliaque et une partie de la
région glutéale jusqu’au grand trochanter parfois.
Nerf ilio-hypogastrique
Il appartient au plexus lombal et est issu de la racine ventrale de L1 avec une composante
variable issue de T12. Il passe au travers du muscle grand psoas pour émerger en avant du
muscle carré des lombes, perfore ensuite le muscle transverse au-dessus de la crête iliaque
pour cheminer entre les aponévroses des muscles oblique interne et transverse, puis entre
oblique interne et oblique externe après perforation de l’oblique interne au niveau de l’épine
iliaque antéro supérieure donnant des branches latérales et antérieures. Il perfore 3 à 4 cm au-
dessus de l’anneau inguinal superficiel le muscle oblique externe, devient sous-cutané. Il
assure l’innervation sensitive de la partie supérolatérale de la cuisse, le muscle oblique interne
et la peau du pubis.
Nerf ilio-inguinal
Issu du même plexus que le nerf ilio-hypogastrique, il naît de la racine ventrale de L1 et suit
le trajet du nerf ilio-hypogastrique sur une distance variable fréquemment à la face inférieure
de celui-ci. Il perfore le muscle oblique interne sous et en avant du nerf ilio-hypogastrique,
passe entre le muscle oblique externe et oblique interne, pénètre dans le canal inguinal
accompagnant le cordon spermatique. Il passe à travers l’anneau inguinal superficiel pour
innerver la face médiale proximale de la cuisse, la partie haute du scrotum (ou des grandes
lèvres) après perforation du muscle oblique externe.
De nombreuses variations sur l’émergence des nerfs ainsi que sur leurs trajets au travers
les couches musculaires ont été décrites avec en plus de nombreuses zones de recouvrements
des territoires cutanés entre les racines ventrales thoraciques, les nerfs ilio-hypogastrique et
ilio-inguinal. Lors d’une infiltration, l’obtention d’un bloc analgésique efficace nécessite un
blocage étendu dans l’espace entre oblique interne et muscle transverse au-dessus de la crête
iliaque pour réduire le risque d’échec.

Pathogénie de hernies de l’aine :
3 facteurs entrent principalement en ligne dans la pathogénie des hernies de l’aine : les
facteurs anatomiques, les facteurs dynamiques et les facteurs métaboliques.
Facteurs anatomiques
La région inguinale décrite par Fruchaud comme étant un trou musculo-pectinéal
(limité en bas par le pubis, en haut par l’arche musculaire du petit oblique et du
transverse, en dedans par le muscle grand droit et en dehors par le muscle psoas
iliaque) au niveau duquel seul le fascia transversalis s’oppose à la pression intra-
abdominale.
Les variations de la surface de l’orifice musculo-pectinéal de Fruchaud.
- L’insertion haute du tendon conjoint chez l’homme entraine une augmentation
de la surface l’orifice musculo-pectinéal, ce qui expose aux hernies inguinales.
- L’insertion basse du tendon conjoint chez la femme entraine une diminution de
la surface de l’orifice musculo-pectinéal, ce qui réduit le risque d’hernie
inguinale.
Chez l’enfant, la hernie inguinale est due à la persistance d’un canal péritonéo-
vaginal perméable. Il s’agit d’une hernie congénitale par défaut de fermeture du
processus vaginalis.
NB : Le canal péritonéo-vaginal (CPV) est créé lors chez le fœtus à la fin du 3ème mois,
par une évagination du péritoine en doigt de gant dans le canal inguinal ; à travers ce tunnel
suit le gubernaculum testis (guide du testicule + cordon) chez le garçon. Le testicule migre
dans la bourse au 5ème mois. Normalement, le CPV se referme par accolement des tissus
avant la naissance (et le testicule se retrouve entouré dans son sac de péritoine appelé alors la
vaginale (d’où le nom de ce canal). Si ce CPV ne se ferme pas complètement, il peut laisser
passer le long du cordon jusque vers la bourse soit du liquide péritonéal (hydrocèle
communicante de l’enfant) soit carrément le grêle (hernie inguinale). S’il se ferme à l’orifice
profond mais pas sur toute la longueur du trajet, il peut contribuer à former un kyste du
cordon. Il faut chez l’enfant en profiter pour rechercher une anomalie testiculaire associée.
Facteurs dynamiques :
En réponse aux augmentations de la pression intra-abdominale, des mécanismes
physiologiques de protection de la région inguinale entrent en jeu et sont d’autant plus
efficaces que l’orifice musculo-pectinéal est petit. En position debout, la pression
intra-abdominale est multipliée par 3 dans le pelvis en raison de la pression
hydrostatique.
L’intensité de la pression intra-abdominale est liée à la qualité du tonus musculaire.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%