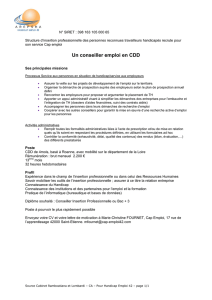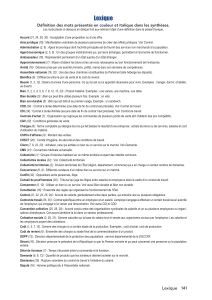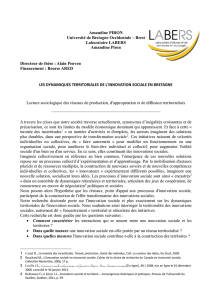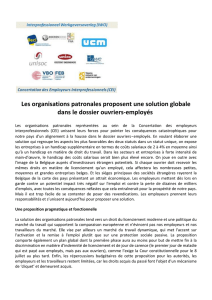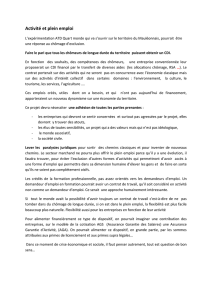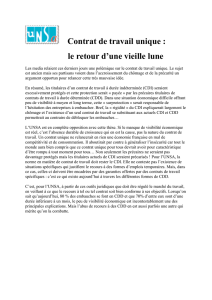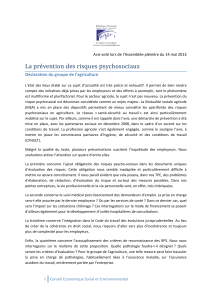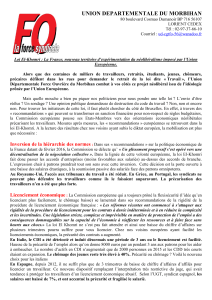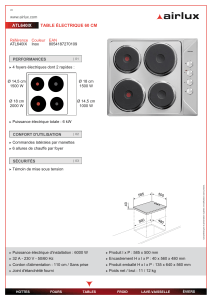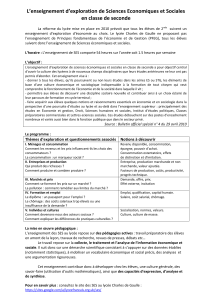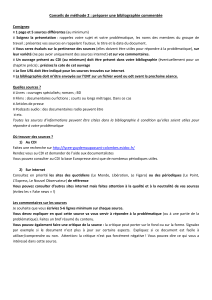1
SOCIO-ÉCONOMIE ET
INNOVATIONS SOCIALES
Marie Fare
Introduction
La socio-économie consiste en l’analyse d’objets économiques à partir d’un cas théorique disciplinaire
ouvert
(éco, socio, histoire, anthropologie)
, d’une méthodologie principalement inductive
(=/
déductive qui part d’un certain nombre d’hypothèses pour l’appliquer à des observations; inductive
= part des observations et construit et formule un ensemble de théories par généralisation)
, relevant
d’un individualisme institutionnel
(la façon dont les chercheurs observent , micro : individu / holisme
méthodologique : primer le groupe, la structure, sur l’individu / individualisme institutionnel :
dépasse ces deux approches, actions des individus évoluant dans un cadre institutionnel, influence
entre actions individuelles et collectives et les institutions*)
et sans postulat quant à la nature du
comportement individuel (
on ne suppose pas que l’individu agit de manière rationnelle, on sort de
l’homo economicus, il existe d’autre formes de rationalité, il existe une pluralité de raisons et poussent
les individus à agir, l’action économique peut résulter de plusieurs raisons : ostentatoire, logique
intéressée ou désintéressée, on ne postule pas qu’ils sont rationnels : on observe et déduit).
*Exemple de la monnaie : à la fois une institution sociale qui émerge de collectif mais en retour la
façon dont les individus vont gérer la monnaie est influencée par leurs pratiques. Mêle des facteurs
liés à l’individu et d’autre liés aux institutions.
1. Point de départ
Dynamique récente, fin 1970, résurgence de la socio-économie.
Premier facteur : une réaction au regard de l’impérialisme de l’économie néo-classique (volonté
d’appliquer cette approche à l’ensemble des phénomènes sociaux, empiècement des économistes sur
un certain nombre de domaines qui cherchent à expliquer à l’ensemble des événements avec la
rationalité).
Deuxième facteur : mutations socio-économiques à cette période qui s’inscrivent dans un contexte de
dérégulation du marché.
Cela s’inscrit parfois dans une dynamique de critique et l’idée de reconnaissance de la pluralité des
pratiques économiques et remettre en question une définition de l’économie qui repose quasiment
tout le temps que sur le marché : élargissement de ce qu’est considéré comme étant économie.
- On intègre des dimensions politiques, culturelles, institutionnelles…
- Observer les relations sociales, le rôle des pouvoirs publics, comment l’économie qui est une
représentation culturelle va influencer les pratiques.

2
- Ne faut-il pas refonder l’économie pour en faire une science sociale ?
- Sortir de la vision marchande de l’économie et l’enrichir d’autres sciences.
- Reconnaitre la complexité et la pluralité des pratiques économiques concrètes. Dire que le
marché s’autorégule c’est nier le rôle de ses acteurs.
- On va considérer qu’il y a d’autres façons pour les individus de transmettre les ressources qui
ne soient pas marchandes (toutes formes de dons).
2. Contre les fondements de la science économique standard
Postulat 1- Autonomie de l’économie
Remise en cause d’un postulat qui est celui de l’autonomie de la sphère économique où il y a eu
progressivement une assimilation entre l’économie et le marché. Il y a eu fin 18e début 19e un
tournant économiciste
: séparation de l’économie et des phénomènes de la société. L’économie
marginaliste va s’éloigner d’un certain nombre de questions traitées par les classiques, elle va exclure
les institutions, l’économie va s’autonomiser.
Cette autonomisation est contestée par les théories de l’encastrement.
Postulat 2 - Naturalité de l’économie
Volonté d’un certain nombre d’auteurs d’établir des lois naturelles. Des orthodoxes défendent à la
naturalité des lois qui ne correspondent pas forcément à la réalité que l’on peut observer. Cela renvoie
au fait que le marché se soit créé tout seul, qu’il s’autorégule, la rationalité supposée des individus. Or
le marché est un construit historique que l’on peut dater.
Conséquence de ce caractère naturel : la neutralité. A partir du moment où on considère les lois
comme naturelles alors il n’y a pas de débat et de conflit. Elles effacent le poids des représentations
sociales et culturelles. Les choix économiques sont forcément idéologiques et politiques. Cette
neutralité est dénoncée par les hétérodoxes. A partir du moment où on souhaite que l’économie soir
une science dure et non une science sociale alors on ne prend pas en compte le contexte institutionnel,
social, etc. On ne plus discuter des choix de politiques économiques.
Postulat 3 - L’homo economicus
C’est l’idée que l’individu agit systématiquement pour chercher son utilité individuelle, cherche à
satisfaire ses besoins et maximiser son utilité. Les socio-économistes pensent qu’il n’existe pas une
seule forme de rationalité, la recherche de satisfaire ses besoins ne peut pas être l’unique raison.
Critiques :
• Vers une rationalité limitée (Simon 1955) : pour lui les individus disposent d’un certain
nombre d’informations et de capacités cognitives limitées ce qui empêche d’optimiser leurs
choix. Il met en avant trois dimensions qui caractérisent cette rationalité limitée : les individus
ne disposent pas d’un accès illimité à l’information car cela demande des ressources (temps
et argent) ; les individus disposent de capacités cognitives qui ne leur permettent pas de

3
disposer d’une vue synthétique de toutes les options et choix ; l’individu n’a pas toujours une
vision claire de ses préférences qui vont évoluer à travers le temps. — Il faut observer
l’environnement dans lequel l’individu prend sa décision.
• L’économie comportementale (Kahneman 2012 ; Thaler, etc.) : prend en compte les facteurs
psychologiques et l’influence des émotions dans le processus de prise de décision. L’individu
n’agit pas systématiquement de façon rationnelle. Invalidation de la rationalité avec le
mimétisme des individus etc. Le jeu de l’ultimatum : un individu peut refuser de maximiser
ses besoins pour cause d’inégalité, il y a ici d’autres motifs qui doivent être appréhendés.
• Un « Grand Partage » disciplinaire entre sociologie et économie qui sont des « mondes
hostiles » (Zelizer), c’est penser qu’introduire de la sociologie dans l’économie c’est venir
dénaturer la science et vice versa. C’est le « consensus Robbins/Parsons ». La critique socio-
économique cherche à dépasser cette limite et montrer qu’il existe des imbrications. Limiter
ce réductionnisme économique et montrer que l’économie est intensément sociale.
• Le problème de l’impérialisme économique (cf la directions prise par Becker, 1976) : il est
possible de mobiliser la boite à outils des économistes pour l’appliquer à l’ensemble des
comportements sociaux.
3. Approches socioéconomiques
3.1 Caractéristiques communes des travaux socio-économiques
Refus des postulats économiques standard, intégrer d’autres logiques pour comprendre l’économie
pour enrichir et complexifier l’approche traditionnelle. Le pouvoir, les conflits, les rôles des groupes
sociaux, les émotions doivent être pris en compte. Pour forger des théories les socio-économistes
s’appuient sur l’observation et un travail de terrain : induction. Chercher le sens de l’action pour
ensuite interpréter, c’est une approche compréhensive, donc l’action économique est constamment
située dans un contexte, le sens de l’action est interprétée.
Le chercheur doit prendre conscience de sa propre subjectivité et ses propres valeurs. La subjectivité
doit être reconnue par le chercheur car elle met en cause la rationalité. Max Weber dit qu’il existe
plusieurs rationalités : - en finalité (instrumentale) c’est l’action intéressée de l’homo economicus ; -
en valeur qui s’appuie sur des convictions, des causes, des devoirs, des valeurs, c'est un ensemble de
valeurs auxquels l’acteur va adhérer, ces actions ne sont pas jugées comme non-rationnelles.
Max Weber considère aussi les actions reposant sur la passion, les sentiments, celles tournées vers
l’ethos, le groupe social et la tradition. Toutes ses actions ne sont pas non plus considérées comme
non-rationnelles.
Le cadre d’analyse n’est ni individuel, ni méthodologique, ni holiste. Prise en compte des interactions
entre les individus et les institutions. Les individus impactent les institutions et les institutions
assurent le fonctionnement global.
Les socio économistes, n’ont pas d’approches unifiées, elles se rapprochent. On retrouve les courants :
• Les institutionnalises, mettent en avant le rôle des institutions et de son contexte, liens entre
déroulement. Polanyi, Lordon…

4
• Les conventionnalistes, mettent avant le rôle des conventions, des institutions qui
coordonnent les échangent au niveau individuel. Une partie de leurs travaux portent sur les
marchés financiers et le mimétisme. Orléan, Favro
• Les nouvelles socio économies : renouveau dans les années 80.
• Les historiens.
• Anthropologie économique.
Ces courants s’inscrivent ou se reconnaissent dans la socio-économie, mais elle n’est pas reconnue
formellement comme en sociologie.
Le pluralisme qui existe en économie est une vraie richesse.
Conclusion :
On peut se demander si la socio économie vise :
• Une pluridisciplinarité (plusieurs regards sur un même objet),
• Une interdisciplinarité (un travail de dialogue entre disciplines conduisant à la construction
de concepts communs),
• Ou une unidisciplinarité (revendication d’Orléans 2005 : les faits économiques sont des faits
sociaux … comme les autres ; la seule discipline valable est la science sociale). Ils refusent le
partage en sciences économiques et science sociales et qu’il y ait une refondions entre
économie et sociologie afin de faire émerger un dialogue entre ces deux disciplines et donc
d’affirmer que l’économie appartient au champ des sciences sociales.

5
Chapitre 1. Le problème de l’encastrement des activités
et des pratiques économiques
L’encastrement originel (Polanyi), institutionnel, politique et culturel (formes plus récentes).
1. La question originale de l’encastrement /
désencastrement
C’est la question à partir de laquelle il y a eu un renouveau de la socio-économie.
1.1 L’encastrement maussien (Essai sur le don, 1923-24)
Marcel Mauss publie un ouvrage sur le don et il montre que l’échange est un phénomène que l’on
retrouve dans tout un tas d’activité et qu’il en existe différentes formes.
Le point de départ c’est que le marché n’est pas le seul mode d’échange au sein des pratiques
économiques et qu’il faut reconnaître ses pluralités.
Il s’appuie dans ses travaux sur des réalités observables dans différentes sociétés autour du
potlatch
(F.Boas) :
Une forme de don sur le mécanisme de lutte et de rivalité, opposition entre clan lors de fêtes
hivernales, donner aux autres une abondance de biens pour que l’autre clan ne soit pas en mesure de
rendre en conséquence : asseoir une position hiérarchique, question d’honneur et de pouvoir, lutte
de générosité.
Et la
kula
(B.Malinowski) en Océanie :
Ce sont des cycles d’échanges entre des partenaires situées sur les îles différentes, les acteurs se
rendent dans des îles où ils ont des partenaires et obtiennent des biens précieux (bracelets, colliers)
et quand leurs partenaires se rendent sur leurs îles devront la rendre la pareille, les cycles n’ont pas
de fin, ils marquent les liens qui sont noués. Ces liens vont dépendre du nombre de partenaires que
les individus ont et de la valeur des biens qu’ils ont reçus. Il y a des enjeux de proportionnalité, c’est
une obligation morale. Liens de coopération.
Selon Mauss, ce sont des formes de dons qui reposent sur une liberté sans obligation. Donc il existe
bien des pratiques d’échanges non-marchand. Ces formes de dons ne sont pas limitées aux sociétés
anciennes car on les retrouve dans nos sociétés modernes aussi.
Pratiques de dons au sein de la Silicon Valley : dans un contexte d’incertitude ils vont collecter tout
un tas d’informations. Triple obligation du don : accepter de donner quelque chose, contre-don, et
rendre.
Chez Mauss, il n’existe pas de don désintéressé. L’individu qui veut recevoir est obligé de donner au
préalable, celui reçoit devra rendre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
1
/
43
100%