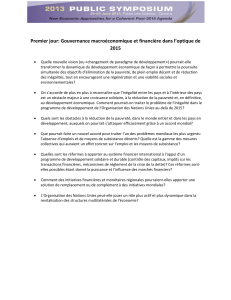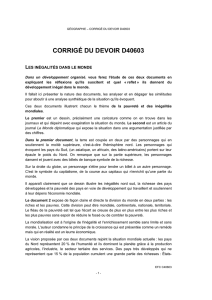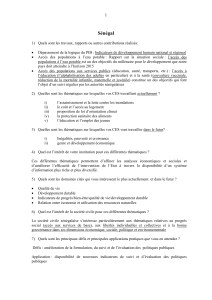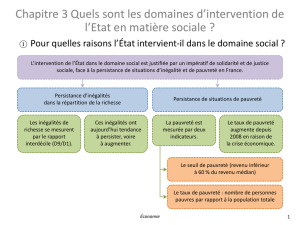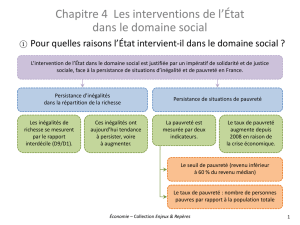L’impact de la croissance économique sur la
pauvreté et l’inégalité
Par Marion Englert

2

Préface
La croissance économique n’a pas d’impact automatique sur la réduction de la pauvreté dans
les pays riches. C’est ce qui ressort d’une analyse théorique et de résultats empiriques. Les
années 80 ont marqué la fin d’une relation positive entre croissance économique et diminution
de la pauvreté de revenu car on assiste, entre autres, à une diminution du rôle de l’Etat, à une
exigence accrue de flexibilité, à un recul des taux de syndicalisation et à une plus grande
concurrence internationale. Le modèle théorique montre l’avantage d’une croissance basée sur
le taux d’emploi par rapport à une croissance basée sur la productivité dans la lutte contre la
pauvreté relative. L’économiste Marion Englert a reçu pour ce travail le prix du meilleur
mémoire pour les 50 ans du DULBEA (ULB) où elle est travaille actuellement.
3

4

Résumé exécutif1
La croissance économique est-elle toujours au service de l’humain et de tous les humains ?
Cette vaste question, faisant l’objet de controverses et de débats intenses, est fondamentale
dans un cadre où la croissance constitue souvent un objectif en soi pour les pays. En effet, la
comparaison internationale du PIB par tête et des taux de croissance reste, malgré les débats,
un critère de choix pour l’évaluation des performances générales d’un pays. Nous allons
aborder ici un aspect spécifique de cette question, à savoir l’impact de la croissance sur la
pauvreté et l’inégalité de revenus, et ce dans le cas des pays à revenu élevé.
Concernant l’effet de la croissance sur la pauvreté au sein d’un pays, il est généralement
admis que la croissance profite au moins dans une certaine mesure à toutes les couches de la
population et donc que celle-ci s’accompagnerait d’une réduction de la pauvreté. Cependant,
on peut démontrer, tant théoriquement qu’empiriquement, que cette relation n’a rien de
systématique.
D’un point de vue théorique, cette « croyance » est basée sur le postulat, très présent dans les
discours politiques et économiques, selon lequel la maximisation de la taille du « gâteau » (le
PIB) implique un accroissement de chacune de ses parts (le revenu des différentes couches de
la population), ce qui induirait une réduction de la pauvreté. Bien que cet argument paraisse à
première vue relever du bon sens, il se trouve invalidé pour deux raisons, à savoir d’une part
la pertinence supérieure de la notion de pauvreté relative par rapport à celle de pauvreté
absolue, d’autre part, l’absence de lien systématique entre le niveau du PIB et la capacité de
redistribution des revenus des économies.
En effet, il existe deux types de définitions conceptuellement très différentes de la pauvreté :
la pauvreté relative et la pauvreté absolue. Cette différence réside dans le type de seuil de
pauvreté choisi : ce seuil peut être défini en termes absolus (par exemple 1$/jour) ou en
termes relatifs c'est-à-dire en comparaison avec un revenu moyen ou médian (par exemple 50
% du revenu médian). Le concept de pauvreté absolue implique une définition de la pauvreté
invariable en tout temps et en tout lieu. Cependant, la perception intuitive de la pauvreté
évolue dans le temps et en fonction du niveau de développement des pays, car les besoins
évoluent. Les niveaux de vie correspondant à une situation de pauvreté en Belgique et dans un
pays du Tiers Monde sont très différents. De même, on ne peut comparer la pauvreté en
Belgique au Moyen Age avec celle d’aujourd’hui. Ce constat amène à privilégier le concept
de pauvreté relative, qui dépend du contexte environnant (la notion de pauvreté relative est
donc une forme spécifique d’inégalité). Donc, à partir du moment où la pauvreté est
considérée comme relative, le postulat selon lequel la croissance du PIB permet un
accroissement de chacune de ses parts n’implique pas forcément une réduction de la pauvreté,
la question n’étant pas la taille des parts du « gâteau », mais bien leur taille relative.
Ensuite, on peut facilement montrer (toujours dans le cas des pays à revenu élevé), en
considérant la population pauvre comme dépendant de la redistribution des revenus (les
allocataires sociaux), qu’il n’y a a priori aucune raison de croire que l’accroissement du PIB
par tête diminuera la pauvreté relative au travers d’un effet sur l’ampleur de la redistribution.
Il apparaît en effet que celle-ci est déterminée par certains choix sociopolitiques qui se
répercutent sur le niveau des taux de prélèvement obligatoire, et non par la croissance. Pour
1 Cet article a été publié dans la Revue « l’Observatoire » n° 58, octobre 2008 sous le titre « L’impact de la
croissance économique sur la pauvreté et l’inégalité : l’importance des choix politiques »
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
1
/
182
100%