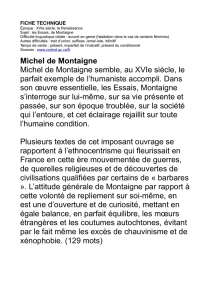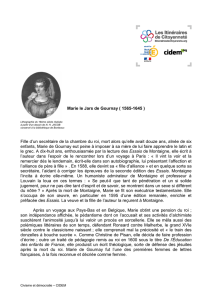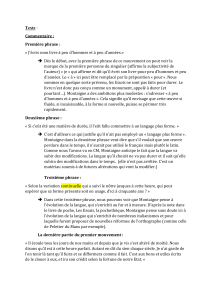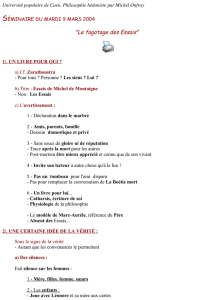Texte :
Commentaire :
Première phrase :
« J’écris mon livre à peu d’hommes et à peu d’années.»
➔ Dès le début, avec la première phrase de ce mouvement on peut voir la
marque de la première personne du singulier (affirme la subjectivité de
l’auteur) « je » qui affirme et dit qu’il écrit son livre pour peu d’hommes et peu
d’années. Le « à » ici peut être remplacé par la préposition « pour ». Nous
sommes en quelque sorte prévenu, les Essais ne sont pas faits pour durer. Le
livre n’est donc pas conçu comme un monument, appelé à durer (et
pourtant…). Montaigne a des ambitions plus modestes : s’adresser « à peu
d’hommes et à peu d’années ». Cela signifie qu’il envisage que cette œuvre si
fluide, si insaisissable, à la forme si nouvelle, puisse se périmer très
rapidement.
Deuxième phrase :
« Si c’eût été une matière de durée, il l’eût fallu commettre à un langage plus ferme. »
➔ C’est d’ailleurs ce qui justifie qu’il n’ait pas employé un « langage plus ferme ».
Montaigne dans la deuxième phrase veut dire que s’il voulait que son œuvre
perdure dans le temps, il n’aurait pas utilisé le français mais plutôt le latin.
Comme nous l’avons vu en CM, Montaigne anticipe le fait que la langue va
subir des modifications. La langue qu’il choisit ne va pas durer et il sait qu’elle
subira des modifications dans le temps. (elle n’est pas arrêtée. C’est un
matériau soumis à de futures altérations qui vont la modifier.)
Troisième phrase :
« Selon la variation continuelle qui a suivi le nôtre jusques à cette heure, qui peut
espérer que sa forme présente soit en usage, d’ici à cinquante ans ? »
➔ Dans cette troisième phrase, nous pouvons voir que Montaigne pense à
l’évolution de la langue, qui s’enrichit au fur et à mesure. D’après la note dans
le livre de poche, Les Essais, la pochothèque, Montaigne pense sans doute ici à
l’évolution de la langue qui s’enrichit de nombreux italianismes et pour
laquelle furent proposer de nouvelles réformes de l’orthographe (comme celle
de Peletier du Mans par exemple).
La dernière partie du premier mouvement :
« Il écoule tous les jours de nos mains et depuis que je vis s’est altéré de moitié. Nous
disons qu’il est à cette heure parfait. Autant en dit du sien chaque siècle. Je n’ai garde de
l’en tenir là tant qu’il fuira et se difformera comme il fait. C’est aux bons et utiles écrits
de le clouer à eux, et ira son crédit selon la fortune de notre Etat. »

➔ L’allongeail produit quelques années plus tard confirme cette idée car le livre,
vu dans les dernières années de sa composition, s’écoule, s’altère, comme une
forme proprement insaisissable. Montaigne, pourtant, se refuse à le figer
artificiellement : il assume cette incertitude qui est le propre de cette écriture
si libre. Il n’exclut pas, toutefois, que ce qu’il livre là puisse un jour être « cloué »,
c’est-à-dire plus fermement fixé, par d’autres « bons et utiles escrits », mais il
passe généreusement le relais à qui voudra s’en saisir, parmi les rares lecteurs
de son temps qu’il vise.
Deuxième mouvement, regroupe une première grande phrase :
La première phrase :
« Pourtant ne crains-je point d’y insérer plusieurs articles privés, qui consument leur
usage entre les hommes qui vivent aujourd’hui, et qui touchent la plus particulière
science d’aucuns, qui y verront plus avant que de la commune intelligence. »
➔ La première phrase de ce deuxième mouvement s’ouvre sur « pourtant » qui
pourrait être remplacé par « c’est pourquoi ». Il s’adresse que à un certain
lecteur qui pourrait comprendre ce que Montaigne veut dire, ce qu’il pourrait
comprendre. Dans cette première phrase, il annonce les conséquences de
l’idée évoqué dans la première partie : le fait que son œuvre ne pourra pas
être compris par tous les hommes plus tard. En employant la commune
intelligence, Montaigne veut dire certains hommes qui verront plus loin que
ne porte l’intelligence ordinaire.
« Je ne veux pas après tout, comme je vois souvent agiter la mémoire des trépassés,
qu’on aille débattant : « Il jugeait, il vivait ainsi ; il voulait ceci ; s’il eût parlé sur sa fin, il
eût dit, il eût donné ; je le connaissais mieux que tout autre. »
➔ Dans cette deuxième phrase, Montaigne constate ce que les personnes
vivantes peuvent dire sur les personnes disparus. Et lui ne veut en aucun cas
qu’on dise des choses sur lui pouvant être fausses lorsqu’il ne sera plus là.
Ceci est marqué par la négation « je ne veux pas après tout » et l’énumération
« il jugeait, il vivait ainsi….. »
« Or autant que la bienséance me le permet, je fais ici sentir mes inclinations et mes
affections ; mais plus librement et plus volontiers le fais-je de bouche à quiconque désir
en être informé.
➔ Ici la conjonction de coordination « or »ouvre la troisième phrase et marque
une opposition avec la deuxième phrase. Montaigne dit que tant qu’il a la
convenance de dire qui il est, il le fait. Ceci se voit avec la suite de la phrase

« je fais ici sentir mes inclinations et mes affections ». Le « ici » veut dire dans
ce texte.
➔ De plus, Montaigne, montre qu’il le fait « plus librement et plus volontiers » à
l’oral à tout ce qui désire en apprendre plus sur lui.
« Tant y a qu’en ces mémoires, si on y regarde, on y trouvera que j’ai tout dit, ou tout
désigné. Ce que je ne puis exprimer, je le montre au doigt :
« Verum animo satis hoec vestigia parva sagaci
Sunt, per quoe possis cognoscere cetera tute » (Mais à un esprit sagace comme le tien
ces légères empreintes suffisent à te faire découvrir tout le reste)
➔ Dans la quatrième phrase Montaigne fait référence à Ses Essais lorsqu’il parle
de ces mémoires, en disant qu’il s’est décrit en totalité dans son œuvre avec
« on y trouvera que j’ai tout dit, ou tout désigné », de plus, avec les reste de la
phrase il cherche a toucher tous les lecteurs puisqu’il reprend une citation en
latin de Lucrèce, qui laisse penser comme dans la traduction que les lecteurs
ayant un esprit subtil auront compris en totalité comment il est réellement
grâce simplement à l’œuvre.
« Je ne laisse rien à désirer et deviner de moi. Si on doit s’en entretenir, je veux que ce
soit véritablement et justement ».
➔ La dernière phrase de ce mouvement, confirme ce qu’il a dit auparavant. Dans
son œuvre Montaigne, « ne laisse rien à désirer et deviner de » lui, tout est dit.
➔ Il emploie également un pronom indéfini neutre « on », qui désigne les
personnes pouvant parler de lui après sa mort.
➔ C’est la raison pour laquelle, dans un souci de vérité et de justice (voir les deux
derniers adverbes, « véritablement et justement »), il « ne laisse rien à désirer
et deviner » de lui mais dit tout ce qu’il peut par avance.
(Fort de sa propre expérience tirée de la mort de proches – et sans doute au
premier chef de celles de son père et de La Boétie – il sait que la tentation est
grande, pour ceux qui survivent au défunt et l’ont plus ou moins bien connu, de
lui faire dire ce qu’ils veulent. Chacun des survivants peut alors donner l’image
qu’il veut du défunt, sans mesure et sans justesse et débattre de la légitimité de la
vision qu’il avait du mort par rapport à celles des autres. Il n’est alors plus temps
pour le mort de se dresser et de dire comment étaient les choses. C’est la raison
pour laquelle, dans un souci de vérité et de justice (voir les deux derniers
adverbes, « véritablement et justement »), il « ne laisse rien à désirer et deviner »
de lui mais dit tout ce qu’il peut par avance.)
Troisième mouvement
Première phrase :

« Je reviendrais volontiers de l’autre monde pour démentir celui qui me formerait
autre que je n’étais, fût-ce pour m’honorer. »
➔ Ici, l’auteur dit qu’il aimerait bien pouvoir revenir sur terre après sa mort
juste pour démentir ce que les gens pourraient dire de faux sur lui, avec
« l’autre monde » qui représente le monde des morts. Ceci étant comme il le
dit : « Fût-ce pour m’honorer », c’est-à-dire simplement pour le respecter.
(Cette pensée peut s’appliquer à toutes les personnes décédées, car il dit ici ce
qu’il pense sur le sujet, que ce n’est rien d’autre qu’un manque de respect.)
Deuxième phrase :
« Des vivants même, je sens qu’on parle toujours autrement qu’ils ne sont. »
➔ Ici Montaigne parle d’un sentiment qu’il ressent avec le verbe « sentir », il dit
qu’il n’y a pas que sur les défunts que les gens racontent des choses fausses,
mais également sur les vivants. Il fait allusion ici au comportement mauvais
des gens en général vis-à-vis d’autrui.
Dernière phrase :
« Et si à toute force je n’eusse maintenu un ami que j’ai perdu, on me l’eût
déchiré en mille contraires visages »
➔ Dans cette dernière phrase, l’auteur fait référence à La Boétie, avec : « un ami
que j’ai perdu », et il le prend pour exemple pour argumenter ses propos
précédents, avec « déchiré en mille contraire visage » qui montre bien ici que
les gens le définissent de multiples façons différentes depuis que celui-ci est
décédé.
(Il faut pourtant quelques années avant que Montaigne ne se décide à la
« retraite » et ne s’enferme dans sa tour avec ses livres. Huit ans, ce qui n’est
pas rien entre la mort de l’ami et la rédaction de ses premiers chapitres des
Essais. Moins le temps de la réflexion que celui du désarroi et des plus noirs
accès de la mélancolie. En perdant La Boétie, Michel de Montaigne s’est perdu
à lui-même. Et par un cercle véritablement vicieux, se perdant il perd aussi le
vrai visage de son ami, il en efface la vérité exemplaire.
(Maintenir son ami, lui rendre son visage vrai, voilà ce que le deuil et la
douleur ne permettent pas. Ils ne disent que la perte et l’absence, la stupeur
muette, la paralysie du corps et le vertige. Ils sont pur anéantissement.)
⇒ On voit donc, sur ce point encore, l’art de la nuance de Montaigne, qui n’est pas
contradiction mais rigoureuse précision, et prise en compte du fait que l’humain n’est pas

monolithique mais bel et bien complexe. Toute simplification le trahit. Il en va de même
de l’ordre : il n’est pas absent de la pensée mais ne doit pas justifier un assèchement de la
réflexion. Pour Montaigne, il est bon d’ordonner lorsque c’est possible, mais l’ordre absolu
n’est définitivement pas dans sa complexion. C’est ce que montre en particulier un
commentaire qu’il propose, après un moment de digression et avant de revenir au propos
provisoirement abandonné, dans un dernier passage, situé à la fin du chapitre.
Introduction :
Sans prétendre proposer une synthèse sur la théorisation de la réception et du lecteur
des Essais élaborée par Montaigne dans son livre, nous voudrions montrer comment l’auteur intègre
la question de l’illisibilité de son propre texte au sein de son œuvre. Ce thème de l’illisibilité prend
en effet toute son ampleur au cours du livre III (alors que Montaigne a connaissance des premières
réactions suscitées par ses deux premiers volumes), et plus particulièrement dans le chapitre 9
intitulé « De la vanité », dans lequel l’illisibilité des Essais devient un motif de la réflexion poétique
de Montaigne sur les enjeux de la destination et de la communication littéraires et, partant, sur sa
position d’auteur.
3L’éventuelle illisibilité des Essais est délibérément posée à l’horizon de l’œuvre d’abord en raison
du choix concerté de la langue française au détriment de la langue latine. Montaigne avait ainsi
envisagé son projet littéraire :
Peut-être à mettre dans l’introduction
1
/
5
100%