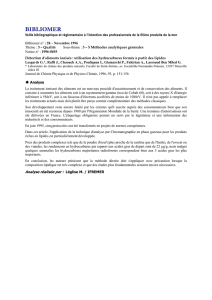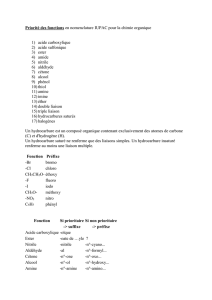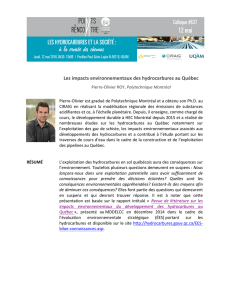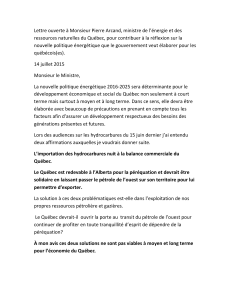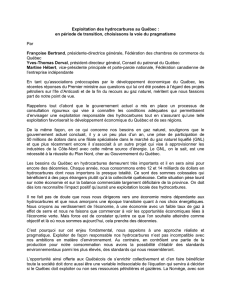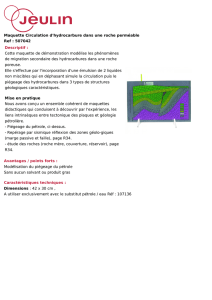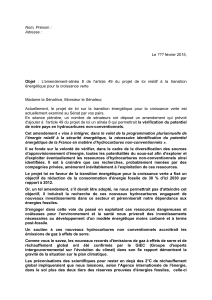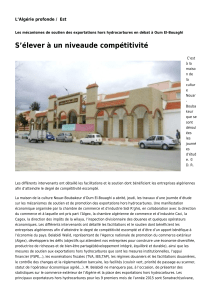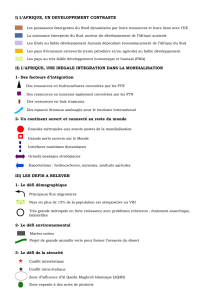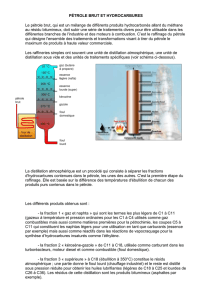2
DEVENIR DES DÉVERSEMENTS
D’HYDROCARBURES EN MER
GUIDE D’INFORMATIONS TECHNIQUES

2 DEVENIR DES DÉVERSEMENTS D’HYDROCARBURES EN MER
Les caractéristiques de distillation d’un hydrocarbure décrivent sa
volatilité. Dans le processus de distillation, au fur et à mesure que
la température d’un hydrocarbure monte, les différents composants
atteignent leur point d’ébullition l’un après l’autre, s’évaporent, puis
sont refroidis et se condensent. Les caractéristiques de distillation
sont exprimées par les proportions de l’hydrocarbure parent qui se
distillent à l’intérieur de plages de températures données (Figure 1).
Introduction
Les hydrocarbures déversés en mer subissent diverses modications physiques et chimiques ; certaines
entraînent leur élimination de la surface de l’eau tandis que d’autres favorisent leur persistance. Le
devenir de ces hydrocarbures est déterminé par différents facteurs, dont la quantité déversée, les
caractéristiques physiques et chimiques de l’hydrocarbure, les conditions climatiques qui prévalent
et l’état de la mer. Le fait que les hydrocarbures restent en mer ou viennent s’échouer sur la côte
inuence également son devenir.
Comprendre les processus et les interactions qui entrent en jeu et altèrent la nature, la composition
et le comportement de l’hydrocarbure avec le temps est fondamental pour tous les aspects de la
lutte antipollution. Il est parfois possible, par exemple, de prévoir avec un relatif degré de certitude
que l’hydrocarbure se dissipera naturellement avant d’atteindre telle ou telle ressource vulnérable,
et donc que des opérations de nettoyage ne seront pas nécessaires. Lorsqu’une opération de lutte
antipollution active s’impose, le type d’hydrocarbure et son comportement probable déterminent les
options les plus susceptibles d’être efcaces.
Ce document décrit les effets combinés des divers processus naturels qui agissent sur les
hydrocarbures déversés, collectivement appelés « vieillissement ». Les facteurs qui déterminent
dans quelles mesures l’hydrocarbure risque de persister dans l’environnement marin sont abordés
en rapport avec leurs conséquences en matière de lutte antipollution. Etant donné que le devenir
des hydrocarbures déversés dans l’environnement marin a d’importantes implications pour tous les
aspects de la lutte antipollution, ce document devrait être lu en conjonction avec d’autres Guides
d’Informations Techniques de cette série.
5Figure 1 : Courbes de distillation de quatre pétroles bruts. Les
hydrocarbures restant au-dessus de la température maximale
indiquée sont principalement des résidus. Données d’analyses sur
les pétroles bruts.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0200400600
Cossack Draugen Coco Boscan
Pourcentage disllé (volume)
Température de disllaon (°C)
Propriétés des hydrocarbures
Les pétroles bruts ont des propriétés physico-chimiques très
différentes selon leurs origines, tandis que de nombreux produits
rafnés conservent les mêmes propriétés bien dénies quel que soit
le pétrole brut dont ils sont dérivés. Les ouls lourds et intermédiaires,
qui contiennent des proportions variables de résidus du processus
de rafnage mélangées à des produits rafnés plus légers, ont eux
aussi des propriétés très variables.
Le comportement et la persistance d’un hydrocarbure déversé
en mer sont avant tout inuencés par sa masse volumique, ses
caractéristiques de distillation, sa pression de vapeur, sa viscosité
et son point d’écoulement. Chacune de ces propriétés dépend de
la composition chimique, c’est-à-dire notamment de la proportion
de composants volatils et de la teneur en asphaltènes, résines et
parafnes.
La masse volumique (ou densité relative) d’un hydrocarbure
correspond à sa densité par rapport à l’eau pure, dont la masse
volumique est égale à 1. La plupart des hydrocarbures sont moins
denses ou plus légers que l’eau de mer, dont la masse volumique
se situe généralement aux alentours de 1,025. L’échelle des masses
volumiques de l’American Petroleum Institute (exprimées en degré
API) est couramment utilisée pour décrire la masse volumique des
pétroles bruts et des produits pétroliers, comme suit :
En plus de déterminer si l’hydrocarbure ottera ou non, la masse
volumique peut donner une indication générale concernant d’autres
propriétés. Par exemple, les hydrocarbures à faible masse volumique
(°API élevé) ont tendance à être caractérisés par une forte proportion
de composants volatils et une faible viscosité.
°API= –131,5
141,5
masse volumique

1,000
10,000
Arab Super Light Brent Cabinda Merey
1
10
100
0 10 20 30 40
Viscosité (cSt)
Température (°C)
3GUIDE D’INFORMATIONS TECHNIQUES 2
5Figure 2 : Rapport viscosité/température pour les quatre pétroles
bruts du Tableau 1.
5Figure 3 : Les hydrocarbures déversés en milieu marin à des
températures inférieures à leur point d’écoulement forment des
fragments semi-solides. Cette image montre le pétrole brut Nile
Blend (point d’écoulement +33 °C) dans une eau de mer à 28 °C.
Ces hydrocarbures sont hautement persistants et peuvent parcourir
de très grandes distances.
Certains hydrocarbures contiennent des résidus bitumineux,
parafniques ou asphalténiques, qui ne se distillent pas facilement
même à fortes températures, et qui ont tendance à persister
longtemps dans l’environnement marin (par ex. le pétrole brut
Boscan à la Figure 1).
La pression de vapeur donne une autre indication de la volatilité
d’un hydrocarbure, généralement citée en pression de vapeur Reid
mesurée à 37,8 °C. Dans la plupart des conditions, une pression
de vapeur supérieure à 3 kPa (23 mmHg) est requise pour que
l’évaporation se produise. Au-delà de 100 kPa (760 mmHg), la
substance se comporte comme un gaz. La pression de vapeur
de l’essence, par exemple, est de l’ordre de 40 à 80 kPa (300 à
600 mmHg). Le pétrole brut Cossack a une pression de vapeur
Reid de 44 kPa et est très volatil, avec une forte proportion de
composants atteignant leur point d’ébullition à basse température.
En revanche, le pétrole brut Boscan est beaucoup moins volatil,
avec une pression de vapeur Reid de tout juste 1,7 kPa.
La viscosité d’un hydrocarbure dénit sa résistance à l’écoulement.
Les hydrocarbures à forte viscosité s’écoulent moins facilement
que ceux à plus faible viscosité. Tous les hydrocarbures deviennent
plus visqueux (c’est-à-dire s’écoulent moins facilement) au fur et
à mesure que la température baisse ; certains plus que d’autres,
selon leur composition. Le rapport température/viscosité de quatre
pétroles bruts est indiqué à la Figure 2. Les unités de viscosité
cinématique* sont employées dans ce document, exprimées en
centistokes (cSt = mm2.s-1).
Le point d’écoulement correspond à la température au-dessous de
laquelle un hydrocarbure ne s’écoule plus ; il dépend de la teneur
parafnique et asphalténique de l’hydrocarbure. En refroidissant,
un hydrocarbure atteint une température appelée point de trouble,
qui correspond au point auquel les composants parafniques
commencent à former des structures cristallines. Plus la température
baisse, plus cette formation de cristaux compromet l’écoulement
de l’hydrocarbure. Lorsque le point d’écoulement est atteint,
l’écoulement cesse et l’hydrocarbure passe de l’état liquide à l’état
semi-solide (Figure 3). Un exemple de ce comportement est donné
pour le pétrole brut Cabinda sur la Figure 2. En refroidissant à partir
de 30 °C, la viscosité de cet hydrocarbure augmente lentement.
Lorsque le point de trouble (20 °C) est dépassé, l’hydrocarbure
commence à s’épaissir de manière exponentielle. Au point
d’écoulement (12 °C), la viscosité a sufsamment augmenté pour
empêcher son écoulement.
Processus de vieillissement
Les processus individuels traités dans la section suivante provoquent
ensemble le vieillissement d’un hydrocarbure déversé (Figure 4).
L’importance relative de chaque processus varie cependant avec le
temps. La Figure 6 illustre le vieillissement d’une nappe de pétrole
brut moyen typique par mer modérée. Il convient également de tenir
compte du fait qu’un déversement d’hydrocarbures dérive sous l’effet
du vent et des courants (voir le Guide d’informations techniques :
Observation aérienne des déversements d’hydrocarbures en mer).
Étalement
Un hydrocarbure commence à s’étaler à la surface de la mer dès
qu’il est déversé. La vitesse à laquelle cela se produit dépend dans
une grande mesure de la viscosité de l’hydrocarbure et du volume
en question. Les hydrocarbures uides à faible viscosité s’étalent
beaucoup plus rapidement que les hydrocarbures à haute viscosité.
Les hydrocarbures liquides s’étalent sous forme de nappe continue
mais se fragmentent vite. Au fur et à mesure qu’ils s’étalent et que
leur épaisseur diminue, leur couleur évolue du noir ou brun foncé des
zones épaisses à une irisation iridescente et argentée en bordure
de la nappe (Figure 5). Au lieu de s’étaler en nes couches, les
* viscosité cinématique = viscosité dynamique ÷ densité. La
viscosité dynamique est mesurée en centipoise (cP) ou en
milliPascals par seconde (mPA/s), unité équivalente dans le SI
5Tableau 1 : Caractéristiques physiques de quatre pétroles bruts
typiques. Les couleurs et les groupements correspondent aux
classications données au Tableau 2 (page 8).

4
5Figure 4 : Processus de vieillissement sur un hydrocarbure en mer. Une fois l’hydrocarbure échoué sur la côte, certains de ces processus n’entrent
plus en jeu.
5Figure 5 : Lorsque des hydrocarbures moyens et légers s’étalent
sans obstacle, des lms très minces nissent par se former. Ils
se présentent sous forme d’irisations iridescentes (arc-en-ciel) et
argentées, qui se dissipent rapidement.
hydrocarbures semi-solides ou très visqueux se fragmentent en
plaques qui évoluent séparément et peuvent parfois atteindre une
épaisseur de plusieurs centimètres. En haute mer, les vents ont
tendance à entraîner la formation de bandes parallèles et étroites
d’hydrocarbure. Avec le temps, les propriétés de l’hydrocarbure
deviennent moins importantes pour déterminer les mouvements
de la nappe.
La vitesse à laquelle un hydrocarbure s’étale ou se fragmente est
également inuencée par les vagues, les turbulences et les courants
de marée et autres ; plus les forces combinées sont fortes, plus le
processus est rapide. Les exemples sont nombreux d’hydrocarbures
étalés sur plusieurs kilomètres carrés en quelques heures seulement
et sur plusieurs centaines de kilomètres carrés en quelques jours.
Exception faite des petits déversements d’hydrocarbures à faible
viscosité, l’étalement n’est pas uniforme et d’importantes variations
d’épaisseur peuvent se produire, de moins d’un micromètre à
plusieurs millimètres ou plus.
Évaporation
Les composants plus volatils d’un hydrocarbure s’évaporent dans
l’atmosphère à un taux dépendant des températures ambiantes
et de la vitesse du vent. En règle générale, les composants de
l’hydrocarbure dont le point d’ébullition est inférieur à 200 °C
s’évaporent dans les 24 heures par conditions modérées. Plus la
proportion de composants à faible point d’ébullition – indiquée par
les caractéristiques de distillation de l’hydrocarbure – est forte, plus
l’évaporation est importante. Sur la Figure 1, par exemple, le pétrole
brut Cossack est constitué à 55 % de composants qui entrent en
ébullition au-dessous de 200 °C. Cette proportion est réduite à 4
% pour le pétrole brut Boscan.
Le degré d’étalement initial de l’hydrocarbure affecte également
le taux d’évaporation. En effet, plus la supercie de la nappe est
importante, plus les composants légers s’évaporent vite. Les mers
agitées, les vents forts et les températures élevées accélèrent
également l’évaporation.
Les résidus de l’hydrocarbure après évaporation ont une densité et
une viscosité accrues, ce qui affecte les processus de vieillissement
ultérieurs ainsi que les techniques de nettoyage.
Les déversements de produits rafnés, comme le kérosène et
l’essence, peuvent s’évaporer entièrement en quelques heures. Les
pétroles bruts légers (type Cossack) peuvent perdre plus de 50 %
de leur volume durant le premier jour. Déversés dans des espaces
connés, ces hydrocarbures extrêmement volatils peuvent présenter
des risques d’incendie et d’explosion, ou des dangers pour la santé
humaine. En revanche, les ouls lourds s’évaporent peu, voire pas du
tout, et le risque d’explosion est minime. Ils présentent toutefois un
risque d’incendie : des débris enammés au milieu d’hydrocarbures
par mer calme peuvent former une mèche qui suft à entretenir un
feu de oul vigoureux.
Dispersion
Le taux de dispersion dépend largement de la nature de l’hydrocarbure
et de l’état de la mer ; il est le plus élevé avec les hydrocarbures de
faible viscosité, en présence de vagues déferlantes. Les vagues et les
turbulences à la surface de la mer peuvent causer la fragmentation
de tout ou partie d’une nappe en gouttelettes de tailles diverses
qui s’intègrent dans les couches supérieures de la colonne d’eau.
Les plus petites gouttelettes restent en suspension, tandis que les
DEVENIR DES DÉVERSEMENTS D’HYDROCARBURES EN MER

5
5Figure 7 : Image considérablement agrandie (x 1 000) d’une émulsion
eau dans l’huile, montrant les gouttelettes d’eau entourées d’huile.
5Figure 8 : Récupération de oul lourd émulsionné, montrant la couleur
rouge/brune typique. L’analyse a montré que la teneur en eau de
cette émulsion atteignait 50 %.
Évapora'on
Dispersion
Émulsifica'on
Oxyda'on
Dissolu'on
Sédimenta'on
Biodégrada'on
Étalement
Émulsionstable
Émulsion
instable
Année Mois Semaine Jour
Heures 1 10 100 1,000 10,000
5Figure 6 : Représentation schématique du devenir d’un déversement
typique d’hydrocarbure de groupe 2/3, montrant les processus de
vieillissement avec le temps. La largeur de chaque bande indique
l’importance du processus (d’après un diagramme fourni par le
SINTEF).
plus grosses remontent à la surface et soit reforment une nappe
par fusion avec d’autres gouttelettes, soit s’étalent en une très ne
couche. Les gouttelettes de moins de 70 μm de diamètre environ
sont maintenues en suspension par l’effet des turbulences marines
sur leur vitesse de remontée à la surface. L’hydrocarbure ainsi
dispersé s’intègre dans des volumes chaque fois plus importants
d’eau de mer, résultant en une réduction rapide et très sensible
de la concentration d’hydrocarbure. La surface de contact accrue
présentée par l’hydrocarbure dispersé favorise par ailleurs d’autres
processus, dont la biodégradation, la dissolution et la sédimentation.
Les hydrocarbures qui restent uides et s’étalent sans être altérés
par d’autres processus de vieillissement peuvent se disperser
entièrement en quelques jours par mer modérée. L’application de
dispersants peut accélérer ce processus naturel. Inversement, les
hydrocarbures visqueux ont tendance à former des fragments épais
à la surface de l’eau, qui ne manifestent qu’une très faible tendance
à se disperser, même sous l’effet de dispersants.
Émulsification
De nombreux hydrocarbures incorporent de l’eau et forment des
émulsions eau dans l’huile. Le volume d’un hydrocarbure émulsionné
peut ainsi être quintuplé. Une concentration combinée de nickel/
vanadium supérieure à 15 ppm ou une teneur asphalténique
supérieure à 0,5 % au moment du déversement de l’hydrocarbure
sont les facteurs les plus favorables à la formation d’une émulsion.
La présence de ces composés et des conditions en mer dépassant
la force 3 sur l’échelle de Beaufort (vitesse du vent de 3 à 5 m/s
ou 7 à 10 nœuds) déterminent la vitesse à laquelle les émulsions
se forment. Les hydrocarbures visqueux, dont les ouls lourds, ont
tendance à incorporer l’eau plus lentement que les hydrocarbures
plus uides. Au fur et à mesure que l’émulsion se forme, le mouvement
de l’hydrocarbure dans les vagues entraîne la réduction de la taille
des gouttelettes d’eau qui ont été incorporées dans l’hydrocarbure
(Figure 7). L’émulsion devient ainsi progressivement plus visqueuse.
En même temps, les asphaltènes de l’hydrocarbure peuvent
précipiter pour enrober les gouttelettes d’eau, augmentant ainsi
la stabilité de l’émulsion. Alors que la quantité d’eau incorporée
augmente, la densité de l’émulsion se rapproche de celle de l’eau
de mer, mais il est peu probable qu’elle la dépasse sans ajout de
particules solides. Les émulsions stables peuvent contenir jusqu’à
70 à 80 % d’eau, sont souvent semi-solides, et ont une couleur intense
rouge/brune, orange ou jaune (Figure 8). Elles sont hautement
persistantes et peuvent rester émulsionnées indéniment. Les
émulsions moins stables peuvent se séparer en huile et eau sous
l’effet de la chaleur solaire, par mer calme, ou lorsqu’elles sont
échouées sur le littoral.
La formation d’émulsions eau dans l’huile ralentit les autres processus
de vieillissement et constitue la raison principale de la persistance
des hydrocarbures bruts légers et moyens à la surface de la mer
et sur le littoral. Bien que les émulsions eau dans l’huile stables se
comportent de manière analogue aux hydrocarbures visqueux, leurs
différences de composition ont des implications en ce qui concerne
les options de lutte antipollution.
Dissolution
La vitesse et le degré auxquels un hydrocarbure se dissout dépendent
de sa composition, de son étalement, de la température de l’eau,
des turbulences et du degré de dispersion. Les composants lourds
du pétrole brut sont pratiquement insolubles dans l’eau de mer
tandis que les composants plus légers, et plus particulièrement
les hydrocarbures aromatiques comme le benzène et le toluène,
sont légèrement solubles. Or, ces composés sont également les
GUIDE D’INFORMATIONS TECHNIQUES 2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%