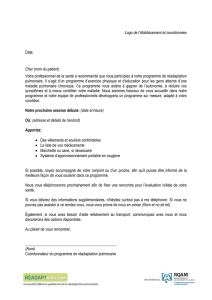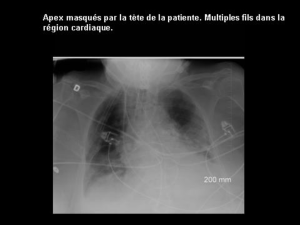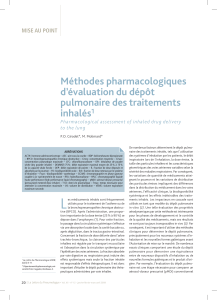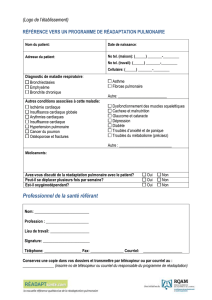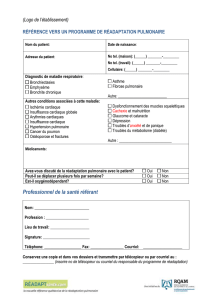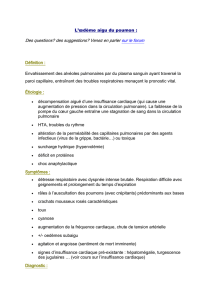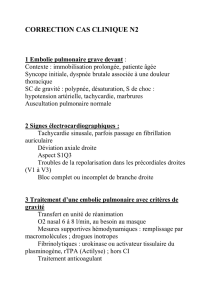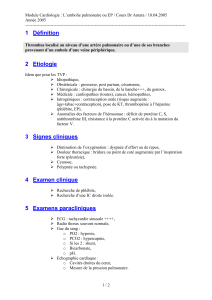Lire l'article complet

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Pharmacologie
Pharmacologie
5
RÉSUMÉ 왘
Le dépôt pulmonaire des traitements inhalés peut être
évalué par des méthodes pharmacocinétiques et phar-
macodynamiques. Le choix de la méthode dépend de la
classe médicamenteuse étudiée. Pour les médicaments
sans e et de premier passage hépatique, tels que les bêta-2
agonistes de courte durée d’action, l’étude pharmacociné-
tique du dépôt pulmonaire doit être e ectuée rapidement
après l’inhalation a n de minimiser l’absorption gastro-
intestinale. Pour les molécules subissant un métabolisme
important en rapport avec un premier passage hépatique,
telles que les corticostéroïdes inhalés, la concentration
plasmatique de médicament est un re et indirect du dépôt
bronchique. L’e et pharmacodynamique peut être évalué
par les e ets cliniques et les e ets indésirables potentiels
des traitements inhalés. Chez l’asthmatique et le patient
a ecté de bronchopneumopathie chronique obstructive,
la réversibilité de l’obstruction bronchique après inhalation
de bronchodilatateur permet d’estimer le dépôt bronchique
si l’obstruction bronchique initiale est signi cative. Pour
comparer l’e et dose-réponse entre corticoïdes inhalés sur
des périodes supérieures à six semaines, la référence actuelle
est la méthode de Finney. L’analyse des e ets indésirables
des bêta-2 agonistes ou des corticostéroïdes administrés
à fortes posologies peut également être utilisée pour
comparer le dépôt bronchique de di érentes molécules.
La pertinence clinique des méthodes pharmacologiques
évaluant le dépôt pulmonaire permet l’obtention d’infor-
mations complémentaires par rapport aux études utilisant
la scintigraphie pulmonaire.
Mots-clés : Voies aériennes – Biodisponibilité – Dépôt –
Médicaments inhalés – Poumon – Pharmacodynamie –
Pharmacocinétique.
SUMMARY 왘
The assessment of drug delivery to the lung in vivo may be
performed using either pharmacokinetic or pharmacodynamic
techniques. The choice of pharmacological method depends
on drug class speci cities. Pharmacokinetic determination
of deposition to the lung for drugs without hepatic rst-pass,
such as short acting β2-agonist, has to be performed shortly
after inhalation to minimize the effect of gastrointestinal
absorption. For medication undergoing important hepatic
rst-pass metabolism such as inhaled corticosteroid, plas-
matic concentration indirectly re ects bronchial deposition.
Pharmacodynamic pro le should be assessed through clinical
e ect and adverse events induced by inhaled drugs. Dose ran-
king of lung deposition for bronchodilators requires patient
selection with su cient bronchial obstruction to maintain
room for improvement after the rst dose. To assess dose e ect
relationship between inhaled corticosteroid, the Finney parallel
line bioassay is the reference method in at least six weeks period
study. Analysis of side e ect with high doses of β2-agonist
or inhaled corticosteroid may also be used to compare lung
deposition. Finally, pharmacological evaluation of lung depo-
sition provides complementary information to scintigraphic
studies, based on their clinical relevance.
Keywords: Airways – Bioavailability – Deposition – Inhaled
drugs – Lung delivery – Pharmacodynamic – Pharmacokinetic.
Méthodes pharmacologiques d’évaluation
du dépôt pulmonaire des traitements inhalés
Pharmacological assessment of inhaled drug delivery to the lung
●● P.O. Girodet*, M. Molimard*
* Département de pharmacologie, université Victor-Segalen, Bordeaux-2.
Abréviations : ACTH : hormone adrénocorticotrope – ASC : aire sous la courbe –
BDP : béclométasone dipropionate – BPCO : bronchopneumopathie chronique
obstructive – Cmoy : concentration moyenne – Cmax : concentration plasmatique
maximale – CFC : chloro uorocarbone – DPI : inhalateur de poudre sèche (dry
powder inhaler) – DEMM25-75 % : débit expiratoire maximal moyen de 25 % à
75 % de la capacité vitale forcée – DEP : débit expiratoire de pointe – fL : fraction
de dose déposée et absorbée par le poumon – FO : biodisponibilité orale – fret :
fraction de dose retenue par le système d’inhalation – Fsyst : biodisponibilité
systémique – GC/MS : chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse – HFA : hydro uoroalkane – HPLC : chromatographie
liquide haute performance (high performance liquid chromatography) – pMDI :
aérosol-doseur pressurisé (pressurized metered-dose inhaler) – T1/2 : demi-vie
plasmatique – Tmax : temps nécessaire pour atteindre la concentration maximale
– Vd : volume de distribution – VEMS : volume expiratoire maximum seconde.
ABRÉVIATIONS

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Pharmacologie
Pharmacologie
6
L
es médicaments inhalés sont fréquemment utilisés pour
le traitement de l’asthme ou de la bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO). Après l’administration,
une proportion importante de la dose émise (25 % à 90 %) se
dépose dans l’oropharynx (1). Pour cette fraction, le passage
dans la circulation systémique s’eff ectue via une absorption
locale dans la cavité buccale ou, après déglutition, dans le tractus
gastro-intestinal. Concernant la fraction de dose délivrée dans
l’arbre trachéo-bronchique, la clairance des particules inhalées
est régulée par le transport mucociliaire et l’absorption dans
la circulation systémique par l’épithélium des voies aériennes.
La fraction absorbée par voie digestive ou respiratoire peut
induire des eff ets systémiques mais seule la fraction inhalée
est responsable d’eff ets thérapeutiques. Il est donc important
d’étudier le dépôt pulmonaire des thérapeutiques administrées
par voie inhalée.
De nombreux facteurs déterminent le dépôt pulmonaire des
traitements inhalés, tels que l’utilisation des systèmes d’inhala-
tion par les patients, le débit inspiratoire lors de l’inhalation, la
dose émise, la taille des particules inhalées et les caractéristiques
géométriques des voies aériennes variables selon la sévérité des
maladies respiratoires. Par conséquent, les variations de quan-
tité de médicaments atteignant le poumon et les variations de
distribution des particules émises impliquent des diff érences
dans la distribution du médicament dans les voies aériennes,
l’effi cacité clinique, la biodisponibilité systémique et les eff ets
indésirables des traitements inhalés. Les impacteurs en cascade
sont utilisés en tant que modèle du dépôt pulmonaire in vitro
(2). Une telle évaluation des propriétés aérodynamiques par cette
méthode est intéressante pour les phases de développement et
le contrôle de la qualité des médicaments, mais ses résultats ne
sont pas toujours transposables in vivo (3). Par conséquent, il est
important d’utiliser des méthodes cliniques pour déterminer le
dépôt pulmonaire, principalement pour les nouveaux systèmes
d’inhalation et les nouvelles formes galéniques avant l’Autori-
sation de mise sur le marché. De nombreux essais cliniques
comportent une étude du dépôt pulmonaire pour démontrer
une équivalence entre de nouveaux dispositifs d’inhalation ou de
nouvelles formules galéniques et le produit d’origine. Par exemple,
l’évaluation du dépôt pulmonaire est une étape nécessaire pour
comparer un aérosol-doseur pressurisé (pMDI) conventionnel
et un inhalateur de poudre sèche (DPI) ou un gaz propulseur
chlorofl uorocarbone (CFC) à un gaz propulseur, plus respec-
tueux de l’environnement, tel que l’hydrofl uoroalkane (HFA).
Actuellement, les deux principales techniques disponibles in
vivo sont les études du dépôt pulmonaire des aérosols radio-
marqués et les méthodes pharmacologiques. L’inhalation des
aérosols radiomarqués implique une mesure de la radioactivité
pulmonaire par une gammacaméra ou un compteur corporel
total. Bien que les études scintigraphiques constituent un outil
valable pour prédire le dépôt pulmonaire régional et total, ainsi
que le dépôt oropharyngé, la précision de cette technique est
limitée par le processus de détection en deux dimensions de ce
système (4). Des développements futurs sont nécessaires pour
l’utilisation en pratique courante de méthodes d’imagerie en
trois dimensions (tomographie par émission de positons) [5]. Les
études scintigraphiques présentent de nombreux inconvénients :
exposition aux irradiations, en particulier chez les enfants (6),
obtention compliquée de molécules radiomarquées, diffi cultés
pour interpréter le dépôt dans certaines zones anatomiques
dans l’espace et accès limité aux dispositifs développés par les
fi rmes pharmaceutiques.
Par conséquent, les approches pharmacocinétiques et pharmaco-
dynamiques fournissent potentiellement des informations
complémentaires sur le dépôt pulmonaire et sur les eff ets clini-
ques des thérapeutiques administrées par voie inhalée. L’objectif
de cette revue est de présenter les principales méthodes phar-
macocinétiques et pharmacodynamiques utilisées pour évaluer
le dépôt pulmonaire des traitements inhalés en précisant les
limites et les intérêts de chaque méthode.
MÉTHODES PHARMACOCINÉTIQUES
Les mesures pharmacocinétiques constituent des indicateurs
utiles pour établir une corrélation entre le dépôt pulmonaire
et la distribution plasmatique des traitements inhalés. Certains
paramètres pharmacocinétiques tels que la demi-vie plasma-
tique (T1/2) et le volume de distribution (Vd) dépendent de la
molécule et ne sont pas infl uencés par le dépôt pulmonaire.
Cependant, la variabilité du dépôt pulmonaire entre plusieurs
molécules peut résulter des diff érences liées à la concentration
plasmatique maximale (C
max
) et à l’aire sous la courbe (ASC) des
concentrations plasmatiques. Il existe également des caractéris-
tiques pharmacocinétiques spécifi ques selon la classe médica-
menteuse en question, en particulier les traitements inhalés les
plus fréquemment utilisés en pneumologie, à savoir les bêta-2
mimétiques et les corticostéroïdes.
Agonistes des récepteurs β2-adrénergiques inhalés
Concernant les bêta-2 mimétiques de courte durée d’action, le
paramètre pharmacocinétique le plus simple pour calculer la
biodisponibilité pulmonaire est la mesure de l’absorption précoce
du salbutamol dans les 20 minutes suivant l’inhalation. Le subs-
tratum pharmacologique de cette mesure est que l’absorption
gastro-intestinale contribue seulement à 0,3 % de l’absorption
systémique globale dans les 30 minutes suivant l’inhalation (7).
À partir des courbes de concentration plasmatique exprimées en
fonction du temps, un certain nombre de paramètres, tels que
la Cmax, la concentration moyenne pendant 20 minutes (Cav) et
le temps nécessaire pour atteindre la concentration maximale
(Tmax) permettent d’estimer le dépôt pulmonaire. Par exemple,
après inhalation de salbutamol (1 200 μg), les valeurs de Cmax
et T
max
sont respectivement de 2,93 ng/ml et 10 minutes pour
dix volontaires sains dont la moyenne d’âge est de 20,5 ans avec
un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) à 112,1 %
de la théorique (8). L’ASC est également considérée comme
un critère primaire pour évaluer l’absorption systémique (9).
Dans les essais cliniques, l’absorption gastro-intestinale peut être
réduite par un rinçage buccal ou prévenue par l’administration

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Pharmacologie
Pharmacologie
7
de charbon activé avant et après l’inhalation. Ainsi, l’absorption
gastro- intestinale étant exclue, les taux plasmatiques refl ètent
le dépôt pulmonaire et l’absorption.
L’utilisation de telles méthodes pharmacocinétiques dans les
études de bioéquivalence in vivo permet de calculer un rapport de
diff érence de C
max
, ce qui constitue un indicateur de dose relative
délivrée aux poumons. Cet indice relatif permet la comparaison
de diff érentes formulations de médicaments inhalés, de divers
systèmes d’inhalation ou des inhalations retardées en chambres
d’inhalation.
Néanmoins, l’interprétation des paramètres pharmacociné-
tiques impose de prendre en compte l’existence d’une maladie
pulmonaire et la fonction respiratoire. Le profi l d’absorption
pulmonaire d’une inhalation de fénotérol (4 mg) a été évalué
dans deux études diff érentes utilisant le même système d’inhala-
tion et une posologie identique chez des volontaires sains et des
sujets asthmatiques (VEMS moyen à 56 % de la théorique). Le
pic de concentration plasmatique de fénotérol est diminué d’un
facteur 2 pour les patientes asthmatiques (1,6 ng/ml) par rapport
aux sujets témoins (3,1 ng/ml) [10]. Des résultats similaires ont
été publiés avec les nébulisations de salbutamol, ce qui soulève
l’hypothèse selon laquelle un rétrécissement du calibre des voies
aériennes peut aff ecter le dépôt pulmonaire des β2-mimétiques
inhalés (11).
En pratique clinique, les études pharmacocinétiques présentent un
intérêt limité pour les agonistes des récepteurs β2-adrénergiques
inhalés, car les doses administrées sont généralement faibles et
les concentrations plasmatiques qui en résultent sont le plus
souvent dans les limites des seuils de détection. Cependant, la
sensibilité des dosages est améliorée par la chromatographie en
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC/MS).
Alors que le seuil de détection de la chromatographie liquide
haute performance (HPLC) avec détection ultraviolet pour la
concentration plasmatique de salbutamol est de 0,2 ng/ml (12),
la linéarité de la méthode GC/MS est validée pour des concen-
trations de salbutamol comprises entre 50 et 10 000 pg/ml (13).
Dans les études de bioéquivalence, les paramètres pharmaco-
cinétiques sont nécessaires, mais insuffi sants pour évaluer la
distribution pulmonaire des molécules étudiées. Les méthodes
granulométriques constituent un complément nécessaire dans
cette optique.
Corticostéroïdes inhalés
Une faible proportion de la dose émise peut atteindre la circula-
tion systémique, puisque la fraction de médicament avalé subit
un important eff et de premier passage hépatique : 90 % pour
le budésonide et 99 % pour la fl uticasone. O.J. Dempsey et al.
ont démontré que l’absorption oropharyngée de fl uticasone ne
contribue pas à l’activité systémique (14). L’intérêt du rinçage
buccal suivant l’inhalation est la prévention des candidoses
oropharyngées et non pas la réduction des eff ets systémiques.
La biodisponibilité systémique des corticostéroïdes inhalés
dépend donc de la fraction médicamenteuse absorbée par les
voies aériennes via la vascularisation pulmonaire. Par consé-
quent, pour ces médicaments métabolisés de manière intense,
le passage systémique dans la circulation générale refl ète le
dépôt pulmonaire.
Cependant, la mesure des concentrations sériques ne corres-
pond pas aux besoins de techniques précises pour évaluer la
dose de médicament délivrée au niveau du tissu pulmonaire.
Étant donné les propriétés lipophiles des corticostéroïdes, le Vd
est variable selon les molécules (tableau I). Les valeurs de Cmax
dépendent de ce paramètre. Suivant l’inhalation de molécules avec
une biodisponibilité identique, les concentrations plasmatiques
sont inversement proportionnelles au Vd (fi gure 1). Ainsi, les
médicaments hautement lipophiles avec un Vd élevé, tels que la
fl uticasone, ont une activité systémique pour des concentrations
plasmatiques plus faibles par rapport à des médicaments moins
lipophiles. Une simple mesure de l’ASC n’est donc pas directement
corrélée à la distribution systémique.
Un correctif peut être apporté par une approche méthodologique
qui identifi e le dépôt pulmonaire en fonction du rapport de la
fraction de la dose déposée et de celle absorbée par le poumon (fL)
sur la biodisponibilité systémique (Fsyst) [15]. Ce calcul, impliquant
une évaluation de la biodisponibilité orale (F
O
) et l’absence de
métabolisme pulmonaire des médicaments étudiés (16), s’énonce
comme suit :
fL = Fsyst – FO.(1-fret)/(1-FO)
Les concentrations plasmatiques et urinaires de médicament
refl ètent le dépôt pulmonaire global, sans fournir d’information
sur des profi ls de dépôts localisés dans certaines régions anatomi-
ques. Considérant la taille des particules, il a été démontré que le
dépôt pulmonaire des médicaments inhalés a tendance à décroître
Tableau I.
Caractéristiques pharmacocinétiques des corticostéroïdes inhalés.
T1/2 (h) Vd (l/kg) Clairance (l/mn) Disponibilité orale (%)
Béclométasone-17-monopropionate 2,7 6,1 2 41
Béclométasone dipropionate 0,5 < 1 2,5 -
Budésonide 2-3 2,7 0,9-1,3 6-13
Flunisolide 1,6 1,8 1 21
Fluticasone propionate 8-14 12,1 0,9-1,3 < 2
Triamcinolone acétonide 1,5 1,3 0,7 23
Abréviations : T1/2 : demi-vie plasmatique ; Vd : volume de distribution.

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Pharmacologie
Pharmacologie
8
Figure 1. Représentation schématique de la distribution systémique des
corticostéroïdes inhalés. Les corticostéroïdes hautement lipophiles (A)
ont un volume de distribution (Vd) potentiellement élevé, alors que les
corticostéroïdes faiblement lipophiles (B) ont un Vd inférieur. Considérant
que la dose x est équivalente pour les médicaments A et B, la comparaison
des concentrations plasmatiques (C) implique de tenir compte des valeurs
de Vd.
Corticostéroïde inhalé
Médicament A x μg Médicament B x μg
Vd élevé Vd faible
C plasmatique faible
C plasmatique élevée
avec l’augmentation de la distance par rapport à la trachée. Un tel
profi l de distribution pulmonaire a été établi pour des patients
ayant bénéfi cié d’une intervention chirurgicale thoracique, avec
une administration préopératoire de traitement inhalé (17). Par
exemple, les concentrations de fl uticasone dans le tissu pulmo-
naire proximal sont 3 à 4 fois plus élevées que celles du poumon
périphérique après une inhalation d’une dose de 1 mg. Il est bien
évident que ces techniques ne permettent pas la comparaison de
diff érentes formulations en pratique courante.
MÉTHODES PHARMACODYNAMIQUES
Selon une approche complémentaire des méthodes pharmaco-
cinétiques, les études pharmacodynamiques permettent dans
certaines conditions d’évaluer le dépôt pulmonaire des traite-
ments inhalés (tableau II). Les paramètres pharmacodyna-
miques étudiés varient en fonction de la classe médicamenteuse,
bronchodilatateurs (β2-adrénergiques inhalés) ou anti-infl am-
matoires (corticostéroïdes inhalés). Les critères de jugement
principaux comportent l’eff et thérapeutique et les événements
indésirables induits par les traitements inhalés.
Agonistes des récepteurs β2-adrénergiques inhalés
Eff ets cliniques des agonistes β2-adrénergiques
Les variables d’effi cacité des bronchodilatateurs de courte durée
d’action sont souvent évaluées avant et après l’inhalation d’une
dose unique (18). Par exemple, pour comparer deux agonistes
β2-adrénergiques administrés par aérosol-doseur pressurisé dont
la formulation diff ère par le gaz propulseur utilisé, la variation
du VEMS par rapport à l’état initial constitue fréquemment le
critère de jugement principal (13). Une diminution de l’hyper-
réactivité bronchique (eff et bronchoprotecteur) induite par les
β2-adrénergiques peut être évaluée par un test de provocation
ventilatoire avec un agent bronchoconstricteur tel que la méta-
choline. Les scores de dyspnée et la consommation d’agoniste
β2-adrénergique de courte durée d’action sont susceptibles d’être
pris en compte pour déterminer l’eff et des bronchodilatateurs
de longue durée d’action dans l’asthme et la BPCO. Ces para-
mètres sont cependant des critères de jugement secondaires
par rapport au VEMS.
Les explorations fonctionnelles respiratoires ne détectent pas
de réponses signifi catives en termes de bronchodilatation si le
sommet de la courbe dose-réponse est facilement atteint. Par
exemple, pour les bronchodilatateurs de courte durée d’action,
la première dose administrée ne doit pas induire une réversi-
bilité complète de l’obstruction. Ainsi, il est important que les
patients inclus dans les essais cliniques aient une obstruction des
voies aériennes signifi cative avec une marge substantielle pour
permettre une amélioration de la fonction ventilatoire.
Eff ets indésirables des agonistes β2-adrénergiques
L’analyse des eff ets indésirables représente un outil complémen-
taire pour étudier les caractéristiques pharmacodynamiques des
médicaments inhalés. Chez les asthmatiques intermittents et
persistants légers, la plus faible dose d’agoniste β2-adrénergique
est à même de provoquer une réversibilité complète d’une
obstruction bronchique spontanée ou pharmacologiquement
induite. Par conséquent, la comparaison des eff ets cliniques
exercés par de fortes doses de bronchodilatateurs est diffi cile à
établir. L’analyse des eff ets indésirables des β2-agonistes repré-
sente une alternative intéressante par rapport aux critères d’effi -
cacité clinique classiques. Étant donné que les eff ets indésirables
des agonistes β2-adrénergiques sont négligeables aux doses
pharmacologiques, de telles études sont conçues pour reproduire
les eff ets adverses potentiels induits par une consommation
importante de bronchodilatateurs lors d’un asthme aigu grave.
Pour les β2-agonistes, le pouls, le tremblement des extrémités
(19), l’hypokaliémie et l’hypoglycémie sont classiquement étudiés
bien que leur survenue soit particulièrement rare en cas d’utilisa-
tion à des doses pharmacologiques. S.J. Fowler et al. ont comparé
les paramètres pharmacocinétiques validés antérieurement et
la réponse systémique aux agonistes β2-adrénergiques dans
un échantillon de volontaires sains (20). Suivant l’inhalation de

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 4 - octobre-novembre-décembre 2008
Pharmacologie
Pharmacologie
9
35
30
20
25
10
5
0100 150 400 800
Dose totale journalière (μg/j) [log scale]
Ratio de dose relative x
x
Médicament B
Médicament A
Variation VEMS initial (% valeur théorique)
Figure 2. Analyse de régression des courbes doses-réponses pour les
variations de VEMS à l’issue de six semaines de traitement pour les
médicaments A et B. L’augmentation du VEMS observée pour la courbe
dose-réponse du médicament A est comparée au médicament B en
utilisant le rapport relatif de dose x (d’après [22]).
fortes doses de salbutamol (1 200 μg) par diff érents systèmes
d’inhalation, les concentrations plasmatiques maximales et
moyennes de salbutamol sont corrélées positivement avec
l’hypokaliémie et le tremblement. Une telle corrélation n’est
pas mise en évidence pour les pulsations cardiaques.
Corticostéroïdes inhalés
Eff ets cliniques des corticostéroïdes inhalés
Par contraste avec les études portant sur les agonistes
β2-adrénergiques, des études menées sur le long terme sont
nécessaires pour mettre en évidence une réponse clinique signi-
fi cative induite par les corticostéroïdes inhalés (21). Il est classi-
quement admis que des modifi cations de la fonction ventilatoire
apparaissent chez des patients traités par corticostéroïdes inhalés
pendant au moins 6 semaines. Les variations du VEMS et du
DEMM 25-75 % représentent les critères d’effi cacité primaires
pour cette classe médicamenteuse. Dans un essai multicen-
trique, W.W. Busse et al. ont comparé l’eff et induit par des doses
croissantes de béclométasone dipropionate (BDP) avec des gaz
propulseurs de type CFC ou HFA sur le contrôle de l’asthme (22).
Les études scintigraphiques antérieures ont démontré un dépôt
pulmonaire supérieur du BDP-HFA en raison d’une plus faible
distribution de taille des particules par rapport au BDP-CFC
(23). Les sujets aff ectés d’un asthme persistant sont assignés de
manière aléatoire dans chacun des six groupes étudiés : 100 μg par
jour, 400 μg par jour ou 800 μg par jour de BDP-HFA, ou 100 μg
par jour, 400 μg par jour ou 800 μg par jour de BDP-CFC-BDP
pendant six semaines. Le résultat principal est une amélioration
signifi cative de la courbe dose-réponse pour le DEMM 25-75 %
après six semaines de traitement par BDP-HFA par rapport au
BDP-CFC. Cette étude indique que la posologie de BDP-CFC
doit être multipliée par 2,6 pour obtenir une augmentation du
VEMS, exprimé en pourcentage de la valeur théorique, similaire
au résultat du traitement par BDP-HFA. Bien qu’il n’existe pas de
consensus dans la littérature internationale, l’analyse en lignes
parallèles de D.J. Finney et H.O. Schild (24) est une méthode de
référence pour comparer des courbes doses-réponses de plusieurs
molécules ou de diff érentes formulations. La fi gure 2 montre
que l’eff et bénéfi que obtenu pour la courbe dose-réponse d’un
médicament A par rapport à un médicament B est quantifi é en
utilisant un ratio x. Cette valeur signifi e que la dose du médica-
ment B multipliée par ce facteur x permet d’atteindre un eff et
équivalent à celui du médicament A. Une seconde approche
consiste à évaluer la réponse clinique d’un traitement inhalé en
comparant la courbe dose-réponse à l’administration d’une dose
unique (fi gure 3). Ainsi, des posologies croissantes du produit
à l’essai sont administrées à un petit échantillon de patients.
Les données cliniques sont comparées à des valeurs de réponse
clinique obtenues par des études antérieures, dans lesquelles le
médicament comparateur était administré en dose unique à un
Tableau II.
Comparaison des méthodes pharmacocinétique et pharmacodynamique pour évaluer le dépôt pulmonaire des médicaments inhalés.
Études pharmacocinétiques Études pharmacodynamiques
Avantages
Reproductibilité Variables d’e cacité
Relation dose-réponse Mesure des e ets indésirables
Comparaison entre le dépôt pulmonaire relatif et l’exposition systémique relative Relation dose-réponse pour les e ets indésirables
Inconvénients
Absorption intestinale Variabilité interindividuelle
Faibles concentrations plasmatiques des médicaments Nécessité d’une marge d’amélioration pour les critères d’e cacité
Absence d’évaluation des variations régionales de dépôt pulmonaire Études à long terme pour les corticostéroïdes inhalés
 6
6
 7
7
1
/
7
100%