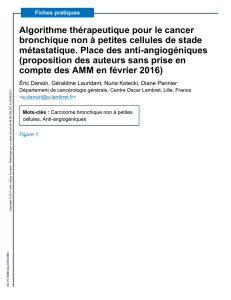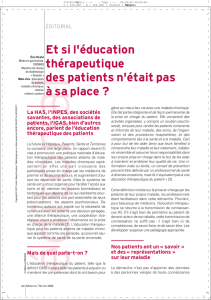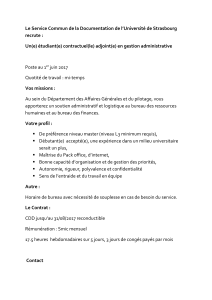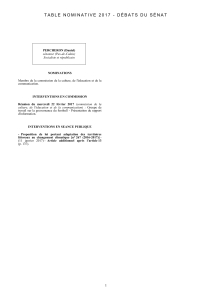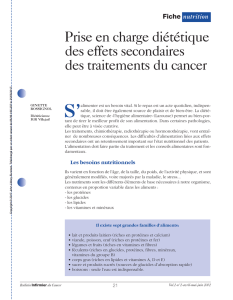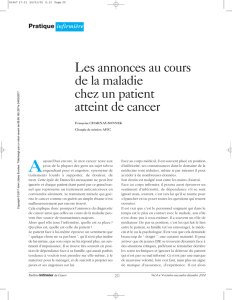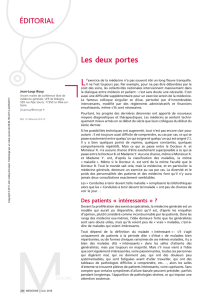Surdiagnostic et surtraitement : on ne nous a

DOI : 10.1684/med.2014.1164
éditorial
Iona Heath 1
Ancienne présidente
du Royal College
of General
Practitionners
(Royaume-Uni)
Mots clés : facteurs
de risque ; médecine
préventive
[Preventive Medicine;
Risk Factors]
ÉDITORIAL
Surdiagnostic
et surtraitement :
on ne nous a pas appris
quand et où arrêter...
Des solutions techniques
aux problèmes existentiels ?
Chercher des solutions techniques aux problè-
mes posés par la détresse, la souffrance, la fini-
tude de la vie et l’inévitabilité du vieillissement,
du deuil et de la mort est un projet sociétal qui
dépasse largement les disciplines médicales. La
prescription d’antidépresseurs a ainsi doublé du-
rant la dernière décennie, notamment dans les
pays les plus riches. Nous avons essayé de traiter
toutes sortes de détresses et de malheurs, ce-
pendant bien compréhensibles, par une solution
biotechnique aux inconvénients significatifs.
Nous étions sans aucun doute motivés par de bon-
nes intentions, pleins de bonne volonté pour aider
les gens. On nous a enseigné que nous pouvions y
arriver en faisant des choses : en réussissant des
opérations, en appliquant des traitements, en
prescrivant... On nous a appris à faire, à intervenir,
à être actifs. Nous nous sommes très rarement
demandé si ce que nous faisions avait des inconvé-
nients. La philosophe britannique Mary Midgley
écrivait à ce sujet : « Ce nouveau pouvoir exerce
sur nous une fascination qui donne lieu aujourd’hui
à cette évolution effrénée de la technologie, en
partie utile, en partie inutile, et à la dangereuse
ampleur qu’atteint le gaspillage des ressources.
S’il nous est difficile de stopper l’incessante mon-
tée des besoins croissants, c’est que notre épo-
que se préoccupe vivement de l’amélioration
constante des moyens plutôt que de réfléchir aux
fins, ce qui nous épargnerait bien des soucis » [1].
Nous sommes parvenus à une époque d’action
irréfléchie : il faut continuer à faire, ne pas s’arrêter
pour penser, il n’y a pas le temps ! Et il n’y a pas le
temps parce que nous sommes trop occupés à
faire. Préoccupés des moyens, nous oublions les
fins : soulager la douleur, soigner les malades et
les mourants, guérir la maladie, accroître la longé-
vité, assurer une bonne santé à une population
performante, vendre des produits pharmaceuti-
ques. Il me semble que nous n’avons jamais suffi-
samment compris les contradictions et conflits en-
tre ces différentes fins, les deux ou trois premières
concernant les individus malades – les quatrième
et cinquième s’intéressant aux populations.Si
nous donnons la priorité à une longévité accrue,
nous pouvons simplement ajouter à la somme des
souffrances humaines, etc., etc. Quelle est la hié-
rarchie de ces fins ? Qui en décide ?
La philosophe hollandaise Annemarie Mol, à pro-
pos de la difficulté de soigner la maladie et la
souffrance, familière à tout médecin, écrivait [2] :
« Vous faites ce que vous pouvez, vous essayez
et essayez encore. Vous êtes le docteur, mais
vous n’avez pas le contrôle. Et finalement, le ré-
sultat n’est pas glorieux : dans une vie avec un
diabète, l’histoire ne finit jamais par “ils vécurent
heureux jusqu’à la fin des temps”. Elle se ter-
mine avec la mort. » Toutes les histoires humai-
nes et toutes les vies humaines finissent avec la
mort – même si nous préférerions le contraire –
et la possibilité de mort, bien que non reconnue,
est présente dans presque chaque soin. L’histo-
rien médical de Harvard Charles Rosenberg po-
sait cette importante et cruciale question [3] :
« Comment faire face à la mort, qui n’est pas pré-
cisément une maladie, lorsque les impératifs d’in-
géniosité technologique et les revendications ac-
tivistes font pratiquement écho aux attentes de
la société envers la médecine ? »
1. Cet éditorial est la suite de l’intervention de Iona Heath lors du 3ecolloque
de Bobigny, les 25 et 26 avril derniers (la 1re partie a fait l’objet de l’éditorial
publié dans le précédent numéro). Traduction-adaptation, intertitres, J.-P. Val-
lée, rédacteur en chef de Médecine.
436 MÉDECINE décembre 2014
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

Le grand projet – erroné – des 50 dernières an-
nées a été de rechercher des solutions techni-
ques aux problèmes existentiels. Nous avons ou-
blié de réfléchir aux limites de la vie en détournant
notre attention sur les moyens techniques, les
interventions biomédicales visant à prolonger la
vie, sans que cela soit utile : les questions exis-
tentielles persistent malgré l’apparente augmen-
tation de puissance de nos moyens.
La clé d'une «bonne mort »
Voici ce que dit cette pierre tombale de 1788 :
« J’ai supporté longtemps ce mal insupportable/
Les médecins n’y pouvaient rien/Jusqu’à ce que
Dieu permette que la mort me saisisse et me sou-
lage de ma douleur. » Ne l’oublions jamais : la
mort restreint nos joies mais aussi nos misères...
Le bioéthicien Daniel Callahan rappelait que
« 1 % de patients consomment quelque 21 %
des dépenses de santé et meurent habituelle-
ment de défaillance progressive de multiples or-
ganes, ce qui illustre le problème du progrès mé-
dical. Il y a 50 ans, ils mouraient plus tôt et, dans
la plupart des cas, avec moins de souffrances.
Nous avons échangé des vies plus courtes et des
morts plus rapides pour le contraire exact, des
vies plus longues et des morts plus lentes » [4].
Je me demande toujours si cet échange est une
bonne chose... Le critique littéraire Christopher
Ricks définit Samuel Becket comme « le grand
écrivain d’une époque qui a créé de nouvelles
possibilités et impossibilités même au chapitre
de la mort. Une époque qui a prolongé la durée
de vie, jusqu’à ce qu’elle tienne plus du cauche-
mar que de la bénédiction » et aussi « ce n’est
pas le savoir qui nous fait défaut, mais le courage
de comprendre ce que nous savons et d’en tirer
les conséquences » [5].
En 2012, Bill Keller décrivait dans un article du
New York Times la mort de son beau-père dans
un hôpital de l’est de l’Angleterre [6]. En voici un
extrait : « L’opération n’a pas réussi, dit le doc-
teur. Nous ne pouvons rien faire de plus. Je vais
donc mourir ? demanda le patient. Le docteur hé-
sita, puis dit oui. Tu vas mourir, papa, dit sa fille.
Bon, conclut le patient, plus de folies alors ? De
l’autre côté, tu pourras en faire des tas, promit
sa fille –ma femme. Le patient acquiesça en riant.
Il mourut 6 jours plus tard, quelques mois avant
son 80eanniversaire. Durant les 6 jours où il vécut
encore, il est passé plusieurs fois de l’état d’in-
conscience à celui d’éveil, au rythme des injec-
tions de morphine. Ni les tubes, ni le va-et-vient
du personnel médical ne l’ont gêné pendant qu’il
se replongeait dans ses souvenirs, faisait
amende honorable, échangeait avec sa famille
des blagues et des témoignages d’affection. Il a
reçu les sacrements catholiques et réussi à ava-
ler l’hostie consacrée qui fut probablement son
dernier repas. Puis il sombra dans le coma. Il
mourut doucement, aimé et le sachant, dans la
dignité et la sérénité. J’ai combattu la mort de-
puis si longtemps, dit-il à ma femme peu avant
son décès, que c’est un grand soulagement de
renoncer. Nous voudrions tous mourir aussi
bien. »
La clé d’une bonne mort est dans ces échanges :
« Rien de plus n’aurait pu être fait. Ainsi, je vais
mourir, demanda le patient. Le docteur hésita.
Oui, dit-il. » Le docteur a hésité mais a eu le cou-
rage d’expliciter ce qu’il savait et d’être honnête
avec son patient. C’est préférable parce qu’il y a
toujours quelque chose que nous puissions faire,
ne serait-ce que de s’asseoir un moment et de
tenir la main. Mais ne sous-estimons jamais le
courage qu’il faut pour lancer ainsi ce « nous ne
pouvons rien faire de plus ».
Ce qu’écrivait le poète Czeslaw Milosz : « Savoir
et se taire/Voilà qui mène à l’oubli/Ce qui est dit
gagne en force/Ce qui est tu est voué au néant »
[7]. Si nous, les docteurs, savons et ne disons
pas, la réalité et l’imminence de la mort tend vers
la non-existence, et les patients et leurs proches
ne peuvent s’y préparer. Comme le disait l’écri-
vain et chirurgien Atul Gawande : « Comment te-
nir compte des idées et préoccupations de la
mort lorsqu’il est presque impossible de détermi-
ner qui est mourant, d’un point de vue médi-
cal ? » [8], et le médecin et bioéthicien américain
Leon Kass : « Comment réconcilier ces deux phi-
losophies de la vie : le point de vue de la méde-
cine de préserver la vie même au détriment de
437décembre 2014MÉDECINE
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

sa qualité, et celui d’une existence ordinaire, à la
fois fragile et source d’épanouissement ? Voilà
sans doute le dilemme éthique le plus profond et
le plus subtil que nous ayons à résoudre » [9].
La médecine n’a pas appris quand et où s’arrêter
comme si nous avions complètement occulté que
la mort n’est pas nécessairement un échec médi-
cal et dans quelle mesure la prise en charge des
mourants est l’une de nos tâches fondamentales.
Injustice et cupidité
Le Global Health Expenditure Atlas 2012 de
l’OMS souligne que les pays de l’OCDE consom-
ment plus de 80 % des ressources de santé mon-
diales mais subissent moins de 10 % des inca-
pacités mondiales ajustées à l’âge. Cela devrait
être intenable en termes à la fois de justice glo-
bale et de capacité financière mondiale. Le pro-
blème est que ces pays sont leaders et que le
reste du monde tend à les suivre, ou est poussé
à le faire. C’est une histoire de cupidité insoute-
nable, la cupidité de ceux qui vivent dans des
pays riches pour une longévité toujours plus
grande, cupidité qui conduit et soutient les impé-
ratifs commerciaux et les industries de technolo-
gie médicale. Le revers de la médaille est la peur,
peur que nous ou quelqu’un que nous aimons
soit privé d’un traitement efficace pour des ques-
tions de coûts ou d’accès aux soins. Mais ni la
peur ni la cupidité ne peuvent réellement nous
aider. Les seules solutions à ces paris profondé-
ment existentiels qui ont assailli l’humanité de-
puis la nuit des temps sont fondées sur le cou-
rage et l’endurance, et l’acceptation des limites
de la vie.
L’écrivain américain Saul Bellow, toujours très
conscient des profonds défis existentiels de l’hu-
manité, a écrit dans Mr Sammler’Planet :
« Quand je vois la créature humaine réclamer da-
vantage lorsque la somme des connaissances hu-
maines n’offre pas d’autre réponse [...], le jeu
n’en vaut pas la chandelle. Il est parfois plus sage
et honorable de renoncer que de s’accrocher à
tout prix. Ne pas étirer indûment le fil de la vie.
Faire le choix le plus noble. Ainsi pensait Aris-
tote. » [10]. Ceci s’applique à la fois aux patients
et à leurs médecins : chacun semble vouloir de-
mander plus que les faits ne peuvent donner.
« Devons-nous toujours intervenir, même au prix
de souffrances ? Insister jusqu’à l’épuisement ?
Peut-être » [10]. Il me semble que tout notre es-
poir repose dans ce « peut-être »...
Sur-diagnostic et
sur-traitement ont au moins
4 implications sérieuses
La première est l’extension des effets adverses à
ceux qui se trouvent étiquetés comme étant à
risque ou ayant une maladie définie entièrement
par des normes ou autres investigations aberran-
tes et les craintes inutiles que cela engendre ; la
deuxième implique la relation directe entre sur- et
sous-traitement, puisque à chaque fois que le
diagnostic concerne davantage de patients, éner-
gies et ressources sont inévitablement redirigées
au détriment de ceux qui sont les plus sévère-
ment affectés ; la troisième concerne le risque de
mettre en danger les systèmes de soins basés
sur la solidarité sociale du fait de l’escalade des
coûts induits ; la quatrième est le fait que l’activité
biotechnique marginalise et occulte les causes
socio-économiques d’un mauvais état de santé.
Aussi, laissez-moi conclure avec le sociologue
Zygmunt Bauman : « Être responsable ne se
borne pas à suivre les règles. Pour être respon-
sables, nous devons souvent faire fi des règles
ou agir d’une façon qui leur est contraire. Seul ce
genre de responsabilité peut construire un ci-
toyen sur qui pourra s’appuyer une communauté
humaine suffisamment inventive et généreuse
pour relever les défis d’aujourd’hui » [11]. À cha-
que fois que je vois combien les guidelines ac-
tuels nous poussent au sur-diagnostic et au sur-
traitement, je pense à cette réflexion.
Liens d’intérêts : aucun.
Références :
1. Midgley M. Science and Poetry. London : Routledge Classics; 2001.
2. Mol A. Ce que soigner veut dire. Repenser le libre choix du patient (trad française). Paris: Presse des mines; 2009.
3. Rosenberg CE. The Tyranny of Diagnosis: Specific Entities and Individual Experience. The Milbank Quaterly. 2002;80(2):237-60.
4. Callahan D. The Difficult Child of Medical Progress. Bioethics Forum 2012. Sur http://childpsychaitry.thehastingscenter.org/Bioethicsforum/Post.aspx?id=5860&blogid=140
5. Ricks C. Beckett’s Dying words. Oxford: Clarendon Lectures; 1990.
6. Keller B. How to die. New York Times. October 8, 2012:A23.
7. Milosz C. Reading the Japanese Poet Issa (1762-1826). In New and collected Poems 1931-2001. London: Penguin Classics; 2005.
8. Gawande A. Letting Go. New Yorker, 27 July 2010.
9. Kass LR. Cancer and Mortality. In: Dresser R (Éd.) Malignant. Oxford: University Press; 2012.
10. Bellow S. La planète de M. Sammler (Trad. Française). Paris: Galimard; 1970.
11. Bauman Z. Alone Again : Ethics after Certainty. 1994. http://www.demos.co.uk/files/aloneagain.pdf
438 MÉDECINE décembre 2014
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.
1
/
3
100%