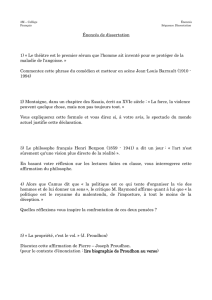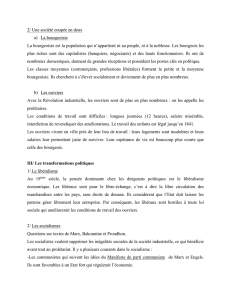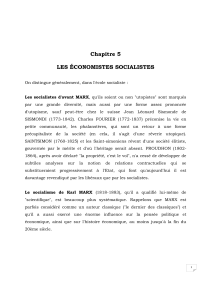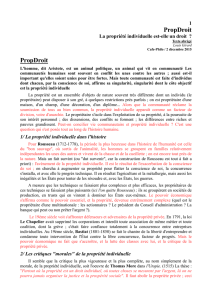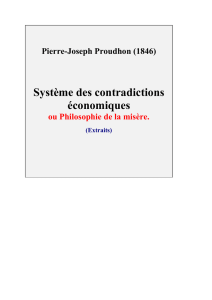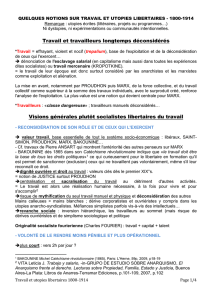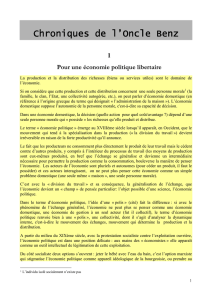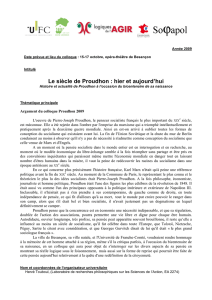pdf, 3 MB - Association Culturelle Joseph Jacquemotte

L’Association Culturelle Joseph Jacquemotte
présente
Marx, à mesure
Une anthologie commentée des écrits
de Marx et d’Engels
par
Le Cercle d’Etude des Marxismes
Fascicule 8

Présentation générale
Le CEDM a entrepris de constituer une anthologie
commentée des écrits de Marx et d’Engels.
Le projet s’inscrit dans le cadre des activités de
formation de l’Association Culturelle Joseph
Jacquemotte : il s’adresse à quelque public désireux de
se mettre à l’étude des textes qui constituent l’apport
de Marx et d’Engels et d’autres qui, au nom du
marxisme, s’en réclament.
Une anthologie
Le principe d’un recueil ne réclame aucun commentaire
spécial. Les ouvrages de ce genre sont légion dans
l’univers des apprentissages. Leur avantage est d’offrir
un éventail d’extraits significatifs d’une œuvre.
Les écrits de Marx et d’Engels se prêtent
particulièrement à ce traitement, en raison de leur
ampleur et de leur chronologie propre. Du reste, les
recueils n’ont pas manqué. Ainsi dans le domaine de
l’édition francophone, les Morceaux choisis édités en
1934, aux éditions Gallimard par H. Lefebvre et N.
Gutermann ou les deux tomes des Pages de Karl Marx
pour une éthique socialiste, par Maximilien Rubel en
1970, chez Payot. Aujourd’hui toutefois, les ouvrages
de ce genre sont devenus plutôt rares. Excepté les
publications en français des Editions du Progrès, de
Moscou, d’accès difficile, on ne compte pratiquement
plus en édition courante que le recueil de Kostas
Papaioannou intitulé Marx et les marxistes, dans la
collection Tel de Gallimard.
Cette situation de pénurie, aggravée par la crise, puis la
disparition des Editions sociales, suffit à justifier l’utilité
de la présente publication.
Une anthologie commentée
Ces ouvrages ont en commun de proposer un
assemblage de courts extraits regroupés par thèmes.
Nous avons choisi une autre méthode.
D’abord l’ampleur plutôt que la brièveté : en effet, il
importe à nos yeux de respecter au plus juste le
rythme des argumentations. Les coupures, supposons-
les pertinentes, seront accomplies de sorte à préserver
les articulations du raisonnement dans l’écrit complet.
Ensuite le commentaire plutôt que la citation brute :
c’est évidemment le plus délicat. Nous aurons de ce
point de vue un double souci.
Un souci de forme : celui de permettre à la fois une
lecture cursive des extraits et une consultation des
commentaires. De préférence aux notes de bas de
page, nous avons choisi un regroupement des
remarques en fin de document, chacune se trouvant
annoncée dans le corps du texte étudié par un souli-
gnement en gras et par une référence numérique.
Un souci de rigueur : nous veillerons à accompagner au
plus près ces analyses par une bibliographie des
ouvrages où sont construites et débattues les questions
qu’elles soulèvent et par des annexes qui donnent
accès à des documents périphériques indispensables à
la compréhension.
Enfin nous avons opté pour une présentation
chronologique en échelonnant les écrits dans l’ordre de
leur élaboration par leur(s) auteur(s). Ce choix garantit,
à nos yeux, que l’on respecte, dans chaque contexte
particulier, le processus même de la recherche, ses
tâtonnements, ses rectifications, ses avancées.
Une anthologie commentée pour une étude
collective des écrits de Marx et d’Engels
Insistons sur la dimension pédagogique de l’entreprise,
laquelle ne souhaite qu’offrir un outil de travail pour la
formation au marxisme et aux théories qui s’en
réclament ou qui s’y réfèrent. Le segment « à mesure »
dans le titre général indique que les textes se
succèderont dans l’ordre chronologique de leur écriture
par Marx et Engels. Mais c’est aussi une manière de
dire notre souhait d’ « y aller à mesure » dans un
rapport d’apprentissage en groupe, en évaluant les
savoirs et les apports de chacun(e) en ces matières.
Pour servir cet objectif, la publication se fera sous la
forme de fascicules d’ampleur variable. Ce dispositif
souple et évolutif nous semble le mieux approprié à
l’usage auquel ces pages sont destinées. Il présente
l’avantage d’enregistrer à la commande tous les
ajustements, toutes les modifications qui s’imposeront
dans le cours du travail collectif. L’électronique permet
de modifier sans peine chacune des versions qui seront
ainsi référencées et datées selon leur dernière mise au
point. Chaque tirage sera reproduit sur le site Internet
de l’ACJJ.

Sommaire
Le présent fascicule, intitulé « Rupture (5), L’Anti-Proudhon », propose une lecture commentée de Misère de la
Philosophie et plus globalement une vue sur les rapports entre Marx et Proudhon. Il contient les 7 cahiers suivants :
1. K. Marx, Misère de la Philosophie
1.1. Contexte et autres enjeux, paginé CaE, de 1 à 7
1.2. Une découverte scientifique, paginé UdS de 1 à 21
1.3. La dialectique en question, paginé DeQ, de 1 à 7
1.4. La métaphysique de l’économie politique
1.4.1. La méthode, paginé LM de 1 à 22
1.4.2. La division du travail et les machines, paginé DeM, de 1 à 9
1.4.3. La concurrence et le monopole, paginé CeM, de 1 à 5
1.4.4. La propriété ou la rente, paginé PoR, de 1 à 9
1.4.5. Les grèves et les coalitions des ouvriers, paginé GeC, de 1 à 7
2. La lettre de Marx à Proudhon du 05.05.1845, paginé MaP, de 1 à 3
3. La réponse de Proudhon à Marx, paginé PaM, de 1 à 6
4. La réaction de Proudhon au pamphlet de Marx, paginé RP, de 1 à 2
5 Annexes
5.1. Lettre de Marx à Schweitzer du 19.01.1865, paginé MaS de 1 à 15
5.2. Lettre de Marx à Annenkov du 28.12.1846, paginé MaA de 1 à 7
5.3. Marx, Engels et Proudhon : Chronique d’une rupture, paginé MEP, de 1 à 6
5.4. P-J. Proudhon, Philosophie de la Misère, résumé analytique de l’ouvrage, paginé PdM, de 1 à 42
5.5. P-J. Proudhon, La Création de l’Ordre dans l’Humanité, résumé analytique du ch. III, paginé CdO, de 1 à 5
5.6. P-J. Proudhon, Le projet d’Association progressive, paginé PaP, de 1 à 10
5.7. P-J. Proudhon : Eléments de biographie, paginé, PbI de 1 à 21
6. Documents
6.1. J. Nagels, « Le point de vue de la production dans le marxisme » paginé D, de 1 à 2
6.2. J. Nagels, « David Ricardo, la loi dite des coûts comparatifs », paginé D, de 2 à 4
7. Table générale

CaE, page 1/7
1. K. Marx, Misère de la Philosophie
1.1. Contexte et autres enjeux
Marx atteint ses 28 ans le jour même, un 5 mai, où il signe avec Engels la lettre par laquelle tous deux
invitent Proudhon à faire partie du Comité de correspondance communiste qu’ils viennent de créer à
Bruxelles.
Son jeune âge n’empêche pas qu’il accomplit en cette période, entre 1845 et 1847, des évolutions
décisives pour l’orientation de sa vie d’intellectuel et de militant politique.
Nous en retiendrons deux aspects contrastés.
D’un côté, l’expérience de l’exil devient plus éprouvante. L’exil parisien était un exil choisi. L’exil
bruxellois est un exil subi. La famille Marx, qui compte à présent deux petites filles, Jenny, née à Paris
en mai 1844 et Laura, née à Bruxelles en septembre 1845, et qui attend la naissance d’Edgar en
décembre 1847, souffre de plus en plus de l’épuisement de ses ressources financières. A vrai dire, Marx
est sans emploi rémunéré depuis sa démission de la Rheinische Zeitung en mars 1843. Par ailleurs, afin
d’échapper aux poursuites et tracasseries de l’Etat prussien, il a pris la décision de renoncer à sa
nationalité : il est désormais et pour toujours un apatride.
D’un autre côté, Marx n’est plus seul à la tâche. Sa rencontre avec Engels en août 1844 et leur amitié
vont aussitôt transformer radicalement ses conditions de travail. Avant même que son aide ne devienne
à proprement parler vitale, Engels apporte son intelligence, de l’énergie et de l’audace, et surtout son
expérience du capitalisme anglais dans sa logique économique et dans ses conséquences sociales. En
conjuguant leurs qualités complémentaires, les deux amis ne vont pas tarder à constituer une véritable
« intellectuel collectif » dont les premiers ouvrages, publiés ou non, se succèdent en accomplissant
autant de ruptures ciblées : La sainte famille, en février 1845, contre les frères Bauer, L’idéologie
allemande, de septembre 45 à août 46, contre les mêmes et Stirner, mais surtout contre Feuerbach et
les socialistes vrais.
En mars 1846, ils écartent Weitling et diffusent la circulaire contre Kriege, prenant ainsi congé avec
toute expression religieuse de la revendication sociale.
C’est dans ce contexte1 et tout particulièrement au cœur même de leur polémique avec les
socialistes vrais, que vient se placer l’épisode de la lettre à Proudhon et que bientôt sera rédigé Misère
de la philosophie.
*
* *
Outre les arguments qui constituent le corps principal du procès, il faut tenir compte d’un éventail
d‘autres motifs d’irritation qui ne trouvent pas d’écho direct dans le livre de Marx mais qui ont joué
un rôle important dans le déclenchement de la riposte, au double sens de rapidité et de vivacité dans
la critique ciblée.
Quels autres motifs d’irritation ?
On peut en identifier au moins trois : 1. La charge de Proudhon contre les communistes, 2. Sa com-
plaisance à l’égard de Malthus, 3. Sa misogynie comme symptôme d’un socialisme à front étroit.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Pour plus de détails, nous renvoyons aux chapitres 1.1 et 1.2. de notre fascicule 3.

!
CaE, page 2/7
1. Proudhon « anti-communiste »
Les guillemets qui entourent le mot soulignent le caractère évidemment anachronique de cette qualifica-
tion si on la reçoit au sens qu’elle a pris au début du 20e siècle en référence avec le parti bolchevique tel
qu’il est issu du congrès de 1903 du POSDR2. En 1847, la signification du terme « communiste » demeu-
re, en effet, flottante et les communistes que vise Proudhon sont principalement, en France, les parti-
sans d’Etienne Cabet3.
Par ailleurs, Proudhon les critique au titre d’idéologues incapables de comprendre les mécanismes de
l’économie et de l’exploitation capitalistes. La dénonciation des expressions idéalistes du réformisme so-
cial est une constante de son œuvre, qu’il s’agisse du réformisme de type utopiste à proprement parler
(au sens des doctrines qui préconisent de bâtir à neuf, dans un cadre propre, phalanstère ou colonie,
des sociétés harmonieuses) ou qu’il s’agisse plus généralement de programmes de rénovation sociale
fondés sur des sentiments d’altruisme et d’amour de l’humanité. S’adressant à « ses amis communis-
tes », il écrit, aux pages 226-227 de Philosophie de la Misère :
« (qu’ils) me le pardonnent ! Je serais moins âpre à leurs idées, si je n'étais
invinciblement convaincu, dans ma raison et dans mon cœur, que la com-
munauté, le républicanisme, et toutes les utopies sociales, politiques et reli-
gieuses, qui dédaignent les faits et la critique, sont le plus grand obstacle
qu'ait présentement à vaincre le progrès. (…) L’égalité se produit entre les
hommes par la rigoureuse et inflexible loi du travail, par la proportionnalité
des valeurs, la sincérité des échanges et l'équivalence des fonctions ; en un
mot, par la solution mathématique de tous les antagonismes. Voilà pourquoi
la charité, première vertu du chrétien, légitime espoir du socialiste, but de
tous les efforts de l'économiste, est un vice social dès qu'on en fait un prin-
cipe de constitution et une loi (…) Au lieu de chercher la justice dans le rap-
port des faits, (les communistes) la prennent dans leur sensibilité; appelant
justice tout ce qui leur paraît être amour du prochain, et confondant sans
cesse les choses de la raison avec celles du sentiment4. »
Sous cet angle, donc, Proudhon ne peut que rencontrer l’assentiment de Marx mais assurément rien que
sous cet angle car s‘il ne cesse d’affirmer l’exigence d’emprunter les chemins de la science5, sa pratique
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Autrement dit le Parti Ouvrier Social Démocrate de Russie. A propos de l’appellation bolchévique, Léni-
ne précise : « Ce nom n’exprime absolument rien, sinon ce fait purement accidentel qu’au congrès de
Bruxelles/Londres en 1903, nous eûmes la majorité. » (Lénine, « L’Etat et la révolution », Œuvres com-
plètes, Tome 25, page 492)
3 On les nomme les Icariens, en référence à l’ouvrage principal de Cabet Voyage en Icarie où se trouve
décrite une cité idéale régie selon des principes de communisme. On trouve un témoignage de
l’efficacité de leur organisation militante dans le livre de souvenirs d’Alfred Darimon, A travers une
Révolution. Evoquant la campagne électorale pour le scrutin du 17.09.1848, Darimon écrit :
« Heureusement, le Comité dispose d’un groupe qui est organisé de longue date et qui exerce une
grande action sur les masses ouvrières. C’est le groupe des Icariens que l’adoption du nom de Cabet a
intéressé au succès de la liste. Actifs et disciplinés, ils se livrent à une propagande qui prend toutes les
formes : appositon d’affiches, distribution de bulletins de vote, visites dans les ateliers, stations chez les
marchands de vin, etc. ». (page 65 dans l’édition E. Dentu, Paris 1834)
4 Le titre complet de l’ouvrage de Proudhon est Système des Contradictions économiques ou Philosophie
de la Misère. Nous le désignerons le plus souvent par son sous-titre. Notre pagination renvoie à l’édition
du groupe Fresnes Antony en trois tomes, Paris 1983
5 On le crédite d’avoir « inventé » l’appellation de « socialisme scientifique », qu’il utilise dans son pre-
mier Mémoire de 1840 sur la propriété : « Ainsi, dans une société donnée, l'autorité de l'homme sur
l'homme est en raison inverse du développement intellectuel auquel cette société est parvenue, et la du-
rée probable de cette autorité peut être calculée sur le désir plus ou moins général d'un gouvernement
vrai, c'est-à-dire d'un gouvernement selon la science. Et de même que le droit de la force et le droit de
la ruse se restreignent devant la détermination de plus en plus large de la justice, et doivent finir par
s'éteindre dans l'égalité, de même la souveraineté de la volonté cède devant la souveraineté de la rai-
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
1
/
214
100%