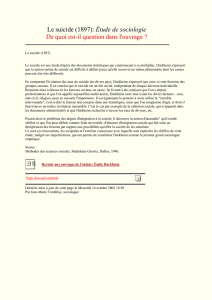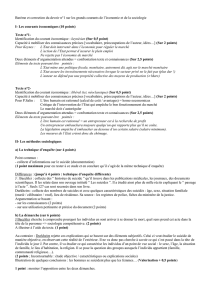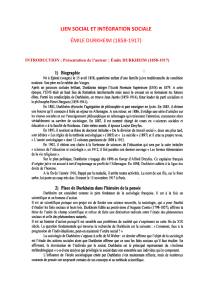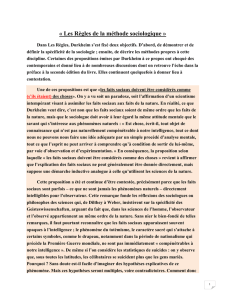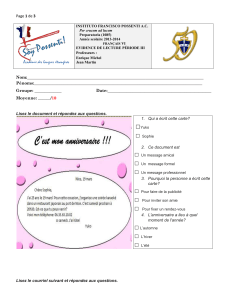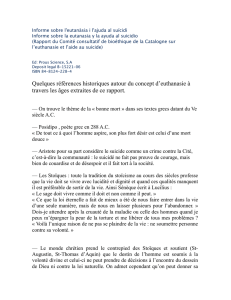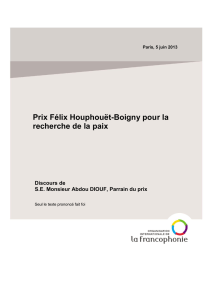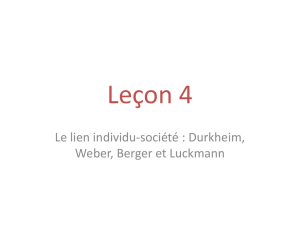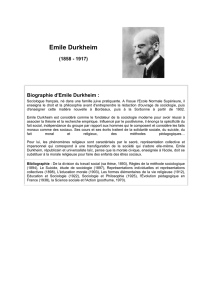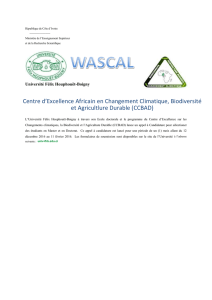Lien de Téléchargement


BEGENAT-NEUSCHÄFER, Anne, Professeur des Universités, Université d'Aix-la-chapelle
BLÉDÉ, Logbo, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny.
BOA, Thiémélé L. Ramsès, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny
BOHUI, Djédjé Hilaire, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny
DJIMAN, Kasimi, Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny
KONÉ, Amadou, Professeur des Universités, Georgetown University, Washington DC
MADÉBÉ, Georice Berthin, Professeur de Universités, CENAREST-IRSH/Université Omar Bongo
SISSAO, Alain Joseph, Professeur des Universités, INSS/CNRST, Ouagadougou
TRAORÉ, François Bruno, Professeur des Universités, Université Félix Houphouët Boigny
VION-DURY, Juliette, Professeur des Universités, Université Paris XIII
VOISIN, Patrick, Professeur de chaire supérieure en hypokhâgne et khâgne A/L ULM, Pau (64)
WESTPHAL, Bertrand, Professeur des Universités, Université de Limoges
Publication / DIANDUÉ Bi Kacou Parfait,
Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan
Rédaction / KONANDRI Affoué Virgine,
Maître de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan
Production / SYLLA Abdoulaye,
Maître-Assitant, Université Félix Houphouët Boigny, de Cocody-Abidjan

(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
INSAAC
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-
Abidjan)
(Université Alassane Ouattara de Bouaké)
(Université Omar Bongo)

(Université de Korhogo)
(Université Félix Houphouët Boigny-
Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)
(Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan)

LE SOCIOTOPE DU SUICIDE : LE SPLEEN COMME IDEAL
Abdoulaye Sylla
Maître-Assistant, Université FHB de Cocody
INTRODUCTION
« On appelle suicide tout cas de mort qui résulte directement ou
indirectement d'un acte positif ou négatif, accompli par la victime elle-même
et qu'elle savait devoir produire ce résultat. »1 L’acte qu’il définit ainsi
interpelle le père de la sociologie Émile Durkheim par sa constance dans les
sociétés européennes, comme marque de « l’humeur des peuples ». Il lui
consacre un livre. Son geste croise celui du poète Charles Baudelaire qui
dans un poème des Fleurs du Mal allégorise le spleen comme ce roi sans
divertissement, encombré de sa vie et n’aspirant qu’à la délivrance procurée
par Hadès. Pourquoi des gens qui ont tout, et plus encore, mettent, avec
une facilité stupéfiante, volontairement fin à leur vie ? Un imaginaire se fait
jour ici, qui distinguent une vision du monde. Face à la vie et la mort, les
conduites actuelles des Européens ne datent pas d’aujourd’hui. Ce sont des
fossiles de mœurs hérités de l’histoire. Le suicide n’étant qu’une modalité de
ces conduites. Dire qu’il est un phénomène social revient à faire comprendre
qu’il est le produit de représentations collectives. En accord avec Christoph
Wulf, notre position est que « [d]ans la mesure où le sens symbolique des
actes sociaux est acquis en même temps que leurs formes concrètes, le corps
et la culture, la nature et l’histoire sont étroitement associés dès la petite
1 E. Durkheim, Le suicide. Étude de sociologie, Paris, Alcan, 1897, Livre I, p.5. Souligné dans le texte.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%