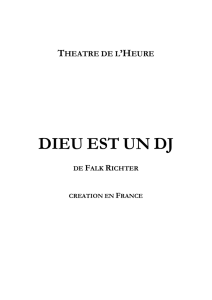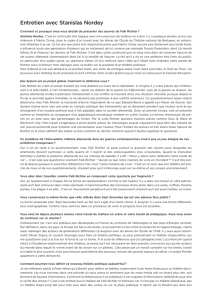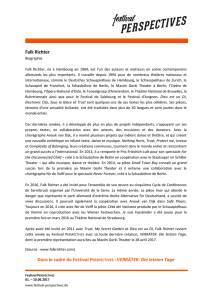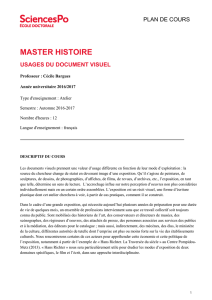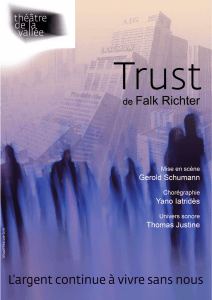dossier - Le Monfort

NOBODY
Cyril Teste
théâtre & performance filmique
Du 3 au 21 novembre 2015

Jean Personne est consultant en restructuration d’entreprise.
Intelligence, charisme et assurance de mise. Soumis aux lois du
benchmarking, lui et ses collègues notent, évaluent, évincent à
l’autre bout du monde comme de l’autre côté du couloir. A viser
l’efficacité et la concurrence, on oublie l’affect et on altère la
confiance. Héros cynique d’un jeu dont il n’a pas le contrôle, à la
fois acteur de l’éviction des autres et de sa déchéance, Jean perd
pied et s’enfonce dans une torpeur, monde flottant où se déversent
ses peurs et les réminiscences de sa vie privée .Entre
documentaire et fiction, Nobody incise en tension, avec humour et
lucidité, la violence sourde d’un système qui infiltre nos structures
intimes.
Un écran, un espace clos, des acteurs. Mise en abyme d’une
société peut être amené à surveiller l’autre, la caméra redouble le
jeu et le sens, révèle les rouages d’une mécanique implacable.
Nobody est une performance filmique : immergé dans un dispositif
cinématographique en temps réel et à vue, le spectateur complice
de la création assiste simultanément à la projection du film et à sa
fabrication. Un instantané en cohérence avec les préoccupations
du collectif MxM : la fictionnalisation du réel, la déperdition de soi,
l’influence des puissances économiques et médiatiques sur nos
modes de vies.
Du plateau à l’écran en front de scène, les différentes temporalités
coïncident et mettent en perspective la réalité. Un temps au sein
duquel s’entrechoquent de réalisme du plateau et l’image filmique.
A travers cette dernière, s’observe la tension d’écoute entre les
acteurs et le public. Dans une scénographie essentielle les
cadreurs opèrent, munis de caméras HF développées
spécialement pour servir la netteté du cadre, le rythme et la
réactivité du récit.

Distribution
Avec Elsa Agnès, fanny Arnulf, Victor Assié, Laurie Barthélémy,
Pauline Collin, Florent Dupuis, Katia Ferreira, Mathias Labelle,
Quentin Ménard, Sylvère Santin, Morgan Llyod Sicard, Camille
Sulerin, Vincent Steinebach, Rébecca Truffot
Metteur en scène Cyril teste / Assistante à la mise en scène
Marion Pelissier / Dramaturgie Anne Monfort / Chef opérateur
Nicolas Doremus / Scénographie Julien Boizard et Cyril Teste /
Musique originale Nihil Bordures / Cadreur Christophe Gaultier /
Régies générales, lumière et plateau Guillaume Allory, Simon
André et Julien Boizard (en alternance / Régie son Thibault Lamy /
Interprétation live Nihil Bordures et Thibault Lamy (en alternance)
/ Montage en direct Mehdi Toutain-Lopez / Construction Ateliers
du Théâtre du Nord et Side Up Concept / Administration et
production Anaïs Cartier / Chargée de production pour le
Fresnoy Barbara Merlier / Diffusion et production Florence
Bourgeon

NOTE D’INTENTION de CYRIL TESTE
« Images et sons comme des gens qui font connaissance en route
et ne peuvent plus se séparer » Rober Bresson
Avec la performance filmique, nous projetons sur le plateau
l’écriture d’un cinéma éphémère, qui n’existe que dans le présent
du théâtre. Les recherches que nous menons depuis 2000 sur la
grammaire commune du théâtre et de l’image amènent aujourd’hui
à une convergence du processus, de la forme et du sujet, en
rupture avec l’esthétique de nos projets antérieurs. La performance
filmique repose sur une charte ouverte qui définit en sept points
son territoire de création. Filmer, monter, étalonner, diffuser l’image
en direct : cette nouvelle écriture scénique et
cinématographique est un nouvel enjeu artistique et
technique.
A la suite des performances filmiques - laboratoires réalisés en
décor naturel, Patio d’après On n’est pas là pour disparaitre de
Olivia Rosenthal en 2011 et Park de Cyril Teste en 2012 – Nobody
– créée en 2013 dans les bureaux du Printemps des Comédiens à
Montpellier – en signe véritablement l’acte de naissance. La
recréation en 2015 au plateau lors du Printemps des Comédiens
impulse un autre sens au concept et prolonge ce qui s’élaborait
déjà pendant la création d’Electronic City en 2007 : la
confrontation des temporalités théâtrales et
cinématographiques, l’écriture d’histoires parallèles entre ce
qui se déroule dans le film et ce qui se passe sur scène,
l’enrichissement du sens par la multiplication des points de
vue.
CHARTE DE LA PERFORMANCE FILMIQUE
« Pour un acteur, la caméra est l’œil du spectateur » Robert
Bresson
Tel le dogme95 qui s’était donné une série de règles pour établir
une charte de cinéma, nous écrivons au fil de nos laboratoires une
charte de création qui consiste à identifier ce qu’est la performance
filmique :
1- La performance filmique est une forme théâtrale,
performative et cinématographique
2- La performance filmique doit être tournée, montée et
réalisée en temps réel sous les yeux du public
3- La musique et le son doivent être mixés en temps réel
4- La performance filmique peut se tourner en décors naturels
ou sur un plateau de théâtre, de tournage

5- La performance filmique doit être issue d’un texte théâtral
ou d’une adaptation libre d’un texte théâtral
6- Les images préenregistrées ne doivent dépasser 5 minutes
et sont uniquement utilisées pour des raisons pratiques à la
performance filmique
7- Le temps du film correspond au temps du tournage
COLLECTIF MxM / CYRIL TESTE
Le collectif MxM saisit le temps à vif. Autour des écritures
théâtrales d’aujourd’hui, il invente une langue vivante, une poétique
sensible qui place l’acteur au cœur d’un dispositif mêlant image,
son, lumière et nouvelles technologies. Cette partition de l’ici et
maintenant donne à voir la fabrique de l’illusion et aiguise nos
perceptions. Comment le système dans lequel nous vivons
structure t-il nos relations ? Comment les gouvernances
médiatiques ou économiques influencent-elles nos émotions ? avec
les auteurs vivants, MxM fait parler le monde du travail, la famille et
ses secrets, questionnant le politique par l’intime. Des récits,
contes ou fantasmagories qui appellent l’imaginaire de l’adulte, de
l’adolescent et de l’enfant.
Impulsé en 2000 par le metteur en scène Cyril Teste, le créateur
lumière Julien Boizard et le compositeur Nihil Bordures, le collectif
se constitue en noyau modulable d’artistes et techniciens, réunis
par un même désir de rechercher, créer et transmettre ensemble ;
de questionner l’individu simultanément en tant que spectateur du
réel, de la représentation et de la fiction. Une quinzaine de
créations, satellites (pièces sonores, installations, court-
métrages...) et le laboratoire nomade d’arts scéniques (réseau de
transmission transdisciplinaire) forment une constellation créative
dont l’expansion porte le nom de performance filmique.
Noyau du collectif : Julien Boizard (créateur lumière & régisseur
général) / Nihil Bordures (compositeur) / Florence Bourgeon
(production & diffusion) / Anaïs Cartier (administration &
production) / Nicolas Doremus (chef opérateur & régisseur vidéo)
/Patrick Laffont (vidéaste) / Cyril teste (directeur artistique &
metteur en scène) / Mehdi Toutain-Lopez (vidéaste) / et les
comédiens, techniciens, dramaturges, professionnels qui gravitent
avec et autour…
Le collectif MxM est artiste associé à Lux, Scène Nationale de
Valence, au Canal, Théâtre Intercommunal du Pays de Redon, et
au CENTQUATRE-Paris, en résidence et soutenu par la Direction
Régionale des affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la
culture et de la communication et la Région Ile-de-France.
www.collectifmxm.com
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%