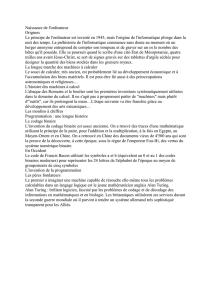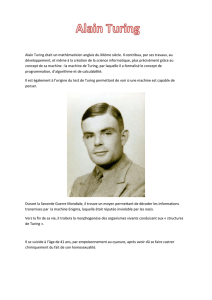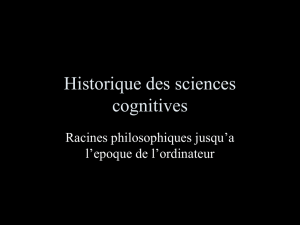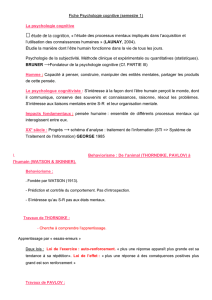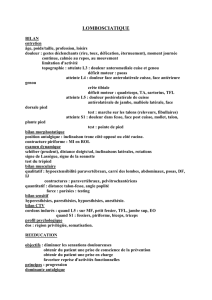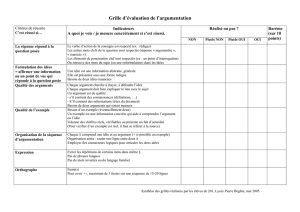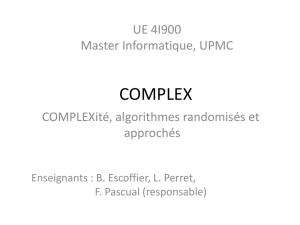questions de logique - E_Studium Thomas d`Aquin

E_STUDIUM THOMAS D’AQUIN
GILLES PLANTE
QUESTIONS DE LOGIQUE

ILLUSTRATIONS
JEAN LASSÈGUE
ET «L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE»
© Gilles Plante
Beauport, 8 mars 2004

UNE SAGESSE SPÉCIEUSE
Jean Lassègue est membre d’un groupe de recherche réuni au sein du laboratoire
LaTTICe (CNRS), qui gravite autour du département d'Études cognitives à l'École Normale
Supérieure. Ce groupe rassemble des linguistes et des mathématiciens-informaticiens.
La contribution de Jean Lassègue, à titre de philosophe, est épistémologique. C’est ainsi
que, dans «L'intelligence artificielle : pensée et calcul»,1 il «[tente] de décrire d'un point de
vue philosophique ce que l'on a coutume d'appeler depuis une quarantaine d'années
"l'intelligence artificielle"», une «discipline relativement nouvelle (...) [qui] vise à étudier
objectivement l'activité de pensée en tant qu'elle manifeste de l'intelligence».
«L'appellation même d'“intelligence artificielle” (...) a beaucoup fait pour la discréditer»,
note Jean Lassègue, et «les rodomontades d'un certain nombre de ses thuriféraires n'ont
rien fait pour arranger la situation». «N'oublions pas en effet que ce que le français
appelle le "renseignement" se dit en anglais "intelligence" : il y a très certainement cette
connotation dans l'expression d'intelligence artificielle», ajoute Jean Lassègue, dont la
thèse porta sur les travaux d’Alan Turing : «L'intelligence artificielle et la question du
continu ; remarques sur le modèle de Turing».
Alan Turing est un mathématicien qui contribua à la Bataille de l’Atlantique, à Bletchley
Park, où il s’employa à «décrypter les messages codés envoyés de Berlin à tous les
sous-marins allemands envoyés en patrouille dans l'Atlantique pour faire le blocus de
l'Angleterre», écrit Jean Lassègue.
Dès la déclaration de la guerre à l’Allemagne par le Royaume-Uni, l’amiral Karl Doenitz
mit en œuvre sa tactique de la Meute de loup, conçue pour s’attaquer aux navires
marchands naviguant en convoi protégé. Il disposait ses sous-marins en ligne
d’observation dans l’Atlantique. Dès qu’un sous-marin repérait un convoi, il en rapportait
la position et la route à son quartier général, par radio. Le quartier général ameutait alors
tous les sous-marins disponibles et les dirigeait vers un point de rassemblement d’où ils
pouvaient se jeter en meute sur le convoi, dans une action coordonnée.
Les communications entre les sous-marins et le quartier général se faisaient par
messages codées grâce à Enigma, une machine d’encryptage réputée inviolable. Alan
Turing s’y attaqua en participant à la création d’une machine de décryptage de ces
messages. Il devenait alors possible de déjouer la Meute de loup en détournant les
convois de la route où ils étaient attendus.
Alan Turing «interprète immédiatement [la naissance de l’ordinateur] comme un moyen
d'investigation de l'intelligence, autrement dit comme le premier modèle scientifique
d'investigation du fonctionnement de l'esprit», écrit Jean Lassègue. Après la guerre, en
1950, Alan Turing publia Computing Machinery and Intelligence,2 un article qui commence
comme suit : «I propose to consider the question, "Can machines think?"».
Selon Jean Lassègue, «l'aspect automatisé, et partant mécanique, du décryptage a pris
de plus en plus d'importance (...). [Car] réussir à décoder pour un temps les messages
1 On peut s’en procurer le texte à : www.ltm.ens.fr/chercheurs/lassegue/ exposes/academie.pdf
2 A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. Mind 49 : 433-460.
1

radio de la Kriegsmarine, c'est connaître la position de l'ennemi, c'est-à-dire pénétrer
dans l'état de son esprit à un moment donné (...). C'est cette leçon que Turing n'oubliera
pas dès 1945 au moment où l'électronique (...) rend possible concrètement la réalisation
de ce qui, en 1936, n'était qu'une idéalité, celle de la machine de Turing». Jean Lassègue
réfère ici à ce qu’il est convenu d’appeler les «fonctions calculables au sens de Turing».3
Dans «L'intelligence artificielle : pensée et calcul», Jean Lassègue propose «de
s'affranchir de l'attitude naturelle de rejet qui entoure encore l'appellation d'intelligence
artificielle», afin de «[l’]envisager (...) comme un projet scientifique et technologique
exigeant, comme tous les autres, une critique épistémologique».
À ce propos, Jean Lassègue soulève la question suivante : «S'agit-il d'une science à part
entière, d'une technologie liée à l'invention de l'ordinateur ou ne serait-elle pas plutôt
devenue, au cours de sa brève histoire, ce que l'on appelle aujourd'hui une “techno-
science” ?» Et, dans sa conclusion, il dit qu’elle est «devenue (...) une “techno-science”» :
[L'intelligence artificielle] (...) vise d'abord à comprendre un certain nombre de
phénomènes, à tester des hypothèses et à faire des expériences par le biais de
simulations informatiques. Or l'appréciation de la justesse d'une simulation est très
subjective et c'est pourquoi l'intelligence artificielle est loin de prétendre à la même rigueur
que les mathématiques ou la physique. L'intelligence artificielle, comme son histoire l'a
amplement montré depuis sa naissance, fait plutôt partie de ce que l'on a coutume
d'appeler la "techno-science", c'est-à-dire ce passage obligé où la science mesure ces
impacts technologiques à l'aune des impératifs sociaux.
Comme «premier trait distinctif» de «l’intelligence artificielle», prise comme «projet
scientifique et technologique», Jean Lassègue retient, «dans une première
approximation, que l'ambition de l'intelligence artificielle consiste à vouloir préciser de
façon objective et scientifique la vieille image platonicienne du colombier», que Platon
emploie «dans le Théètète» (197 a-b). Et «pour justifier ce premier trait distinctif et le
développer», il s’engage dans une «argumentation [à] deux volets, le premier
épistémologique et le second historique». Nous nous intéressons au «premier».
«[L’]argumentation» que Jean Lassègue propose au sujet du «volet (...) épistémologique»
est tributaire de ses «options philosophiques» qu’il «résume (...) aux deux points
suivants» :
Il n'y a pas de domaine théorique commun à la philosophie et à la science. Le domaine du
théorique relève exclusivement du domaine de la science tandis que la philosophie couvre
entièrement le domaine du théorétique. Le théorétique est une approche réflexive dans le
domaine du concept : c'est un point de vue qui ne cherche pas à constituer sur le mode de
l'objectivité scientifique un rapport à l'objet mais sur le mode de la mise au jour de ses
conditions de possibilité. La distinction entre théorique et théorétique n'est pas spécieuse ;
elle a été pensée sous de multiples formes au cours de l'histoire de la philosophie depuis
Platon ; elle n'implique pas que l'esprit de quiconque en particulier soit intégralement et
continûment rangé dans l'une ou l'autre catégorie : le théorétique ne manque pas au
scientifique même s'il n'apparaît pas directement dans ses travaux, ni le théorique au
philosophe, même s'il ne cherche pas de contact privilégié avec la science, car il hérite d'un
contexte culturel qui lui en fournit toujours un certain état. Une épistémologie qui veut tirer
parti de l'inspiration mutuelle, toujours possible, entre la philosophie et la science implique
3 Stephen C. Kleene, Logique mathématique, traduction de Jean Largeault, Paris, 1971, Librairie Armand Colin,
p. 240 2

de se placer non pas seulement du point de vue des acteurs mais du point de vue des
parcours interprétatifs qu'ils engendrent presque malgré eux.4
S’il «n'y a pas de domaine théorique commun à la philosophie et à la science», explique
Jean Lassègue, c’est que «le domaine du théorique relève exclusivement du domaine de
la science tandis que la philosophie couvre entièrement le domaine du théorétique».
Évidemment, si «le domaine du théorique relève exclusivement du domaine de la
science», il est nécessaire qu’il «n’y [ait] pas de domaine théorique commun à la
philosophie et à la science». Même si cette division en deux «catégories» «n'implique pas
que l'esprit de quiconque en particulier soit intégralement et continûment rangé dans l'une
ou l'autre catégorie», il demeure que le «domaine» de la philosophie, comme
«catégorie», n’est en rien «théorique», puisque «le domaine du théorique relève
exclusivement du domaine de la science».
Le «domaine» de la philosophie, comme «catégorie», c’est le «théorétique».
Évidemment, rien n’empêche «l'esprit de quiconque en particulier», s’il est «scientifique»,
d’explorer l’autre «catégorie». De même en est-il pour «l'esprit de quiconque en
particulier» qui est un «philosophe». Par contre, au plan des «catégories», si «la
philosophie couvre entièrement le domaine du théorétique», le «domaine du théorique
[qui] relève exclusivement du domaine de la science» n’est en rien «théorétique». Si,
comme le dit, Jean Lassègue, «la distinction entre théorique et théorétique n'est pas
spécieuse», c’est que, au plan des «catégories», le «théorique» et le «théorétique» se
divisent l’un de l’autre.
Or, Jean Lassègue ajoute : «Une épistémologie qui veut tirer parti de l'inspiration
mutuelle, toujours possible, entre la philosophie et la science implique de se placer non
pas seulement du point de vue des acteurs mais du point de vue des parcours
interprétatifs qu'ils engendrent presque malgré eux». Ce plan «des acteurs» concerne
«l'esprit de quiconque en particulier».
On peut bien admettre que «des acteurs» agissant dans leur «domaine» prennent le
«point de vue des parcours interprétatifs qu'ils engendrent presque malgré eux». On peut
encore admettre que «le théorétique ne manque pas au scientifique même s'il n'apparaît
pas directement dans ses travaux, ni le théorique au philosophe, même s'il ne cherche
pas de contact privilégié avec la science, car il hérite d'un contexte culturel qui lui en fournit
toujours un certain état».
Ce «contexte culturel» évoque manifestement l’épistémè du «contexte philosophique
dominé (...) par ce qu'il est convenu d'appeler la “Pensée française postmoderne”»,
notamment avec Michel Foucault. Mais cet épistémè ne doit pas être confondu avec
l’analutikê epistêmê d’Aristote qui, lui, s’intéresse à la division en «catégorie» de deux
«domaines» : le «domaine du théorique» et le «domaine du théorétique».
Au plan de cette division, comment est-il «toujours possible» de «tirer parti de l'inspiration
mutuelle (...) entre la philosophie et la science» ? Que ce soit «toujours possible» pour
les «acteurs», ou à «l'esprit de quiconque en particulier [de ne pas être] intégralement et
continûment rangé dans l'une ou l'autre catégorie», on peut bien l’admettre. Mais il en va
4 http://lattice.linguist.jussieu.fr/article.php3?id_article=123
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%