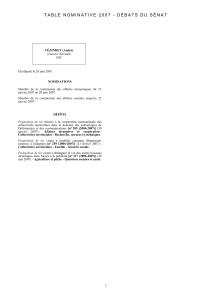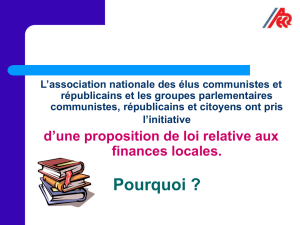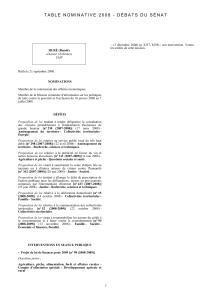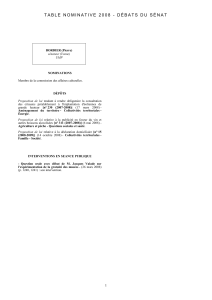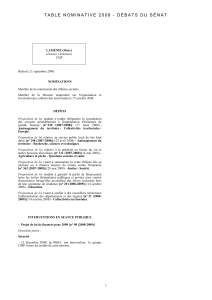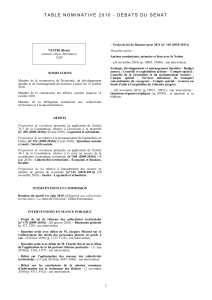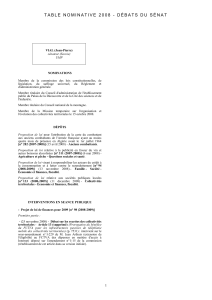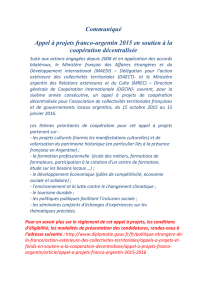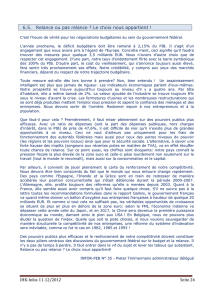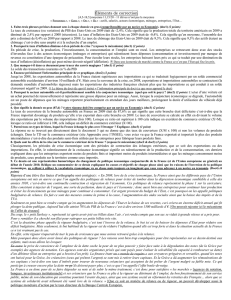l`investissement public - Conseil Général de la Nièvre

w
w
w
.
c
g
5
8
.
f
r
-
w
w
w
.
c
g
5
8
.
e
u
10 avril 2012
Synthèse documentaire
de l’investissement
de l’économie locale
de l’investissement
de l’économie locale
Session spéciale

L’enjeu de l’investissement public dans le développement de l’économie locale
INTRODUCTION......................................................................................................................2
I L’INVESTISSEMENT PUBLIC MOTEUR DE L’ECONOMIE DES TERRITOIRES..4
A) Qu’est ce que l’investissement public ?............................................................................4
B) Un impact sur l’économie productive et sur l’économie résidentielle…..........................6
C) L’exemple du BTP............................................................................................................9
II L’ACTION DETERMINANTE DES COLLECTIVITES LOCALES ...........................11
A) La spécificité de l’investissement en France...................................................................11
B) Les schémas de financement de l’investissement ...........................................................13
C) Les évolutions récentes ...................................................................................................14
III Les INVESTISSEMENTS PUBLICS FACE A LA crise : UN DEBAT DE MODELES
ECONOMIQUES.....................................................................................................................16
A) Entre deux voies : relance ou rigueur..............................................................................16
B) Entre deux leviers : emprunt ou fiscalité........................................................................20
C) Le mirage du partenariat public privé (PPP)...................................................................25
IV LA FORCE DE L’ENGAGEMENT LOCAL................................................................28
A) Une stratégie de territoire qui refuse le renoncement .....................................................28
B) La lourde responsabilité de prioriser les investissements ............................................... 28
C) Un nouveau pacte entre les acteurs .................................................................................29
OUVRAGES CONSULTES....................................................................................................31
Les numéros signalés entre crochets dans le texte renvoient à la bibliographie p.31 (extraits
d’auteurs)
1

L’enjeu de l’investissement public dans le développement de l’économie locale
INTRODUCTION
L’investissement constitue une variable-clé pour apprécier la vitalité d’une économie et, au-
delà, d’une société toute entière. Son dynamisme est souvent considéré comme un signe de
bonne santé, comme un révélateur très significatif de la confiance d’une collectivité en
l’avenir et de sa capacité d’innovation.
Dans notre pays, l’investissement relève bien entendu pour une large part des entreprises
privées et des ménages, ces derniers essentiellement pour leur logement. Mais il est aussi
le fait des acteurs publics dont les investissements contribuent à la poursuite de trois
objectifs essentiels :
• promouvoir la cohésion sociale et le bien-être de la population, assurer la solidarité et
garantir la sécurité collective ;
• assurer une croissance soutenue, durable et équilibrée, s’appuyant sur un haut
niveau d’emploi de qualité et le favorisant ;
• réguler les fluctuations conjoncturelles par des actions contra cycliques.
L’opportunité d’une relance de l’investissement public en France apparaît comme une
question largement récurrente : elle est posée chaque fois que la marche de l’économie est
jugée trop modérée ou lorsque survient un choc récessif ; elle est aussi très souvent
d’actualité lorsqu’il s’agit de mieux répondre aux exigences de la compétition internationale
et d’améliorer l’attractivité du territoire ; elle est enfin fréquemment sur le devant de la scène
lorsque des besoins sociaux pressants s’expriment, que des incidents aux conséquences
parfois dramatiques surviennent en matière de sécurité collective ou qu’il faille faire face à
des catastrophes naturelles.
Tel est le cas aujourd’hui encore dans ces différents aspects, alors même que, depuis le
début des années 1990, l'investissement public connaît un certain affaiblissement
principalement lié à des préoccupations financières dans un contexte national, européen et
international tendant à privilégier les mécanismes de marché et les horizons de court
terme…
Dans un contexte désormais marqué par l’ouverture croissante des économies,
l’intensification de la concurrence, l’accélération des innovations technologiques et la montée
des exigences de transparence et d’efficacité, de nombreuses interrogations concernent les
conditions dans lesquelles doivent être décidés, financés, réalisés et gérés de tels
investissements pour qu’ils permettent d’atteindre, dans les meilleures conditions, les
objectifs qui leur sont assignés.
[5]
L’ensemble du territoire national est aujourd’hui soumis à l’impact d'une crise financière,
économique et sociale ayant engendré concomitamment une crise des finances publiques.
Les conséquences sont nombreuses pour les territoires : objectif de réduction des déficits
publics, gel des concours de l’Etat aux collectivités, crise du financement bancaire, réduction
de la solvabilité de la population liée à sa précarisation.
Les budgets locaux sont particulièrement contraints car se conjuguent une situation déjà
initialement tendue et des évolutions défavorables. Or c’est pourtant justement dans ce
contexte que l’action des collectivités territoriales est cruciale : elle doit permettre de lutter
contre une aggravation de la fracture territoriale déjà perceptible entre régions dynamiques
(territoires littoraux, urbains, …) et territoires ruraux. Face à une répartition toujours plus
inégale des ressources, il est capital pour les collectivités de maintenir une capacité
2

L’enjeu de l’investissement public dans le développement de l’économie locale
d’intervention leur permettant d’agir de façon contra cyclique pour financer rapidement et de
façon durable la relance de leur économie.
L’investissement se définit également comme l’ensemble des dépenses des collectivités qui
consistent à accroître la consistance de la valeur de leur patrimoine, de manière durable
(dépenses d’équipements, c'est-à-dire de travaux, achats de terrains et bâtiments,
acquisition de matériels durables, mais aussi de manière indirecte, les participations au
financement des investissements d’entités extérieures qui assument des missions d’intérêt
locales, ainsi que les remboursements de dette puisqu’ils réduisent le passif en augmentant
les actifs nets1).
Les dépenses d'investissement comprennent à la fois :
- les remboursements d'emprunts ;
- les prêts et avances accordés par la collectivité ;
- les dépenses directes d'investissement (acquisitions mobilières et immobilières, travaux
neufs, grosses réparations) ;
- les subventions d'équipements versées.
[18]
L’investissement public local, par son importance et les enjeux auxquels il doit répondre,
place les décideurs publics face à la nécessité de réfléchir à la performance de leurs
interventions.
La difficulté est de faire en sorte que les investissements répondent bien aux attentes de
l’ensemble des acteurs du territoire, temporellement et spatialement. Ces attentes sont
réputées de plus en plus exigeantes, parce que les bénéficiaires des investissements sont
nombreux, et revêtent des exigences de plusieurs natures.
Les usagers des services et équipements publics attendent de ceux-ci qu’ils soient de
qualité, qu’ils soient aptes à répondre à leurs besoins.
Les élus doivent sans cesse arbitrer, opérer des choix, les recettes n’étant pas élastiques et
le financement par l’emprunt présentant des limites sur lesquelles nous reviendrons. La
difficulté est alors de savoir sur quels critères faire ces choix, quel type de stratégie mettre
en œuvre ? La réflexion est d’autant plus importante qu’en matière d’investissement, les
décisions prises engagent la collectivité sur le moyen et le long terme et sont souvent
irréversibles. La recherche de performance de l’investissement est au centre de ces
préoccupations.
[13]
1 Définition comptable de l’investissement donnée par les instructions budgétaires et comptables des
collectivités territoriales. Une circulaire du 26 février 2002 dresse une liste non exhaustive des éléments
considérés comme de l’investissement
3

L’enjeu de l’investissement public dans le développement de l’économie locale
I L’INVESTISSEMENT PUBLIC MOTEUR DE L’ECONOMIE
DES TERRITOIRES
A) Qu’est ce que l’investissement public ?
Dans un rapport du Conseil économique et social datant de 2002 est rappelée la difficulté à
définir avec précision ce qu’est l’investissement public : « Il n’existe pas de clivage simple
entre investissement public et privé et donc pas de définition précise et communément
admise de la notion d’investissement public. Il n’est dès lors pas aisé de répondre à la
double question qui en dérive :
• qu’est-ce qui confère à telle ou telle dépense le caractère d’investissement ? En
matière de dépenses publiques, il s’agit d’une question difficile à trancher eu égard
au caractère divers de ces dépenses dont certaines portent leurs effets bien au-delà
d’un horizon de court terme, à l’image des dépenses d’éducation ou de recherche
développement;
• qu’est-ce qui confère à un investissement son caractère public ? Selon un point de
vue « organique », il s’agit d’un investissement réalisé par une entité publique ; selon
un point de vue « matériel », le fait d’être destiné à la réalisation d’une mission de
service public ou d’intérêt général fonde le caractère public de l’investissement. Mais
l’existence de délégations de service public à des entités publiques, privées ou
mixtes fait que ces deux dimensions ne sont pas superposables.
Ainsi, à défaut de pouvoir traiter de l’investissement public à partir d’une définition préalable
claire, l’examen de ses évolutions a été fondé sur le champ couvert par les informations de
la comptabilité nationale ».
[5]
Le terme « investissement public » fait généralement référence à une définition de nature
comptable et relève d’une approche basée plus sur la « nature de la dépense » que sur « la
fonction de la dépense ».
L’investissement public national, défini par l’Insee
Dans les comptes nationaux, l’investissement public a deux composantes : la formation brute
de capital fixe (FBCF) et les transferts versés :
- La « FCBF publique » est une mesure des flux financiers qui affectent l’actif des
administrations, hormis les amortissements des biens. Il s’agit donc d’un solde entre
des dépenses augmentant la valeur de cet actif (achat de terrains, de bâtiments,
construction de routes…) et des recettes qui proviennent de la diminution de cet actif
(cession de terrains, bâtiments…).
- Les « transferts versés » sont constitués d’aides à l’investissement d’autres tiers.
L’investissement public national des collectivités locales défini par la comptabilité
locale
La comptabilité des collectivités locales est légèrement différente puisque au sein des
dépenses d’investissement figurent :
- les remboursements de dette, flux qui affectent leur « compte financier » mais ne
touchent en rien leurs actifs ;
- les dépenses d’équipement, essentiellement constituées d’investissements dans les
bâtiments et travaux publics ;
- les achats de bâtiments ou de matériel ;
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%