Phil d`or n° 10 251111

« Les soirées Phil’d’or »
Dixième rencontre (25/11/2011) :
« Mots et notions.
Le beau »
L’intérêt de ces petits « bilans », à la suite de chaque rencontre, c’est que vous
puissiez, si vous le souhaitez, vous constituer un petit livret, rassemblant, au fil
des séances, nos réflexions partagées. Je vous invite en tout cas à vous constituer
une petite boîte à outils progressive (les outils de la pensée sont les concepts,
lesquels sont l’éclaircissement des notions) ; ils seront mis en évidence en bleu à
chaque fois. Vous ne retrouverez certes pas tout ce que nous avons « remué »
mais ce qui a fait le socle de nos réflexions.
*
L’occasion m’a été donnée de commencer par préciser, avec Bergson, que le
philosophe ne se soucie pas de définir des mots. Les mots trouvent leur
signification dans le dictionnaire dont on peut ne jamais sortir car il faut parfois
définir les mots mêmes de la définition définissant le mot de départ. Quant aux
dictionnaires de philosophie, ils sont presque une contradiction dans les termes
vu l’objectif de la philosophie. Cet objectif est de s’intéresser au réel. Et les
mots qui désignent le réel à interroger, précisément pour ne pas être pris pour de
simples mots dont il faudrait s’attacher à déterminer la signification, s’appellent
des notions. Eclairer une notion, c’est dégager le sens de la réalité interrogée ; en
d’autres termes, c’est élever la notion en concept. On devra dire alors que le
concept est le réel pensé.
La conséquence de cela, c’est qu’une même notion (désignée par un même
mot) ne conduit pas au même sens selon le cheminement de la pensée déployé
par tel ou tel philosophe. De sorte que de la même façon que l’on peut faire dire
beaucoup de choses à une citation sortie de son contexte, choses dont certaines
sont étrangères au sens que l’auteur déploie dans le corps global de son texte (ce
qui n’est pas le cas de l’aphorisme qui se suffit à lui seul), on peut bavarder
indéfiniment autour de mots tirés du corpus philosophique sans jamais aboutir à
quelque chose de bien consistant sur le fond.
C’est autour de la notion de beau que je vous ai proposé de réfléchir lors de
notre dernière séance. Qu’est-ce donc que le beau ? Nous l’avons vu, un critère
de l’art qui a été déterminant, notamment à la Renaissance (bien que, selon
Hegel, le beau ait été l’affaire avant tout de la sculpture grecque classique, après

l’art symbolique et avant l’art romantique - pour utiliser sa terminologie -). Ce
critère, nous y tenons car il renvoie à une expérience d’un genre particulier que
nous aimons faire en art ; l’art de chaque époque peut du coup proposer une telle
expérience (qui reste encore à déterminer), quand bien même, aujourd’hui, le
critère du beau n’est pas le plus déterminant (« Merde à la beauté ! » Dada). De
toute façon, la nature nous donnera toujours l’occasion de vivre cette expérience
que nous désignons par le beau.
Lorsque nous disons d’une chose, d’un visage… qu’ils sont beaux, nous sous-
entendons que le beau est quelque chose de la chose, du visage… ou dans la
chose, dans le visage... Le beau serait ainsi objectif, au même titre que la vérité
de 2+2 = 4 ou de n’importe quelle autre vérité scientifique. Pourtant, nous ne
pouvons pas nier que, bien souvent, ce que nous trouvons beau quant à nous ne
paraît pas tel à d’autres. Alors ? Objectif ou subjectif ? Que nous balancions
d’un côté ou de l’autre, nous ne sommes pas satisfaits : pas objectif puisqu’on ne
peut pas justifier (par démonstration ou preuve) qu’un objet est beau, mais pas
davantage subjectif car si tel était le cas, le mot n’aurait pas été inventé et l’on
ne s’exprimerait jamais, en matière de goût, qu’en termes de « ça me plaît ».
L’expérience du « ça me plaît », nous la connaissons. Et nous l’assumons
parfaitement comme une expérience strictement subjective : je dis « ça me
plaît » quand je sais très bien que ce que je ressens (un plaisir ou un déplaisir),
nul ne peut le ressentir exactement comme moi car il n’est pas moi (il n’a pas
ma sensibilité, mon histoire, etc.). Des goûts et des couleurs ? On ne discute
pas ! Car il n’y a sur le fond rien de plus à faire qu’à prendre acte des
différences : moi je préfère le salé et la couleur orange, toi tu préfères le sucré et
la couleur verte. Point.
A l’opposé, nous connaissons l’expérience de l’accord universel : chaque fois
que nous résolvons un problème mathématique, que nous accédons au savoir
d’une loi expérimentale, etc., nos raisons respectives se retrouvent effectivement
dans l’unité de l’accord.
L’expérience du beau est quant à elle d’un genre particulier car nous savons
bien qu’elle sollicite notre sensibilité (portée vers le « ça me plaît ») mais, aussi,
notre pensée (portée vers l’universel). Mais pour autant, notre sensibilité n’est
pas, là, dans son élan habituel qui est d’aller vers ce qui lui est agréable et de
fuir ce qui lui est désagréable : je ne salive pas devant la peinture d’une assiette
de pommes, pas plus que je ne souffre de frustration sexuelle devant celle d’un
nu ; je fuirais les violences de la guerre mais je peux rester devant le tableau
d’un combat, etc. Il en est de même pour ma pensée : elle est bien là, à se
déployer librement devant l’œuvre, mais elle n’a aucune opération à faire,
aucune dissertation à produire. Qu’est-ce que cela indique, si ce n’est que devant
un objet que j’ai plaisir à regarder ou écouter sans le besoin d‘aller jusqu’à la
consommation, je fais l’expérience d’un sentiment, sentiment qui est
l’expérience d’une réconciliation intérieure entre deux facultés qui,

généralement, sont sollicitées séparément ? Voici ainsi ce que je veux dire
quand je dis d’une chose qu’elle est belle : en fait, cette chose me donne
l’occasion d’éprouver un sentiment de satisfaction d’un genre particulier, celui
lié au libre jeu de mes facultés ici réconciliées (aucune ne prend le dessus sur
l’autre, ne fait « taire » l’autre). Et cette satisfaction éprouvée est d’un genre si
particulier que j’attends qu’elle soir partagée par d’autres. J’attends cela
vivement, c’est-à-dire que tandis que le fait que l’autre n’apprécie pas les mêmes
couleurs que moi m’indiffère, le fait qu’il boude ce que je trouve beau me
déconcerte !
Parlant du beau, Hegel parle également d’une réconciliation entre le corps et la
pensée, la matière et l’esprit : l’art qu’il dit symbolique, qui excella dans l’art de
l’Egypte archaïque, fut le moment de l’art où la pensée se heurtait encore à la
matière (Sphinx, Pyramide), tandis que l’art qu’il dit romantique, lequel se
déploya durant tout le Moyen-âge, fut le moment de l’art où la pensée exprimait
son sentiment d’être désormais à l’étroit dans la matière pour dire tout ce qu’elle
a à dire ; et l’art qu’il dit classique, quant lui, art qui exista entre les deux, fut le
moment par excellence de l’art, celui où la pensée se trouvait « chez elle » dans
une matière qu’elle réussissait à rendre « à son image ».
Ce que Hegel appelle l’art romantique correspond un peu à cette expérience
que Kant appelle l’expérience du sublime (qui n’est pas non plus l’exclusivité de
l’art puisque il y a des occasions d’éprouver le sentiment de sublime aussi dans
la nature). Le sublime renvoie au sentiment d’une déchirure intérieure
immédiatement surmontée : je dis sublime un objet, une scène, une musique…
qui me font sentir ma fragilité, ma petitesse, mais en même temps qui recèlent
l’occasion, pour moi, d’éprouver la fierté de la maîtrise humaine sur cela même
qui pourrait m’anéantir : dans la cathédrale gothique, je frémis devant la hauteur
des plafonds faits de pierres lourdes, mais je me « gonfle » devant tant de
prouesse architecturale !
N. Abécassis
1
/
3
100%


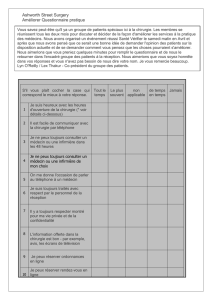

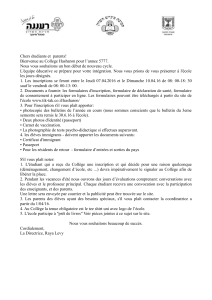
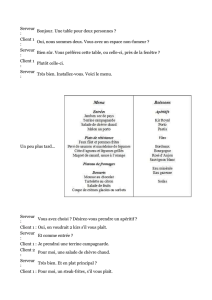

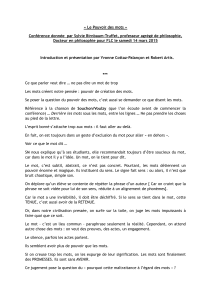
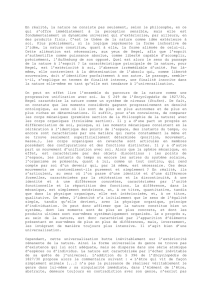

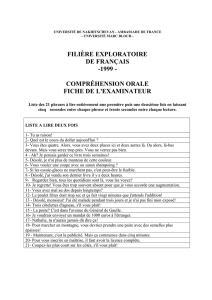
![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)