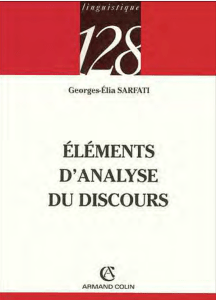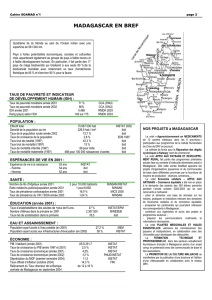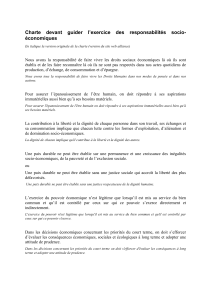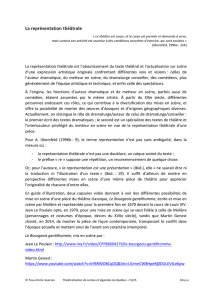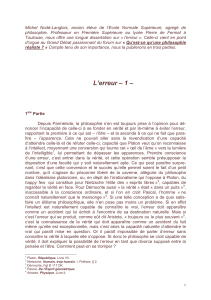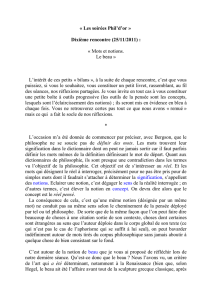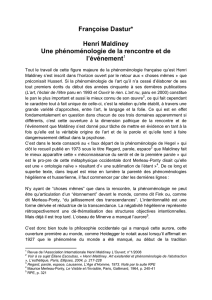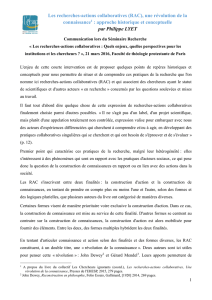Le sublime après kant

Le sublime va ensuite traverser l’esthétique, depuis le romantisme jusqu’au 20è siècle.
Si Kant ne parle que du sentiment de sublime « dans la nature » et non dans l’art, c’est déjà
Hegel qui va l’inclure dans l’esthétique artistique, notamment son Esthétique et la préface à la
phénoménologie de l’esprit. Pour Hegel, le sublime est abordé selon la dialectqiue de
l’exprimé et de la forme expressive, la forme se suspend totalement au profit d’une pleine
idée exprimée : « l’expression de l’idée se manifeste comme une suppression de
l’expression » est la sublime. Il y a une totale dissociation éprouvée entre le sentiment
océanique que fait ressentir le sublime, et la forme de l’oeuvre sublime qui détruit sa propre
forme, qui nous fait ressentir un au-delà de la forme.
C’est à la notion, de dissociation que fait appel Hegel. La conception latente est celle du
protestantisme ! 1) monde parfait ; 2 ; monde corrompu par l’homme ; 3) retrouver le monde
parfait des pures idées
La théorie est dialectique
Premièrement le sublime est une négation du monde réel (imparfait), il permet de se dissocier
(du moi imparfait). Il s’agit de se poser alors comme « un autre comme je ». Mais s’il permet
de se dissocier, du même coup il permet ensuite de dissocier cette dissociation et de revenir à
une nouvelle unité la moi se pose comme un autre, et supprime ensuite cette altérité pour se
reconstituer. L’esprit est « ce mouvement qui consiste à devenir lui-même un autre, c’est-à-
dire un objet de son soi-même, et à abolir cette altérité le non-découvert par l’expérience
s’étrange, puis, de cet étrangement, revient à soi-même »
Bref, il y a une résolution où cette unité, monde des pures idées chez Hegel, résout la
dissociation du sublime, comme le retour sur la pure raison dont parle Kant. On a les deux
temps liés au sublime : le négatif (dissociation) et le positif final.
C’est tout le sens de la téléologie hégélienne avec la célèbre « fin de l’art ». Dans l’évolution
s’il faut quitter le monde corrompu, ce sera la rôle des arts, et des arts du romantisme que
hegel place au faîte de son système. Ces arts servent la dissociation sublime, mais ensuite, ils
sont appelé à laisser la place à la philosophie, où l’homme va se réconcilier avec lui-même en
retrouvant les Idées pures… le sublime ne serait qu’une étape….
La perspective va changer avec Nietzsche. Si Nietzsche ne peut être situé dans une filiation
directe du kantisme, s’il reprend en fait le système de Schopenhauer qui distinguait le monde
matériel, représenté, de son essence énergétique, la « volonté », le personnage philosophie
principal de nietzsche n’en reste pas moins accordé au sublime. Ce personnage c’est
Dionysos, qui sera ensuite Zarathoustra, puis le « ça »…Notons que Nietzsche ne parle pas du
sublime, sauf dans une brève remarque à propos du grotesque. Mais Dionysos, c’est la
sublimité par excellence, puisque Dionysos est informe, illimité, et qu’il est le dieu de la
démesure.
C’est à la naissance de la tragédie qu’il faut remonter. La tragédie attique selon nietzche
mettait en scène une lice entre le monde formel, ordonné, stabilisé, et les passions. Le premier
est représenté par le symbolisme du dieu au regard scolaire, Apollon, dieu de la belle
apparence, de la forme fixe, de la proportion (l’aspect rationnel des paroles), tandis que les
secondes (le choeur, les musiciens) étaient incarnées par Dionysos. La tragédie se donnait
doublement : dans la déroulement horizontal de l’intrigue, mais aussi dans un constant conflit

vertical entre la rationalité des paroles et le choeur dionysiaque qui emportait les paroles dans
une transe ineffable et sublime, qui débordait toujours le système verbal.
Malheureusement, vint selon Nietzche Euripide, qui congédia la partie dionysiaque de la
tragédie, pour ne retenir que la partie apollinienne qui, privée de son altérité contradictoire,
s’ est desséchée, momifiée dans un schématique logique. Celui-ci correspond à ce que
Nietzsche nomme « l’optimisme socratique », où « tout pour être beau , doit être rationnel ».
Telle serait la grande catastrophe du monde qui va finir par courir à sa perte…
Ceci signifie qu’il faille réintroduire le dieu musicien et sublime, Dionysos, mais ceci ne
signifie pas qu’il faille éradiquer le baume salvateur d’Apollon. Ce qu’il faut c’est
réintroduire le conflit fondateur entre Dionysos et Apollon, et non résoudre le sublime
(dionysos)) par la raison (apollon). C’est ainsi un conflit permanent, nécessaire aux deux
parties adverses, que va introduire la pensée nietzchéen, un éternel combat entre l’effroi
sublime et les synthèses de la raison.
Cette tension permanente, va se retrouve chez deux philosophes du 20ème siècle, qui écrivent
l’un contre l‘autre, et qui, pourtant, me semblent se rejoindre.
Le premier est la philosophe Adorno.
L’une des grandes notions adorniennes est celle de la dialectique négative. A savoir que, à
l’inverse d’un moins et d’un moins du moins qui se résout en un plus, (hegel), il s’agit de
postuler une dialectique infinie, à tout jamais irrésolue, mais nécessaire à l’esprit critique.
Il faut nuancer la filiation kant/adormo, et, notamment à la suite de l’ouvrage la dialectique de
la raison, adorno rejette kant. En même temps, l’un des arguments du rejet adornien du
sublime kantien est précisément l’idée que le sublime est ensuite résolu par la raison. Il faut
au contraire, laisser l’opposition vive. De fait, selon adorno, l’expressivité de l’art « refuse
l’ultime réconciliation
1
». La pensée ne peut se mouvoir dans le clairement résolu, mais au
contraire ne peut être critique qu’en rejetant toute affirmation. Ce qui guide la pensée
adornienne, c’est l’opposition, héritant en large part du marxisme, de la domination et de
l’émancipation.
Ainsi, dans cette perspective, il est alors moins question d’un rejet du sublime, que de la
recherche d’une nouvelle forme prenant le relais d’un « sublime [qui] finit pas se changer en
son contraire
2
». Ainsi T. W. Adorno retrouve-t-il ce qu’E. Kant « eut raison de définir […]
par la résistance de l’esprit contre la surpuissance
3
», en l’adaptant alors à une dialectique
résolument négative. Celle-ci cherche à s’émanciper de toute résolution unitaire dans une
synthèse figée qui devient à terme un dogme normatif accaparé par la domination. Cette
nouvelle forme, où dans « les traits de la domination qui stigmatisent sa puissance et sa
grandeur, le sublime proteste contre la domination
4
», n’est autre que ce que T. W. Adorno
nomme le « contenu de vérité des œuvres d’art » : les « œuvres dans lesquelles la structure
esthétique se transcende sous la pression du contenu de vérité occupent la place que visait
autrefois le concept de sublime
5
».
1
Ibid., p. 71.
2
Ibid., p. 275.
3
Ibid., p. 276.
4
Ibid., p. 274.
5
Ibid., p. 273.

Quel est donc ce « contenu de vérité », nouvelle figure d’un sublime, et d’un sublime qui ne
pourrait être résolu par la raison ? Il s’agit de ce qu’Adorno nomme l’irréconcilié. Ce que
l’œuvre donne à éprouver est irréconcilié tant avec les possibilités de représentation sensible
et la forme donnée au matériau esthétique, qu’avec la réalité empirique elle-même. L’esprit
des œuvres s’expérimente « comme un non-représentable sensible, et leur matériau, ce à quoi
elles sont liées en dehors de leur limite, comme non-conciliable avec l’unité des œuvres
6
».
Le « contenu de vérité » est alors à chercher dans le surplus de sens ineffable que l’œuvre fait
ressentir, dans les « apparitions d’un autre
7
», dans l’épiphanie d’un insu, d’un inconnu.
« Dans toute œuvre authentique, apparaît quelque chose qui n’existe pas
8
».
D’une part, cette révélation d’une altérité, radicalement « irréconciliée » avec le monde et ce
que celui-ci a « déjà approuvé ou pré-formé
9
», a alors une force de contestation. L’art est
« antinomie de la réalité empirique qui s’oriente vers la négation déterminée de l’organisation
du monde existant
10
». Inconnu en soi, l’apparaissant que fait surgir l’œuvre n’a pas
d’équivalent : il ne peut être échangé et s’affranchit ainsi de la valeur même de l’échange
propre à l’industrie culturelle. « L’art se transforme en idéologie lorsque, image du non-
échangeable, il suggère l’idée que tout dans le monde ne serait pas échangeable
11
». Il rend
possible autre chose, un autre rapport au monde. « Les œuvres d’art anticipent une praxis qui
n’a pas encore commencé et dont personne ne serait capable de dire si elle avalise ses
traites
12
».
D’autre part, le vertige alors provoqué par cet « irréconcilié » que l’œuvre installe, par cette
révélation d’un autre pourtant présent, interpelle, pose une question : celle où l’on se dit « est-
ce donc vrai ?
13
» « Le surgissement d’un non-étant comme s’il était, voilà ce qui suscite la
question de la vérité
14
». Mais cette sommation à la vérité, à déchiffrer sans le résoudre le
paradoxe de la présence/absence que fait éclater l’œuvre, ne peut trouver de solution ou de
réconciliation dans une réponse définitive. « Les œuvres d’art disent quelque chose et en
même temps le cachent
15
». L’art est « une énigme agaçante
16
», et non un mystère. On se
résigne au mystère, on s’abandonne à la loi de son inaccessible secret. En revanche, l’énigme
met la pensée en quête de la réponse. Toutefois, cette dernière ne sera jamais donnée avec les
œuvres d’art. « Les œuvres parlent à la manière des fées dans les contes : ‘‘Tu veux l’absolu,
tu l’auras, mais il te sera cependant inaccessible’’
17
».
C’est alors cette mise en tension du penser, cette quête sans réponse possible, que donne « le
contenu de vérité ». Si l’on préfère, le vertige que jamais ne comblera « l’irréconcilié », sa
permanente dissociation envers le monde préformé et le déjà su, provoquent le déclenchement
de la pensée critique, mais une pensée qui, dans la logique de la dialectique négative, ne
trouvera guère d’« ultime réconciliation ». De la sorte, elle continuera alors à penser et à
s’émanciper des réifications dogmatiques. Aussi, ce questionnement de la vérité et du
6
Ibid.
7
Ibid., p. 119, souligné par l’auteur.
8
Ibid., p. 123.
9
Ibid., p. 138.
10
Ibid., p. 132.
11
Ibid.
12
Ibid., p. 125.
13
Ibid., p. 182.
14
Ibid., p. 123
15
Ibid.
16
Ibid., p. 175.
17
Ibid., p. 180.

dépassement de ce qui existe déjà retrouve, selon T. W. Adorno, la même quête que la
philosophie : « la vérité de l’œuvre d’art qui se déploie progressivement n’est pas autre chose
que celle du concept philosophique [...] Le contenu de vérité des œuvres n’est pas ce qu’elles
signifient, mais ce qui décide de la fausseté ou de la vérité de l’œuvre en soi ; seule cette
vérité de l’œuvre en soi est commensurable à l’interprétation philosophique et coïncide, tout
au moins selon l’idée, avec la vérité philosophique
18
». Ainsi, lorsque le philosophe note
qu’une « véritable expérience esthétique doit devenir philosophie, ou bien elle n’existe
pas
19
», ou que le déploiement des œuvres « et le déploiement philosophique de leur contenu
de vérité se trouvent en action réciproque
20
», on peut se demander, malgré ses précautions,
s’il ne rejoint pas en large part le couple kantien du sublime et de la raison. La simple
différence est que le sublime va résister à la raison qu’il convoque, va la relancer sans cesse,
sans ne pouvoir s’y épuiser. Il y a comme une permanence du sublime, et non plus une simple
apparition, et cette permanence signifie une tension vive, où la raison s’alimente, sans pouvoir
dominer l’informe du sublime. Ainsi, les œuvres d’art les plus anciennes continuent-elles à
nous fasciner, sans qu’on puisse en résoudre l’énigme…
L’art, dans son paradoxe à tout jamais irréconcilié avec le conçu empirique est bien, selon la
Théorie Esthétique, une invitation à la « raison interprétative
21
», certes une raison qui, ici, se
soustrait à toute réconciliation finale. Mue par l’énigme artistique qui l’alimente, la pousse
sans cesse à de nouvelles synthèses, elle s’accorde à la permanente remise en cause de ses
limites où prend pleinement effet la critique. Et la thèse adornienne voit en l’industrie
culturelle ce qui précisément tue le sublime, et au-delà toute possibilité de désaliénation par
l’effet du contenu de vérité de l’oeuvre d’art.
Sur le chemin heideggérien de l’Ereignis et de l’Erörterung
La perspective d’influence marxiste de T. W. Adorno, « l’anti-Heidegger
22
», est souvent
opposée au « sol » phénoménologique de Martin Heidegger. Pourtant, c’est aussi selon une
configuration conflictuelle que celui-ci aborde la question de l’art. L’essai L’Origine de
l’Œuvre d’Art
23
se fonde sur la thèse d’une permanente tension, voire d’un combat entre le
monde-fable, arraisonné par les certitudes discursives, et son autre que Martin Heidegger
nomme la « Terre ». L’œuvre ouvre le monde pour y faire sourdre une « é-normité
24
» qui
fait « éclater ce qui jusqu'à présent paraissait normal
25
». Elle pousse « hors de l’ordinaire
26
»
et dérange. « Suivre ce dérangement signifie alors : transformer nos rapports ordinaires au
monde et à la terre, contenir notre faire et notre évaluer, notre connaître et notre observer
courants en une retenue qui nous permette de séjourner dans la vérité advenant en
l’œuvre
27
». Si le philosophe ne se réfère pas au sublime kantien, c’est pourtant la thématique
de la démesure, « l’é-norme » de la réserve infinie de sens inédits que recèle la Terre et que
l’art porte au Monde, qui sous-tend son analyse. Ainsi, et non sans évoquer l’analyse
18
Ibid., p. 186.
19
Ibid., p. 186.
20
Ibid., p. 183.
21
Ibid.
22
« Adorno, l’anti-Heidegger », Libération, 2 février 1989, pp. 17-19.
23
HEIDEGGER, M., L’Origine de l’Œuvre d’Art, in : Chemins qui ne mènent nulle part, trad. W. Brokmeier,
Paris, Gallimard, 1962, p. 74.
24
Ibid.
25
Ibid., p. 74.
26
Ibid.
27
Ibid.

« mathématique » chez E. Kant, l’œuvre « fait apparaître précisément ce qui n’est pas encore
décidé et ce qui est encore dépourvu de mesure
28
».
Ce combat entre la Terre, dont l’œuvre fait jaillir la présence, et le Monde qui est alors ouvert,
se solde alors par la question même de l’origine du langage : l’indicible que l’œuvre révèle se
porte au monde discursif sur un mode fondamentalement métaphorique, « poématique » selon
l’expression heideggérienne, où s’inscrit et se fonde l’essence ontologique du Dasein en tant
qu’être de parole et de pensée. Le choc de « l’ é-normité » artistique doit se comprendre
comme la révélation d’une altérité qui a « pourtant un jour surpris l’homme en étrangeté, et a
engagé la pensée dans son premier étonnement
29
», à savoir dans ce qui fonde la spéculation
philosophique.
A l’inverse d’une dialectique négative, c’est alors une visée ontologique que propose
M. Heidegger, en dépassant d’ailleurs la proposition en réciprocité formulée par l’esthétique
hégélienne selon laquelle l’origine de l’œuvre est l’artiste, et inversement. Avec L’Origine de
l’Œuvre d’Art, il devient en effet possible de conclure que, d’une part, l’origine de l’art est la
Terre, mais que celle-ci ne donne que par sa différenciation avec le monde et le suppose ainsi,
et que, d’autre part, l’art est l’origine du monde, du langage en son instauration déjà
« poématique ». Mais la spéculation heideggérienne n’entend pas préconiser un repli exclusif
sur l’essence terrestre, de façon extra-mondaine. A l’inverse elle demande de regarder « le
combat essentiel
30
» où « les parties adverses s’élèvent l’une l’autre dans l’affirmation de leur
propre essence
31
» , où les adversaires dévoilent leur identité respective au lieu de se détruire.
Cette lice, cette limite des adversaires est précisément l’endroit où s’érige l’œuvre, « installant
un monde et faisant venir la terre
32
». Or le fonctionnement de l’œuvre qu’analyse alors
M. Heidegger est celui d’une oscillation « entre ce que le philosophe nomme « l’éclaircie » et
la « réserve
33
». Le choc de l’œuvre, « l’é-normité » qu’elle fait apparaître ouvre le Monde, y
fait jaillir un autre non encore mesuré ou pensé. Telle est l’éclaircie. Mais dès qu’il est
confronté à cette apparition, le monde cherche à l’arraisonner, à en nommer l’insu, à
rationaliser celui-ci. Or ce dernier, comme dans l’énigme à laquelle il manque à tout jamais la
clef, se retire aussitôt, retourne dans la « réserve » terrestre de sens ineffables et non encore
dits. C’est ainsi que l’œuvre, éternellement, peut nourrir le Monde sans être définitivement
capturée par celui-ci. Elle garantit la tension vive d’une surprise qui à chaque fois, dans
l’expérience d’une présence/absence, d’un ineffable à dire qui « s’inter-dit
34
» dès que le dire
mesurant s’en empare, ressource le langage par un moment « initial
35
», l’ouvre vers de
nouvelles possibilités qui le prémunissent de toute faillite et tout bouclage insensé.
M. Heidegger définit un trait dans le combat entre la Terre et le Monde. Celle-ci, par l’œuvre,
surgit dans le Monde pour s’en retirer aussitôt, mais en donnant alors à nommer ce que son
« éclaircie » a dévoilé. Ce trait qui « attire les adverses
36
», tout en les séparant et les
28
Ibid.
29
Ibid., p. 22.
30
Ibid.
31
Ibid.
32
Ibid.
33
« La terre ne surgit à travers le monde, le monde ne se fonde sur la terre que dans la mesure
où advient le combat originel entre éclaircie et réserve ». Ibid., p. 61.
34
Ch§
oix personnel de ce terme.
35
Ibid. Pour reprendre un extrait de la note du traducteur : « Anfang est l’initial, non pas au sens de l’antériorité
chronologique, mais au sens de la détermination historiale. »
36
Ibid., p. 71.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%
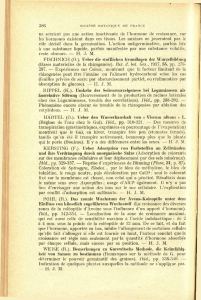
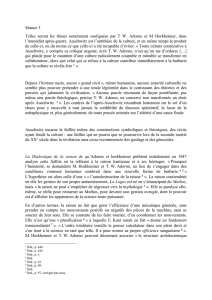
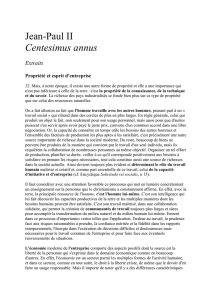
![[….] Mais une deuxième considération s`impose. Nous avions jusqu](http://s1.studylibfr.com/store/data/000852584_1-5369db7b64c38bfb08426a90323d86fc-300x300.png)