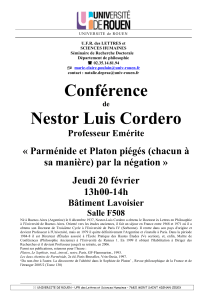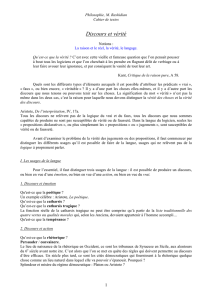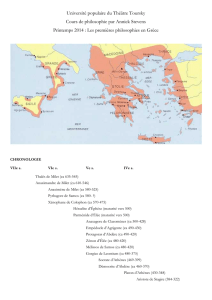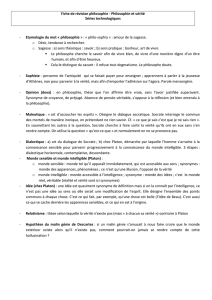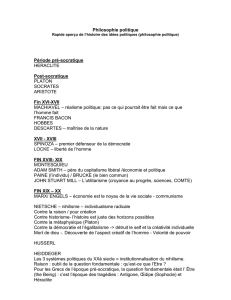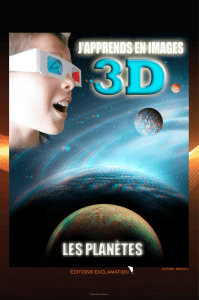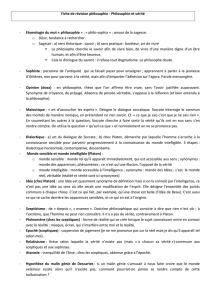L`étymologie est instructive dans la mesure où elle nous donne à

Michel Nodé-Langlois, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de
philosophie, Professeur en Première Supérieure au lycée Pierre de Fermat à
Toulouse, nous offre une longue dissertation sur « l’erreur ». Celle-ci vient en point
d’orgue au Grand Débat passionnant du forum sur « Qu’est-ce qu’une philosophie
réaliste ? » Compte tenu de son importance, nous la publierons en trois parties.
L’erreur – 1 –
1ère Partie
Depuis Parménide, la philosophie s’en est toujours prise à l’opinion pour dé-
noncer l’incapacité de celle-ci à se fonder en vérité et par là-même à éviter l’erreur,
rapportant la première à ce qui est – l’être – et la seconde à ce qui ne fait que para-
ître – l’apparence. Cela ne pouvait aller sans la revendication d’une capacité
d’atteindre celle-là et de réfuter celle-ci, capacité que Platon veut qu’on reconnaisse
à l’intellect, moyennant une conversion qui tourne cet « œil de l’âme » vers la lumière
de l’intelligible1, lui permettant de dépasser les apparences. Prendre conscience
d’une erreur, c’est entrer dans la vérité, et cette opération semble présupposer la
disposition d’une faculté qui y soit naturellement apte. Ce qui peut paraître surpre-
nant, c’est que cette conversion et le succès qu’elle permet soient le fait d’un petit
nombre, qu’il s’agisse du prisonnier libéré de la caverne, allégorie du philosophe
dans l’idéalisme platonicien, ou, en dépit de l’irrationalisme qui l’oppose à Platon, du
happy few qui constitue pour Nietzsche l’élite des « esprits libres »2, capables de
regarder la vérité en face. Pour Démocrite aussi « la vérité » était « dans un puits »3,
inaccessible à la conscience ordinaire, et si l’on en croit Pascal, l’homme « ne
connaît naturellement que le mensonge »4. Si une telle conception a de quoi satis-
faire un élitisme philosophique, elle n’en pose pas moins un problème. Si en effet
l’intellect est naturellement capable de connaître le vrai, l’erreur doit apparaître
comme un accident qui lui échoit à l’encontre de sa destination naturelle. Mais si
c’est l’erreur qui se produit, comme eût dit Aristote, « toujours ou le plus souvent »5,
c’est la connaissance de la vérité qui doit apparaître comme un accident du fait
même qu’elle est exceptionnelle, mais c’est alors la capacité naturelle d’atteindre le
vrai qui paraît mise en question. Or il paraît impossible de parler d’erreur sans
connaître la vérité à laquelle elle s’oppose. Si donc le philosophe se croit capable de
vérité, il doit expliquer la possibilité de l’erreur en tant que divorce supposé entre la
pensée et l’être. Comment peut-on se tromper ?
1 Platon, République, Livre VII.
2 Nietzsche, Humain, trop humain, I, Préface, § 2.
3 Démocrite, Fgt B 117 DK.
4 Pascal, De l’Esprit géométrique.
5 Aristote, Physique, Livre II.
1

*
Il peut paraître absurde de s’interroger sur la possibilité de l’erreur, dans la
mesure où celle-ci apparaît comme un fait banal, et où, selon l’adage scolastique, ab
esse ad posse valet consequentia6. C’est le cas par exemple lorsqu’on cherche son
stylo dans le tiroir du haut alors qu’il est dans le tiroir du bas, ou lorsque l’on se
trompe de chemin. Rapportée à ce dernier cas, l’étymologie est instructive, car elle
nous donne à distinguer, en français comme en latin, deux manières d’errer. Le
verbe errare peut en effet désigner l’errance, ou la divagation, par exemple le libre
cours donné aux pensées dans la rêverie, ou, plus concrètement, la libre déambula-
tion que nous appelons la balade. Dans ce dernier cas, l’absence de but visé, autre
que la promenade elle-même, fait qu’il ne saurait y être question de se tromper de
chemin, ou de le perdre, ce que pourrait encore désigner le verbe errer, mais au
sens d’une erreur et non plus d’une simple errance ; ou plutôt, au sens d’une errance
qui s’ignore en tant que telle : on prend un mauvais chemin en croyant prendre le
bon. Cette deuxième sorte d’errance ne s’entend qu’en référence à ce bon chemin
que l’on aurait dû ou voulu prendre, parce que c’était lui et lui seul qui menait au lieu
que l’on voulait atteindre : c’est le cas si l’on s’est aventuré au point de ne plus savoir
rentrer chez soi. Dans le premier cas l’on était dans l’illusion quant au chemin à
prendre, et celle-ci ne devient douloureuse qu’après-coup, lorsque l’on réalise avoir
manqué son but ; dans le deuxième, l’ignorance de la bonne voie induit d’avance la
conscience angoissante que l’on risque de se tromper, et d’échouer en consé-
quence.
Cette banalité de l’erreur explique sans doute le dicton célèbre qui la présente
comme un ingrédient habituel de notre expérience. « L’erreur est humaine », dit-on,
ou, en latin : errare humanum est. On aurait tort toutefois de vouloir lui faire dire
qu’elle est réservée à l’homme. Il est vrai que l’homme est voué par nature à sup-
pléer l’instinct qu’il n’a pas en acquérant des modes de comportements efficaces,
appris à l’aide de la méthode dite « des essais et des erreurs ». Il faut toutefois noter
que non seulement plus d’une espèce animale recourt à ladite méthode – par exem-
ple les félins qui apprennent à chasser avec leurs parents –, mais encore que
l’infaillibilité que l’on reconnaît à l’instinct en tant que schéma inné de comportement7
est aussi ce qui entraîne la possibilité de certaines erreurs : c’est ainsi que des oi-
seaux, tels les geais, imitent le chant d’autres espèces pour éloigner les parents de
leur nid, et se faciliter la capture des oisillons ; ou que des petits échassiers miment
la démarche claudicante d’un oiseau blessé pour attirer les prédateurs loin de leur
nichée ; ou encore que certains oiseaux font le mort pour inhiber les gestes instinctifs
de capture des carnassiers. Il y a donc des bêtes qui trompent, et d’autres qui sont
trompées, induites en erreur, les unes comme les autres adoptant une conduite que
l’on peut qualifier d’intentionnelle, dans la mesure où elle comporte manifestement
une finalité déterminée, et répond à la perception d’une certaine situation, interpré-
tée, à tort ou à raison, comme profitable ou dangereuse.
6 « Du réel au possible la conséquence est valide ».
7 Sur le concept d’instinct, voir les études scientifiques approfondies de Konrad Lorenz dans Trois essais sur le
comportement animal et humain, 1ère partie (Points Seuil), et de Niko Tinbergen, L’étude de l’instinct (Payot,
Paris, 1953), ainsi que sa belle présentation dans : Morris et Goscinny, Ma Dalton (Dargaud éditeur, Neuilly-sur-
Seine, 1971), pp. 12 et 35.
2

On ne saurait donc dire que l’erreur est propre à l’homme. Les scolastiques
aristotéliciens, qui définissaient l’homme avant tout – génériquement – comme un
animal, et tenaient moins que les modernes à opposer les deux, dénommaient esti-
mative cette capacité qu’ils observaient chez des bêtes d’apprécier le sens de certai-
nes situations, telle « la brebis qui voit le loup » et reconnaît en lui son « ennemi de
nature »8. Comme il s’agit ici d’un discernement qui va au-delà de la seule discrimi-
nation de certaines couleurs, objets propres de la vision, saint Thomas n’hésite pas à
dire que la brebis « juge (judicat) qu’il faut fuir, par un jugement naturel (...) fruit d’un
instinct naturel »9. L’usage du terme de jugement (judicium) peut surprendre, étant
donnée sa connotation logique, mais il indique que l’acte de discerner (en grec : kri-
neïn) est tenu pour plus essentiel au jugement que le fait qu’il soit signifié dans un
discours, et non pas seulement dans un comportement. Dans la mesure où l’homme
appartient au genre animal, il n’est pas étonnant que l’on trouve chez lui la même
faculté de discernement que chez les bêtes : les scolastiques le dénommaient cogita-
tive seulement du fait d’une certaine « affinité et proximité », chez l’homme, à la pen-
sée rationnelle, celle-ci exerçant sur celle-là une « influence en retour (refluentia) »10.
Monter ou descendre un escalier, ou une gamme sur un clavier, sont des activités
qui deviennent comme instinctives à l’homme après avoir été réfléchies, mais il lui
arrive de trébucher en croyant une marche moins haute qu’elle n’est, tout de même
qu’à un prédateur de manquer sa proie.
Si donc il n’est pas vrai qu’il n’y ait pas d’erreur en dehors de l’espèce hu-
maine, ils semble en revanche qu’il n’y en ait pas en dehors d’un acte de jugement,
fasse-t-il ou non l’objet d’un énoncé. C'est pourquoi, alors même que l’on rencontre
de nombreux cas d’illusion sensible, on peut se refuser à parler d’une erreur des
sens. La vue ne peut manquer de donner l’impression qu’une règle droite est coudée
lorsqu'elle est partiellement plongée dans de l’eau. Et il y a assurément erreur à af-
firmer que la règle est coudée, mais l’erreur est ici dans le jugement et non pas dans
la perception, dont une bonne théorie optique nous expliquera pourquoi elle est
conforme à ce qu’elle doit être, moyennant les lois de la réfraction des rayons lumi-
neux. La même théorie nous expliquera pourquoi la vue ne permet pas de discerner
de loin si une tour est ronde ou carrée. C'est pourquoi l’on peut bien dire que « les
sens [sont] trompeurs »11, puisqu’ils nous induisent à porter des jugements faux. On
ne peut pour autant dire qu’ils « se trompent » – soit qu’ils sont dans l’erreur, ou que
nous soyons dans l’erreur en sentant comme nous sentons –, « non pas parce qu'ils
jugent toujours juste, mais parce qu'ils ne jugent pas du tout »12. Aussi bien l’erreur
de jugement pourra-t-elle être rectifiée alors même que l’illusion sensible demeurera.
Et ici encore, il faut noter qu’une telle rectification se produit en dehors de l’espèce
humaine, par exemple lorsque des étourneaux d’abord dispersés, pour des raisons
d’hygiène, par le son d’un haut-parleur émettant le cri d’un rapace, cessent de s’y
laisser prendre, une fois constatée l’inexistence de celui-ci : ils reviennent alors en-
vahir les places, souillant les bancs et les automobiles.
C'est pourquoi l’on peut penser que Kant conclut trop vite en écrivant que « la
vérité aussi bien que l’erreur (Irrtum), et par suite aussi l’apparence (Schein) en tant
qu’elle induit en erreur, ne se trouvent que dans le jugement, c'est-à-dire dans le
8 Thomas d'Aquin, Somme de Théologie, Ia, q.78, a.4.
9 Op.cit., Ia, q.83, a.1.
10 Op.cit., Ia, q.78, a.4, ad 5m.
11 Descartes, 1ère Méditation, § 3.
12 Kant, Critique de la Raison pure, Dialectique transcendantale, Introduction, § I.
3

rapport de l’objet à notre entendement »13 : on ne saurait alors rendre compte du fait
de l’erreur, comme de sa rectification, chez les êtres dont Kant pense après beau-
coup d’autres qu’ils ne disposent pas d’une faculté intellectuelle. De tels faits parais-
sent attester que si l’erreur est dans le jugement, il n’est pas vrai que l’entendement
soit seul à juger. C'est pourquoi Aristote admettait la possibilité d’une erreur, anté-
rieure au jugement de l’intellect, et par suite commune à l’homme et aux bêtes, dans
l’appréciation de ce qu’il appelle les « sensibles communs » et les « sensibles par
accident »14. Ces deux notions s’entendent par opposition aux « sensibles pro-
pres »15 – couleur, son, odeur, saveur, qualités tangibles, objets respectivement de
nos cinq sens externes. Les autres sont d’une part les attributs qui, tout en étant
d’ordre sensible, ne relèvent proprement d’aucun sens, tels le mouvement ou la dis-
tance, d’autre part les sujets auxquels les qualités sensibles sont attribuées, comme
par exemple si « ce qui est blanc se trouve être le fils de Diarès »16. La faillibilité de
leur appréciation vient pour Aristote de ce qu’elle rapporte à une qualité perçue par
un sens une autre qualité qui n’est pas son objet propre – telle une grandeur –, ou
qui rapporte la première à un certain sujet – par exemple : prendre le fils de Diarès
pour Callias. C’est le même type d’erreur que commet le jeune chaton qui ajuste mal
un saut, ou le rouge-gorge lorsqu’il agresse sa propre image renvoyée par un miroir ;
ou encore les oies cendrées de Konrad Lorenz lorsqu'elles prennent son leurre en
carton soit pour une oie, soit pour un rapace en vol, suivant le sens de son déplace-
ment.
À la faillibilité de l’appréciation des sensibles communs ou accidentels, Aris-
tote oppose l’infaillibilité de l’appréciation des sensibles propres17, car la première
paraît présupposer la seconde. Un sensible propre n’est en effet chaque fois que
« l’acte commun »18 d’un sens, supposé en état d’accomplir sa fonction, et de l’objet
auquel il est naturellement approprié, lequel, en l’absence de la faculté sensitive,
n’est sensible qu’ « en puissance »19. Or tout de même que le prédateur trompé par
le comportement visible de sa proie, on ne peut se tromper sur l’identité d’une per-
sonne que l’on voit arriver de loin, ou sur la taille réelle du soleil, que si l’œil les
« discerne (krineï) »20 sur le fond de ce qui les entoure : il ne saurait y avoir d’erreur
sur cela même qui rend l’erreur possible. Il convient donc de distinguer deux sortes
de discernement, exprimées en grec par le même verbe, et d’opposer à la simplicité
intuitive de l’acte de discernement perceptif des sensibles propres la sorte de com-
position qui intervient dans l’appréciation des autres. Cette distinction se vérifie
d’ailleurs dans l’ordre logique, « car c’est dans la composition ou la division », c'est-
à-dire dans l’affirmation ou la négation, soit dans la proposition, « qu’il y a fausseté
ou vérité » : pris séparément les termes d’une proposition « ne sont encore ni vrais ni
faux »21. Ainsi, « bouc-cerf (tragélaphos) signifie bien quelque chose, mais rien de
vrai ni de faux si l’on n’ajoute pas qu’il est ou n’est pas »22. Mais on peut tout aussi
bien dire que sur un terme pris à part, c'est-à-dire en tant qu’élément simple d’un ju-
gement composé, « il n’est pas possible d’être dans l’erreur »23 : on ne peut se trom-
13 Ibid.
14 Aristote, De l’Âme, Livre II, ch.6.
15 Ibid.
16 Op.cit, Livre II, ch.6, 418a 21.
17 Ibid., 418a 12.
18 Op.cit., Livre III, ch.2, 425b 25.
19 Ibid., 426a 24.
20 Op.cit, Livre II, ch.6, 418a 14.
21 Id., De l’Interprétation, ch.1.
22 Ibid. Tragélaphos est le nom d’une antilope africaine.
23 Id., Métaphysique, Livre Θ, ch.10, 1051a 27.
4

per en disant que la diagonale du carré est commensurable à son côté qu’à la condi-
tion de concevoir adéquatement ce que c’est qu’une diagonale et ce que c’est qu’une
commune mesure. Il faut donc dire que l’erreur prédicative, intermédiaire entre
l’ignorance et la vérité judicative, présuppose la vérité antéprédicative du concept,
lequel est soit connu soit ignoré. Et ce qui distingue l’acte de jugement n’est pas seu-
lement la réunion de plusieurs termes, laquelle pourrait ne produire qu’un concept
complexe – tel celui de commune mesure –, mais le fait de signifier par le moyen
d’une composition de termes une vérité qui n’est pas signifiée comme telle dans le
simple concept.
Ces distinctions aristotéliciennes paraissent donner la solution d’une aporie
sophistique à laquelle s’était heurté Platon. Celle-ci mettait en cause non pas tant
l’erreur en général sous les formes envisagées précédemment, mais sa forme pro-
prement humaine, logique, en contestant la possibilité de « dire faux »24. L’argument
sophistique se comprend en référence à la définition de la vérité héritée de Parmé-
nide et assumée par Platon, à savoir sa corrélation à l’être. Le premier avait donné
comme principe de la pensée vraie cette « merveille des merveilles »25 dont parle
Heidegger, à savoir que « l’étant (to on) » – ce qui est – « est (emménaï) »26, et Pla-
ton en avait tiré la définition du discours vrai comme celui qui « dit ce qui est tel qu’il
est (ta onta hôs esti) »27, et, par suite, celle du discours faux comme celui qui dit
« autre chose que ce qui est (hétéra tôn ontôn) »28. À quoi le sophiste objecte, d’une
manière en fait très conforme aux injonctions de Parménide, que ce qui n’est pas
n’est rien, que dire ce qui n’est pas, c’est donc ne rien dire, et que la prétendue défi-
nition du discours faux est inconsistante puisqu’elle le présente en fait comme un
non-discours : parler, c’est toujours parler de quelque chose, et par conséquent,
« personne ne dit ce qui n’est pas »29. Platon s’était en fait aperçu qu’on ne saurait,
comme Parménide, opposer l’être véritable, objet de connaissance, et l’apparence,
source d’illusion, sans accorder qu’il y a de l’apparence, c'est-à-dire sans lui prêter
une réalité, et donc attribuer un certain être au non-être30. Par ailleurs, l’argument
sophistique n’en paraît pas moins comporter un paradoxe insoutenable, que la lan-
gue grecque rend particulièrement évident : c’est en effet un même verbe – pseudès-
thaï – qui sert à y dénommer les deux manières de dire faux que sont l’erreur et le
mensonge. Or si la première n’est pas possible, le second ne doit pas l’être non plus,
puisqu’il consiste à induire quelqu'un en erreur par un discours dont celui qui le pro-
nonce sait qu’il est contraire à la vérité : le mensonge est la forme proprement hu-
maine de la tromperie déjà rencontrée ailleurs dans le monde animal. Ce n’est pas
sa péjoration morale qui importe ici, mais bien la possibilité qu’elle atteste, et qui
montre que sa réfutation sophistique n’est pas plus consistante que l’ontologie qui la
rend possible. Socrate n’a d’ailleurs pas de peine à montrer au sophiste que si
l’erreur est impossible, non seulement « il n’est pas possible de se tromper (examar-
taneïn) quand on agit »31, mais encore que celui-ci est enfermé dans un dilemme :
« si je ne me suis trompé, ni tu ne me réfuteras, malgré tout ton savoir, ni ne sauras
24 Platon, Euthydème, 283e 8.
25 Heidegger, De l’essence de la vérité.
26 Parménide, Poème.
27 Platon, Le Sophiste, 263b 4.
28 Ibid., 263b 7.
29 Id., Euthydème, 284c 3.
30 Id., Le Sophiste, 256d 11.
31 Ibid., 287a 2.
5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%