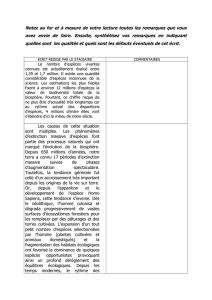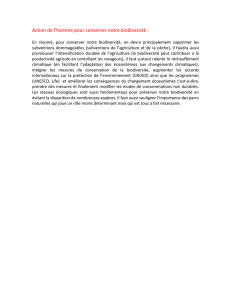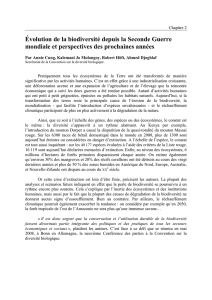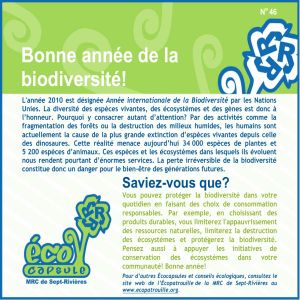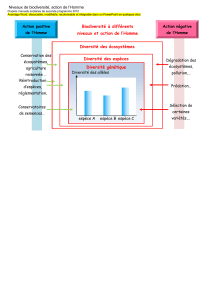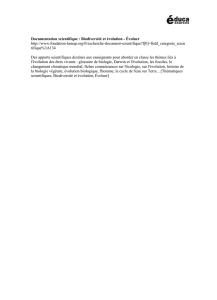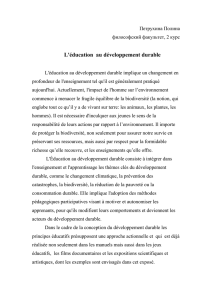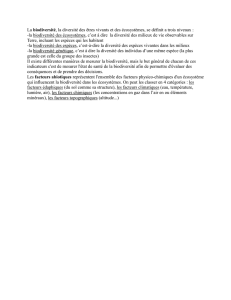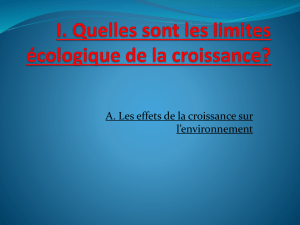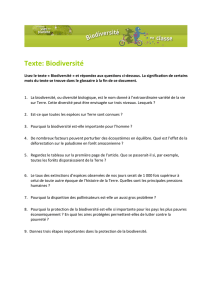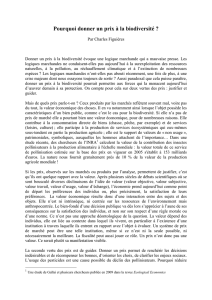Biodiversité et changements globaux


∏dpf association pour la di{usion de la pensée française •
Ministère des A{aires étrangères
Direction générale de la Coopération internationale
et du Développement
Direction de la Coopération scientifi que
et universitaire
Isbn 2-914935-27-7
∏dpf association pour la di{usion de la pensée française •
6, rue Ferrus 75014 Paris + [email protected]
©Novembre 2004 ∏dpf ministère des A{aires étrangères
Sous la direction
de Robert Barbault
& Bernard Chevassus-au-Louis
Ouvrage coordonné
par Anne Teyssèdre
Chapitres
de Luc Abbadie
Robert Barbault
Patrick Blandin
Bernard Chevassus-au-Louis
Philippe Cury
Jean-Claude Génot
Jean-François Guégan
Éric Lateltin
Serge Morand
François Renaud
Anne Teyssèdre
Michel Trommetter
Jacques Weber

Né de la prise de conscience collective des enjeux
que porte la diversité du vivant et des menaces qui pèsent
sur elle, le concept de biodiversité s’est imposé au monde
à la faveur du Sommet planétaire de Rio de Janeiro,
en juin 1992. Dix ans plus tard, à Johannesburg,
les exigences d’action étaient rappelées et l’engagement
était pris de freiner l’érosion de la biodiversité
à l’horizon 2010.
Dans ce débat mondial, la France s’est montrée
particulièrement active. Sur le plan national,
un programme de recherche sur la dynamique de
la biodiversité a été lancé dès 1992. Celui-ci a abouti,
huit ans après, à la création, sous l’autorité des ministres
en charge des Affaires étrangères, de la Recherche
et de l’Environnement, de l’Institut français de
la biodiversité, groupement scientifique coordonnant
les initiatives de l’ensemble des organismes
de recherche concernés.
Sur le plan international, le Président de
la République a annoncé au G8 d’Évian, en juin 2003,
sa volonté de mobiliser toutes les compétences
sur cet objectif et a proposé que la France organise
une conférence scientifique mondiale pour appuyer
cette initiative.
Le présent ouvrage a précisément été conçu
dans cette perspective, sa parution précédant la tenue
à Paris de la conférence mondiale « Biodiversité :
Science et Gouvernance », qui se tiendra du 24
au 28 janvier 2005 à Paris, au siège de l’Unesco.
Son objectif est de présenter, sous la plume
de scientifiques français appartenant à des organismes
de recherche aussi divers que le Centre national
de la recherche scientifique (Cnrs), le Muséum national
d’histoire naturelle, l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra), le Centre de coopération
internationale en recherche agronomique
pour le développement (Cirad) ou l’Institut de recherche
pour le développement (Ird), l’état des connaissances
en matière de biodiversité.
Il se propose aussi de lancer une réflexion stratégique
sur les perspectives et les mesures à prendre pour
préserver la dynamique de la biodiversité et en permettre
une utilisation durable.
Au vu de quelques-unes des questions abordées,
on peut apprécier l’ampleur des enjeux pour nos sociétés
et des défis scientifiques posés au monde de la recherche.
Comment la biodiversité affecte-t-elle les écosystèmes
terrestres et marins, les ressources et services écologiques
qu’ils garantissent ? Pourquoi les changements
planétaires peuvent-ils conduire à l’émergence
de nouvelles maladies et comment peut-on y parer ?
Est-on entré dans une crise d’extinction majeure et
quelle politique faut-il mettre en place pour y répondre,
comme le monde s’y est engagé au Sommet
de Johannesburg ? Que doit-on faire et combien de temps
nous reste-t-il pour agir et assurer un développement
durable ? Quelle stratégie de recherche sur
la biodiversité ?
L’apport des scientifiques français, tant dans l’analyse
des phénomènes en cause que dans la réflexion
stratégique, est ici présenté sous une forme largement
accessible et doit favoriser le débat entre chercheurs
et citoyens. Nous sommes tous concernés par les enjeux
que représente la biodiversité. Les mesures à prendre
touchent nécessairement au fonctionnement de
nos sociétés et à nos propres comportements, qu’il s’agisse
de l’énergie, des transports, ou de l’usage parfois
inconsidéré des ressources naturelles. Aussi est-il essentiel
de dresser un état de la situation et des perspectives
qui se dessinent.
Le bilan présenté ici, largement pluridisciplinaire,
est une contribution majeure à la stratégie française
sur la biodiversité pour un développement durable.
Il marque la détermination de notre pays à jouer un rôle
d’éclaireur pour informer et alerter la communauté
internationale sur des enjeux majeurs pour l’avenir
de notre planète.
Michel Barnier
Ministre des Affaires étrangères

Luc Abbadie
est docteur en écologie, directeur de recherche
au CNRS et professeur à l’université Pierre et Marie Curie,
directeur-adjoint du Laboratoire d’écologie de l’École
normale supérieure. Il enseigne l’écologie de la biodiversité,
des cycles biogéochimiques et des écosystèmes dans
le Master Sciences de l’univers, environnement, écologie
de l’université Pierre et Marie Curie. Ses recherches portent
principalement sur le cycle du carbone et de l’azote
à l’interface sol-plante, dans les milieux herbacés tempérés
et tropicaux. Il s’intéresse actuellement aux mécanismes
écologiques qui régulent la capacité des sols à produire
des nutriments minéraux et à accumuler des composés
organiques.
Robert Barbault
est professeur d’écologie à l’université
Pierre et Marie Curie. Il dirige le département d’Écologie
et Gestion de la biodiversité du Muséum de Paris.
Membre de l’Academia Europea et de nombreux comités
scientifi ques, il préside le Comité français du programme
de l’UNESCO ‹ L’homme et la biosphère ›. Spécialiste
de la dynamique des populations et des peuplements
de vertébrés, il s’est fortement engagé dans
le développement des recherches sur la dynamique
de la biodiversité. Il a contribué à la création
du premier programme national français sur le domaine,
en connexion étroite avec la mise en œuvre du programme
international Diversitas, auquel il a participé.
Il est l’auteur d’une centaine de publications scientifi ques
et d’une douzaine d’ouvrages.
Patrick Blandin
agrégé de sciences naturelles, docteur d’État,
est professeur du Muséum national d’histoire naturelle
depuis 1988. Membre du département Hommes-Natures-
Sociétés, il est chargé de mission scientifi que
à la Direction générale pour la conservation de la nature,
le développement durable et l’éthique environnementale.
Il a été directeur du laboratoire d’Écologie générale
(1988-1998), de la Grande Galerie de l’évolution (1994-2002),
du laboratoire d’Entomologie (2000-2002) et du département
du Musée de l’Homme (2002-2003). Il a présidé le Comité
français pour l’UICN (Union mondiale pour la nature)
de 1992 à 1999. Depuis 2003, il anime le Comité scientifi que
de la Réserve de biosphère du pays de Fontainebleau.
Auteur, depuis 1968, de travaux de systématique,
d’écologie théorique et appliquée, il a également développé
des recherches en histoire et épistémologie de l’écologie
et animé des programmes interdisciplinaires
en environnement.
Bernard Chevassus-au-Louis
est, depuis janvier 2002, président du Muséum
national d’histoire naturelle. Agrégé de sciences naturelles,
docteur en sciences de l’université Paris 11, directeur
de recherches à l’INRA (Institut national de la recherche
agronomique), il a été préalablement chef du département
d’Hydrobiologie et Faune sauvage de l’INRA (1984-1989),
directeur général de cet organisme (1992-1996) puis,
de 1998 à 2002, président du conseil d’administration
de l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire
des aliments). Ses travaux scientifi ques portent
sur la caractérisation et la gestion génétique
des populations de poissons. Il a également consacré
plusieurs articles à l’expertise et à l’analyse des risques
sanitaires et environnementaux.
Philippe Cury
est directeur de recherches à l’IRD (Institut
de recherche pour le développement). Ses travaux
en écologie marine ont démarré en 1980 et lui ont permis
de travailler sur les grands écosystèmes d’upwelling
mondiaux (Afrique de l’Ouest, Benguela, Californie, Golfe
de Guinée). Il développe l’approche écosystémique
des pêches et vient d’organiser en avril dernier à UNESCO-
Paris, avec V. Christensen (UBC), le symposium international
sur le thème ‹ indicateurs écosystémiques pour
l’aménagement des pêcheries ›. Il a publié plus de 70 articles
scientifi ques sur les relations entre l’environnement
et la dynamique des populations et des écosystèmes marins
et plusieurs livres sur les écosystèmes d’upwelling.
Il a reçu plusieurs prix scientifi ques (prix scientifi que
national Philip Morris 1991 des sciences de la vie,
médaille de la Société d’océanographie de France 1995
et la médaille Gilchrist sud-africaine en 2002).
Jean-Claude Génot
est ingénieur écologue chargé de la protection
de la nature au Syndicat de coopération pour le Parc naturel
régional des Vosges du Nord, Réserve de biosphère.
En tant que professionnel de la conservation de la nature,
il coordonne un programme d’études et d’inventaires
sur le patrimoine naturel ainsi que l’édition d’annales
scientifi ques et s’intéresse tout particulièrement
à la gestion forestière proche de la nature. Il est membre
du bureau du comité français pour le programme
Homme et Biosphère (MAB) de l’UNESCO. Il est l’auteur
d’un ouvrage
Quelle éthique pour la n∑ture?
paru
chez Édisud en 2003.
Jean-François Guégan
est actuellement directeur de recherche à l’Institut
de recherche pour le développement (IRD) dans l’unité mixte
‹ Génétique et évolution des maladies infectieuses ›
(UMR 2 724 IRD-CNRS) à Montpellier dans une équipe
travaillant sur l’épidémiologie intégrative et la génétique
évolutive des maladies infectieuses et parasitaires.
Ses recherches mettent particulièrement l’accent sur
les dynamiques spatiales et temporelles des maladies
et sur l’impact des vaccinations sur de telles dynamiques
ainsi que sur les facteurs d’émergence de maladies
transmissibles. Il est responsable de l’édition de 3 ouvrages
scientifi ques et de 80 articles scientifi ques internationaux,
et a donné 45 conférences dans des congrès internationaux.
Il appartient à plusieurs groupes d’études et d’expertises
nationaux et internationaux.

Éric Lateltin
est docteur en physique de l’atmosphère.
Il est chargé de mission à l’Institut national des sciences
de l’univers et à l’Institut français de la biodiversité.
Ses recherches ont porté sur la physico-chimie
de la stratosphère, via la mise au point d’un modèle
numérique. Il s’intéresse actuellement aux interactions
entre le changement climatique, les écosystèmes
et les sociétés humaines, en privilégiant une démarche
interdisciplinaire.
Serge Morand
est directeur de recherches au CNRS, actuellement
détaché à l’IRD. Il dirige le Centre de biologie et de gestion
des populations (CBGP) à Montpellier. Ses travaux
portent sur l’écologie et l’évolution des relations hôtes-
parasites. Plus récemment, il concentre ses travaux
sur la compréhension et les conséquences de
la diversifi cation des parasites. Il coordonne l’appel d’offre
de l’IFB et du GICC ‹ Biodiversité et Changement global ›.
François Renaud
est directeur de recherches au CNRS.
Il dirige l’équipe ‹ Évolution des systèmes symbiotiques ›
au sein de l’unité mixte de recherches IRD/CNRS 2 724
‹ Génétique et évolution des maladies infectieuses ›.
Après avoir obtenu un DEA en parasitologie et pathologie
puis soutenu sa thèse de spécialité fi n 1980, il effectue
un DEA en écologie et sciences de l’évolution qu’il obtient
en 1983. Cette pluri-formation universitaire le conduit
à soutenir, en 1988, une thèse de docteur ès sciences
sur la biologie et l’évolution d’Helminthes parasites.
Ses recherches s’orientent dès lors vers la biologie
évolutive et l’écologie des interactions qui lient hôtes
et parasites dans les populations et les écosystèmes.
Avec Michel Tibayrenc (directeur de recherches IRD),
il développe une unité de recherche entre le CNRS
et l’IRD, pour allier les compétences scientifi ques
des deux institutions dans l’axe de ‹ l’écologie de la santé ›.
Il s’intéresse plus particulièrement à l’écologie
et à l’évolution des interactions entre les agents
de la malaria et leurs vecteurs dans les populations.
Il est l’auteur de plus de 110 publications dans des revues
scientifi ques internationales.
Anne Teyssèdre
est médiateur scientifi que. Docteur en biologie
évolutive, elle se consacre principalement à la diffusion
des connaissances en écologie, éthologie et autres
sciences de l’évolution. Elle a ainsi écrit cinq livres
sur le comportement animal, l’écologie et/ou l’évolution,
collaboré en tant que rédactrice principale à un CD-ROM
sur la biodiversité marine réalisé au Muséum, et rédigé
de nombreux articles en sciences de la vie et de la Terre
pour des revues de vulgarisation et pour le CNDP.
Elle a également réalisé une cinquantaine de dossiers
et livrets pédagogiques pour le CNDP en biologie, géologie,
technologie et sciences de l’Homme. Elle a collaboré
et collabore actuellement, en tant que conseillère
scientifi que ou auteur, à divers fi lms et expositions
sur le comportement animal et la biodiversité.
Michel Trommetter
est chargé de recherche à l’INRA. Ses recherches
portent sur les questions de l’accès dans la gestion
de la biodiversité et plus particulièrement sur la mise
en œuvre d’une propriété intellectuelle dans
les biotechnologies. Il réalise ses recherches dans
l’UMR GAEL INRA université Pierre Mendès France
de Grenoble. Parallèlement, il est chercheur associé
au laboratoire d’économétrie de l’École polytechnique
à Paris et chercheur associé à l’Institut du développement
durable et des relations internationales (IDDRI) à Paris.
Au niveau institutionnel, Michel Trommetter est membre
de la commission scientifi que de l’Institut français
de la biodiversité (IFB).
Jacques Weber
est économiste et anthropologue. Chercheur
à l’ORSTOM (aujourd’hui IRD) de 1971 à 1983, directeur
du département d’économie à l’IFREMER de 1983 à 1992,
responsable d’unité de recherche sur la gestion
des ressources et de l’environnement au CIRAD à partir
de 1993, il a mené et dirigé des recherches dans de nombreux
pays tropicaux et en Europe. Il dirige actuellement l’Institut
français de la biodiversité. Chargé de conférences à l’École
des hautes études en sciences sociales et à l’université
de Paris X-Nanterre, il est membre de plusieurs comités
scientifi ques nationaux et internationaux, et vice-président
du Comité français du programme ‹ L’homme et la biosphère ›
de l’UNESCO. Son domaine principal d’intérêt est relatif
aux interactions entre dynamique sociale et dynamique
naturelle, dans le domaine de la biodiversité
et des ressources renouvelables. Il est l’auteur
de 88 publications en revues, ouvrages collectifs
et communications à congrès, et de nombreux rapports
de recherche et de consultance.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
 210
210
 211
211
 212
212
 213
213
 214
214
 215
215
 216
216
 217
217
 218
218
 219
219
 220
220
 221
221
 222
222
 223
223
 224
224
 225
225
 226
226
 227
227
 228
228
 229
229
 230
230
 231
231
 232
232
 233
233
 234
234
 235
235
 236
236
 237
237
 238
238
 239
239
 240
240
 241
241
 242
242
 243
243
 244
244
1
/
244
100%