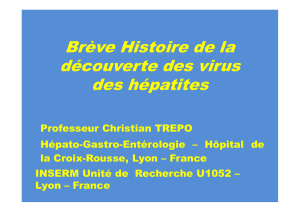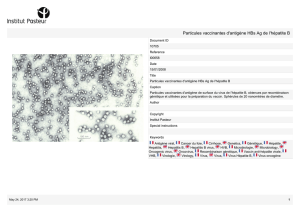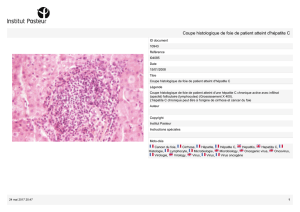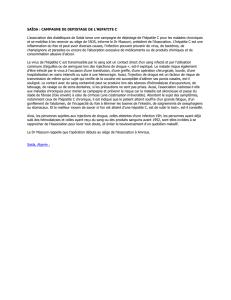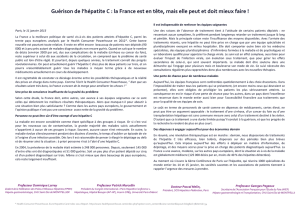Hépatite D - Swiss Medical Forum

Hépatite D
En-Ling Leung Ki, Isabelle Pache, Darius Moradpour
Service de Gastroentérologie et d’Hépatologie, CHUV, Lausanne
CURRICULUM Forum Med Suisse 2009;9(9):184–187 184
reuse. Si sa prévalence a diminué dans les régions
endémiques classiques, on observe depuis quelque
temps un certain regain d’activité en Europe cen-
trale et du Nord en relation avec l’immigration de
patients en provenance surtout d’Europe de l’Est
et des Etats de l’ancienne Union soviétique. Nous
présentons ci-dessous quelques-uns des aspects
essentiels concernant la virologie et l’épidémio-
logie, l’évolution naturelle, ainsi que le traitement
et la prévention de l’hépatite D.
Virologie
Le virus de l’hépatite D (HDV) a été découvert en
1977 [1] et c’est en 1986 qu’il a été cloné et sé-
quencé [2]. Il s’agit d’un agent subviral, qui dépend
pour la production du virion des protéines de l’en-
veloppe (HBsAg) du virus de l’hépatite B (HBV),
dont la réplication proprement dite est cependant
indépendante du HBV (fig. 1 x) [3]. L’infection
HDV n’est par conséquent observée qu’en asso-
ciation avec une infection HBV. L’HDV possède un
génome fait d’un RNA circulaire à brin unique et
à polarité négative, d’une longueur de 1700 nucléo-
tides. C’est le plus petit génome viral capable
d’infecter l’homme. Compte tenu de sa variabilité
génétique, on distingue au moins trois géno-
types. Le génome viral ne code que pour deux pro-
téines, le grand et le petit antigène delta (195, resp.
214 acides aminés, 24 resp. 27 kDa). Le premier
nommé est indispensable à la réplication du gé-
nome viral et le second à la production du virion.
Une particularité du génome HDV est qu’il contient
un ribozyme, qui scinde le RNA par autocatalyse
et qui est indispensable à la réplication. La répli-
cation survient par synthèse d’un antigénome
complémentaire, à partir duquel est transcrit un
mRNA à cadre de lecture unique. Le mRNA code
pour les deux formes d’antigène delta, la trans-
lation du grand antigène delta s’effectuant par
RNA editing sous l’effet d’une enzyme cellulaire
(ADAR-1). Une série d’observations laissent à
penser que le HDV s’est développé au cours de
l’évolution à partir du transcriptome humain [4].
On peut dire, en résumé, que la réplication du HDV
dépend pour une large part de la cellule hôte. Le
ribozyme constitue la seule activité catalytique co-
dée par le virus. Toutes les autres fonctions cata-
lytiques sont mises à disposition par la cellule
infectée. Il est donc très difficile de développer
des inhibiteurs spécifiques de la réplication du
HDV.
Introduction
L’hépatite D chronique est la forme la moins
fréquente des hépatites virales chroniques, mais
également celle dont l’évolution est la plus dange-
Vous trouverez les questions à choix multiple concernant cet article à la page 179 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.
Quintessence
L’hépatite D chronique est la forme la moins fréquente, mais la plus sévère
des hépatites virales chroniques.
L’hépatite D ne s’observe qu’en combinaison avec une infection par le virus
de l’hépatite B (HBV).
Chaque patient dont l’antigène HBsAg est positif doit être mis au bénéfice
d’un dépistage sérologique à la recherche d’une co-infection par le virus de l’hé-
patite D (HDV).
Une hépatite D chronique doit être plus particulièrement recherchée dans les
situations suivantes: hépatite active avec HBsAg positif et HBV DNA faible ou in-
détectable, exacerbation d’une hépatite B chronique avec anticorps IgM anti-HBc
négatif, hépatite B aiguë sévère ou fulminante.
Le traitement actuel consiste en l’administration d’interféron-apégylé. Ce
traitement n’est cependant curatif que chez 20% des patients environ.
Une transplantation hépatique doit être envisagée chez les patients ayant une
cirrhose avancée ou un carcinome hépatocellulaire d’extension limitée.
Les mesures préventives contre l’hépatite D sont les mêmes que celles contre
l’hépatite B.
Summary
Hepatitis D
Chronic hepatitis D is the least frequent albeit most severe form of chronic
viral hepatitis.
Hepatitis D is only seen in patients infected with the hepatitis B virus (HBV).
Every HBsAg-positive patient should be screened for concurrent hepatitis D
virus (HDV) infection. Anti-HDV serology is the screening test of choice.
Hepatitis D should in particular be searched for in the following situations:
active hepatitis with positive HBsAg and low or undetectable HBV DNA, flare
of a chronic hepatitis B with negative anti-HBc IgM, acute severe or fulminant
hepatitis B.
The current standard treatment of hepatitis D consists of pegylated inter-
feron-
a
. Sustained virological response rates are approximately 20%.
Liver transplantation should be considered in patients with advanced
cirrhosis or limited hepatocellular carcinoma.
Preventive measure for hepatitis D are the same as for hepatitis B.
184-187 Leung Ki 170_f.qxp 12.2.2009 15:24 Uhr Seite 184

CURRICULUM Forum Med Suisse 2009;9(9):184–187 185
au cours de l’année écoulée, cinq sont originaires
d’Europe de l’Ouest ou d’un pays de l’ex-Union
soviétique (Roumanie, Albanie, Moldavie) et cinq
d’Afrique. Cinq autres patients ont été infectés par
le HDV dans le cadre d’une consommation de
drogues intraveineuses et seulement un patient
vient d’un pays méditerranéen (Italie).
Histoire naturelle
On distingue en principe la co-infection, au cours
de laquelle le HBV et le HDV sont transmis simul-
tanément, de la surinfection, qui décrit une infec-
tion de HDV surajoutée chez un patient déjà por-
teur du HBV (fig. 2 x) [5, 6]. L’hépatite aiguë peut
connaître une évolution sévère, voire fulminante
dans environ 5% des cas. En cas de lésions hépa-
tiques préexistantes, le taux d’hépatites fulmi-
nantes grimpe même à près de 20%. La co-infection
à l’âge adulte HBV et HDV aboutit souvent à l’éli-
mination spontanée des deux virus. La surinfec-
tion par le HDV passe en revanche à la chronicité
dans environ 90% des cas. Comme le HDV est en
règle générale dominant, on parle alors d’une hé-
patite D chronique.
L’évolution naturelle de l’hépatite D chronique et
les cofacteurs de la progression de la maladie n’ont
pas encore été suffisamment étudiés. L’hépatite D
chronique est habituellement caractérisée par une
progression rapide vers la cirrhose et par un haut
risque de dégénérescence vers un carcinome hépa-
tocellulaire (HCC). Les patients infectés tôt dans
l’enfance présentent ainsi souvent une cirrhose, si
ce n’est même un HCC, dès l’âge de 20 à 30 ans.
On connaît cependant également des cas d’évolu-
tion bénigne.
Une transplantation du foie peut être suivie d’une
infection HDV dite latente, au cours de laquelle le
HDV reste présent dans le greffon en l’absence de
récidive d’infection HBV manifeste. Dans ces cas,
on peut assister en cas d’échec de la prévention de
récidive de HBV (heureusement rares à l’heure ac-
tuelle) à une réactivation de l’hépatite D.
Les patients avec co-infection par les virus HBV,
HDV et le virus de l’hépatite C (HCV) avec ou sans
infection simultanée par le HIV, présentent un défi
Epidémiologie
Environ 5% des porteurs du HBV à travers le
monde sont co-infectés par le HDV, ce qui représente
15–20 millions de personnes, la prévalence locale
du HBV n’étant toutefois pas directement corrélée
à celle du HDV [5, 6]. A l’instar du HBV, le HDV est
transmis par voie parentérale. Grâce à l’améliora-
tion globale des mesures d’hygiène, au screening
systématique des produits sanguins, au dépistage
du HBsAg au cours de la grossesse, à la vaccina-
tion contre le HBV et aux mesures de prévention
du HIV, la prévalence de l’infection à HDV a nette-
ment diminué ces vingt dernières années dans les
régions endémiques classiques, en particulier dans
les pays méditerranéens [7]. On entend par ré-
gions endémiques classiques, les pays de la Médi-
terranée, mais aussi le Moyen-Orient, le bassin
amazonien, ainsi que l’Afrique centrale et l’Afrique
de l’Ouest.
Avec l’ouverture de l’Est et l’immigration croissante
en provenance de l’Europe de l’Est et des Etats
de l’ancienne Union soviétique, nous retrouvons
depuis quelques années chez nous un nombre
croissant de patients porteurs d’une hépatite D
chronique [8]. Les consommateurs de drogues par
voie intraveineuses ne sont par conséquent plus la
seule population à risque classique. Des 16 patients
atteints d’une hépatite D recensés dans notre centre
Figure 1
Représentation schématique des virus de l’hépatite B (HBV)
et de l’hépatite D (HDV). C, capside; dAg, antigène delta.
HBV HDV
RNA
DNA
ddAg
HBsAgHBsAg
C
Figure 2
Evolution de l’infection HDV. A: Co-infection HBV-HDV. B: Surinfection HDV. ALT = alanine aminotransférase.
AB
Mois Mois Années
Symptômes Symptômes
184-187 Leung Ki 170_f.qxp 12.2.2009 15:24 Uhr Seite 185

CURRICULUM Forum Med Suisse 2009;9(9):184–187 186
par le HDV active est confirmée par une RT-PCR
établissant la présence du HDV RNA dans le sé-
rum. On pensera aussi à différentes alternatives
comme la mise en évidence immunohistochimique
de l’antigène delta dans le matériel de biopsie de
foie (fig. 3 x) ou la recherche de l’IgM anti-HDV
signalant une infection active. Le HBV DNA sé-
rique est classiquement bas ou négatif dans l’hé-
patite D chronique. La virémie HDV peut varier de
plusieurs niveaux de log, sans qu’elle soit corrélée
de façon certaine avec l’activité de la maladie ou
avec le taux de réponse au traitement antiviral.
L’HBeAg est typiquement négatif, l’anti-HBe posi-
tif.
Une biopsie de foie est fortement conseillée, car
elle permettra d’objectiver le degré de l’activité
inflammatoire et de la nécrose (grading), ainsi que
le stade de fibrose (staging), et de documenter les
cofacteurs éventuellement présents (par ex. alcool,
surcharge martiale, «non alcoholic fatty liver di-
sease» [NAFLD]).
Tr aitement
Les possibilités de traitement d’une hépatite D
chronique restent malheureusement encore limi-
tées à l’heure actuelle [9]. Comme la réplication du
HDV et la production du HBsAg sont toutes deux
des processus qui se déroulent indépendamment
de la reverse transcriptase/DNA polymérase du
HBV, les analogues nucléos(t)idiques agissant sur
le HBV dont nous disposons aujourd’hui sont ino-
pérants. Les études avec l’interféron-a(IFN-a)
conventionnel ont montré que des dosages plus
élevés et des durées de traitement plus longues que
ceux utilisés dans l’hépatite B chronique sont
nécessaires et que, malgré cela, les rechutes sont
fréquentes à la fin du traitement. Des rémissions
prolongées ont néanmoins été observées chez cer-
tains patients [10]. Ces cas sont d’ailleurs aussi in-
téressants dans la mesure où on observe une nette
régression de la fibrose hépatique documentée ini-
tialement.
Des études récentes avec l’interféron-apégylé
(PEG-IFN-a) aux doses utilisées dans le traitement
de l’hépatite B et C chronique sur une durée d’un
an ont trouvé des taux de réponse de l’ordre de
20% (fig. 4 x) [11–14]. Le PEG-IFN-apendant au
moins un an est par conséquent le traitement re-
commandé à l’heure actuelle. Le PEG-IFN-a2a est
approuvé aujourd’hui en Suisse dans le traitement
de l’hépatite B chronique, mais le traitement de
l’hépatite D chronique ne figure pour l’instant pas
spécifiquement dans les indications reconnues.
Les essais cliniques sur la combinaison d’IFN-aou
PEG-IFN-aavec un analogues nucléos(t)idiqe agis-
sant contre le HBV ou avec la ribavirine n’ont pas
montré à ce jour d’amélioration par rapport à une
monothérapie d’IFN-aou de PEG-IFN-a.
Les endpoints du traitement de l’hépatite D ne sont
pas encore assez clairement définis. Les essais
évoqués ci-dessus avec le PEG-IFN-aont consi-
déré un HDV RNA négatif à six mois comme un cri-
clinique particulier. Le HDV ou le HCV peut alors
constituer le virus dominant.
Diagnostic
L’infection HDV est souvent méconnue dans la pra-
tique clinique. On recherchera la présence de
l’anticorps anti-HDV signant la présence d’une
infection HDV chez chaque patient avec HBsAg
positif nouvellement documenté. Cette détermi-
nation est automatiquement réalisée dans notre
centre devant tout nouveau cas de HBsAg positif.
Une possible hépatite D chronique doit être évo-
quée plus particulièrement en présence d’une hé-
patite très active avec HBsAg positif et HBV DNA
bas ou négatif (fig. 2). On pensera en particulier à
une surinfection à HDV en cas d’exacerbation IgM
anti-HBc négative chez des patients avec infection
HBV chronique connue. Enfin, on recommande la
recherche des anticorps anti-HDV dans les formes
sévères ou fulminantes d’hépatite B aiguë.
La mise en évidence à des fins de dépistage des
anticorps anti-HDV est utile et fiable. Une infection
Figure 3
Mise en évidence immunohistochimique de l’HBsAg (A) et de l’antigène delta (B). Biopsie du foie
chez une jeune patiente avec hépatite D chronique. Le HBsAg est localisé dans le cytoplasme des
hépatocytes, alors que l’antigène delta se situe dans le noyau cellulaire. Gracieusement mis à dis-
position par le Prof. Luigi Terracciano, Institut de pathologie de l’Université de Bâle.
AB
Figure 4
Résultats du traitement de l’hépatite D chronique par l’interféron-apégylé (PEG-IFN-a). Les réfé-
rences entre les crochets concernent la liste bibliographique. Ni la combinaison avec la ribavirine
dans l’étude de Niro et al., ni la combinaison avec l’adéfovir dans l’essai HIDIT- 1 n’ont représenté
une amélioration par rapport à une monothérapie de PEG-IFN-a.
43%
21% 17%
~25%
60
50
40
30
20
10
0
Castelnau [12]
PEG-IFN-aa2b
pendant 12 mois
n = 14
Erhardt [11]
PEG-IFN-aa2b
pendant 48 semaines
n = 12
Niro [13]
PEG-IFN-aa2b
Ribavirin
pendant 72 semaines
n = 38
HIDIT [14]
PEG-IFN-aa2a
Adefovir
pendant 48 semaines
n = 61
Réponse persistante (%)
184-187 Leung Ki 170_f.qxp 12.2.2009 15:24 Uhr Seite 186

CURRICULUM Forum Med Suisse 2009;9(9):184–187 187
Les patients atteints d’une cirrhose du foie néces-
sitent un suivi régulier par des ultrasons de l’ab-
domen et des dosages de l’AFP tous les six mois
pour le dépistage du HCC.
Prévention
Comme la transmission du HDV est semblable à
celle du HBV, les mesures de prévention sont les
mêmes pour les deux virus. Elles comprennent,
outre la vaccination contre le HBV, qui protège
contre les deux virus, un screening systématique
des produits sanguins, un dépistage du HBsAg au
cours de la grossesse et les mesures de prévention
de l’infection par le HIV.
Résumé et perspectives
Bien que l’hépatite D ait connu ces dernières
années un regain d’importance dans notre pays,
elle est souvent méconnue dans la pratique cli-
nique. Certains aspects importants de la virologie
moléculaire et de la pathogenèse, de même que
de l’évolution naturelle n’ont pas encore été tirés
au clair. De plus, il n’existe que peu de données
actuelles sur l’épidémiologie en Europe. La standar-
disation du diagnostic, une meilleure compréhen-
sion de la signification des différents génotypes du
HDV, ainsi que l’optimisation des traitements ac-
tuellement disponibles revêtent une importance
particulière. De nouvelles stratégies thérapeu-
tiques devront néanmoins être développées pour
améliorer les taux de réponse encore toujours in-
suffisants.
tère de réponse durable au traitement. En ce qui
concernele devenir àlong terme,on ne disposetou-
tefois que de quelques données isolées chez des pa-
tients sous traitement conventionnel d’IFN-a[10].
Il est vrai qu’on a pu documenter chez certains de
ces patients une réponse biochimique et histolo-
gique durable même en cas de persistance du virus.
Une détermination quantitative du HDV RNA tous
les 3 à 6 mois peut être recommandée à titre de
monitoring durant le traitement. Il n’existe cepen-
dant pas de «stopping rules», comme c’est le cas
dans le traitement de l’hépatite C chronique. Nous
mettons fin au traitement lorsque la virémie ne s’est
pas modifiée après un an. Comme on le constate
aussi dans l’hépatite B chronique, ces patients
peuvent manifester une réponse tardive survenant
dans les 6 à 12 mois après l’interruption du trai-
tement (late response). Une négativation du HDV
RNA ou une réduction de plus de trois logs de ce
dernier après six mois de traitement constitue un
facteur prédictif positif [11, 12]. Chez ces patients
aussi nous interrompons le traitement au bout
d’un an. Lorsque le HDV RNA se négativise plus
tardivement dans l’évolution de la maladie, on
peut prendre en considération une prolongation
de la thérapie en fonction de la tolérance et en ac-
cord avec la caisse-maladie.
Le dosage quantitatif du HBsAg pour le suivi du
traitement est encore en cours d’évaluation [15].
Pour les patients avec cirrhose avancée et/ou un
HCC, remplissant les critères dits de Milan (un no-
dule de <5 cm ou 93 nodules de <3 cm), la greffe
du foie est une bonne option thérapeutique, car on
est aujourd’hui en mesure de prévenir efficace-
ment et de façon fiable les récidives d’infections à
HBV et donc à HDV dans le greffon, grâce aux im-
munoglobulines et aux analogues nucléos(t)ides.
Références
1Rizzetto M, Canese MG, Arico S, Crivelli O, Trepo C, Bonino
F, et al. Immunofluorescence detection of new antigen-
antibody system (delta/anti-delta) associated to hepatitis B
virus in liver and in serum of HBsAg carriers. Gut. 1977;
18:997–1003.
2Wang KS, Choo QL, Weiner AJ, Ou JH, Najarian RC, Thayer
RM, et al. Structure, sequence and expression of the hepa-
titis delta viral genome. Nature. 1986;323:508–14.
3Taylor JM. Hepatitis delta virus. Virology. 2006;344:71–6.
4Salehi-Ashtiani K, Luptak A, Litovchick A, Szostak JW. A
genomewide search for ribozymes reveals an HDV-like
sequence in the human CPEB3 gene. Science. 2006;313:
1788–92.
5Farci P. Delta hepatitis: an update. J Hepatol. 2003;39:
S212–S219.
6Rosina F, Rizzetto M. Epidemiology and natural history of
hepatitis D. In: Thomas HC, Lemon SM, Zuckerman AJ,
eds. Viral hepatitis. Third ed. Oxford, UK: Blackwell, 2005;
583–92.
7Gaeta GB, Stroffolini T, Chiaramonte M, Ascione T, Stor-
naiuolo G, Lobello S, et al. Chronic hepatitis D: a vanishing
disease? An Italian multicenter study. Hepatology. 2000;32:
824–7.
8Wedemeyer H, Heidrich B, Manns MP. Hepatitis D virus
infection – not a vanishing disease in Europe! Hepatology.
2007;45:1331–2.
9Farci P, Chessa L, Balestrieri C, Serra G, Lai ME. Treatment
of chronic hepatitis D. J Viral Hepat. 2007;14(Suppl 1):58–63.
10 Farci P, Roskams T, Chessa L, Peddis G, Mazzoleni AP,
Scioscia R, et al. Long-term benefit of interferon alpha ther-
apy of chronic hepatitis D: regression of advanced hepatic
fibrosis. Gastroenterology. 2004;126:1740–9.
11 Erhardt A, Gerlich W, Starke C, Wend U, Donner A, Sagir A,
et al. Treatment of chronic hepatitis delta with pegylated
interferon-alpha2b. Liver Int. 2006;26:805–10.
12 Castelnau C, Le Gal F, Ripault MP, Gordien E, Martinot-
Peignoux M, Boyer N, et al. Efficacy of peginterferon alpha-
2b in chronic hepatitis delta: relevance of quantitative
RT-PCR for follow-up. Hepatology. 2006;44:728–35.
13 Niro GA, Ciancio A, Gaeta GB, Smedile A, Marrone A,
Olivero A, et al. Pegylated interferon alpha-2b as mono-
therapy or in combination with ribavirin in chronic hepa-
titis delta. Hepatology. 2006;44:713–20.
14 Wedemeyer H, Yurdaydin C, Dalekos G, Erhardt A,
Cakaloglu Y, Degertekin H, et al. 72 week data of the HIDIT-1
trial: a multicenter randomised study comparing peginter-
feron alpha-2a plus adefovir vs. peginterferon alpha-2a plus
placebo vs. adefovir in chronic delta hepatitis. J Hepatol.
2007;46(Suppl 1):S4.
15 Manesis EK, Schina M, Le Gal F, Agelopoulou O, Papaioan-
nou C, Kalligeros C, et al. Quantitative analysis of hepatitis D
virus RNA and hepatitis B surface antigen serum levels in
chronic delta hepatitis improves treatment monitoring.
Antivir Ther. 2007;12:381–8.
Correspondance:
Prof. Dr Darius Moradpour
Service de Gastroentérologie
et d’Hépatologie
CHUV
BU44/07/2421
Rue du Bugnon 44
CH-1011 Lausanne
Darius.Moradpour@chuv.ch
184-187 Leung Ki 170_f.qxp 12.2.2009 15:24 Uhr Seite 187
1
/
4
100%