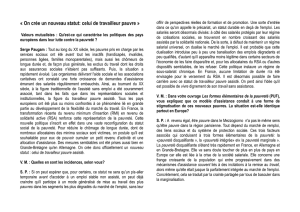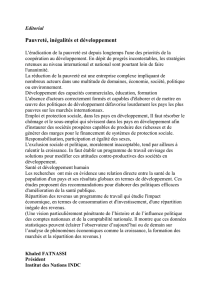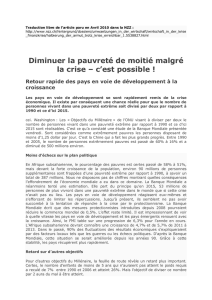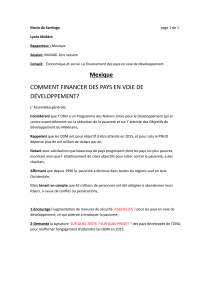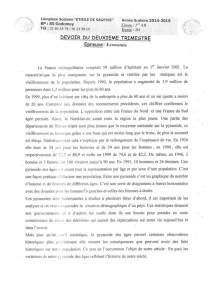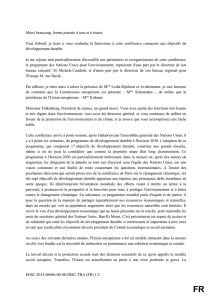Serge Paugam et Nicolas Duvoux, La régulation des pauvres

Lorsque les aides cessent, les personnes sont alors
confrontées à un cumul de handicaps, à une série
d’échecs pouvant conduire à rompre le lien social.
Par l’inscription dans la notion de « parcours » qui
permet de prendre en compte l’ensemble des élé-
ments constitutifs de la vie des individus, le rapport
à l’emploi prend une place centrale dans la
réflexion de S. Paugam. Dans sa nouvelle préface,
il insiste sur le fait que la pauvreté n’est plus une
pauvreté strictement monétaire mais que sa « par-
ticularité », en quelque sorte, est d’être liée à la
question de la stabilité de l’emploi. En outre, cette
pauvreté est également relationnelle et cumule
bien souvent des problèmes de santé et des diffi-
cultés d’accès au logement. La disqualification
sociale ne concerne plus seulement les individus
« privés » d’emploi mais désormais aussi les sala-
riés précaires. Ainsi, le sociologue critique-t-il
le terme « Rmiste » qui installe l’individu qui le
perçoit dans un certain statut venant s’opposer en
quelque sorte au type idéal de l’intégration, défini
«comme la double assurance de la reconnais-
sance matérielle et symbolique du travail et de la
protection sociale qui découle de l’emploi »
(p. XVI). Aujourd’hui, S. Paugam propose trois
types de déviation face à ce modèle idéal d’inté-
gration :
•l’intégration incertaine : satisfaction au travail et
instabilité de l’emploi ;
•l’intégration laborieuse : insatisfaction au travail
et stabilité de l’emploi ;
•l’intégration disqualifiante : insatisfaction au
travail et instabilité de l’emploi.
Selon S. Paugam, la pauvreté disqualifiante est
désormais devenue une configuration sociale
durable encouragée par les dispositifs publics
reposant sur une « fausse » solidarité. Le sociolo-
gue dénonce les logiques qui visent à mettre les
« pauvres » à tout prix sur le marché du travail en
les incitant à accepter n’importe quel emploi ; ils
occupent alors, le plus souvent, des emplois peu
attractifs en termes de salaire et de conditions de
travail. Une perspective basée sur les analyses
économiques ou une dimension comparative
aurait sans doute mérité d’être articulée au
propos. Quoiqu’il en soit, cette nouvelle préface
offre ainsi au sociologue l’opportunité de vives
critiques du revenu de solidarité active (RSA).
Avec le RSA, S. Paugam considère que l’on a créé
le statut de travailleur précaire assisté et craint
que ce revenu ne participe à un mode généralisé
de mise au travail des plus pauvres dans les seg-
ments les plus dégradés du marché de l’emploi.
Le risque est de créer du précariat, c’est-à-dire
une installation durable dans la précarité qui
amène à interroger les différents modèles d’inté-
gration. Au-delà de la critique, le RSA méritera
sans doute de réinterroger ce qui est au cœur de
la thèse du chercheur, à savoir la relation d’inter-
dépendance entre la catégorie des pauvres et les
services sociaux susceptibles de leur apporter une
aide (p. XII).
Sandrine Dauphin
Rédactrice en chef
Politiques sociales et familiales n° 98 - décembre 2009
112 Comptes rendus de lectures
Le format utilisé dans cet ouvrage est plutôt inhabi-
tuel : il s’agit d’un dialogue entre deux sociologues
spécialistes de l’exclusion. Sous-titré « Du RMI au
RSA », il prend appui sur les thèses de Serge Paugam
et Nicolas Duvoux réalisées à vingt ans d’écart lors,
précisément, de la mise en place de ces deux pres-
tations. Ces deux travaux, dont le premier traite du
statut et de l’identité des pauvres à Saint-Brieuc et
le second des politiques d’insertion à Paris, compor-
tent de grandes similitudes : portant sur les relations
entre les pauvres et les dispositifs d’insertion qui leur
sont adressés, les auteurs s’appuient sur un corpus
d’entretiens auprès de bénéficiaires. Au-delà d’un
rapport maître-disciple – S. Paugam est le direc-
teur de thèse de N. Duvoux –, l’ouvrage comporte
une mise en perspective des résultats respectifs des
deux chercheurs, une discussion sur l’actualité des
politiques d’insertion et une réflexion sur la place
du sociologue dans la société. Il est composé, de
façon didactique, autour de cinq chapitres.
Serge Paugam et Nicolas Duvoux
LLaarréégguullaattiioonnddeessppaauuvvrreess
DDuuRRMMIIaauuRRSSAA
2008, Paris, PUF, collection Quadrige – essais débats, 114 pages.

Le premier chapitre, intitulé « À quoi servent les
pauvres ? » s’interroge sur la signification de la pau-
vreté. Dépassant les débats sur les modalités de
mesure de la pauvreté, les sociologues se position-
nent résolument dans le sillage de Georg Simmel (1),
sur une définition relationnelle de la pauvreté :
sont pauvres les individus que la société considère
comme tels et auxquels elle apporte son soutien
pour cette raison. Au-delà du nombre de pauvres,
c’est donc la signification de cette catégorie
sociale qui intéresse S. Paugam et N. Duvoux et, à
ce titre, ils soulignent la dimension multiple de la
pauvreté, notamment les problématiques relation-
nelles. Ainsi, selon eux, la pauvreté a une utilité
dans la société. D’un point de vue économique,
l’existence de pauvres garantit la possibilité du
recours à une main-d’œuvre peu coûteuse. D’un
point de vue social, la pauvreté offre à l’ensemble
de la société un statut enviable de non-pauvres.
Constatant par ailleurs le retour d’une certaine
forme de philanthropie (via les ONG notamment),
les deux sociologues soulignent que l’assistance
permet de garantir la moralité et le sens de la cha-
rité du donateur. En somme, la société n’aurait pas
intérêt à traiter de façon trop radicale la pauvreté,
qui remplit une mission sociale.
Dans un deuxième chapitre, les auteurs soulèvent
un paradoxe : alors que, depuis les années 1970,
le nombre de pauvres diminue, le sentiment
commun pense le contraire. Plusieurs phénomènes
justifient ce mouvement contradictoire en appa-
rence. La pauvreté d’antan était celle des personnes
âgées ; une redistribution sociale efficace en
termes de retraites pouvait combler le problème.
Aujourd’hui, les formes nouvelles de la pauvreté
touchent des publics plus divers ; il semble même
qu’elle puisse concerner tout le monde ; par
ailleurs, alors qu’au-delà de la pauvreté moné-
taire, la pauvreté est aujourd’hui pluridimension-
nelle, sa solution semble moins évidente. Repre-
nant sa typologie devenue classique, S. Paugam
distingue à ce propos la pauvreté intégrée des
pays où le nombre de pauvres est important mais
où ils sont intégrés à la vie sociale, la pauvreté
marginale où le nombre de pauvres est faible et où
ils sont traités par l’assistance, formant les marges
de la société, et la pauvreté disqualifiante, où le
traitement de la pauvreté ne parvient pas à libérer
les individus du stigmate de leur position sociale.
Notre société corporatiste conduirait plutôt à ce
troisième type de pauvreté, dans un contexte
d’échec des politiques d’insertion menées depuis
vingt ans.
Le troisième chapitre aborde plus précisément
l’usure de la compassion. Sous ce vocabulaire
réside une interprétation commune croissante
de la pauvreté par des facteurs individuels (la
paresse), au détriment de facteurs causaux sociaux
(l’injustice). Les périodes de reprise économique
sont particulièrement propices à ce type d’analyse
(il suffirait de chercher du travail). Aujourd’hui, le
développement du temps partiel, qui déplace la
norme du travail à un demi-SMIC, la comparaison
financière du montant du revenu minimum d’in-
sertion avec le salaire des travailleurs précaires, la
valorisation médiatique de la fraude, tendent à
délégitimer l’action publique auprès des publics
vulnérables, dont l’hétérogénéité est très mal
retranscrite dans le débat public. Ce mouvement
de culpabilisation est si important que les béné-
ficiaires eux-mêmes intériorisent cette nouvelle
contrainte d’injonction à l’autonomie. Selon les
auteurs, la responsabilisation des bénéficiaires ne
doit toutefois pas conduire à une déresponsabili-
sation de la société vis-à-vis d’eux. Les individus
doivent pouvoir compter, de la part de la société,
sur la protection (compter sur) et sur la reconnais-
sance (compter pour). Ainsi, le développement de
la responsabilité individuelle ne peut se faire sans
que la société elle-même donne à chacun les possi-
bilités de réaliser ses projets, liberté que l’écono-
miste Amartya Sen a théorisé sous le vocable de
« capabilité » (2).
Dans un quatrième chapitre est abordée la question
des territoires de la solidarité, et du rôle de l’État.
Pour S. Paugam et N. Duvoux, si elle ne repré-
sente pas en soi un désengagement des pouvoirs
publics, la décentralisation pose trois types de
problèmes. Le premier est celui de la séparation
du traitement des pauvres de celui de l’ensemble
de la société. Selon les deux sociologues, les doc-
trines du solidarisme impliquent que la pauvreté
concerne toute la société. Par ailleurs, faisant du
département le pivot des politiques d’insertion, la
décentralisation scinde la question sociale de la
question économique, traitée par la région. Enfin,
ce mouvement provoque une certaine inégalité
sur le territoire. Parallèlement à ce mouvement,
on assiste à une individualisation du vécu de l’ex-
clusion, a priori en tension avec la nécessité
étatique d’avoir, pour objectiver le soutien public,
des catégories de bénéficiaires. De ce fait, et alors
même que c’est toujours l’État qui détermine les
catégories de la solidarité, son rôle est de plus
en plus contesté, avec la multiplication des
niveaux d’interventions (de l’Europe à la commune).
C’est pourquoi la nécessité d’organiser ce « sys-
tème multisolidaire emboîté » (p. 80) leur semble
impérative.
Dans un cinquième chapitre, est traité le lien entre
l’assistance et l’emploi. Après une critique des
dispositifs d’insertion en général et du revenu de
Politiques sociales et familiales n° 98 - décembre 2009
113 Comptes rendus de lectures
(1) Simmel G., 1998, Les pauvres, édition allemande 1907, édition française Paris, PUF, Quadrige.
(2) Sen A., 2000, Repenser l’inégalité, Paris, Seuil.

solidarité active (RSA) en particulier, ce chapitre
part de l’idée que la fonction de l’assistance
sociale vis-à-vis du marché du travail diffère selon
la période économique. Dans les périodes de
repli économique, l’assistance vise la protection
des salariés ; dans les périodes de reprise, elle
poursuit plutôt l’incitation au travail. En quelque
sorte, le RSA comme le revenu minimum d’acti-
vité avant lui seraient des variables « d’ajuste-
ment économique » (p. 96). De ce fait, poussant
à l’extrême au travail, quel qu’en soit la qualité,
le RSA institutionnaliserait un sous-salariat. Il
s’instaurerait ainsi une dualisation de l’emploi
entre des salariés protégés et des travailleurs pré-
caires assistés, dualisation créée par le marché du
travail qui pousse à toujours plus de flexibilité et
favorisée par les dispositifs publics. Ce mouve-
ment d’activation des dépenses d’assistance et de
limitation des trappes à inactivité traverse certes
la plupart des pays industrialisés. Les auteurs y
distinguent toutefois deux modèles. Dans le
modèle libéral, les dispositifs incitent les person-
nes sans emploi à sortir de l’assistance par une
baisse de la protection ou une incitation financière
à la reprise d’emploi ; le workfare à l’américaine,
et les réformes allemandes font partie de ce
modèle, le RSA y est ici associé. Dans le modèle
nordique, l’incitation provient plutôt d’une indem-
nisation élevée des personnes sans emploi, un
accompagnement et un accroissement de la qua-
lification permettant de réinsérer les individus ;
protégés, les travailleurs seraient alors en mesure
d’accepter la flexibilité qui est recherchée par le
marché du travail. Même s’ils reconnaissent les
limites de ce modèle – difficulté à intégrer des
populations immigrées, recours au statut de han-
dicapé pour limiter le recours au chômage – et
les implicites culturels – forte confiance dans les
institutions, culture de la négociation, fort taux de
syndicalisation –, S. Paugam et N. Duvoux y voient
des implications possibles en France. Adapté à
notre modèle, ils imaginent que ce renouvelle-
ment de la pensée autour du concept d’« activa-
tion » pourrait se faire via le concept de sécurisa-
tion des parcours professionnels, garantissant à
l’individu rémunération et formation tout au long
de la vie, en échange d’une certaine flexibilisa-
tion du marché du travail.
Traversant tout l’ouvrage, et poursuivant la
réflexion initiée par S. Paugam dans RReeppeennsseerrllaa
ssoolliiddaarriittéé, est discutée la posture du sociologue et
son rôle dans la société. Les deux auteurs enta-
ment ce débat par une discussion sur la position
de chercheur face à un allocataire du RMI ; ils
constatent que la juste distance, entre l’empathie
et le recul, n’est pas aisée à trouver et que,
malgré eux, une certaine forme de domination
est exercée par l’intellectuel. Mais c’est en fin
d’ouvrage, après le cinquième chapitre qui se révèle
le plus engagé, que les sociologues discutent la
fonction de la sociologie comme une capacité à
décrire la complexité du monde. Si elle n’a pas
pour enjeu une critique des politiques contem-
poraines, la sociologie a néanmoins une mission
critique ; en cela elle « fait la chasse aux mythes »
(p. 114).
À la liste des atouts de ce court essai, on note tout
d’abord une écriture particulièrement agréable que
le format de dialogue, tout comme la présence
d’encadrés très pédagogiques, facilite. Cette confron-
tation permet d’aborder les principaux débats qui
traversent la politique d’insertion. Idéologiquement
très proches, les deux chercheurs font parfois
preuve de divergences, permettant au lecteur
d’accéder à un jugement cohérent mais nuancé.
Les lecteurs habituels de S. Paugam remarqueront
également le brio avec lequel il expose son chemi-
nement intellectuel, qui a considérablement
enrichi la sociologie de l’exclusion, lui permettant
de reconstruire un lien entre tous ses travaux. En
contrepartie, même si c’est le jeu d’un ouvrage
qui se veut synthétique, on regrettera une absen-
ce d’étayage de certaines opinions, notamment
lorsque les deux chercheurs sont en – relatif –
désaccord. À cet égard, l’attaque des médias sur le
thème de la fraude (p. 64) aurait mérité un déve-
loppement. Il semble que le juste équilibre entre
une analyse objective de la réalité et la défense de
certaines idées, notamment celle de solidarité, soit
délicat, et la frontière en est parfois franchie. Par
ailleurs, et dans la lignée des développements de
la dernière partie, on imagine aujourd’hui de nou-
veaux développements à ces travaux : un lien avec
les analyses économiques, notamment une ana-
lyse plus aboutie des réalités du monde de l’entre-
prise (qui complèterait le diptyque analytique :
bénéficiaire-dispositif d’insertion) pourraient être
des pistes à creuser dans le futur.
Delphine Chauffaut
CNAF – Responsable du département de l’Animation
de la Recherche et du Réseau des chargés d’études
Politiques sociales et familiales n° 98 - décembre 2009
114 Comptes rendus de lectures
1
/
3
100%