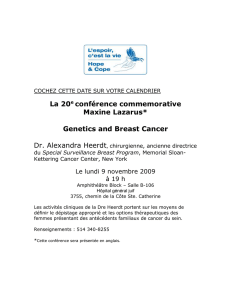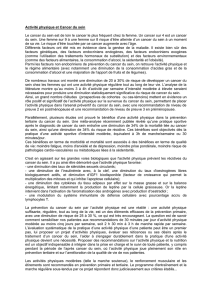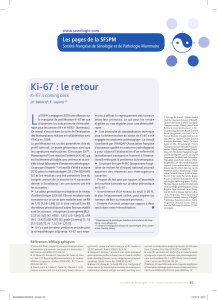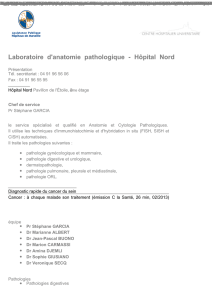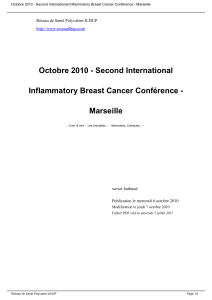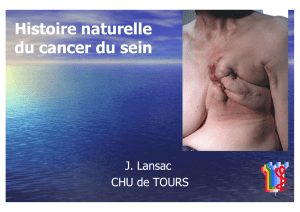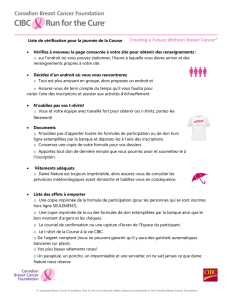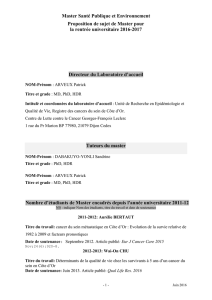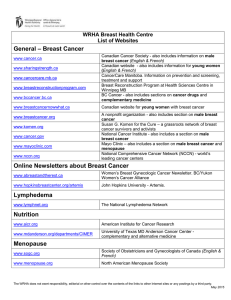Biologie tissulaire : facteurs de pronostic dans le cancer du sein.

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1 31
F. Descotes
Résumé
De par son incidence, le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent de la femme.
L’exploration de la biologie des tissus tumoraux a débuté, il y a plus de 30 ans, avec la découverte
du concept des récepteurs hormonaux qui a permis de rendre compte de l’hormonodépendance
des tumeurs. Par la suite, les recherches ont permis d’identifier un certain nombre d’autres fac-
teurs biologiques responsables des modalités évolutives des tumeurs mammaires en raison de leur
implication dans les mécanismes de la progression tumorale. Ces facteurs tissulaires représentent
des caractères biologiques mesurables dont le rôle est connu soit dans les mécanismes propres de
la prolifération cellulaire soit dans les réactions paracrines avec les cellules de l’environnement
(activité protéasique ou angiogénique) qui participent à l’extension locale et métastatique.
Outre leur intérêt pronostique, on envisage désormais que certains de ces facteurs biolo-
giques puissent être considérés comme des cibles thérapeutiques ce qui permettrait de freiner leur
activité.
Cancer du sein / Pronostic / Prolifération / Invasion
Correspondance : Françoise Descotes - Service de Techniques Nucléaires & Biophysiques - Unité In Vitro - Pavillon 3B,
Centre Hospitalier Lyon Sud - 69495 Pierre Bénite Cedex
Tel : 04 78 86 21 50 - Fax : 04 78 86 32 63 - E-mail : fr[email protected]
Biologie tissulaire : facteurs de pronostic dans le cancer du sein.
Françoise Descotes Service de Techniques Nucléaires & Biophysiques - Unité In Vitro -
Pavillon 3B - CHU Lyon Sud - Pierre Bénite.
INTRODUCTION
ðLe cancer du sein est le cancer le
plus fréquent chez la femme : 34 000
nouveaux cas ont été observés en
France en 1995 et son incidence est
en augmentation constante (60 % en-
tre 1975 et 1995). C’est ce qui expli-
que que, malgré les progrès dans la
prise en charge de ces malades et
l’amélioration globale de la survie, il
soit responsable de 19 % des décès
par cancer chez la femme (données
fournies par l’INSERM).
La dissociation entre l’augmentation
de l’incidence et celle de la morta-
lité est significative d’une améliora-
tion notable du taux de curabilité.
Celle ci tient à plusieurs facteurs : en
premier lieu, des diagnostics de tu-
meurs opérables à des stades beau-
coup plus précoces, conséquence à
la fois de l’éducation sanitaire des
femmes, de la vigilance des médecins
spécialisés et de l’amélioration des
moyens techniques de diagnostic
(mammographies plus performantes,

Biologie tissulaire : facteurs de pronostic dans le cancer du sein
Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1
32
échographies). En second lieu, les in-
dications et les protocoles thérapeu-
tiques ont été rationalisés et généra-
lisés. Ces derniers ont bénéficié de
l’exploration de la biochimie des tis-
sus tumoraux en relation avec les
aspects cliniques, le cancer du sein
étant le modèle de tumeurs solides
qui a sans doute été le plus étudié.
Les recherches ont démontré la va-
riabilité individuelle quantitative des
activités qui sous-tendent les méca-
nismes eux-mêmes de la progression
tumorale. Les premières études ont
montré que les informations les plus
significatives sont celles qui tradui-
sent le taux de division cellulaire, la
capacité de dissociation du tissu et
l’activité angiogène. Ces activités sont
maintenant mesurables avec préci-
sion dans une très petite masse tissu-
laire, ce qui permet d’établir une vé-
ritable carte d’identité tumorale.
L’intérêt est double puisque les in-
formations fournies sont non seule-
ment des indicateurs de risque de
récidives mais également des indica-
teurs de la nature de l’activité biolo-
gique impliquée dans ce risque et
qu’il convient, le cas échéant de ré-
duire.
L’information clinique clé qui a servi
jusqu’à présent de critère de choix
des indications thérapeutiques (chi-
rurgie, radiothérapie, traitements mé-
dicaux) est celle liée à la classifica-
tion "TNM" de l’O.M.S. qui permet
d’évaluer de façon reproductible l’ex-
tension locorégionale, c’est-à-dire les
dimensions tumorales et le degré
d’envahissement ganglionnaire axil-
laire et/ou mammaire interne. Elle
inclut maintenant l’information
histopathologique (pTNM).
En effet, sur l’ensemble des popula-
tions traitées, il existe une relation très
forte entre le degré d’extension
locorégionale au moment du traite-
ment initial et le risque d’une évolu-
tion secondaire. Mais l’étude des ob-
servations individuelles de tumeurs
opérables montre que cette corréla-
tion est prise en défaut dans nombre
de cas où l’on observe, au cours de
l’évolution, des discordances avec le
pronostic initialement supposé,
1) évolution plus favorable qu’atten-
due des tumeurs T2-T3 accompa-
gnées d’un faible envahissement gan-
glionnaire, 2) évolution métastatique
de tumeurs T1 ou T2 plus fréquente
que ne laissait prévoir l’envahisse-
ment ganglionnaire, et ce malgré les
traitements adjuvants standards,
3) évolution métastatique après 5 ans
de 20 % des tumeurs T1-T2 de moins
de 3 cm et sans envahissement gan-
glionnaire.
Pour pallier les 2 dernières éventua-
lités, plusieurs lignes thérapeutiques
ont été mises en œuvre qui visent à
alourdir les programmes de chimio-
thérapie dans un cas et à introduire
dans l’autre une chimiothérapie de
principe même en l’absence de gan-
glions envahis. Les essais n’ont pas
apporté le bénéfice clinique attendu.
En effet il s’avère que le traitement
appliqué est insuffisant ou inappro-
prié pour certaines tumeurs ; pour
d’autres au contraire (80 % des tu-
meurs sans envahissement ganglion-
naire), le traitement chimiothérapeu-
tique est inutile tandis qu’il est mon-
tré qu’il augmente le risque d’induc-
tion d’une autre tumeur (cf. mise en
garde récente de l’AFSSAPS concer-
nant les indications de la
Novantrone™ dans le cancer du sein)
[1].
JUSTIFICATION DE L’IDENTIFI-
CATION DE NOUVEAUX FACTEURS
DE PRONOSTIC DANS LE CANCER
DU SEIN
ðL’établissement du stade d’exten-
sion d’une tumeur était jusqu’à pré-
sent basé sur les informations clini-
ques et les données morphologiques
histopathologiques. Les discordances
sont devenues beaucoup plus évi-
dentes au cours de la dernière décen-
nie en raison de la proportion rela-
tive bien plus élevée qu’autrefois de
tumeurs traitées au stade T1N0. Les
critères de la classification "TNM" sont
devenus insuffisants. Si une tumeur
récidive à distance après que la tota-
lité de la lésion initiale ait été enle-
vée, cela signifie que l’essaimage s’est
produit précocement, en dehors des
relais ganglionnaires. La tumeur pré-
sente donc dès le début les proprié-
tés biologiques caractéristiques res-
ponsables de ce phénomène d’essai-
mage.
Si l’on met à part les altérations géni-
ques et les fonctions qui ont permis
l’induction de la tumeur, l’évolution
de celle ci est conditionnée par deux
types d’anomalies.
1) Celles qui contribuent à la perte
de contrôle de la division cellulaire,
ces anomalies concernent les cellu-
les tumorales elles-mêmes.
2) Celles qui contribuent à l’altération
de l’environnement proche de la tu-
meur pour lui permettre d’essaimer.
Ces anomalies ont leur origine dans
des altérations des cellules tumora-
les elles-mêmes mais elles affectent
les cellules environnantes permettant
aux cellules tumorales d’essaimer
soient par voie lymphatique soit par
voie métastatique. Les anomalies que
l’on peut identifier, qu’elles soient
quantitatives ou qualitatives et qui
sont la conséquence de la tumori-
génèse, n’ont pas forcément une va-
leur pronostique. Très souvent, ces
anomalies accompagnent la tumeur,
elles la caractérisent mais elles n’ont
pas d’impact sur le pronostic.
Un bon candidat comme facteur bio-
logique de pronostic doit répondre
à certains critères. Il doit correspon-
dre à une activité biologique caracté-
risée et ayant un rôle identifié dans
les mécanismes de prolifération ou
d’invasion locale. De plus, il doit être
mesurable par une technique robuste,
fiable, contrôlée et répondant aux re-
commandations du GBEA (Guide de
Bonne Exécution des Analyses).
PREMIERS FACTEURS
BIOLOGIQUES IDENTIFIÉS
PRÉDICTIFS DE LA RÉPONSE THÉRA-
PEUTIQUE, LES RÉCEPTEURS
HORMONAUX
ðLe seul facteur biologique tissulaire
dont la signification pronostique ait
été validée dans le cancer du sein est
le contenu en récepteurs des hormo-
nes stéroïdiennes.

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1 33
F. Descotes
Ce sont les travaux de Jensen dès
1967 [2] qui ont permis de montrer
l’intérêt des récepteurs d’estrogènes
(RE) dans le cancer du sein. Ces ré-
cepteurs sont observés dans de nom-
breux organes cibles des estrogènes
et également dans des tissus non
estrogénodépendants. Différents ty-
pes de cancer expriment ces récep-
teurs sans que l’on ait pu mettre en
évidence de valeur pronostique. Ainsi
80 % des cancers de l’endomètre pré-
sentent des RE sans que l’hormono-
sensibilité de ce type de cancer ne
puisse être utilisée pour mettre en
place un traitement hormonal. Ce
n’est que dans le cancer du sein
qu’ils ont une signification pronosti-
que. Leur présence dans une tumeur
a permis de mettre en évidence
l’hormonosensibilité de cette tumeur.
La suppression de l’activité estrogéni-
que permet d'inhiber l’action prolifé-
rative des estrogènes et donc de frei-
ner la croissance cellulaire. A partir
de là, se sont développés des traite-
ments hormonaux de type anti-estro-
génique. En bloquant les sites récep-
teurs à l’aide de molécules comme
le Tamoxifène qui est un agoniste de
l'estradiol vis-à-vis de son récepteur,
on inhibe la prolifération cellulaire.
McGuire dès 1973 [3] montrait l’inté-
rêt des récepteurs de progestérone
(RPg) dont la synthèse est estrogéno-
dépendante. L’hormonosensibilité
d’une tumeur ne s’établit pas seule-
ment par la présence de RE mais en-
core faut-il qu’ils soient fonctionnels
(capables d’induire la synthèse de
protéine estrogénodépendante
comme les RPg). C’est donc la me-
sure des deux types de récepteurs RE
et RPg qui permet de le dire. En ce
qui concerne la mesure biologique,
il existe une adéquation entre la me-
sure du nombre de sites récepteurs
et l’évaluation de l’activité de la pro-
téine récepteur [4].
En 1996, Gustafsson [5] a identifié un
second isoforme appelé REβ en op-
position au REα (premier isoforme
identifié). Il existe une très grande ho-
mologie structurale du gène (96 %)
entre les deux isoformes. Les conte-
nus en REα et REβ seraient variables
suivant les tissus cibles. Il a été sug-
géré que le rapport des taux d’expres-
sion de REβ sur REα diminue durant
la tumorigénèse [6] ; REβ intervien-
drait comme un régulateur négatif du
REα [7]. La mesure de l’expression
de REα donne une réponse sur l’hor-
monosensibilité de la tumeur alors
que la mesure de l’expression de REβ
permettrait de prévoir l’échappement
aux traitements anti-estrogéniques [6],
le Tamoxifène n’ayant pas d’effet ago-
niste sur les REβ.
Actuellement, compte tenu que les
tumeurs sont diagnostiquées à des
stades de plus en plus précoces et
que dans ces stades le contenu en
récepteurs hormonaux est générale-
ment peu altéré, leur seule mesure
ne permet pas de distinguer les ma-
lades à haut risque de récidive.
AUTRES FACTEURS LIÉS À LA
CAPACITÉ DE PROLIFÉRATION
CELLULAIRE
Les facteurs de croissance et
leur récepteurs
ðLa prolifération cellulaire peut être
évaluée par l’étude de ses facteurs de
régulation que sont les hormones et
les facteurs de croissance. Les estro-
gènes influencent soit directement
soit indirectement la prolifération cel-
lulaire en modulant la production des
facteurs de croissance et l’expression
des récepteurs de ces facteurs de
croissance. Les facteurs de croissance
sont normalement produits par les
tissus dont ils assurent la régulation.
Ils ont un rôle dans l’entrée des cel-
lules dans le cycle cellulaire au mo-
ment opportun. Mais lorsque les fac-
teurs de croissance ou leur récep-
teurs sont produits à contre temps,
on parle de facteurs "transformants" ;
ils permettent l’expression de pro-
priétés en dehors d’un contexte nor-
mal. Ces activités inappropriées con-
tribuent au développement tumoral.
Parmi les facteurs de croissance étu-
diés, on peut citer EGF (Epidermal
Growth Factor) et TGFα (Transfor-
ming Growth Factor alpha). Ces deux
facteurs de croissance se lient au
même récepteur EGFR à la surface
des cellules cibles. EGF est exprimé
dans les cellules épithéliales du tissu
mou, il a un rôle dans les mécanis-
mes sécrétoires ou de lactation. Il in-
formerait sur la capacité de la tumeur
à maintenir des caractéristiques de
type normal. TGFα donne un reflet
de l’état prolifératif et transformé de
la cellule. Il aurait un rôle dans les
étapes précoces de la tumorigénèse
[8].
Dans le cancer du sein, les récepteurs
des facteurs de croissance comme
EGFR, IGFR (Insulin-like Growth Fac-
tor Receptor) n’ont pas montré de va-
leur pronostique. Par exemple, prati-
quement toutes les tumeurs du sein
expriment EGFR.
Les recherches se sont plus intéres-
sées aux protéines apparentées des
formes altérées de ces récepteurs. Par
exemple, HER-2/neu qui est un EGFR
tronqué est retrouvé surexprimé
dans 20 à 30 % des cancers du sein.
Sa valeur pronostique au moment du
diagnostic reste faible ; il serait sur-
tout informatif dans le sous-groupe
de patientes avec un envahissement
ganglionnaire. Il pourrait être un in-
dicateur de réponse à certaines chi-
miothérapies. Les tumeurs HER-2/neu
positives répondraient mieux aux
chimiothérapies incluant une
anthracycline. Ces tumeurs présente-
raient également une résistance ac-
crue à une hormonothérapie. Mais
l’intérêt majeur de ce facteur est sur-
tout lié au développement d’anti-
corps monoclonaux humanisés diri-
gés contre lui. La mesure de HER-2/
neu permet d’identifier les patientes
pouvant bénéficier de ce type de trai-
tement [9,10].
Evaluation du taux de prolifération
cellulaire
ðAu niveau de la prolifération cellu-
laire, le premier facteur qui ait été étu-
dié a été la vitesse d’augmentation du
volume de la tumeur, telle qu’elle
pouvait être autrefois appréciée cli-
niquement. En effet, même si de nom-
breux mécanismes entrent en jeu
dans la croissance tumorale, celle-ci
passe obligatoirement par une aug-
mentation du contingent cellulaire

Biologie tissulaire : facteurs de pronostic dans le cancer du sein
Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1
34
malin. La division cellulaire est nor-
malement régulée par de nombreux
facteurs externes différents suivant les
types cellulaires. Les cellules tumo-
rales peuvent rester sensibles à une
partie de ces facteurs mais, ce qui les
caractérise, c’est qu’elles ont perdu
les moyens cellulaires propres de
contrôle négatif et sont devenues
potentiellement "immortelles". En
conséquence, quel que soit le profil
des facteurs mis en jeu dans la crois-
sance de chaque tumeur, le taux de
division cellulaire représente la résul-
tante de l’activité de ces facteurs au
moment de l’examen. Différentes
approches sont possibles pour les
évaluer ; les unes et les autres ne sont
cependant significatives qu’au prix de
contrôle de qualité et de standardisa-
tion extrêmement strictes. On peut
mesurer de façon directe le nombre
de cellules tumorales en division ex-
primé en pourcentage d’une popula-
tion définie. Cette information est très
significative du pronostic. L’analyse
par cytométrie de flux, plus comple-
xe, est encore plus significative parce
qu’elle renseigne sur les anomalies
de la ploïdie [11,12]. C’est une mé-
thodologie lourde qui, s’appliquant
à des tumeurs solides, nécessite une
étape de dissociation cellulaire. Cette
technique ne peut être mise en œu-
vre que dans des centres spécialisés
ayant acquis, par une longue expé-
rience, la pratique de cette méthodo-
logie.
L’autre approche de l’évaluation du
taux de prolifération est la mesure
d’activités enzymatiques impliquées
dans la synthèse de l’ADN.
La thymidine kinase (TK) est l’en-
zyme qui intervient dans la voie de
récupération des bases pyrimidiques
issues de la dégradation de l’ADN. Il
existe plusieurs isoformes. C’est
l’isoforme TK1 qui est étudié ; il est
extrêmement élevé dans la phase G1-
S. Une valeur péjorative a été décrite
dans des tumeurs du sein pour des
concentrations élevées [13-16].
La thymidylate synthétase (TS) inter-
vient pour sa part dans la voie de novo
de néosynthèse des nucléotides, voie
impliquant des enzymes comme la
dihydrofolate réductase, cible du mé-
thotrexate par exemple. A coté de leur
signification pronostique aussi bien
pour TK que pour TS [16,17], l’étude
de ces activités permet de désigner
des cibles thérapeutiques privilégiées.
Selon la voie de synthèse de l’ADN
qui est sollicitée, on pourra privilé-
gier le médicament le mieux adapté.
FACTEURS LIÉS À LA CAPACITÉ
D’INVASION ET D’ANGIOGÉNÈSE
ðL’autre catégorie de propriétés bio-
logiques évaluées concerne les mé-
canismes d’invasion locale et/ou à
distance. L’activateur du plasmino-
gène de type urokinase ou uPA est
une protéase intervenant dans les mé-
canismes de dissolution de la matrice
extracellulaire lors des processus de
remodelage tissulaire au cours de la
cicatrisation. Dans les processus in-
vasifs, uPA a le même rôle d’activa-
tion du plasminogène que dans les
processus physiologiques de cicatri-
sation. Dans les mécanismes cancé-
reux, uPA est exprimé par les cellu-
les stromales au voisinage des cellu-
les tumorales et plus exactement par
les myofibroblastes. Il a été montré
dans plusieurs types de cancers dont
le cancer du sein, que la détermina-
tion de uPA par des méthodes bio-
chimiques sur un extrait cellulaire
avait une valeur pronostique de pre-
mière importance [18, 19].
L’inhibiteur de l’activateur du plasmi-
nogène de type 1 ou PAI-1 est un autre
candidat comme facteur pronostique.
Il aurait un rôle beaucoup plus com-
plexe que le seul rôle d’inhibiteur
d’uPA. Les premières hypothèses al-
laient dans le sens d’une inhibition
de la croissance tumorale ou de l’in-
vasion. Mais de nombreux travaux
suggèrent un rôle plus complexe de
PAI-1 dans l’apparition des métasta-
ses. Il doit certainement exister un
équilibre très sensible entre protéo-
lyse et inhibition. uPA et surtout PAI-
1 ont été définis comme des facteurs
indépendants de mauvais pronostic
dans le cancer du sein [20-25]. De-
puis 1990, aucune publication n’est
en contradiction avec ces données.
Il semblerait que ce soit surtout PAI-
1 qui soit le facteur le plus pertinent
en terme de pronostic [26-29]. Il reste
très significatif dans la population des
tumeurs sans envahissement gan-
glionnaire [30]. uPA et PAI-1 sont uti-
lisés comme paramètre de choix dans
l’essai européen Biomed-2 associés
à HER-2/neu [31]. Cet essai s’adresse
aux patientes sans envahissement gan-
glionnaire. Les taux d’uPA et de PAI-1
permettent de distinguer deux grou-
pes de patientes : 1) celles pour les-
quelles la tumeur présente des taux
faibles d’uPA et de PAI-1 et qui ne
bénéficieront pas de chimiothérapie
et 2) celles pour lesquelles on a un
taux élevé d’uPA et/ou de PAI-1 et qui
bénéficieront d’une chimiothérapie.
L’évaluation de HER-2/neu permet de
tester deux types de chimiothérapie
associant ou non une anthracycline.
D’autres protéases impliquées dans
les processus invasifs ont également
été étudiées. La stromélysine III est
exprimée dans 10 % des cancers in
situ et dans 65 % des cancers inva-
sifs. Elle présente donc une forte cor-
rélation avec la progression tumorale.
Son expression s’observe dans les cel-
lules stromales au voisinage des cel-
lules tumorales avec un gradient dé-
croissant du centre de la tumeur vers
la périphérie [32-34]. Pour les gélati-
nases, on observe une expression
croissante de la gélatinase A des can-
cers in situ vers les formes invasives
puis métastatiques [35].
L’angiogenèse est un processus com-
plexe par lequel de nouveaux vais-
seaux sont générés à partir de vais-
seaux préexistants. L’angiogenèse tu-
morale permet la vascularisation de
la tumeur pour que celle ci puisse
bénéficier de l’apport en oxygène et
en nutriments qui sont indispensa-
bles à une croissance rapide et aux
processus métastatiques. Les cellules
tumorales sécrètent des facteurs
angiogènes qui vont stimuler différen-
tes catégories de cellules stromales
et ceci pour permettre 1) une dégra-
dation de la matrice extracellulaire,
2) une lyse de la membrane basale
des capillaires lymphatiques et vas-
culaires et 3) une modification de la
perméabilité capillaire.
Ce processus aboutit à des échanges
cellulaires et à la prolifération des

Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique - 2002 - vol.26 - n°1 35
F. Descotes
cellules endothéliales des vaisseaux.
Cette néoangiogenèse qui se met en
place au voisinage de la tumeur va
alors faciliter la croissance tumorale
et faciliter l’essaimage des cellules tu-
morales par voie vasculaire. Cette
néoangiogenèse est régie par des ré-
gulateurs qui peuvent être soient
positifs comme VEGF (Vascular Endo-
thelial Growth Factor), bFGF (basic
Fibroblast Growth Factor), l’endothé-
line, soit négatifs comme la thrombo-
spondine, l’angiostatine ou le TGFβ
(Transforming Growth Factor béta)
[36]. Sont également impliqués dans
ce processus d’angiogenèse les inté-
grines qui sont des récepteurs de dif-
férents composés de la matrice ex-
tracellulaire comme la laminine, la
vitronectine, la fibronectine et le col-
lagène [revue dans 37]. Les mécanis-
mes de transduction liés à ces récep-
teurs entraînent l’induction de la syn-
thèse de collagènases, de stromély-
sines ou d’autres métalloprotéases
impliquées dans les processus de
dégradation de la matrice extracellu-
laire et donc, dans les processus in-
vasifs. L’angiogenèse est une nouvelle
voie de thérapie. En utilisant des mo-
lécules anti-angiogènes comme l’an-
giostatine, l’endostatine ou TIMP-2
(Tissue Inhibitor of MetalloProtei-
nase 2), on pourrait bloquer ce pro-
cessus. La principale protéine angio-
gène VEGF représente une cible thé-
rapeutique particulièrement intéres-
sante ; son blocage permettrait d’in-
duire l’apoptose des cellules tumo-
rales directement ou indirectement
en augmentant la sensibilité des cel-
lules aux thérapies hormonales et/ou
aux chimiothérapies [38].
CONCLUSION
ðLes perspectives de la biologie des
tissus tumoraux sont tout d’abord
d’ordre méthodologique.
La rt-PCR (reverse transcriptase-PCR)
en temps réel est une méthode quan-
titative qui permet d’évaluer l’expres-
sion génique. Comme les tumeurs
sont de plus en plus petites au mo-
ment du diagnostic, il est nécessaire
de s’orienter vers une méthodologie
nécessitant le moins de matériel tu-
moral possible pour l’étude d’un
maximum de paramètres. Cette mé-
thodologie est en cours de validation
pour les paramètres déjà évalués par
les méthodes biochimiques afin de
comparer les résultats obtenus par
ces deux méthodologies qui ne me-
surent pas la même chose : les mé-
thodes biochimiques mesurent l’ex-
pression protéique alors que la rt-PCR
mesure l’expression génique. Il existe
des automates très performants per-
mettant d’avoir une approche vrai-
ment quantitative. En complément, se
développent des techniques de mi-
crodissection permettant de sélec-
tionner les îlots de cellules tumora-
les.
Une autre approche est la carte
d’identité des tumeurs. Cette carte
d’identité concerne tout d’abord le
trtr
trtr
transcranscr
anscranscr
anscriptomeiptome
iptomeiptome
iptome. La technique fait ap-
pel à des biopuces d’ADN. L’étude du
transcriptome permettra d’établir un
profil d’expression de milliers de
séquences d’ARN. Sur des supports
de silice sont déposés quelques 8000
gènes et les développements techno-
logiques laissent supposer que l’on
pourra aller encore plus loin. De plus,
les systèmes de lecture et d’interpré-
tation évoluent très rapidement. Mais
à l’heure actuelle, ces biopuces d’un
coût encore élevé sont réservées à
des études ciblées. On ne peut pas
encore envisager de routine pour ces
méthodologies.
La 3ème approche avec l’étude du
protéomeprotéome
protéomeprotéome
protéome est encore plus promet-
teuse puisqu’elle permettra l’étude
de l’expression des protéines car ce
sont elles qui assurent les fonctions
de la cellule.
En ce qui concerne l’étude des fac-
teurs biologiques tissulaires, compte
tenu des stades de plus en plus pré-
coces des cancers du sein au moment
du diagnostic initial, les facteurs les
plus prometteurs pour le pronostic
seront ceux qui apparaissent dans les
états précoces pré anatomiques de
l’invasion. Une meilleure connais-
sance de ces facteurs biologiques tis-
sulaires, de leur rôle dans les méca-
nismes tumoraux, permettra égale-
ment de définir de nouvelles cibles
pour une nouvelle génération de
biothérapie : traitement ciblé sur les
facteurs qui induisent ou contrôlent
l’entrée dans le cycle de prolifération
cellulaire, les facteurs impliqués dans
l’angiogenèse et les facteurs protéo-
lytiques.
Tissue biology : prognostic factors in breast cancer
By its incidence, breast cancer remains the most frequent malignant tumor affecting
women. Biology of tumor tissue began thirty years ago with the steroid receptor concept that
showed tumor was hormonodependent. Subsequently, researches have helped to identify several
other factors responsible for mammary tumor development because of their implication in the
mechanisms of tumor progression. These factors represent measurable biological characteristics
whose role is known either in mechanisms of cellular proliferation or in paracrine reactions with
environmental cells (proteasis or angiogenic activities) that participate in local and metastastic
invasion. Besides their prognostic interest, we envisage in future that some of these biological
factors might be considered as therapy targets and thus allow the deceleration of their activities.
Breast cancer / Prognostic factor / Proliferation / Invasion
 6
6
 7
7
1
/
7
100%