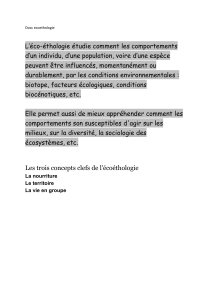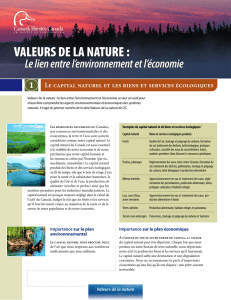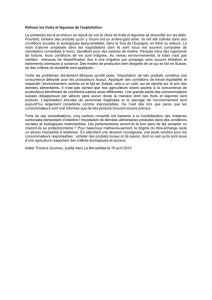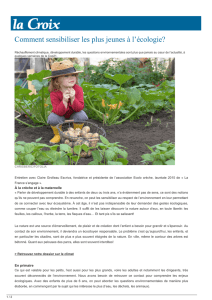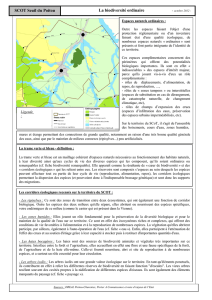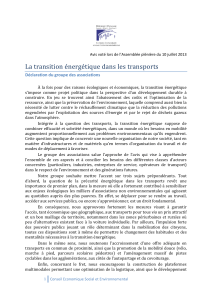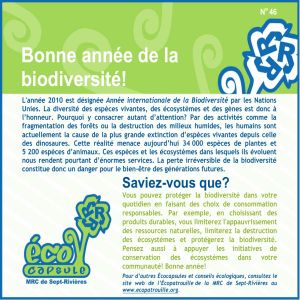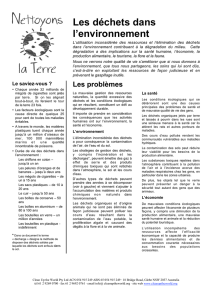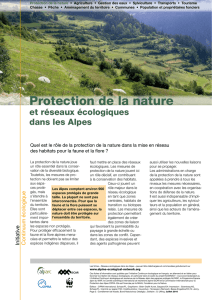Biodiversité, services écologiques et changements

30 Vecteur Environnement • Novembre 2014
Biodiversité, services
écologiques et
changements climatiques
Réduire nos vulnérabilités
Les changements climatiques (CC) représentent une des
principales causes de l’érosion de la biodiversité, qui se poursuit,
malgré les objectifs que se fixent depuis des années les instances
internationales et les gouvernements. Or, la biodiversité et le
fonctionnement des écosystèmes fournissent des services
écologiques dont nous tirons de nombreux bénéfices pour assurer
notre survie et notre bien-être. Les services écologiques contribuent
notamment à réduire nos vulnérabilités face aux CC. Il faut donc les
préserver.
BIODIVERSITÉ
La plantation d’arbres et la création d’espaces
verts pour atténuer les îlots de chaleur en
milieu urbain lors des canicules représentent
certainement le service écologique le plus
connu en termes d’adaptation aux CC, mais
ce n’est pas le seul! Nous explorons ici les
liens entre biodiversité, services écologiques
et changements climatiques en utilisant le
concept d’interdépendance des entreprises à
la biodiversité (dépendance et impacts) proposé
par Houdet et Auzel (2013), mais en l’élargissant
à l’ensemble de la société et aux CC.
Cela requiert d’aborder la problématique sous
ses deux angles: 1) l’impact des CC sur la
biodiversité et les services écologiques; et 2)
le rôle essentiel des services écologiques pour
réduire nos vulnérabilités dans une démarche
d’adaptation aux CC. Pour illustrer ces enjeux,
nous nous appuyons sur les connaissances
acquises dans le cadre de la programmation
sur les écosystèmes, la biodiversité et les
changements climatiques (ÉcoBioCC) d’Ouranos,
dont nous présentons quelques résultats récents
concernant les services écologiques fournis par
les écosystèmes du Québec. Pour mettre en
contexte les exemples choisis, nous utilisons
le cadre conceptuel du Millenium Ecosystem
Assessment (2005), qui a catégorisé les services
écologiques en services d’auto-entretien (de
l’écosystème), d’approvisionnement, de régulation
et culturels.
ENJEU 1: LES SERVICES ÉCOLOGIQUES SONT
AFFECTÉS PAR LES CC
La modélisation écologique basée sur des
scénarios de CC a démontré que les niches
bioclimatiques de la grande majorité des
espèces se déplaceront de plusieurs centaines
de kilomètres vers le nord/nord-est au Québec
d’ici la fin du siècle (Berteaux
et al.
, 2014).
Le Québec, avec sa situation géographique
particulière au nord du continent américain,
deviendra en effet un refuge thermique pour de
nombreuses espèces, dont le nombre devrait
augmenter sur son territoire: c’est le «paradoxe
de la biodiversité nordique».
Toutefois, il ne faut pas se réjouir trop rapidement
de cette augmentation de la richesse biologique,
car celle-ci va s’accompagner d’un grand
remaniement du patrimoine naturel dont les
conséquences sont encore peu connues,
notamment sur le fonctionnement des
écosystèmes et les services écologiques. Des
études récentes nous permettent néanmoins
de penser qu’il y aura des impacts importants
sur les services écologiques.
Voici quelques exemples de ces impacts, parmi
les mieux documentés:
Impacts sur les services d’auto-entretien:
la dégradation ou la perte d’habitats
Une des principales menaces à la biodiversité est
justement l’arrivée et la prolifération d’espèces
exotiques envahissantes (EEE). Parmi celles-
ci, une quarantaine de plantes sont jugées
prioritaires, car la plus grande partie du territoire
québécois présentera des conditions climatiques
favorables à leur croissance et à leur expansion
à l’horizon de 2050 et au-delà. Quelques cas
bien documentés, comme le roseau envahisseur
(
Phragmites australis
) et la renouée japonaise
(
Fallopia japonica
), montrent que l’allongement de
la saison de croissance favorise la reproduction
par germination de ces plantes ce qui augmente
le risque d’invasion biologique, avec des
conséquences importantes sur les espèces
indigènes (compétition entre espèces) et sur
leurs habitats (dégradation de la qualité).
Par ailleurs, certaines plantes à statut précaire,
classées en vertu de la Loi sur les espèces
PAR Dr ROBERT SIRON
coordonnateur du programme
ÉcoBioCC, Consortium Ouranos
Siron.robert@ouranos.ca

31Vecteur Environnement • Novembre 2014
menacées ou vulnérables, pourraient aussi
subir les effets des CC à travers la perte ou
la dégradation de leurs habitats préférentiels.
Par exemple, dans les hauts-marais de
l’estuaire du Saint-Laurent, où quelques plantes
menacées ont trouvé refuge, certains facteurs
(géomorphologiques, hydrodynamiques et
climatiques) grandement influencés par les CC
sont déterminants dans le processus d’érosion
du talus qui protège ces marais fluviaux.
Les écosystèmes aquatiques fournissent
aussi des habitats essentiels pour la flore et
la faune aquatiques et riveraines (habitat du
poisson). L’augmentation de la température des
eaux de surface va réduire l’habitat thermique
des poissons d’eaux froides, notamment les
salmonidés, que ce soit dans les rivières lors
de canicules ou dans les lacs nordiques plus
exposés au réchauffement climatique.
Impacts sur les services de régulation:
le cas des milieux humides
Les milieux humides ont une grande valeur
écologique et jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement des écosystèmes terrestres et
aquatiques. Ils fournissent en effet de nombreux
services écologiques, tels que la filtration de l’eau,
la régulation des crues ainsi que la régulation
du climat (p. ex.: stockage de carbone par les
tourbières).
Pourtant, ils continuent de disparaître au
Québec à un rythme inquiétant, et ce, malgré
les lois et règlements qui visent à assurer leur
protection. Comme les milieux humides sont
sensibles aux conditions hydroclimatiques, ils
sont particulièrement vulnérables aux variations
des précipitations qui sont anticipées avec les
CC. Il s’agit là d’une source de perturbation
supplémentaire pour ces milieux déjà soumis à
la pression de nombreuses activités humaines.
Impacts sur les services culturels et
d’approvisionnement: l’exemple des
poissons et des caribous
Dans le fleuve Saint-Laurent, la baisse des
niveaux d’eau anticipée avec les CC, combinée
à l’envahissement progressif des rives par les
roseaux , va conduire à des pertes importantes de
frayères. Cela aura des impacts sur la reproduction
et le taux de survie des populations de poissons
et, conséquemment, sur les pêches, autant
sportive (services culturels) que commerciale
(services d’approvisionnement).
Le réchauffement des températures anticipé
au Québec va favoriser également l’arrivée, la
croissance et, dans certains cas, l’expansion
envahissante de plusieurs autres espèces de
végétaux aquatiques. Cette invasion biologique
risque de se faire le plus souvent au détriment
de la qualité des habitats aquatiques et riverains
essentiels pour les poissons, alors que certaines
espèces se trouvent déjà dans une situation
précaire, faisant l’objet de mesures de protection
(p. ex.: le moratoire sur la pêche à la perchaude
dans le lac Saint-Pierre).
Les espèces nordiques sont parmi les plus
vulnérables aux CC puisque leurs niches
bioclimatiques risquent de se contracter en se
déplaçant vers le nord et qu’elles font face à une
plus grande compétition de la part d’espèces
venant du sud. Or, plusieurs de ces espèces sont
à la base de l’alimentation (pêche et chasse de
subsistance) et de la culture des communautés
inuites.
Le réchauffement climatique va s’accompagner
d’une augmentation de la température de l’eau
des lacs et d’une diminution du couvert de glace,
ce qui entraînera une diminution de l’habitat
thermique de certaines espèces de salmonidés
comme le touladi (
Salvelinus namaycush
) et
l’omble chevalier (
Salvelinus alpinus
). Selon une
vaste étude menée sur les troupeaux de caribou
migrateur (
Rangifer tarandus)
dans le nord du
Québec et du Labrador, des printemps plus hâtifs,
des hivers doux et des variations du couvert de
neige sont des facteurs climatiques qui semblent
déjà influencer leurs patrons de migration et
leurs choix d’aires d’hivernage.
ENJEU 2: LES SERVICES ÉCOLOGIQUES
AU CŒUR D’UNE STRATÉGIE D’ADAPTATION
RÉGIONALE
Pour être efficace, une telle stratégie devrait
s’appuyer sur quelques principes visant à
maintenir la diversité biologique et la résilience
des écosystèmes:
Assurer la connectivité des paysages
Les plans d’aménagement du territoire doivent
tenir compte des CC en préservant – voire en
restaurant – les corridors écologiques de façon
à favoriser le déplacement des espèces vers le
nord. La modélisation de corridors écologiques
intégrant des scénarios de CC et d’utilisation
des terres a été réalisée pour la Montérégie. Les
initiatives régionales visant la préservation des
milieux naturels périurbains peuvent dorénavant
se baser sur des cartes modélisées pour choisir
les options de corridors les plus robustes aux
CC, qui permettraient de maintenir le niveau
actuel de services écologiques et éventuellement
l’améliorer.
L’agroforesterie, encore peu développée
au Québec, pourrait contribuer localement
à renforcer la connectivité écologique dans
les régions du sud du Québec fragmentées
par la déforestation et l’agriculture intensive.
La combinaison de cultures et de plantations
d’arbres favorise en effet plusieurs services
écologiques dont peuvent bénéficier le milieu
naturel (p. ex. les habitats pour la biodiversité),
la société en général (p. ex. par la séquestration
Il s’agit là d’un outil très
puissant, car il fournit, pour
la première fois, une base
de comparaison entre les
bénéfices de la
conservation (fourniture de
services écologiques) et
ceux du développement
(p. ex. immobilier ou
agricole) pour une prise de
décision et une
planification éclairées
dans un contexte de CC.

32 Vecteur Environnement • Novembre 2014
Biodiversité, services écologiques et changements climatiques
Réduire nos vulnérabilités
BIODIVERSITÉ
de carbone) et le secteur agricole en particulier
(p. ex. pour la production de bois, la diminution
de l’érosion des sols et la rétention d’eau). Selon
une étude récente, il s’agit aussi d’une solution
d’adaptation qui permettrait aux agriculteurs de
réduire la variabilité de leurs productions dans
un contexte de CC.
Protéger de grands écosystèmes
Une des stratégies de conservation et
d’adaptation les plus reconnues est la création
de grandes aires protégées. Dans un contexte
de CC, le design et la gestion du réseau
d’aires protégées au Québec devrait passer
par la mise en place d’un ensemble d’aires
protégées «multicatégories» associant des
aires de conservation stricte avec, sur leur
pourtour, des aires polyvalentes agissant
comme zones tampons, au sein desquelles
la gestion écosystémique des ressources
renouvelables serait permise. Cette approche
permettrait d’assurer la protection de plus grands
écosystèmes, plus résilients face aux CC, et de
maintenir les processus écologiques essentiels
à leur bon fonctionnement, tout en soutenant
d’autres services écologiques au bénéfice des
collectivités locales (p. ex. en ce qui a trait à la
foresterie, à l’écotourisme, etc.).
Préserver les milieux humides les plus
importants
La valeur économique des services écologiques
offerts par les milieux humides dépend de
nombreux facteurs (les caractéristiques du bassin
versant, l’hydrologie et la connectivité des milieux
humides avec les cours d’eau avoisinant, leurs
fonctions écologiques, , , etc.) et de leur évolution
sous un climat changeant. Dans le cadre d’un
projet pilote réalisé sur les bassins versants des
rivières Yamaska et Bécancour, ces informations
spatiale et économique ont été intégrées à l’aide
d’un outil géomatique qui permet ainsi de poser
un diagnostic sur l’état des milieux humides –
actuel et futur – pour, ultimement, prioriser les
actions de restauration et de conservation et
mieux planifier les interventions sur le terrain. Il
s’agit là d’un outil très puissant, car il fournit, pour
la première fois, une base de comparaison entre
les bénéfices de la conservation (fourniture de
services écologiques) et ceux du développement
(p. ex. immobilier ou agricole) pour une prise de
décision et une planification éclairées dans un
contexte de CC.
La protection des milieux humides et de leurs
fonctions écologiques est aussi un élément central
dans une stratégie de gestion durable des cours
d’eau préconisant, entre autre, la préservation de
l’espace de liberté des rivières, une approche
qui est actuellement à l’étude au Québec.
CONCLUSION
Les impacts des CC doivent être pris en compte
dans la gestion de la faune et la protection des
habitats afin d’assurer une utilisation durable
de ces ressources. Toutefois, celle-ci ne se
réalisera pleinement qu’à travers une approche
plus large d’adaptation aux CC basée sur les
écosystèmes (adaptation écosystémique) et
mise en œuvre à l’échelle régionale dans le cadre
d’un aménagement planifié du territoire (Siron,
2013). C’est à cette condition que les services
écologiques seront maintenus au bénéfice de
toute la société et de son adaptation progressive
au climat futur.
Dans ce contexte, les résultats mentionnés
dans cet article nous permettent d’ores et
déjà d’entrevoir les liens complexes entre tous
ces éléments et ainsi commencer à planifier
la conservation et l’aménagement du territoire
en conséquence. Ces études sont disponibles
sur le site web d’Ouranos (www.ouranos.ca/fr/
publications/documents-scientifiques.php). ■
RÉFÉRENCES
Berteaux, D., N. Casajus et S. de Blois (2014).
Changements
climatiques et biodiversité du Québec: Vers un nouveau
patrimoine naturel
. Presses de l’Université du Québec
(PUQ), Québec, 202 p.
Houdet, J. et P. Auzel (2013). « La biodiversité et les services
écologiques. Les enjeux de la prise en compte par les
entreprises ».
Vecteur Environnement
, mars 2013, p. 46-48.
Millenium Ecosystem Assessment (2005).
Ecosystem
and Human Well-Being: Synthesis
. Island Press,
Washington DC. 155 p.
Siron, R. (2013). Aménager le territoire pour s’adapter
aux changements climatiques. La biodiversité
fait partie de l’équation.
Vecteur Environnement
,
septembre 2013, p. 34-37.
Les impacts des CC
doivent être pris en
compte dans la gestion
de la faune et la
protection des habitats
afin d’assurer une
utilisation durable de
ces ressources.
1
/
3
100%