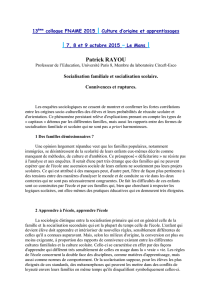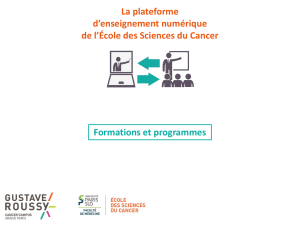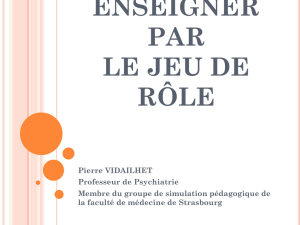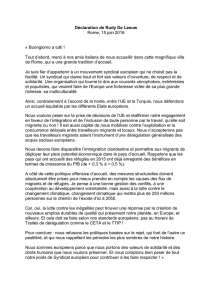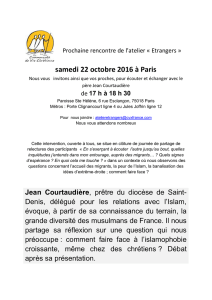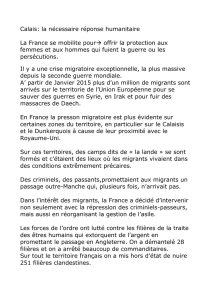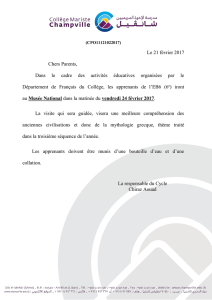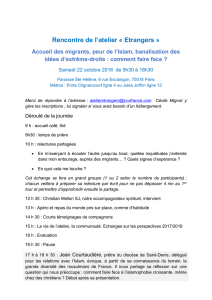Perception socioscolaire ou logique d`un rapport à la

1
Misbao AÏLA
Président de l’Association “Aujourd’École-France”,
Chercheur en Éducation et Sociologie
Perception socioscolaire ou logique d’un rapport à la
cognition : une perspective théorico-pratique
Espace de Philosophie et de Recherche sur l’Immigration et le Social
(ESPRISOCIAL - FRANCE)
http://www.esprisocial.org/documents
LILLE (FRANCE)
FRANCE
17 novembre 2014

2
PLAN
INTRODUCTION
I. INSTRUCTION ET PERCEPTION SOCIOSCOLAIRE
1. De la situation de réussite ou d’échec scolaire
2. Échec scolaire dans une perspective migratoire
3. Extension sociale et enjeux du phénomène de l’échec scolaire
a. Des contextes socioscolaires pleins d’enjeux pratiques
b. De la thèse du conditionnement socioéducatif des migrants
II. ENJEU DE MUTATION DE LA CONSCIENCE SOCIALE
III. CONFRONTATIONS ET RÉSISTANCES DANS LA COOPÉRATION
ÉDUCATIVE
CONCLUSION
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

3
Résumé de l’article
L’une des plus délicates entreprises est, pour cet article, celle de bâtir judicieusement, – à
partir d’un éventail de publications scientifiques –, la logique limpide d’un rapport à la
cognition et y cerner sa pertinence essentielle, principalement dans la transmission du savoir
au sein d’une communauté studieuse. Autrement dit, le terme de perception socioscolaire (qui
donne tout son sens à l’exposé) semble adéquat en raison même de la relation dialectique
entre l’insu et l’imprévu, et l’impact absolu du perçu sur les attitudes et les résultats
d’apprentissage. En réalité, l’acte de percevoir évoque un point de départ incontournable pour
l’expérience matérielle cognitiviste, et rien en ce sens ne saurait être durablement acquis s’il
n’est d’abord efficacement perçu, vécu ou du moins ressenti par un processus conséquemment
organisé. C’est, en quelque sorte, toute la recherche en sciences sociales qui se révèle en plein
droit de passer au crible de la perception, par la complexité du rapport au savoir ou la
panoplie connexe des résistances individuelles et collectives en formation formelle ou non-
formelle. Les ouvertures pédagogiques et/ou andragogiques, les circonstances interculturelles
ou confrontations relationnelles, a priori, poussent à éclairer le cheminement par lequel se
déroulent – sous formes d’impedimenta – les incompréhensions et confusions que des
ambiguïtés conceptuelles cristallisent autour de réelles ou moins réelles performances
éducatives.
Mots clés
: Intégration, éducation, malentendus ou conflits.

4
INTRODUCTION
L’idée que toute discipline se fait de la connaissance, notamment celle de toute
construction s’incluant dans une perspective universitaire ou théorico-pratique, même
violemment controversée ou solennellement partagée, fait indubitablement partie d’un champ
de réflexions qui n’exclut pas la perception d’un environnement mental. Une telle conception
répond à un besoin problématique suggéré sur un phénomène humain ou social, ou concernant
une entité réelle ou idéelle. C’est en effet à ce titre que des échanges ou concertations, des
constructions et déconstructions s’associent ou s’opposent entre elles, ou s’établissent dans
une intentionnalité épistémique. Cela se révèle d’autant plus évident qu’il s’impose d’en
prendre conscience, et donc d’en tenir compte, pour garder systématiquement une ligne de
conduite, aussi logiquement que possible. En effet, toute théorie de la connaissance, si elle est
fidèle aux exigences de la vérité, si elle marie sûrement l’objectivité scientifique qui lui est
proprement inhérente, lorsqu’elle s’offre en tant que guide d’un cheminement cognitif, ne
peut s’interdire une méthodologie dictée par la raison.
Mais, ici plutôt qu’ailleurs, le cheminement est bien théorico-pratique et l’on constatera,
au fil de l’écrit, que la logique pratique de nombreuses publications scientifiques contribue au
peaufinage de la présente perspective, ou rend claire la notion du rapport au savoir tout en
explicitant par là quelques aspérités de la perception socioscolaire. Il s’agit d’une théorie
épistémologiquement éprouvée, diversement analysée, fort suggestive mais partielle, qui
entend saisir les conditionnements psychosociologiques de l’école tels que perçus chez les
partenaires éducatifs, à savoir les parents et les apprenants. Il nous semble que les usagers de
l’école, notamment les élèves ou les apprenants, ne se rangeraient pas tous dans une
perception identique du contenu de la vie socioscolaire. La marginalisation ou les sentiments
de rejet, qui semblent toucher particulièrement les masses migrantes, affecteraient leur vision
de l’école ainsi que celle de leur milieu d’accueil.
En effet, dans la vie sociale, il est des phénomènes qui ne sont pas toujours simples à
expliquer ou à comprendre, mais qui ont des impacts sur les attitudes de l’individu ou du
groupe. La perception socioscolaire en fait distinctement partie. Elle intègre les
représentations de soi et d’autrui, de la société et des événements ou des faits ; et ce par le
biais, estimons-nous, d'une dynamique mécaniciste de cognition. Dans cette perspective, nous
nous sentons en droit de soutenir que la conscience perceptuelle constitue le moteur (ou la
mesure) dont dépendent les opinions ou jugements d’attribution causale liés aux
comportements. Conscience, perception et comportement n’étant donc pas opposables a
priori sur le plan cognitif, la tâche consiste à dépister les fondements conscients ou
inconscients des opinions et attitudes individuelles ou collectives envers l’instruction, et
mettre en exergue les conditionnements majeurs qui favorisent les dissonances cognitives
ainsi que les crises relationnelles qu’évoquent diverses théories concernant la problématique
éducative.
Dans le présent cheminement que nous proposons, l’on peut lire implicitement
l’esquisse d’un lien triadique (à la fois systémique, fonctionnel et interactionnel) qui se
construit entre la famille, l’école (ou la société) et les rapports à l’échec et à la réussite.
Autrement dit, à la base du lien triadique supposé entre l’école, la société et les perceptions
qu’élaborent les auteurs au sujet des familles, prolifèrent des malentendus complexes par
lesquels le conditionnement psychique a tendance d’interférer. Ainsi, les explications que
sollicitent ces malentendus seraient toutes fondées sur des rapports de l’individu ou du groupe
au savoir, à l’école, à la famille ou à la société. Tous les conditionnements qui semblent ainsi
mis en jeux, s’aimanteraient (du moins en théorie) par un mécanisme d’association et

5
graviteraient ensemble par progression versus régression autour et au travers de la relation
école-famille-société. Il y a donc lieu d’estimer que si un tel cheminement explicatif se révèle
effectif, la trame sociocognitive des conflits liés à l’échec (ou à la réussite scolaire ou sociale)
apparaîtra dans toute sa transparence théorique, et l’on pourrait, a posteriori, en faire des
observations par le truchement d’un isomorphisme méthodologique.
Ainsi, plutôt que d’une compilation encyclopédique, il va s’agir d’une présentation
strictement partielle de travaux sur l’échec scolaire : celle en particulier de différents auteurs
sur le rapport au savoir. Personne, en effet, ne s’attendrait ici à une étude exhaustive –
d’ailleurs impossible à réaliser – sur la question infinie de l’éducation ou de la perception de
l’échec versus la réussite scolaire. Qu’il nous suffise alors de prélever, dans une galaxie de
publications toutes importantes les unes que les autres, un minimum de littératures
scientifiques susceptibles de nous donner à voir comment la réflexion sur les rendements
éducatifs a survécu sous la plume des chercheurs contemporains, et ce qu’une telle réflexion
constitue pour notre exposé. L’on y trouvera ainsi des travaux qui permettent de comprendre
les réussites ou les échecs scolaires plus ou moins proches de la situation des familles
migrantes et non-migrantes, sous des aspects sociocognitifs.
I. CONNAISSANCE ET PERCEPTION SCOLAIRE
Si l’on veut traiter de l’intégration cognitive ou de la perception socioscolaire chez les
usagers de l’école, il convient préalablement de ressortir les indices à partir desquels il est
possible d’établir que ceux-ci connaissent une situation de réussite ou d’échec. Mais
répondons d’abord à une question : de quand date la notion d’ "échec scolaire" ? Le terme
apparaît originalement en France ; et sous cette désignation, il devient un sujet de prédilection
dans les années 1960 (Isambert-Jamati, 1996). Toutefois, affirmer que les élèves n’échouent
en France qu’à partir de cette époque serait un canular. Déjà, dans les années 1930, la moitié
des élèves issus de la catégorie populaire ratait leur certificat d’études. Mais la différence en
ce moment-là, c’est que ces élèves n’étaient guère perçus comme déviants ou sources de
difficultés (Isambert-Jamati, 1996). C’est finalement dans les années 1960 qu’il a été fait clair
que les élèves redoublant une ou deux classes et maîtrisant à peine le français écrit étaient
principalement les enfants de classes sociales économiquement et culturellement les plus
défavorisées, corrélation qui a été de nombreuses fois mise en avant.
Cependant, dès 1970, les pédagogues et autres chercheurs en éducation ont commencé à
insister sur le fait qu’une corrélation statistique est loin d’être une explication causale de
l’échec scolaire, mais qu’elle nous amène à voir l’échec scolaire dans son rapport aux classes
sociales et à ne plus attribuer ce phénomène à la seule école, ou à des "manques de dons"
individuels. Élisabeth Bautier, dans sa préface qu’elle a donnée à l’ouvrage Comprendre
l’échec scolaire de Stéphane Bonnéry (2007), rappelait explicitement que le problème des
inégalités sociales a été mis au clair dans les années 1960, par deux types de recherches en
sociologie. « D’une part les travaux quantitatifs de grande ampleur mettant en évidence les
différences de parcours des élèves en fonctions de leur origine sociale ; d’autre part, les
travaux connus sous le nom de « sociologie de la reproduction », conduits en particulier par
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron en France » (Bautier in Bonnéry, 2007, p. 9). Les
conclusions des auteurs évoqués ci-dessus par Bautier donnent, en quelque sorte, une certaine
forme à la notion d’échec scolaire. L’idée bourdieusienne de « l’inégalité des chances de
réussite selon les origines sociales et culturelles » se répandra alors comme un brouillard
nucléaire, et l’on en viendra à parler de handicap socioculturel : les couches populaires
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%