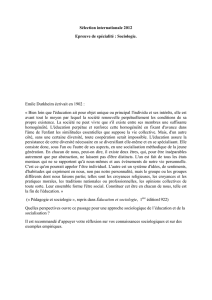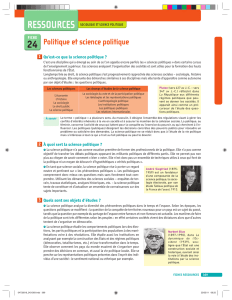L’enfance au regard des Sciences sociales

AnthropoChildren - N° 1 AnthropoChildren janvier 2012 / Issue 1 AnthropoChildren January 2012
L’enfance au regard des Sciences sociales
Régine SIROTA,
Professeur, Directrice du Département de sciences de l’éducation, Faculté des sciences humaines et sociales-Sorbonne, Université Paris
Descartes, Centre de recherche sur les liens sociaux, CERLIS, CNRS (Paris, France)regine.sirota@parisdescartes.fr
Résumé
Discipline récente, la sociologie de l’enfance s’est largement développée dans les vingt dernières années. Certains ont pu dire que la
sociologie de l’enfance s’est structurée comme discipline vertébrante au sein des Childhood Studies. Ce statut sera réinterrogé en situant
ruptures et continuités par rapport aux disciplines qui l’ont précédée ou qui ont navigué de conserve. Seront présentés les ancrages
académiques et institutionnels successifs qui ont marqué cette émergence et permis la structuration de ce champ de recherche. Sur le
plan méthodologique, l’approche ethnographique, en apparence plus consensuelle, s’est largement imposée dans des travaux de terrain
au carrefour des disciplines, ce qui amène à revenir sur ses modes d’utilisation pour saisir les articulations et confluences entre
sociologie de l’enfance et anthropologie de l’enfance.
Mots-clés : ethnographie, Sociologie de l’enfance, sciences sociales, espace national, espace linguistique, espace discursif, enfant Acteur
Abstract
Although recent, sociology of childhood has largely developed in the ultimate 20 years. Some assert that sociology of childhood got
structured thanks to Childhood Studies. I will question here this assertion, mentioning the ruptures and continuities in comparison with
older or parallel disciplines. I will present the successive academic and institutional anchors that have marked this emergence and
allowed the structuring of the field. From a methodological point of view, ethnographic approach, apparently more consensual, imposed
itself in the different fieldworks at the crossing of several disciplines. This leads me to question its uses in order to understand the
articulations and confluences between sociology of childhood and anthropology of childhood.
Keywords : Ethnography, Agency, fieldwork, Sociology of Childhood, childhood studies, social sciences, national space, linguistic
space, discursive space, Child-actor
Introduction
« L’enfance au regard des sciences sociales »… Cette exploration, certes nécessaire dans un moment qui se veut une refondation du champ,
reste un titre aussi alléchant qu’ambitieux, je proposerai ici plus simplement le regard d’une cousine germaine présentant un tableau, certes non
exhaustif, mais destiné à donner quelques aperçus sur la structuration du champ. Je me situerai en tant que sociologue relisant sa propre
expérience de recherche du point de vue de la sociologie des sciences en tentant de prendre un regard distancié.
Un petit objet au classement difficile
Laissez-moi partir à titre d’anecdote, peut-être significative, d’une expérience personnelle. Je travaille depuis de nombreuses années sur
l’anniversaire en tant que rite de socialisation et mise en représentation de l’enfance. Combien de fois me suis-je heurtée à la surprise,
l’ambivalence de mes très chers collègues devant ce sujet qui paraissait si peu sérieux pour une sociologue de l’éducation, spécialiste de
l’analyse de l’échec et de la réussite scolaire. J’étais en dehors des problématiques légitimes, telles qu’inégalité des chances et démocratisation,
pourtant mon objet initial était bien la déconstruction de l’habitus (Sirota 2006) mais pourquoi l’aborder dans les délices et les rires du gâteau
d’anniversaire ?
Hors champ, peut-être, mais pour autant où étais-je ? Si les sociologues anglo-saxons m’ont accueilli d’emblée au sein de la sociologie de
l’enfance, il situait ce travail parfois en termes de Cultural Studies (discipline dont je n’avais quasiment jamais entendu parler). Les ethnologues,
eux, m’invitaient spontanément à publier, mais semblaient fort surpris que ce travail fasse partie d’un véritable programme de recherche sur la
sociologie de l’enfance. Et leur faire admettre les petits objets de la culture enfantine semblait plus difficile que ceux de toute autre tribu, que de
confusion et de méfiance à l’égard des produits dérivés ou des figurines d’action représentant Robin, Batman et autres Playmobil ! Sans parler des
erreurs de traduction bien intentionnée où la référence à une « Anthropologie at home » devient « Anthropology of home », bref de la « Kitchen
Sociology », puisque je suis une femme parlant d’enfants. On pourrait multiplier les anecdotes sur ces incompréhensions. C’est dire si un travail
ethnographique sur l’enfance vous emporte rapidement à la marge des champs canoniques. C’est dire combien travailler sur l’enfance réinterroge
et dérange souvent nos pratiques et partages disciplinaires.
L’enfance, un objet au carrefour des disciplines des sciences sociales
La redécouverte de ce « petit objet », longtemps resté terre inconnue du sociologue, se situe à l’intersection d’un carrefour où coexistent des
frontières poreuses, des enrichissements réciproques, mais aussi des ignorances ravageuses. Je m’étendrai ici plus volontiers sur les apports et
contributions des uns et des autres, dans une perspective d’emblée internationale. Bien entendu l’apport de l’anthropologie, faisant l’objet d’articles
spécifiques, ne sera qu’effleuré ici, nombre de constatations sur les difficultés de l’émergence de ce petit objet étant tout à fait communes. De
l’œuvre inaugurale de Philipe Ariès à la très récente revue Girlhood portant sur la culture des petites filles, explorons comment s’est structuré le
champ, champ entendu au sens bourdieusien avec ses tensions, ses rapports de forces qui se traduisent autant par des enrichissements
réciproques que par des exclusives.
Page 1 of 7

L’histoire
L’histoire représente la discipline pionnière qui dans la période contemporaine avec le travail de Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous
l’ancien régime, paru en 1960, ouvre le champ. Cette redécouverte du statut de l’enfance au sein d’une famille devenue sentimentale, s’effectue
dans le cadre d’un mouvement plus général du travail des historiens qui s’attaque à la vie privée et pénètre ainsi l’envers du décor et l’univers
domestique en redécouvrant les personnages oubliés que sont prolétaires, femmes et enfants. Ceci amène à porter l’éclairage sur de nouveaux
âges de la vie que ce soit la petite enfance, l’enfance, la vieillesse ou la mort. Dans l’ensemble de ces travaux (Crubelier 1975, Prost 1981,
Becchi & Julia 1998) est pointée l’évolution du statut de l’enfant non seulement au sein de la sphère familiale mais aussi au sein de l’ensemble
des institutions responsables du processus de socialisation (Yablonka 2010). Les régimes d’autorité deviennent de moins en moins évidents. Les
appareils d’encadrement de l’enfance et de la jeunesse de l’après-guerre, mouvements de jeunesse ou colonies de vacances perdent de leurs
poids, les calendriers d al scolarisation s’étirent et s’installent de nouveaux découpages des âges tels que petite enfance et adolescence
transcendant en partie l’espace des classes sociales. L’accélération des mutations est soulignée en particulier l’apparition de nouvelles pratiques
culturelles dans le cadre d’une culture juvénile articulée à une société de consommation qui s’attaque à la cible adolescente puis enfantine.
La psychologie
Pour saisir les mutations de cette enfance en pleine évolution, voilà donc la psychologie détrônée alors qu’elle était considérée comme « la
science de l’enfance » (Ottavi 2001), car ses apports sont relus de manière distanciée et critique (Neyrand 2000). Tout spécifiquement est remis
en question, l’absolutisme de la vision d’une certaine psychologie du développement, longtemps largement dominante dans le champ. Indifférente
aux conditions socioculturelles de la socialisation, celle-ci a longtemps présenté les étapes du développement de l’enfant - quelle qu’en soit la
théorie sous-jacente - suivant des modèles de progression particulièrement normatifs vers un statut d’adulte, entendu comme l’acmé de cette
vision d’un être considéré comme en devenir. Effectivement dans sa scientifisation de l’observation de l’enfant (James & Prout 1990, Turmel
2008), elle s’est principalement intéressée à un enfant devenu un enfant de laboratoire désertant les cadres ordinaires de la socialisation au
quotidien, s’intéressant paradoxalement bien peu à l’ici et maintenant de l’enfance. Celle-là même qui fait problème et interroge l’éducateur et le
politique. Car c’est bien l’enfant au présent qui va intéresser les sciences sociales. D’autant que l’apport de la psychanalyse et sa vulgarisation a
changé le regard sur l’enfant en le considérant comme une « personne ». Mais la psychologie expérimentale a laissé en quelque sorte, le terrain
vide en s’installant du côté des sciences cognitives. Pourtant de nouveaux protocoles expérimentaux et de nouvelles conceptions du
développement de l’intelligence du bébé vont contribuer à faire évoluer la vision tant du bébé que de la petite enfance en mettant en évidence sa
capacité d’action.
La sociologie
La sociologie a joué un rôle de discipline vertébrante, dans cette relecture de la socialisation. Considérant à l’instar des historiens que l’enfance
est une construction sociale variable dans le temps et dans l’espace, les sociologues de l’enfance se sont attelés à déconstruire et reconstruire le
nouveau statut attribué à l’enfance, mettant en lumière les nouvelles normativités qui inscrivent l’enfance comme catégorie sociale de l’action
publique, les enfants comme acteur collectif et l’enfant comme acteur social (James & Prout 1990, Javeau 1994, Sirota 2006). Reprenant la
question de la socialisation pour démêler comment s’effectue, au travers d’une « reproduction interprétative » (Corsaro 1997), la fabrique du petit
individu contemporain. Et s’attachant à comprendre tant les mutations de cette forme structurelle de l’enfance (Qvortrup 2001) que la place et le
statut de cet enfant considéré comme un être sans prix (Zelizer 1985), dernier lien inaliénable (Beck 1986), dans une société dite du risque
Différents champs de la sociologie vont redécouvrir successivement l’enfance, que ce soit la sociologie de l’éducation, la sociologie de la famille,
la sociologie de la culture et des medias ou la sociologie de l’alimentation. Portées par une pluralité de positions théoriques, des sociologies
interactionnistes et interprétatives aux sociologies de l’individu, de nouvelles approches théoriques et méthodologiques s’emparent de l’objet. Les
mutations du statut de l’enfant amènent les sociologues à redécouvrir ce nouvel acteur qui trouble et bouleverse les instances de socialisation
traditionnelles. Des sociologues de l’éducation se mettent à s’intéresser à cette enfance, longtemps abandonnée à l’état de fantôme aux portes de
l’école, pour comprendre qui sont ces nouveaux acteurs qui envahissent et troublent les différents échelons du système scolaire. S’attachant à
l’analyse de la forme structurelle attribuée à l’enfance (Qvortrup 2001), dans le cadre de l’institutionnalisation de l’enfance au travers de la
scolarité, et plus spécifiquement du Métier d’enfant et Métier d’élève (Chamboredon & Prevot 1975, Perrenoud 1994, Sirota 1993, 1994 et1998,
Dubet & Martucelli 1996). S’émancipant lentement des théories de la reproduction pour aborder expériences et épreuves spécifiques de ce temps
de la vie. Puis les sociologues de la famille (de Singly 2004, Segalen 2010, Théry 1998) de conserve avec démographes (Rollet 1990) et
anthropologues vont se pencher sur son berceau pour saisir comment « l’enfant fait la famille », et décrypter son nouveau statut au sein de la
démocratisation de la cellule familiale et tenter d’appréhender les profondes mutations des modalités de la parentalité, de la procréation à la
transmission. De nouvelles pratiques culturelles vont aussi être mises en évidence, prenant appui sur l’apparition des nouveaux moyens de
communication qui modifient modes de transmission et modes de sociabilité, renforçant une culture de pairs et ses aspects générationnels
(Pasquier 2000, 2005, Octobre 2004, 2010 et 2010). L’ensemble de ces évolutions met au centre de l’analyse tant les modes de négociation que
de construction et d’expression de soi des petits individus.
Les sociologues des medias prenant appui sur les Cultural Studies, se sont attachés à comprendre ces nouvelles pratiques des « digital natives »,
attaquant de front le bousculement des pratiques culturelles, qu’incarne ce que l’on nomme parfois maintenant « la culture de la chambre »
(Glévarec 2010, Metton-Gayon 2009). À l’intersection d’un renouveau d’intérêt des sciences sociales pour la culture matérielle, entre culture
patrimoniale et culture médiatique, les pratiques légitimes et illégitimes sont investiguées. Les objets de l’enfance, tels que jouets (Brougère 2003
et 2009, Vincent 2001) ou littérature enfantine (Diament 2009, Nières-Chervel 2005) sont soumis à de nouveaux éclairages. De même, l’évolution
des pratiques alimentaires devenues plurielles (Corbeau 2008, Diasio & Pardo 2010), fait l’objet d’investigation spécifique à l’intersection de
problématiques de santé publique et de l’analyse des comportements d’une classe d’âge devenue de plus en plus autonome. Car en parallèle, la
sociologie de la consommation, a aussi été mise à contribution pour analyser ces industries destinées à une cible du marché considérée depuis
longtemps par le marketing comme un des pivots de plus en plus importants de la grande consommation, comme prescripteur direct ou indirect
(Kline 1993, De La Ville 2005, Cook 2004). D’autant que l’aspect générationnel devient de plus en plus important, dans la constitution d’une culture
de pairs.
Construction des âges, des différences de classes et de genres, catégories les plus classiques de la sociologie se trouvent profondément
réinterrogés par ce qui ne plus être considéré comme un petit objet marginal, d’autant que les modalités de la construction du lien social s’en
trouvent profondément transformées.
Page 2 of 7

Les Gender Studies
Les Gender Studies ont ainsi paradoxalement contribué à la construction de ce nouveau regard sur l’enfance. Après avoir considéré l’enfance
comme un fardeau et une charge aliénante portée principalement par les femmes, on pourrait presque dire que les Etudes féministes ont joué le
rôle d’une sorte de laboratoire conceptuel pour un certain nombre de chercheurs se situant à l’intersection de ces deux champs. Considérant dans
quels rapports de pouvoirs structuraux se constitue l’altérité de l’enfance, celle-ci a été considérée dans le cadre de rapports de domination. C’est
ainsi que dans la recherche anglo-saxonne (Thorne 1987, Alanen 2003, Mayall 2010) à l’instar des rapports de genre et plus précisément de l’ordre
des genres a été pensé l’ordre des générations. Puis dans la recherche francophone ont été abordées assignation de genre et construction de
l’identité d’un groupe social considéré comme doublement minoritaire, les petites filles. Considérant alors l’enfance comme un « laboratoire de
l’identité de genre » (Cromer & Dauphin & Naudier 2011), sont mises en évidence les représentations les plus stéréotypées, par exemple dans les
manuels scolaires, la littérature enfantine ou les catalogues de jouets. Puis au travers non seulement des objets de l’enfance, mais des pratiques
culturelles et du rapport au corps sont explorées les négociations et arrangements des sexes qui tout au long des temps de l’enfance en marquent
les étapes (Pasquier 2005, Diasio 2010). Tout d’abord du côté des petites filles, ces travaux reprennent l’analyse certes dénonciatoire mais
toujours actuelle de l’italienne Helena Gianni Belloti, dont on peut remarquer qu’il s’agit du tout premier ouvrage publié par Les Editions des
Femmes, traduite en France dés 1973. Puis, l’accent est porté du côté de la fabrication des mâles, c’est- à dire des pratiques des petits garçons
et de la construction de la masculinité dans son articulation avec les appartenances sociales. La mise en lumière de l’univers culturel de cet âge
(Mitchell & Reid Walsh 2008) donnant même lieu à la publication aux USA, d’une revue spécialisée comme Girlhood.
La philosophie politique
La philosophie politique, dans une interrogation plus générale sur la redéfinition des âges de la vie dans la période contemporaine, (Dechavanne &
Tavoillot 2007) réinterroge le statut de cet alter égo paradoxal (Renaut 2007), devenu l’enfant du désir (Gauchet 2004). Si, de Rousseau aux
grands figures des pédagogies nouvelles, de Montessori à Freinet, bien des penseurs se sont pensés sur le statut de l’enfant dans le cadre
éducatif, les mutations profondes du régime d’autorité dans la deuxième modernité amènent à un renouveau d’intérêt de la philosophie politique,
sur la place et le statut de l’enfant que ce soit dans la sphère éducative ou familiale (Rayou 1998) ou dans ses traductions juridiques (Théry 1998)
distinguant par exemple, conjugalité et parentalité et mettant au centre un supposé intérêt supérieur de l’enfant.
Les Childhood Studies
Cette éclosion de l’intérêt académique a ainsi permis l’apparition d’une nouvelle discipline dans la sphère anglo-saxonne, avec ses cursus et
publications. Car à cette première phase de défrichement du champ d’un point de vue mono-disciplinaire a succédé une recomposition de champs
pluridisciplinaire, qui s’est instaurée principalement dans le champ anglo-saxon, au sein des Childhood Studies. Destinées à présenter le
développement des recherches et ses principaux acquis, quelques publications permettent de mesurer le chemin parcouru ces 20 dernières
années. Le programme proposé a-t-il été accompli ? Pour répondre à cette question, comparons les présupposés de l’ouvrage coordonné par
Allison James et Alan Prout Constructing and reconstructing Childhood paru en Angleterre en 1990 et considéré comme séminal, et le Palgrave
Handbook of Childhood Studies, édité en 2009 sous la direction de Jens Qvortrup, Michaël Honig et de William Corsaro. Même s’il faut bien
remarquer que les deux ouvrage sont principalement, si ce n’est uniquement, basés sur la littérature anglo-saxonne. Nombre de points communs
entre ces deux ouvrages apparaissent, ce que soulignent d’ailleurs leurs auteurs. Il s’agit :
- d’étudier l’enfance normale, plutôt que l’enfance anormale ou à problèmes.
- de revisiter la socialisation contemporaine, tout en déconstruisant la problématique de la socialisation.
- de donner une voix aux enfants en faisant apparaître d’une part l’activité sociale spécifique des enfants et leurs points de vue, et en considérant
l’enfant comme un être au présent.
- de prendre en compte les contraintes structurelles qui pèsent sur les enfants, considérés comme des membres à part entière de la société, à
partir d’un point de vue se basant sur l’intersectionnalité des rapports sociaux dans lesquels s’insère la vie quotidienne des enfants.
- d’utiliser les outils ordinaires des disciplines des sciences sociales.
- Cependant, l’approche ethnographique n’est plus considérée comme la seule voie noble d’accès de l’enfance, l’ensemble des protocoles de
recherche se devant d’être utilisé pour donner un portrait englobant position structurelle et expérience des acteurs.
La sociologie de l’enfance entre des traditions nationales, des champs linguistiques différents et un
espace discursif globalisé commun
Mais ces disciplines concourent différemment à la redécouverte de l’objet, suivant l’échelle à laquelle on situe l’angle de l’analyse. Je m’appuierai
ici principalement sur des travaux comparatifs menés avec Doris Buehler Niderberger1 sur une dizaine de pays où nous avions demandé à des
chercheurs de faire un bilan de l’évolution de la sociologie de l’enfance dans leurs pays respectifs.
Certes, si dans un premier temps, la difficulté de faire sortir l’enfance de son invisibilité scientifique apparaît comme un point commun, les
conditions de cette réinvention s’appuient sur des situations et des leviers en partie communs mais aussi en partie spécifiques.
L’espace national
La conjugaison du statut particulier des disciplines avec les débats sociaux et les différentes conceptions de l’Etat providence, ainsi que les
traditions de politiques sociales de prise en charge de l’individu, donne un statut différent à l’objet enfance, suivant le cadre national. De plus les
cartographies universitaires et intellectuelles sont loin d’être identiques, car les découpages académiques sont parfois assez différents les uns
des autres. Les mêmes éléments pouvant être considéré par les uns comme du ressort de la sociologie, ou par d’autres comme ressortant de
l’anthropologie, du folklore ou de la psychologie sociale ou culturelle ou même de la sociolinguistique.
Donnons quelques exemples, forcément en partie simplificateurs.
Premier exemple : La Scandinavie a joué un rôle très important dans l’émergence d’une sociologie de l’enfance. À l’instar de la Finlande (Strandell
2010), les folkloristes, attachés à maintenir et préserver un folklore enfantin, considéré comme celui d’une tribu en voie de disparition devant la
modernisation et l’urbanisation, ont accordé d’emblée une grande importance à la culture enfantine. Cet intérêt s’est conjugué à une tradition
politique de défense de l’individu, et une législation d’avant-garde, sur le plan européen, reconnaissant l’égalité des individus. La prise en compte
d’une démocratisation de la cellule familiale, reconnaissant une place égale dans un premier temps aux femmes puis aux enfants, amène ainsi
sociologues et anthropologues à faire entendre particulièrement la voix de l’enfant.
Alors qu’en Angleterre, sociologie et anthropologie médicale vont contribuer à construire un nouveau regard sur l’enfant (Mayall 2002, Prout 2005,
Morran Ellis 2010), en s’attachant à reconnaître sa place en tant qu’acteur social dans une perspective interactionniste insistant sur l’écoute de la
parole de l’enfant et la mise en évidence de leur capacité d’action. Ce qui a eu pour conséquence de s’intéresser assez spécifiquement à la prise
Page 3 of 7

en compte de l’enfant dans l’éthique des protocoles de recherche.
Troisième exemple, en Allemagne, avec la reconstruction sociale et morale de l’après-guerre les sociologues de l’éducation, sociologues de la
jeunesse et pédagogues se sont très vite penchés sur les conditions éducatives des nouvelles générations. C’est ainsi que non seulement
l’expérience sociale et l’édification des valeurs mais le rapport intergénérationnel a pris une importance sociale et politique accrue lors de la
réunification des deux Allemagnes (Zeyer 2010).
Cependant, en Italie, l’intérêt pour l’enfant en tant que citoyen trouve en grande partie son origine dans les politiques sociales de Reggio Emilia
(Baraldi 2010) autour d’une prise en charge locale de la petite enfance. Issues des politiques de désinstitutionalisation psychiatrique, elles mettent
l’accent sur les compétences du sujet et plus précisément de l’enfant dans la vie quotidienne, ce qui a pour effet d’accentuer l’intérêt pour les
politiques de la ville.
Dernier point, on ne saurait oublier qu’en France, la tradition républicaine française donne à l’école une place prépondérante pour construire l’égalité
des futurs citoyens. En extrayant l’enfant de sa famille et faisant disparaître l’enfant derrière l’élève, elle a de ce fait longtemps accentué la
primauté du regard d’une sociologie de l’éducation, principalement préoccupée de l’égalité des chances au sein d’un système scolaire basé sur la
méritocratie.
Certes le cadre national ne correspond en partie qu’à une communauté imaginée et symbolique, mais elle reste aussi bien réelle,
organisationnellement et institutionnellement sur le plan académique. Car s’y joue aussi la reconnaissance des travaux et des carrières des
chercheurs à travers l’ensemble des systèmes de légitimation qui opèrent comme les revues, jurys de thèse, listes de qualification, évaluations,
et appels d’offre qui donnent leur imprimatur en permettant l’émergence d’un champ et son épanouissement en une « science normale », enjeux
qui furent loin d’être négligeables dans l’émergence de la sociologie de l’enfance (Ambert 1996).
Mais le cadre national n’est pas forcément l’échelle d’analyse la seule pertinente pour expliquer l’orientation des travaux et la plus percutante, un
autre espace se superpose.
L’espace linguistique
Espace qui n’est pas à négliger, à défaut d’être bien glorieux, pour comprendre la circulation des travaux en sciences humaines et sociales. Les
espaces linguistiques des échanges scientifiques jouent puissamment même si leur rôle n’est que rarement explicite, dans la circulation des
références, des auteurs et des reconnaissances académiques. Jouant le rôle de ponts ou de barrières, les langues d’échanges, souvent issues et
ancrées dans les pôles de formation académique initiales des chercheurs, constituent de réels réseaux sous-tendant les publications. De plus les
rares traductions ne jouent pas dans des sens équivalents, car généralement elles ne fonctionnent qu’à sens unique, de l’anglais vers d’autres
langues, et bien peu à l’inverse.
L’espace anglophone
La sociologie de l’enfance s’est d’abord éclose dans l’espace anglophone, comme nous l’avons vu précédemment, de manière relativement
concomitante en Scandinavie et en Grande-Bretagne avec l’appui des travaux américains, et dans un dialogue constant avec la sociologie de
l’enfance allemande, devançant ainsi les travaux francophones d’une bonne dizaine d’années. Il s’agit bien d’un champ anglo-saxon. Au sein de
l’ISA (International Sociological Association) naît en 1986, le comité Sociology of Childhood, crée et animé par Jens Qvortrup. Ce sociologue
d’origine danoise, dirige le premier projet d’envergure de 1987 à 1992, Childhood as a social phenomenon basé à Vienne rassemblant des
chercheurs issus de quatorze pays européens. L’objectif est de faire un état des lieux comparatifs entre pays et de faire apparaître l’enfance sur
l’agenda scientifique en lui donnant une visibilité et une autonomie scientifique. À cet appel d’offre va succéder en Grande-Bretagne, le programme
Childhood from 5 to 16 dirigé par Alan Prout et financé par l’Economic and Social Research Council, qui va redonner une impulsion importante à la
thématique en mettant plus précisément l’accent sur l’enfant acteur. Puis au sein de l’ESA (Association européenne de sociologie) se crée un
groupe de recherche Sociology of Children and Childhood.
Des revues telles que Sociological Studies of Children puis la revue Childhood, a journal of global child research, publiée par le Child Center de
Trondheim, en Norvège, joue un rôle important de rassemblement et de diffusion.
Si ces travaux se réfèrent parfois à la sociologie francophone, il s’agit essentiellement de la « French Theory » (Cusset 2003) et de ses
réinterprétations internationales.
L’espace francophone
D’où le sentiment de malaise de certains chercheurs francophones participant à ces échanges, car la méconnaissance de la littérature
francophone est patente et les difficultés d’échanges certaines. Ce qui a amené à la naissance du comité de recherche « Sociologie de l’enfance »
au sein de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française en 2000. Ce réseau mettra en place des rencontres annuelles,
destinées à permettre un échange scientifique soutenu soit sous forme d’ateliers de travail soit sous forme de colloques internationaux, au travers
des « Journées de sociologie de l’enfance »2.
Au sein de ce réseau de l’AISLF, participent certes principalement des sociologues travaillant sur l’enfance mais aussi des chercheurs issus
d’autres disciplines. Nulle exclusive sur les âges travaillés, se conjugue ainsi la présentation de travaux allant de la petite enfance à
l’adolescence, l’ensemble de l’âge de l’enfance en tant qu’âge de minorité étant exploré. Ce réseau rassemble des chercheurs d’une douzaine de
pays, permettant la rencontre de chercheurs qui seraient trop isolés dans leurs pays respectifs, mais travaillant sur l’enfance contemporaine des
pays développés, c’est-à-dire principalement sur des terrains européens. Le dialogue est peut-être plus facile quand les réalités de terrain ne sont
pas trop éloignées. Les ancrages institutionnels se situent principalement au sein de départements de sciences de l’éducation ou de laboratoire de
sociologie, hébergeant parfois aussi quelques anthropologues ou philosophes.
Des appels d’offre, d’une certaine envergure vont donner un support institutionnel important tant en Suisse, avec le programme fédéral PNR 52,
« L’enfance, la jeunesse et les relations entre générations dans une société en mutation » de 2003 à 2008, qu’en France avec l’Appel d’offre de
l’ANR sur « Enfance, enfants » lancé en 2009. En parallèle, à la suite du lancement des grandes enquêtes du ministère de la culture, (Octobre
2004), sera mis en place un Appel d’offre intitulé « Enfance et Culture», en 2007 (Octobre 2010). Un programme du ministère de l’agriculture, au
sein du PNRA financera des projets portant spécifiquement sur l’alimentation des enfants et des adolescents (Corbeau 2009, Diasio & Pardo
2010). Tandis que le projet Elf, destiné à construire un suivi pluridisciplinaire d’une cohorte de 20.000 enfants à l’instar d’autres projets européens
vient de démarrer.
Du premier groupe de travail autour de l’enfance, réuni au sein du GDR « Modes de vie du CNRS », Enfance et sciences sociales (Mollo 1994) à la
récente mise sur Internet du colloque « Enfance et cultures, regards des sciences humaines et sociales » (Octobre & Sirota 2011), un certain
nombre de colloques et leurs publications scandent ce renouveau d’intérêt. Bien qu’initialement fortement fragmenté et dispersé (Sirota 2006,
2010) entre les différentes sous disciplines et territoires des sciences sociales, le champ tend à prendre place et à se rassembler dans des
rencontres principalement sociologiques mais aussi pluridisciplinaires. Celles-ci s’organisent autour de thématiques parfois tout à fait classiques
ou plus novatrices, pour certaines marquant l’émergence concomitante de champs de recherche comme la sociologie de la consommation, la
sociologie de l’alimentation, ou de la sociologie de la culture et leur rencontre avec la nouvelle matrix de la socialisation de l’enfance3.
Une des caractéristiques du champ français étant, au sein de la redécouverte de cet âge de l’enfance, d’être marqué, d’un côté par une conception
Page 4 of 7

qui considère l’enfance comme un âge spécifique et un continuum constitué d’éventuels découpages de la naissance à la petite enfance en
passant par l’adolescence (Plaisance 1994, Mozère 2006, Sirota 2010, Diasio 2010) dont il importe de comprendre la variabilité et la multiplicité
des positions. Et d’un autre côté d’une conception, nettement centrée autour de l’entrée dans l’adolescence (de Singly 2006, Galland 2010) qui se
focalise sur la conquête de l’autonomie vers un statut d’adulte. L’articulation avec les mouvements de la sociologie générale, de la sociologie de la
reproduction aux sociologies de l’individu en passant par les sociologies interactionnistes, marque les tempos théoriques, dans des allers-retours
qui permettent de mettre en évidence tant les mutations des représentations de l’enfance que les pratiques de cet acteur collectif et leurs
conséquences.
L’espace lusophone
Le pôle lusophone est un des rares champs qui traduit et publie tant des textes d’origine francophone qu’anglophone, conjuguant des références
dans les trois espaces linguistiques, (Nunes de Almeida 2000, Quinteiro 2003, Rabello di Castro & Kosminski 2010, Sarmento 2008). Ici les
traductions sont rapides et transportent dans un même espace de publication et de confrontation des textes issus des différentes communautés4.
De plus un pont très particulier et intense existe au travers de congrès lusophones rassemblant chercheurs brésiliens et portugais. Les colloques
de Braga (1997) ou de Lisbonne (2009) rassemblent d’emblée chercheurs anglophones, francophones et lusophones5.
Cependant les régimes de visibilité données à l’enfance sont assez spécifiques, dus aux contextes sociopolitiques particuliers de ces pays. La
figure de l’enfance pauvre est dominante, comme composante structurelle des inégalités sociales, et la défense d’une cause de l’enfance
particulièrement importante. Sortie de régimes dictatoriaux, développement des BRIC, évolution rapide des législations, investissement sur des
politiques de développement particulièrement dédiées à l’enfance, reconnaissance de la convention des droits de l’enfant, tant en termes de
recherches que de politiques sociales vont jouer fortement. Une situation de l’enfance, souvent considérée comme critique et comme problème
social a impulsé une attention particulière sur l’exclusion de l’enfance et des enfants, de l’enfance des rues au travail des enfants. Une articulation
entre la sociologie interprétative et la sociologie critique s’est construite s’attaquant tant à l’enfance comme catégorie sociale minoritaire qu’à
l’enfant acteur social, sujet de droits. Ceci, en s’ouvrant à la pluridisciplinarité des sciences sociales.
L’espace monde globalisé ou la production d’un espace discursif commun
Pourtant il serait très insuffisant et injuste d’en rester à ce partage, car certains chercheurs participent de ces différents réseaux. D’autant qu’un
autre espace, plus large, retravaille les espaces précédents. Des phénomènes d’ordre très différents s’y conjuguent, qu’ils importent de prendre en
compte étant donné leur importance et leur transversalité, constituant ce nouvel espace de la mondialisation et de la globalisation, qu’il devient
impossible d’ignorer car s’y construit un espace discursif au sein duquel se pensent se réfléchissent et s’administrent imaginaires et politiques
publiques de l’enfance.
Une culture mondialisée
L’explosion de la culture médiatique et des échanges culturels, ainsi que l’importance de la marchandisation de l’enfance et son poids
économique, ne permet tout simplement plus de raisonner dans un cadre national. La diffusion mondiale d’objets industriels d’entreprises
multinationales, de Disney à Pampers, nous projette face à une culture enfantine qu’elle soit matérielle ou symbolique qui se constitue en
convergence. (Jenkins 1998, Brougère 2010). La multiplicité des produits dérivés et leurs logiques publicitaires et marketing relayant à l’infini ces
éléments culturels d’une culture de masse infiniment mobile que certains qualifient de culture « mainstream » (Martel 2010), sur les supports les
plus variés dans les lieux les plus éloignés.
Une rhétorique de la protection de l’enfance
L’édiction de la convention internationale des droits de l’enfant et le poids des grands organismes de défense de l’enfance et leurs politiques
souvent communes, comme l’UNICEF, les ONG tels Child Watch, Save the Children (Schlemmer 2006, Pen 2010) ou le BIT transportent du Nord
au Sud et parfois même du Sud au Nord, des conceptions et des idéologies de l’enfance. Celles-ci influent sur les modes d’encadrement et de
gouvernance de l’enfance, tant au niveau des politiques publiques, des programmes d’aide humanitaire que des programmes de recherche. Une
rhétorique de la protection de l’enfance s’installe au travers de la défense de l’intérêt d’un enfant universel.
Les flux migratoires et les mutations des conditions de la prise charge de l’enfance, dans une chaîne de prise en charge de « care globalisé »
d’un « amour mondialisé » (Horchild 2003), importent et réimportent force de travail et conceptions éducatives.
Les effets de l’expertise et des évaluations internationales des politiques sociales
Phénomène certes d’un tout autre ordre, mais, ici, jouent ce que les sociologues des sciences nomment « les collèges invisibles ». Qu’il s’agisse
de la diffusion des dites « bonnes pratiques » par exemple au niveau européen par les Observatoires des politiques sociales et éducatives, mis en
place par la communauté européenne, ou des évaluations menées par les agences nationales de recherche. D’autant que l’ensemble de ces
organismes soumet tout projet à une évaluation internationale. Point certes positif, mais aussi point négatif, elles les soumettent à des critères de
productivité et de légitimité académiques identiques bridant parfois inventivité et originalité de la recherche sur des sujets aussi délicats que
l’enfance, pour des garanties de productivité.
La construction médiatique d’une figure compassionnelle
Sans oublier la médiatisation d’une figure compassionnelle de l’enfance omniprésente, devenue l’illustration de première page de la couverture
médiatique des conflits et des catastrophes naturelles. De l’affaire de l’arche de Zoé (Yablonka 2010) aux orphelins d’Haïti, en passant par les
orphelins du SIDA en Afrique du Sud (Fassin 2010) se mettent en exergue risques et incertitudes des figures d’une enfance en péril (Leblic 2010).
Oscillant entre enfance en danger et enfance dangereuse, s’affrontent certes différentes conceptions de l’enfance, mais qui globalement
transforment celle-ci en une catégorie morale et politique exacerbée (Javeau 1998, Fassin 2010). L’intolérable des sociétés modernes s’est
déplacé (Fassin, Bourdelais 2007), donnant une place particulière à l’enfance dans les débats médiatiques au travers d’un miroir compassionnel
des passions contemporaines (Gavarini 2001).
Diffusion des normes et des références se conjuguent ici dans un espace « glocalisé » dont les tensions n’épargnent pas un objet tel que
l’enfance. Mutations de l’objet et des conditions du regard scientifique et médiatique se combinent pour construire les rhétoriques qui fabriquent
des figures de l’enfance en réverbération les unes par rapport aux autres (Sirota 2012) contribuant à produire un espace discursif commun.
Page 5 of 7
 6
6
 7
7
1
/
7
100%