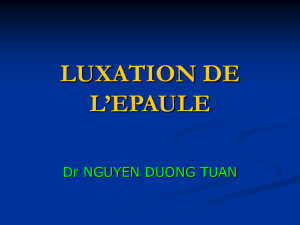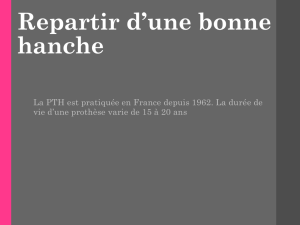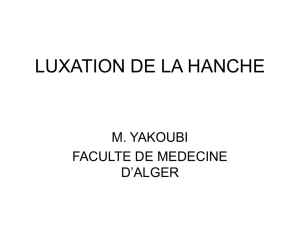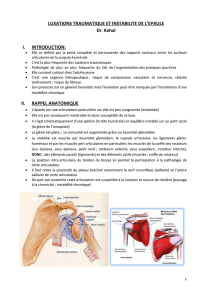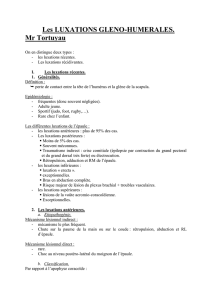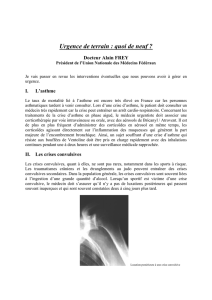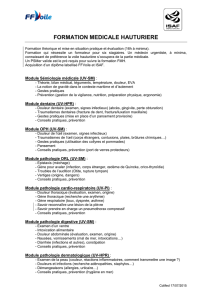entorses et luxations des doigts longs

DOSSIER FMC
N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002
1
!Les atteintes proximales
de la chaîne digitale P.2
!IPP UNE ARTICULATION TRÈS EXPOSÉE.
Traumatismes fermés et récents
des interphalangiennes proximales P.4
!IPD Ruptures possibles P.6
SOMMAIRE
PRÉSERVER
LA MOBILITÉ
2
32
1
3
ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS
2167-Doigts-Longs-web 22/04/02 17:08 Page 1

2
32
1
3
B : la rotondité
céphalique et la
détente des
ligaments
latéraux en
extension
permettent des
mouvements
normaux de
latéralité.
SCHÉMA D’UNE ARTICULATION MÉTACARPO-PHALANGIENNE.
A1 : plaque palmaire,
A2 : faisceau principal métacarpo-
phalangien du ligament latéral,
A3 : faisceau accessoire
métacarpo-glénoïdien.
2
N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002
Les entorses et luxations des
doigts sont très fréquentes, car
la main est en permanence
exposée dans tous les gestes
de la vie quotidienne. La main est
un outil précieux, mais fragile !
Les entorses et luxations des
doigts résultent des mêmes méca-
nismes lésionnels et sont parfois dif-
ficiles à différencier quand la luxa-
tion s’est spontanément réduite.
L’examen du patient est souvent
faussement rassurant : le doigt est
simplement gonflé et un peu dou-
loureux, les radiographies sont nor-
males ou ne montrent qu’un très pe-
tit arrachement osseux juxta-articu-
laire. Il convient donc de rester très
prudent dès que le diagnostic est
évoqué et de réaliser systématique-
ment un testing de l’articulation
pour retenir un diagnostic lésionnel
précis qui fixera la conduite théra-
peutique. On ne saurait se contenter
du simple diagnostic vague « d’en-
torse », car il y a de nombreux types
d’entorses et des traitements très dif-
férents, allant de la rééducation im-
médiate, sans immobilisation, jus-
qu’à l’intervention chirurgicale. En
cas de luxation, il reste nécessaire
de réduire la luxation, de préférence
après avoir réalisé une radiographie
pour identifier une éventuelle frac-
ture associée et pour que celle-ci ne
soit pas imputable à la manœuvre
de réduction.
Accidents sportifs
et professionnels
Ces traumatismes surviennent
majoritairement lors de la pratique
des sports de ballon, notamment
lorsque la main entre en contact di-
rect avec la balle comme instrument
de frappe ou de propulsion, pour
des sports tels que le volley-ball, le
basket-ball, le handball, le rugby,
etc. Les traumatismes profession-
nels sont également fréquents, en
particulier lors de l’utilisation d’ou-
tils motorisés, ou du port ou de chu-
te de charges lourdes. Une autre
cause de lésion des axes digitaux est
la percussion accidentelle du doigt
lors d’une chute ou lorsqu’il se situe
sur la trajectoire soit de la balle
(football) soit d’un mouvement ef-
fectué (professionnel ou sportif). Ces
lésions sont le plus souvent consé-
cutives à un geste brusque ou in-
adapté, parfois très violent, pouvant
entraîner des lésions graves.
Trois types de lésions principales
peuvent être observées :
— les entorses, particulièrement
fréquentes, qui correspondent à la
lésion d’un seul plan capsulo-liga-
mentaire, sans perte de congruence
articulaire ;
— les luxations, qui sont la
conséquence d’une rupture complè-
te des plans capsulo-ligamentaires,
avec perte de la congruence articu-
laire ;
— les fractures, qui peuvent ac-
compagner la luxation ; ces frac-
tures-luxations sont plus graves. ■
FMC
ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS
PRÉSERVER
LA MOBILITÉ
!A l’inverse des entorses et des luxations du pouce, ou de la première colonne, pour lesquels c’est la stabilité
de la métacarpo-phalangienne (MCP) qui prime pour la bonne fonction de la pince pollicidigitale,
pour les doigts longs c’est la mobilité qu’il faut à tout prix conserver. !La rééducation doit donc être la plus
précoce possible pour éviter les séquelles graves d’enraidissement, particulièrement au niveau de l’articulation
interphalangienne proximale. DOSSIER RÉALISÉ PAR LE DRERIC ROULOT (CHIRURGIEN DE LA MAIN, HOPITAL LARIBOISIERE ET INSTITUT DE LA MAIN, PARIS)
D
E
manière générale, les entorses
et luxations de l’articulation mé-
tacarpo-phalangienne sont plus
rares que les lésions distales, cette ar-
ticulation étant en situation anato-
mique protégée. Des éléments extrin-
sèques et intrinsèques assurent sa sta-
bilité.
Rappel anatomique
La surface articulaire de la tête du
métacarpien est elliptique de profil.
La longueur de la tête est plus impor-
tante en antéro-postérieur, expliquant
que les ligaments latéraux de la mé-
tacarpo-phalangienne (MCP) soient
tendus en flexion, une position qui
assure une stabilité maximale à cette
articulation. En extension, ces liga-
ments latéraux sont détendus, auto-
Les atteintes proximales
de la chaîne digitale
!Au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes, les entorses sont latérales, les luxations (simples ou complexes)
sont dorsales et palmaires. Les luxations palmaires sont exceptionnelles.
risant des mouvements de latéralité
et de circumduction.
Les ligaments latéraux ont deux
faisceaux :
— un faisceau principal, épais,
oblique de haut en bas et d’arrière en
avant, s’étendant de la tête du méta-
carpien jusqu’à la base de la première
phalange ;
— un faisceau accessoire solidari-
sant la tête du métacarpien aux bords
latéraux de la plaque palmaire.
La plaque palmaire est plus exten-
sible qu’au niveau de l’interphalan-
gienne proximale (IPP). Elle prolonge
la surface articulaire de la base de la
première phalange et s’articule avec
les condyles métacarpiens lorsque
l’articulation est en extension. Elle est
plus solidement liée à la base de P1
que sur le métacarpien au niveau du-
quel elle aura plus volontiers tendan-

N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002
ses expansions latérales. Latérale-
ment, les ligaments intermétacarpiens
profonds relient les plaques pal-
maires entre elles. Ce ligament n’exis-
te pas sur le bord radial de l’index et
sur le bord cubital du cinquième
doigt, expliquant la prépondérance
des lésions traumatiques à ces ni-
veaux.
Laxité recherchée
A l’examen clinique, la laxité laté-
rale doit être recherchée par des
épreuves dynamiques, réalisée sur
une métacarpo-phalangienne en
flexion. L’instabilité consiste en la
perte de congruence des surfaces ar-
ticulaires, soit en statique, soit au
cours des mouvements actifs.
L’examen radiographique nécessi-
te la réalisation de radiographies de
face et de trois quarts, les profils étant
difficilement interprétables du fait
des superpositions. Mais surtout l’in-
cidence de Brewerton réalisée sur des
métacarpiens en flexion de 65°, avec
un rayon oblique de 15° en cubital,
est importante, puisqu’elle permet
d’explorer à la fois les faces latérales
des condyles et la surface articulaire.
On décrit quatre formes d’entorses
et de luxations de l’articulation mé-
tacarpo-phalangienne : les entorses
latérales, les luxations dorsales,
simples ou complexes, et les luxa-
tions palmaires.
Entorses latérales : avec
ou sans arrachement osseux
Les entorses latérales sont relative-
ment rares, surtout celles des troisiè-
me et quatrième doigts qui sont les
mieux protégés. C’est l’examen cli-
nique qui permet de faire le diagnos-
tic de gravité, en mettant en évidence
une laxité ou une instabilité ; les
autres entorses sont qualifiées de bé-
nignes
Le testing se fait en flexion et
éventuellement sous anesthésie loca-
sans arrachement osseux et comme
des entorses bénignes s’il n’y a pas de
laxité ou d’instabilité [photos 3 et 4].
Luxation dorsales :
simples ou complexes
Les luxations dorsales résultent
d’une hyperextension forcée, avec
une désinsertion de la plaque palmai-
re au niveau du métacarpien.
Il s’agit d’une luxation simple
(également appelée subluxation) :
l’articulation est alors en hyper-
extension de P1 d’une soixantaine de
degrés avec, à la radiographie, une
image de chevauchement des sur-
faces articulaires. La réduction est
réalisable par une manœuvre exter-
ne : le poignet étant mis en flexion
pour détendre l’appareil fléchisseur,
la réduction doit s’effectuer selon la
technique de Farabeuf. Cette ma-
nœuvre maintient la base de la pha-
lange fortement appliquée sur la tête
du métacarpien tout au long de son
parcours de réduction. Il faut éviter
toute traction axiale sur le doigt sans
avoir au préalable détendu l’appareil
fléchisseur pour éviter d’incarcérer la
plaque palmaire ; cette incarcération
transformerait cette luxation initiale-
ment réductible en une luxation irré-
ductible.
Il s’agit d’une luxation complète
irréductible (luxation complexe). Ce
type de lésions s’accompagne d’une
interposition de la plaque palmaire
ou d’une incarcération de la tête du
métacarpien entre les fléchisseurs et
la musculature intrinsèque.
Cliniquement, on observe une hy-
perextension de P1, la tête du méta-
carpien étant palpable à la paume. Il
existe à ce niveau une ombilication
cutanée tout à fait typique, avec signe
du sillon qui traduit l’ombilication
des tissus captifs dans l’articulation.
Le doigt ne peut plus fléchir et la ra-
diographie retrouve une perte du pa-
rallélisme des surfaces articulaires
[photos 5 et 6].
Ces formes ne sont pas réductibles
par manœuvre externe et imposent
une réduction chirurgicale par voie
palmaire, en prenant bien garde de ne
pas léser les paquets collatéraux di-
rectement exposés en sous-cutané du
fait de la saillie de la tête du métacar-
pien [photo 7].
Il n’est pas nécessaire, une fois la
réduction obtenue, de réinsérer la
plaque palmaire en proximal.
Pour ces deux types de luxation,
une mobilité active sera d’emblée réa-
lisée dans un secteur protégé par une
attelle dorsale antiextension en
flexion de 30°, pendant trois se-
maines.
Luxations palmaires :
exceptionnelles
Les luxations palmaires sont ex-
ceptionnelles. Elles sont irréductibles
lorsqu’il y a une l’interposition de la
capsule dorsale, voire de la plaque
palmaire si celle-ci s’est désinsérée
distalement (ce qui reste très rare). ■
3
FMC
ce à se désinsérer lors des mouve-
ments d’hyperextension forcée.
Les structures extrinsèques ont un
rôle stabilisateur : la poulie en avant
qui s’applique sur la plaque palmaire,
avec les tendons fléchisseurs immé-
diatement en avant de l’articulation
et, en arrière, le tendon extenseur et
Photo 1
Entorse du ligament latéral
radial (LLR) de la
métacarpo-phalangienne du
cinquième doigt, avec
laxité importante en
abduction au testing.
L’intervention chirurgicale
est nécessaire.
Photo 2
Vue opératoire chez le
même patient, le ligament
(sur un fil) est
complètement déchiré et
doit être réinséré pour
permettre une cicatrisation
correcte sans laxité
résiduelle. L’articulation est
largement ouverte par le
traumatisme qui a déchiré
toute la capsule articulaire
sur son versant radial.
Photo 4
Entorse du ligament latéral
cubital de la métacarpo-
phalangienne de l’index avec
fragment osseux arraché.
Celui-ci est volumineux
et déplacé avec retournement
du fragment. La rupture
ligamentaire est donc complète
et le risque de non-
consolidation majeur.
Il est donc nécessaire de
refixer le fragment osseux.
Photo 6
L’examen de la paume de la
main chez le même patient
retrouve le signe du sillon centré
sur la métacarpo-phalangienne.
Le diagnostic de luxation dorsale
avec incarcération est évident et
l’intervention s’impose.
Photo 7
Même patient que
précédemment. La tête du
métacarpien est directement
visible sous la peau, ainsi que
le nerf collatéral radial très
exposé. La simple libération
de la plaque palmaire
interposée va suffire à
résoudre le problème.
structures latérales lésées. Il faut être
particulièrement vigilant pour les lé-
sions de l’index en recherchant une
lésion du ligament latéral radial : les
déficits fonctionnels secondaires sont
beaucoup plus importants que pour
les autres doigts compte tenu de son
rôle fondamental dans la stabilité de
la pince pouce-index.
En cas d’arrachement osseux as-
socié, l’examen clinique est tout aussi
indispensable pour faire le diagnostic
de gravité, mais la présence d’un frag-
ment osseux dépassant 20 % de la
surface articulaire constitue à elle
seule une indication chirurgicale
d’ostéosynthèse.
Les arrachements de plus petite
taille sont traités comme des entorses
le. Il devrait être réalisé en statique et
en dynamique, éventuellement com-
plété par des radiographies en situa-
tion de stress. C’est l’importance de
la laxité qui guide l’indication chirur-
gicale [photos 1 et 2].
Sans arrachement osseux, la plu-
part des entorses latérales sont bé-
nignes et traitées fonctionnellement
par une mobilisation active immédia-
te en syndactylie. Le doigt sain choisi
sera celui situé du côté de la lésion
pour ne pas mettre en tension les
Photo 5
Même patient, une fois le vissage
du fragment osseux effectué.
Photo 3
Patient vu dans les suites
d’un traumatisme en
hyperextension. La main
est gonflée et la flexion
de la métacarpo-
phalangienne impossible.
[ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS]

N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002
LES traumatismes fermés des
interphalangiennes proximales
sont parmi les lésions les plus
fréquentes des doigts. Leur gravité
tient à l’importance de l’interpha-
langienne proximale (IPP) dans la
fonction de la chaîne digitale.
Entorses et luxations sont au pre-
mier plan. Différentes fractures arti-
culaires peuvent leur être associées.
La prise en charge des lésions liga-
mentaires vise à éviter des séquelles
graves, encore trop fréquentes. Les
résultats des traitements ne sont
bons que dans 45 % des cas, alors
que 86 % des entorses et luxations
de la métacarpo-phalangienne trou-
vent une solution thérapeutique
satisfaisante.
Rappel anatomique
L’articulation interphalangienne
proximale est une articulation tro-
chléenne à un seul degré de liberté,
la flexion-extension. Les mobilités
en flexion-extension de l’interpha-
langienne proximale sont de 110
degrés, avec un arc fonctionnel utile
jugé à 60 degrés pour les gestes de
la vie courante. Cette flexion est
sion de l’articulation. En vis-à-vis
de P1, se situe la base de P2 consti-
tuée de deux cavités glénoïdes,
séparées par une crête qui répond
à la gorge intercondylienne, avec,
de chaque côté de sa surface articu-
laire, la zone d’insertion des liga-
ments latéraux principaux.
4
FMC
IPP Une articulation
très exposée
Traumatismes fermés et récents des interphalangiennes
proximales
!Les conséquences des entorses et luxations de l’interphalangienne proximale
(IPP), articulation particulièrement sollicitée, sont beaucoup plus sévères qu’au
niveau de la métacarpo-phalangienne. Le but du traitement est la restauration
de la congruence articulaire en limitant au minimum les durées d’immobilisation
qui ne doivent jamais dépasser trois semaines.
Photo 8
Luxation dorsale de
l’interphalangienne proximale du
cinquième doigt. Ces luxations sont
très fréquentes et résultent d’un
traumatisme en hyperextension
(fréquent chez les sportifs).
La solide plaque palmaire
de l’articulation
interphalangienne
proximale s’attache
distalement sur la base
de P2 ; proximalement,
ses deux freins s’insèrent
sur la diaphyse de P1.
Elle est suspendue à la
tête de P1 par les
ligaments latéraux
accessoires. Sur elle
s’attache la gaine
fibreuse des tendons
fléchisseurs.
C’est l’inverse en
extension : les ligaments
latéraux accessoires sont
tendus alors que les
ligaments latéraux
principaux sont détendus.
En flexion, le ligament
latéral principal est tendu.
Pour tester sa qualité
mécanique, le testing se
fait en demi-flexion.
Photo 9
Luxation latérale à réduire
rapidement.
assurée par le fléchisseur commun
superficiel. L’extension, quant à
elle, est le fait de l’action de la ban-
delette médiane de l’extenseur et
des muscles intrinsèques qui inter-
viennent lorsque la métacarpo-pha-
langienne est fléchie.
La tête de P1 est constituée de
deux condyles avec une gorge
médiane, dont la direction est dif-
férente pour chacun des doigts
longs afin d’assurer leur conver-
gence en flexion.
Les tubercules latéraux donnent
l’insertion aux ligaments latéraux
sur les faces latérales de leurs
condyles et matérialisent ainsi une
ligne qui est l’axe de flexion-exten-
Photo 10
La radio avant réduction reste
de pratique prudente pour
dépister les associations
fracturaires préexistant à la
réduction.
[ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS]
Suite page 5 ◆◆◆

FMC
Les ligaments latéraux princi-
paux et latéraux accessoires présen-
tent une tension qui ne se modifie
pratiquement pas dans l’arc de
flexion-extension. Ces fibres, du fait
de leur position, sont surtout ten-
dues en flexion.
La plaque palmaire est un fibro-
cartilage tendu en extension, qui se
plisse en flexion et qui, s’insérant
sur toute la largeur de la base de P2,
constitue le plancher de l’articula-
tion interphalangienne proximale.
Cette structure limite l’hyperexten-
sion et la luxation n’est possible que
si ce contexte est rompu en deux
plans différents.
Le consensus semble se faire sur
une position d’immobilisation en
extension qui assure une meilleure
stabilité, avec des possibilités
d’arthrolyse ultérieure plus simple
que sur les enraidissements en
flexion et qui évitent par ailleurs les
interposions après réduction.
Mobilité active,
stabilité passive
Outre les radiographies systéma-
tiques sous de multiples incidences,
l’examen repose surtout sur le tes-
ting, réalisé au mieux sous anesthé-
sie locale, permettant d’explorer la
mobilité active et la stabilité pas-
sive.
Une mobilité active normale en
flexion-extension autorise une
mobilisation précoce en syndacty-
lie.Le testing de la stabilité passive
est indispensable en latéralité et en
tiroir antéro-postérieur :
— en flexion latérale, on teste le
ligament latéral principal, alors
qu’en extension latérale on teste le
ligament accessoire et sa jonction
avec la plaque palmaire ;
— lors des manœuvres en tiroir
antéro-postérieur, une hyperexten-
sion anormale signe une lésion de
la plaque palmaire, alors qu’une
subluxation palmaire signe une
lésion de l’appareil extenseur.
Des luxations dorsales,
latérales et palmaires
Les luxations dorsales [photo 8]
sont les plus fréquentes et elles
s’accompagnent nécessairement
d’une rupture complète de la
plaque palmaire et d’au moins un
ligament latéral. Cette rupture est
presque toujours distale. Le traite-
ment reste orthopédique dans la
grande majorité des cas, confié soit
à une attelle « IPP stop » (autorisant
une mobilisation en flexion, mais
limitant l’extension à – 20 degré), soit à une mise en extension com-
plète de l’interphalangienne proxi-
male, avec mobilisation précoce en
syndactylie à la troisième semaine.
Le traitement chirurgical doit être
réservé aux grosses instabilités ou
aux luxations irréductibles ; il
repose sur la réinsertion de la
plaque palmaire.
Les luxations latérales [photos 9
et 10] sont la conséquence d’un
traumatisme en extension, qui
rompt à la fois le ligament latéral
inséré sur P1 et la plaque palmaire.
Les lésions débutent en dorsal et se
propagent en direction palmaire et
distale. Le traitement est le plus
souvent orthopédique ; il repose sur
une réduction et mise en syndacty-
lie pour quatre semaines. Le traite-
ment chirurgical, exceptionnel,
repose sur la réinsertion ligamen-
taire et s’adresse aux formes qui se
reluxent lors de la mobilisation
active ou qui restent désaxées après
réduction du fait d’une interposi-
tion [photo 11].
Les luxations palmaires [photo
12] sont les plus rares et résultent
d’un mécanisme de compression-
rotation sur un doigt demi-fléchi.
Un ligament latéral est toujours
rompu ; l’appareil extenseur est for-
tement lésé ; une rupture quasi
constante de la bandelette médiane
est associée à la luxation palmaire
d’une bandelette latérale qui peut
s’incarcérer et rendre cette luxation
irréductible. Une fois la réduction
effectuée, il faut tester la bandelette
médiane de l’appareil extenseur,
responsable — lorsqu’elle est rom-
pue — d’un déficit de l’extension
active ou de la persistance d’une
subluxation palmaire, imposant
alors un traitement chirurgical de
résinsertion du tendon extenseur et
du ligament latéral avulsé [photo 13].
Le diagnostic d’entorse est le
plus fréquent mais il reste un dia-
gnostic d’élimination et impose un
testing au moindre doute devant
une grosse articulation doulou-
reuse.
Entorses :
lésion d’un seul plan
Ces entorses sont le fait de la
lésion d’un seul plan, qu’il s’agisse
de la plaque palmaire, de la bande-
lette médiane ou du ligament laté-
ral.
Leur prise en charge impose de
laisser libres les articulations méta-
carpo-phalangienne et interphalan-
gienne distale et d’immobiliser pré-
férentiellement l’interphalangienne
proximale en extension.
La mobilisation active précoce
est possible pour les ruptures iso-
lées d’un ligament latéral ou de la
plaque palmaire, avec syndactylie
ou, éventuellement, une attelle de
protection.
Les ruptures sous-cutanées de la
bandelette médiane imposeront une
immobilisation en extension stricte
pendant trois semaines.
Entorses et luxations avec
fractures articulaires ajoutées
Les fractures articulaires de
l’interphalangienne proximale inté-
ressent, par définition, au moins
25 % d’une des surfaces articu-
laires. Les arrachements marginaux
s’apparentent aux entorses et aux
luxations. Ces fractures sont poten-
tiellement graves, exposant aux
risques de cal vicieux, de raideur et
d’arthrose secondaire.
La rééducation reste fondamen-
tale, fondée sur une mobilisation
immédiate de la métacarpo-phalan-
gienne et de l’interphalangienne
distale et sur une rééducation pré-
coce, active, aidée de l’interphalan-
gienne proximale.
En dehors des formes non dépla-
cées stables, les fractures de la tête
de P1 relèvent plutôt du traitement
chirurgical, alors que les fractures
de la base de P2 relèvent préféren-
tiellement d’un traitement orthopé-
dique. Les fractures de la tête de P1,
qui se subdivisent en fractures uni-
condyliennes et fractures sus-
condyliennes et intercondyliennes,
ne font pas partie du sujet des
entorses et luxations. Les fractures
non déplacées de la base de P2 sont
traitées par la mise en place d’une
attelle en rectitude pendant trois
semaines ; le traitement chirurgical,
quand il est nécessaire, se fait par
un abord plutôt dorso-latéral.
Quand elles s’accompagnent
d’une luxation, ces fractures entrent
dans le cadre des luxations-frac-
tures de traitement difficile ; elles
exposent à des séquelles impor-
tantes lorsqu’elles concernent la
base de la deuxième phalange.
Deux éléments guident la conduite
thérapeutique : la stabilité de l’arti-
culation après réduction et l’aspect
du fragment palmaire :
— la stabilité dépend directe-
ment de la taille du fragment pal-
maire : lorsqu’il est volumineux, il
peut recevoir toutes les insertions
distales du ligament latéral princi-
pal si bien que la base de P2 se luxe
en position dorsale, sous l’action de
la bandelette médiane de l’exten-
seur et du fléchisseur superficiel ;
l’examen après réduction sous bloc
digital est indispensable pour dif-
férencier les formes qui seront
stables après réduction de celles qui
se reluxent ;
— l’aspect du fragment palmaire
est également important à analyser :
est-il unifragmentaire ou plurifrag-
mentaire ? est-il associé ou non à un
enfoncement articulaire ?
Différentes méthodes thérapeu-
tiques pourront alors être mises en
route, visant à corriger le déplace-
ment dorsal et à restaurer une
congruence articulaire (orthopé-
dique par attelle et/ou
chirurgicale). ■
5
N° 2167 - MARDI 15 JANVIER 2002
Photo 11
Vue opératoire d’une
interposition ligamentaire du
ligament latéral radial dans
l’articulation empêchant la
bonne réduction.
Photo 13
Vue opératoire d’une
interphalangienne proximale
après luxation palmaire avec
arrachement de la bandelette
médiane de l’extenseur et du
ligament latéral cubital tous
deux bien visibles sur des fils
tracteurs avant leur réinsertion.
Photo 12
Luxation palmaire de
l’interphalangienne proximale.
Notez la composante rotatoire
qui traduit la lésion
systématique complète d’un des
ligaments latéraux.
◆◆◆Suite de la page 4
LES RESULTATS THERAPEUTHIQUES SUR
LES ENTORSES ET LUXATIONS DES IPP NE SONT
BONS QUE DANS 45% DES CAS.
[ENTORSES ET LUXATIONS DES DOIGTS LONGS]
 6
6
1
/
6
100%