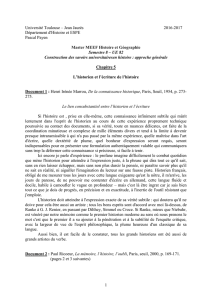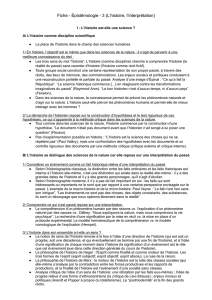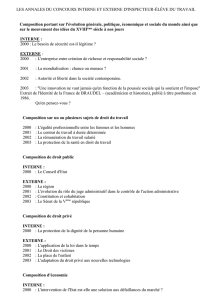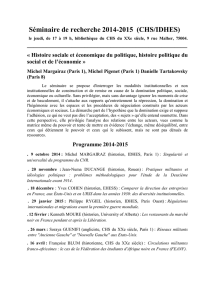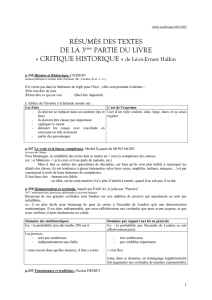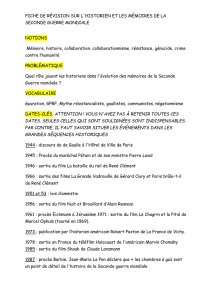Le terme d`histoire est ambigu : que signifie cette ambiguïté ? « Le

Le terme d'histoire est ambigu : que signie cette ambiguïté ?
« Le même mot, en français, en anglais, en allemand, s'applique à la réalité historique et à la
connaissance que nous en prenons. Histoire, history, Geschichte désignent à la fois le devenir
de l'humanité et la science que les hommes s'efforcent d'élaborer de leur devenir (même si
l'équivoque est atténuée, en allemand, par l'existence de mots, Geschehen, Historie, qui n'ont
qu'un des deux sens). Cette ambiguïté me paraît bien fondée ; la réalité et la connaissance de
cette réalité sont inséparables l'une de l'autre […]. La science physique n'est pas un élément
de la nature qu'elle explore (même si elle le devient en la transformant). La conscience du
passé est constitutive de l'existence historique. L'homme n'a vraiment un passé que s'il a
conscience d'en avoir un, car seule cette conscience introduit la possibilité du dialogue et du
choix. Autrement, les individus et les sociétés portent en eux un passé qu'ils ignorent, qu'ils
subissent passivement. Ils offrent éventuellement à un observateur du dehors une série de
transformations, comparables à celles des espèces animales et susceptibles d'être rangées en
un ordre temporel. Tant qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils furent, ils
n'accèdent pas à la dimension propre de l'histoire.
L'homme est donc à la fois le sujet et l'objet de la connaissance historique. »
Raymond ARON, Dimensions de la conscience historique, Plon, 1964, p.5
« Dans notre expérience commune nous sommes tous entourés d'objets physiques. La science
doit décrire et expliquer ces objets, mais nous ne les perdrions pas de vue si nous ne
possédions pas l'aide de la science ; il semble que nous puissions les percevoir et que nous
puissions les voir, les toucher immédiatement. Mais nous ne pouvons saisir notre vie passé, la
vie de l'humanité de cette façon. Sans le labeur constant et infatigable de l'histoire, cette vie
demeurerait un livre clos. Ce que nous appelons notre conscience historique moderne dut
être construite pas à pas par le travail de grands historiens. L'histoire inverse pour ainsi dire
le processus créateur qui caractérise notre civilisation humaine. La civilisation humaine crée
nécessairement de nouvelles formes, de nouveaux symboles, de nouvelles formes matérielles
en lesquelles la vie de l'homme trouve son expression interne. L'historien poursuit toutes ses
expressions jusqu'en leur origine. Il essaie de reconstruire la vie réelle qui est à la base de
toutes ces formes singulières. »
Ernst CASSIRER, « Séminaire sur la philosophie de l'histoire » (1942), in L’Idée de l’histoire,
éd. du Cerf, p.84
Quels sont les enjeux de l'histoire ?
« L'histoire est pour l'espèce humaine ce que la raison est pour l'individu. Grâce à sa raison,
l'homme n'est pas renfermé comme l'animal dans les limites étroites du présent visible ; il
connaît encore le passé inniment plus étendu, source du présent qui s'y rattache : c'est cette
connaissance seule qui lui procure une intelligence plus nette du présent et lui permet même
de formuler des inductions pour l'avenir. L'animal, au contraire, dont la connaissance sans
réexion est bornée à l'intuition, et par suite au présent, erre parmi les hommes, même une
fois apprivoisé, ignorant, engourdi, stupide, désarmé et esclave. – De même un peuple qui ne
connaît pas sa propre histoire est borné au présent de la génération actuelle : il ne comprend
ni sa nature, ni sa propre existence, dans l'impossibilité où il est de les rapporter à un passé
qui les explique ; il peut moins encore anticiper sur l'avenir. Seule l'histoire donne à un
peuple une entière conscience de lui-même. L'histoire peut donc être regardé comme la
conscience raisonnée de l'espèce humaine ; elle est à l'humanité ce qu'est à l'individu la
conscience soutenue par la raison, rééchie et cohérente, dont le manque condamne l'animal
à rester enfermé dans le champ étroit du présent intuitif. »
SCHOPENHAUER, « De l'histoire », Le Monde comme volonté et comme représentation,
supplément au livre III, PUF, 1998, p.1185-1186
Textes sur l'histoire

« En cette n de millénaire, les Européens, et tout particulièrement les Français, sont obsédés
par un nouveau culte, celui de la mémoire. Comme s'ils étaient saisis de nostalgie pour un
passé qui s'éloigne irrévocablement, ils s'adonnent avec ferveur à des rites conjuratoires,
censés le maintenir vivant […] Il faut d'abord noter que la représentation du passé est
constitutive non seulement de l'identité individuelle – la personne présente est faite de ses
propres images d'elle-même –, mais aussi de l'identité collective. Or qu'on le veuille ou non,
la plupart des êtres humains ont besoin de ressentir leur appartenance à un groupe : c'est
qu'ils trouvent là le moyen le plus immédiat d'obtenir la reconnaissance de leur existence,
indispensable à tout un chacun. Je suis catholique, ou berrichon, ou paysan, ou communiste :
je ne suis pas personne, je ne risque pas d'être englouti par le néant. […]
Une autre raison pour se préoccuper du passé est que cela nous permet de nous détourner du
présent, tout en nous procurant les bénéces de la bonne conscience. Qu'on nous rappelle
aujourd'hui avec minutie les souffrances passées nous rend peut-être vigilants à l'égard de
Hitler et de Pétain, mais nous fait aussi d'autant mieux ignorer les menaces présentes –
puisqu'elles n'ont pas les mêmes acteurs ni ne prennent les mêmes formes. Dénoncer les
faiblesses d'un homme sous Vichy me fait apparaître comme un vaillant combattant de la
mémoire et de la justice, sans m'exposer à aucun danger ni m'obliger d'assumer mes
éventuelles responsabilités face aux détresses actuelles. Commémorer les victimes du passé
est gratiant, s'occuper de celles d'aujourd'hui dérange […]. »
Tzvetan TODOROV, Les Abus de la mémoire, éd. Arléa, 1995, pp.51-55
« Celle-ci [L'histoire] intéresse l’être vivant sous trois rapports: dans la mesure où il agit et
poursuit un but, dans la mesure où il conserve et vénère ce qui a été, dans la mesure où il
souffre et a besoin de délivrance. A ces trois rapports correspondent trois formes d’histoire,
pour autant qu’il est permis de distinguer entre une histoire monumentale, une histoire
traditionaliste, et une histoire critique.»
NIETZSCHE, Considérations Inactuelles, 2
L'histoire peut-elle prétendre à la vérité ?
« Qu'est-ce donc que l'histoire ? Je proposerai de répondre : L'histoire est la connaissance du
passé humain. […] Nous dirons connaissance, et non pas, comme d'autres, « recherche », ou
« étude » (bien que ce sens d'« enquête » soit le premier sens du mot grec historia), car c'est
confondre la n et les moyens ; ce qui importe c'est le résultat atteint par la recherche : nous
ne la poursuivrions pas si elle ne devait pas aboutir ; l'histoire se dénit par la vérité qu'elle
se montre capable d'élaborer. Car, en disant connaissance, nous entendons connaissance
valide, vraie : l'histoire s'oppose par là à ce qui serait, à ce qui est représentation fausse ou
falsiée, irréelle du passé, à l'utopie, à l'histoire imaginaire […], au roman historique, au
mythe, aux traditions populaires ou aux légendes pédagogiques — ce passé en images
d'Épinal que l'orgueil des grands États modernes inculque, dès l'école primaire, à l'âme
innocente de ses futurs citoyens. Sans doute cette vérité de la connaissance historique est-elle
un idéal, dont, plus progressera notre analyse, plus il apparaîtra qu'il n'est pas facile à
atteindre : l'histoire du moins doit être le résultat de l'effort le plus rigoureux, le plus
systématique pour s'en rapprocher. C'est pourquoi on pourrait peut-être préciser utilement :
« la connaissance scientiquement élaborée du passé », […] c'est-à-dire, par opposition à la
connaissance vulgaire de l'expérience quotidienne, une connaissance élaborée en fonction
d'une méthode systématique et rigoureuse, celle qui s'est révélée représenter le facteur
optimum de vérité. »
Henri-Irénée MARROU, De la connaissance historique, Seuil, p.32

« Comme le roman, l'histoire trie, simplie, organise, fait tenir un siècle en une page […] en
aucun cas ce que les historiens appellent un événement n'est saisi directement et
entièrement ; il l'est toujours incomplètement et latéralement, à travers des documents ou des
témoignages, disons à travers des tekmeria, des traces. Même si je suis contemporain et
témoin de Waterloo, même si j'en suis le principal acteur et Napoléon en personne, je n'aurai
qu'une perspective sur ce que les historiens appelleront l'événement de Waterloo ; je ne
pourrai laisser à la postérité que mon témoignage, qu'elle appellera trace s'il parvient jusqu'à
elle. Même si j'étais Bismarck qui prend la décision d'expédier la dépêche d'Ems, ma propre
interprétation de l'événement ne sera peut-être pas la même que celle de mes amis, de mon
confesseur, de mon historien attitré et de mon psychanalyste, qui pourront avoir leur propre
version de ma décision et estimer mieux savoir que moi ce que je voulais. Par essence,
l'histoire est connaissance par documents. Aussi la narration historique se place-t-elle au-delà
de tous les documents, puisqu'aucun d'eux ne peut être l'événement ; elle n'est pas un
photomontage documentaire et ne fait pas voir le passé « en direct, comme si vous y étiez
» […]. [L]'histoire est connaissance mutilée. Un historien ne dit pas ce qu'a été l'Empire
romain ou la Résistance française en 1944, mais ce qu'il est encore possible d'en savoir. Il va
assurément de soi qu'on ne peut pas écrire l'histoire d'événements dont il ne reste aucune
trace, mais il est curieux que cela aille de soi : ne prétend-on pas cependant que l'histoire est
ou doit être reconstitution intégrale du passé ? N'intitule-t-on pas des livres « Histoire de
Rome » ou « La Résistance en France » ? L'illusion de reconstitution intégrale vient de ce
que les documents, qui nous fournissent les réponses, nous dictent aussi les questions ; par là,
non seulement ils nous laissent ignorer beaucoup de choses, mais encore ils nous laissent
ignorer que nous les ignorons. […] La connaissance historique est taillée sur le patron de
documents mutilés ; nous ne souffrons pas spontanément de cette mutilation et nous devons
faire un effort pour la voir, précisément parce que nous mesurons ce que doit être l'histoire
sur le patron des documents. Nous n'abordons pas le passé avec un questionnaire préétabli
(quel était le chiffre de la population ? le système économique ? la civilité puérile et
honnête ?), en étant décidés à refuser à l'examen toute période qui laisserait en blanc les
réponses à un trop grand nombre de questions ; nous n'exigeons pas non plus du passé qu'il
s'explique clairement et ne refusons pas le titre de fait historique à quelque événement, sous
prétexte que les causes en demeurent inconnaissables. L'histoire ne comporte pas de seuil de
connaissance ni de minimum d'intelligibilité et rien de ce qui a été, du moment que cela a été,
n'est irrecevable pour elle. L'histoire n'est donc pas une science ; elle n'en a pas moins sa
rigueur, mais cette rigueur se place à l'étage de la critique. »
Paul VEYNE, Comment on écrit l'histoire, p.14-15
« La science historique commence […] en réagissant contre les transformations imaginatives
du passé. On s'efforce d'établir ou de reconstruire les faits selon les techniques les plus
rigoureuses, on xe la chronologie, on prend les mythes eux-mêmes et les légendes comme
objet an d'arriver à la tradition et, par-delà, à l'événément qui leur ont donné naissance,
bref, pour reprendre la formule fameuse de Ranke, l'ambition suprême de l'historien est de
savoir et de faire savoir wie es geschehen ist, comment cela s'est passé. La réalité pure, tel est
son objectif dernier, son objectif unique. »
Raymond ARON, Dimensions de la conscience historique, Plon, p.12

« Le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays : quoiqu'il aime sa patrie, il ne la
atte jamais en rien. L'historien français doit se rendre neutre entre la France et l'Angleterre :
il doit louer aussi volontiers Talbot que Duguesclin ; il rend autant de justice aux talents
militaires du prince de Galles, qu'à la sagesse de Charles V.
Il évite également le panégyrique et les satires : il ne mérite d'être cru qu'autant qu'il se borne
à dire, sans atterie et sans malignité, le bien et le mal. Il n'omet aucun fait qui puisse servir à
peindre les hommes principaux, et à découvrir les causes des événements ; mais il retranche
toute dissertation où l'érudition d'un savant veut être étalée. Toute sa critique se borne à
donner comme douteux ce qui l'est, et à en laisser la décision au lecteur, après lui avoir
donné ce que l'histoire lui fournit. L'homme qui est plus savant qu'il n'est historien, et qui a
plus de critique que de vrai génie, n'épargne à son lecteur aucune date, aucune circonstance
superue, aucun fait sec et détaché ; il suit son goût sans consulter celui du public ; il veut
que tout le monde soit aussi curieux que lui des minuties vers lesquelles il tourne son
insatiable curiosité. Au contraire, un historien sobre et discret laisse tomber les menus faits
qui ne mènent le lecteur à aucun but important. Retranchez ces faits, vous n'ôtez rien à
l'histoire : ils ne feront qu'interrompre, qu'allonger, que faire une histoire, pour ainsi dire,
hachée en petits morceaux, et sans aucun l de vive narration. Il faut laisser cette
superstitieuse exactitude aux compilateurs. Le grand point est de mettre d'abord le lecteur
dans le fond des choses, de lui en découvrir les liaisons, et de se hâter de le faire arriver au
dénouement [...]
La principale perfection d'une histoire consiste dans l'ordre et dans l'arrangement. Pour
parvenir à ce bel ordre, l'historien doit embrasser et posséder toute son histoire ; il doit la
voir tout entière comme d'une seule vue ; il faut qu'il la tourne et qu'il la retourne de tous les
côtés, jusqu'à ce qu'il ait trouvé son vrai point de vue [...]
Le point le plus nécessaire et le plus rare pour un historien est qu'il sache exactement la
forme du gouvernement et le détail des mœurs de la nation dont il écrit l'histoire, pour
chaque siècle. »
FÉNELON, « Lettre à M Docier sur les occupations de l'Académie française », VIII, Projet
d'un Traité sur l'histoire (1714), Edit. F. Didot, p. 524.
« Thucydide est à mon gré le vrai modèle des historiens. Il rapporte les faits sans les juger,
mais il n'omet aucune des circonstances propres à nous en faire juger nous-mêmes. Il met
tout ce qu'il raconte sous les yeux du lecteur ; loin de s'interposer entre les événements et les
lecteurs, il se dérobe ; on ne croit plus lire, on croit voir. »
ROUSSEAU, Émile ou de l'éducation, L, IV. (1762).
« De plus, il s'en faut bien que les faits décrits par l'histoire soient la peinture exacte des
mêmes faits tels qu'ils sont arrivés : ils changent de forme dans la tête de l'historien, ils se
moulent sur ses intérêts, ils prennent la teinte de ses préjugés. Qui est-ce qui sait mettre
exactement le lecteur au lieu de la scène pour voir un événement tel qu'il s'est passé ?
L'ignorance ou la partialité déguise tout. Sans altérer même un trait historique, en étendant
ou resserrant des circonstances qui s'y rapportent, que de faces différentes on peut lui
donner ! Mettez un même objet à divers points de vue, à peine paraîtra-t-il le même, et
pourtant rien n'aura changé que l'œil du spectateur. Suft-il, pour l'honneur de la vérité, de
me dire un fait véritable en me le faisant voir tout autrement qu'il n'est arrivé ? Combien de
fois un arbre de plus ou de moins, un rocher à droite ou à gauche, un tourbillon de poussière
élevé par le vent ont décidé de l'événement d'un combat sans que personne s'en soit aperçu !
Cela empêche-t-il que l'historien ne vous dise la cause de la défaite ou de la victoire avec
autant d'assurance que s'il eût été partout ? Or que m'importent les faits en eux-mêmes,
quand la raison m'en reste inconnue ? Et quelles leçons puis-je tirer d'un événement dont
j'ignore la vraie cause ? L'historien m'en donne une, mais il la controuve ; et la critique elle-
même, dont on fait tant de bruit, n'est qu'un art de conjecturer, l'art de choisir entre
plusieurs mensonges celui qui ressemble le mieux à la vérité. »
ROUSSEAU, Émile ou de l'éducation, livre IV, GF, (p.309)

« Nous attendons de l'histoire une certaine objectivité, l'objectivité qui lui convient : c'est de
là que nous devons partir et non de l'autre terme. Or qu'attendons-nous sous ce titre ?
L'objectivité ici doit être prise en son sens épistémologique strict : est objectif ce que la
pensée méthodique a élaboré, mis en ordre, compris et ce qu'elle peut ainsi faire comprendre.
Cela est vrai des sciences physiques, des sciences biologiques; cela est vrai aussi de l'histoire.
Nous attendons par conséquent de l'histoire qu'elle fasse accéder le passé des sociétés
humaines à cette dignité de l'objectivité. Cela ne veut pas dire que cette objectivité soit celle
de la physique ou de la biologie : il y a autant de niveaux d'objectivité qu'il y a de
comportements méthodiques. Nous attendons donc que l'histoire ajoute une nouvelle
province à l'empire varié de l'objectivité. »
RICŒUR, Histoire et vérité, p.23
Qu'est-ce qu'un fait historique ?
« Les faits n'existent pas isolément, en ce sens que le tissu de l'histoire est ce que nous
appellerons une intrigue, un mélange très humain et très peu « scientique » de causes
matérielles, de ns et de hasards ; une tranche de vie, en un mot, que l'historien découpe à
son gré et où les faits ont leurs liaisons objectives et leur importance relative […]. Une
intrigue n'est pas un déterminisme où des atomes appelés armée prussienne culbuteraient des
atomes appelés armée autrichienne ; les détails y prennent donc l'importance relative
qu'exige la bonne marche de l'intrigue. Si les intrigues étaient de petits déterminismes, alors,
quand Bismarck expédie la dépêche d'Ems, le fonctionnement du télégraphe serait détaillé
avec la même objectivité que la décision du chancelier et l'historien aurait commencé par
nous expliquer quels processus biologiques avaient amené la venue au monde du même
Bismarck. […] Quels sont les faits qui sont dignes de susciter l'intérêt de l'historien ? Tout
dépend de l'intrigue choisie ; en lui-même, un fait n'est ni intéressant, ni le contraire. Est-il
intéressant pour un archéologue d'aller compter le nombre de plumes qu'il y a sur les ailes de
la Victoire de Samothrace ? Fera-t-il preuve, ce faisant, d'une louable rigueur ou d'une
superfétatoire acribie ? Impossible de répondre, car le fait n'est rien sans son intrigue ; il
devient quelque chose si l'on en fait le héros ou le gurant d'un drame d'histoire de l'art où
l'on fera se succéder la tendance classique à ne pas mettre trop de plumes et à ne pas gnoler
le rendu, la tendance baroque à surcharger et à fouiller le détail et le goût qu'on les arts
barbares de remplir le champ avec des éléments décoratifs. […]
Un événement, quel qu'il soit, implique un contexte, puisqu'il a un sens ; il renvoie à une
intrigue dont il est un épisode, ou plutôt à un nombre indéni d'intrigues […]. Il est
impossible de décrire une totalité et toute description est sélective ; l'historien ne lève jamais
la carte de l'événementiel, il peut tout au plus multiplier les itinéraires qui le traversent.
Comme l'écrit à peu près F. von Hayek, le langage nous abuse qui parle de la Révolution
française ou de la guerre de Cent Ans comme d'unités naturelles, ce qui nous porte à croire
que le premier pas dans l'étude de ces événements doit être d'aller voir à quoi ils ressemblent,
comme on fait quand on entend parler d'une pierre ou d'un animal ; l'objet de l'étude n'est
jamais la totalité de tous les phénomènes observables en un temps et en un lieu donnés, mais
toujours certains aspects seulement qui en sont choisis ; selon la question que nous posons, la
même situation spatiotemporelle peut contenir un certain nombre d'objets différents d'étude
[…]. Les historiens racontent des intrigues, qui sont comme autant d'itinéraires qu'ils tracent
à leur guise à travers le très objectif champ événementiel (lequel est divisible à l'inni et n'est
pas composé d'atomes événementiels) […]. Les événements ne sont pas des choses, des objets
consistants, des substances ; ils sont un découpage que nous opérons librement dans la
réalité, un agrégat de processus où agissent et pâtissent des substances en interaction,
hommes et choses. […] Les événements n'existent donc pas avec la consistance d'une guitare
ou d'une soupière. »
Paul VEYNE, Comment on écrit l'histoire, p.51-58
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%