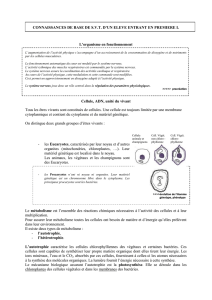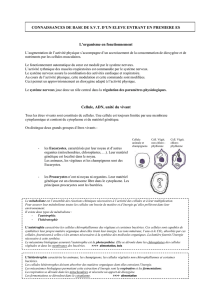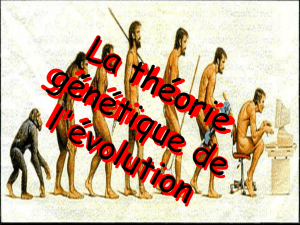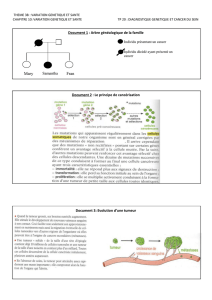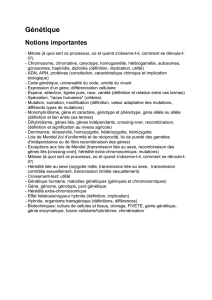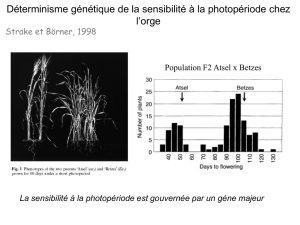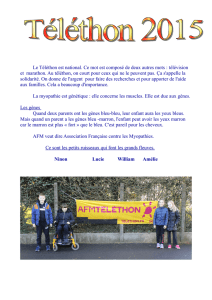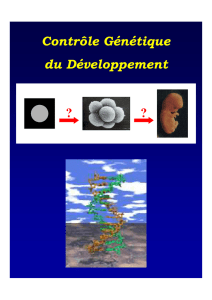Télécharger/Lire tout le chapitre - Manuel de l`évolution biologique

3 - LES MÉCANISMES ÉVOLUTIFS
Ce chapitre aborde les mécanismes qui sont à l'origine de l'évolution : les
phénomènes génétiques, la sélection naturelle, et leur conséquence immédiate, la
spéciation.
3.1 - La variabilité génétique
La variabilité génétique est l’une des principales sources de l'évolution ; les
méthodes d'estimation et les mécanismes qui président à son maintien et à son
développement sont exposés dans cette section.
3.1.1 - Les méthodes d'appréciation de la variabilité
Trois méthodes principales sont utilisées :
- séquençage des acides nucléiques (voir la section 2.1.2),
- séquençage des protéines (voir la section 2.1.2),
- électrophorèse.
L'électrophorèse utilise la polarité d'un certain nombre de molécules telles que
les acides nucléiques ou les protéines. Lorsque l'on veut identifier les molécules d'un
mélange, on les sépare en les plaçant dans un champ électrique. Selon leur polarité,
leur charge électrique globale et leur conformation, elles vont migrer vers l’un des
pôles à une vitesse qui leur est propre. On utilise également leurs propriétés
amphotères. Les acides aminés, par exemple, peuvent être chargés positivement ou
négativement suivant les valeurs du pH. Si le pH est bas, ils sont chargés positivement
(+) ; pour une valeur précise du pH (pH isoélectrique ou pHi), ils sont chargés
positivement (+) et négativement (-) ; enfin, lorsque le pH est élevé, ils sont chargés
négativement (-). Par exemple, si la solution tampon utilisée pour l'électrophorèse
possède un pH de 5,2, les acides aminés dont le pHi est supérieur à 5,2 deviennent
des anions (-), ceux dont le pHi est inférieur à 5,2 deviennent des cations (+). Les
acides terminaux et les radicaux (R), comprenant parfois une ou plusieurs fonctions
carboxyles et/ou amines libres, déterminent la polarité totale du polypeptide, les
fonctions carboxyles (COOH) et amines (NH2) caractéristiques des acides aminés
d’une chaîne peptidique sont engagées dans les liaisons peptidiques et elles ne
peuvent intervenir dans la polarité de la molécule.
149

Dans la solution tampon, les protéines ont des charges résultantes différentes.
Placées dans un champ électrique, elles migrent à des vitesses spécifiques soit vers le
pôle (+), soit vers le pôle (-) . Des réactifs colorés révèlent leur emplacement.
Très sensible, l'électrophorèse peut séparer ainsi des protéines qui ne diffèrent parfois
que par un acide aminé.
Fig 3.1
Mais elle possède deux limites :
1) À la suite d'une mutation, l'acide normal et l'acide substitué n’ont pas toujours
des propriétés électriques différentes. Selon les biochimistes :
- Glu et Asp ont les mêmes propriétés chimiques.
- Leu, Ileu, Val et Met en ont de presque identiques.
- Leu, Thr, Lys et Arg en ont de différentes.
2) Les mutations synonymes ne sont pas décelées.
Quoi qu'il en soit, cette technique rapide permet d'apprécier le nombre d'allèles
présents dans une population avec une bonne précision si l’échantillonnage est
important ; aussi est-elle largement utilisée par les biologistes pour estimer plusieurs
paramètres :
- le taux d'hétérozygotie, c'est-à-dire le pourcentage des gènes hétérozygotes dans
une population ; ce taux est peu sensible à l'effectif de l'échantillon ;
Fig. 3.2
150

- le taux de polymorphisme, qui est le rapport du nombre de gènes polymorphes au
nombre total des gènes examinés ;
- le nombre moyen d'allèles, qui se calcule par le rapport du nombre total d'allèles
au nombre total de gènes étudiés ; son estimation dépend de l'effectif de
l'échantillon.
3.1.2 - Les origines de la variabilité.
L'évolution sous-entend l'apparition de nouveautés héréditaires. Par conséquent
il ne peut y avoir de changements sans mutations, c'est-à-dire sans modifications
brusques et aléatoires du matériel génétique ; c'est l’une des raisons pour laquelle le
hasard tient une place à part entière dans les phénomènes évolutifs. La variabilité
génétique concerne les mutations responsables de modifications soit géniques, soit
chromosomiques.
Différents types de mutations sont responsables d'une variabilité génétique
suffisante pour engendrer des nouveautés évolutives. Les mutations affectent aussi
bien l'ADN codant que l'ADN non-codant. Les premières peuvent avoir des
répercussions immédiates sur le phénotype, les secondes semblent souvent sans
conséquence, mais elles sont trop peu connues pour généraliser.
Les mutations ponctuelles
Elles concernent aussi bien les gènes de structure gouvernant, par exemple, la
synthèse d'enzymes, de récepteurs membranaires, d'anticorps... que les gènes de
régulation - parmi lesquels les gènes du développement - dont le fonctionnement,
beaucoup plus discret, n'en est pas moins fondamental. Elles n'affectent que des
nucléotides en nombre limité ou de courtes séquences d'ADN.
- Les mutations des gènes de structure ou gènes réalisateurs
Ce sont les mutations géniques les plus classiques. Elles consistent en
l'insertion, la délétion ou la substitution d'un ou de quelques nucléotides.
Deux exemples illustreront ce type de mutations. Le premier concerne la
synthèse d'une enzyme, la tyrosinase, responsable, par exemple chez le Chat, de la
pigmentation du pelage ; le deuxième affecte la synthèse du polypeptide β.
Le gène de la tyrosinase a subi, chez le Chat siamois, une mutation qui la rend
thermosensible. Elle ne fonctionne que pour des températures légèrement inférieures
à celles du corps. C'est pourquoi seules les régions de la tête, de la queue et de
l'extrémité des pattes sont pigmentées ; le corps, plus chaud, inhibe cette enzyme et
reste dépigmenté.
151

Le gène du polypeptide β de l’hémoglobine est sujet à des mutations
responsables de l'anémie falciforme et de maladies regroupées sous le nom de
thalassémies, maladies plus ou moins graves de l'hémoglobine, fréquentes chez les
populations du bassin méditerranéen. La figure 3.3 présente quelques exemples de
ces mutations, ainsi que la carte de l'ARN messager sur laquelle sont portées les
mutations les plus fréquentes.
Fig. 3.3
152

La formation d'allèles très proches les uns des autres augmente la variabilité
génétique. Ces mutations alléliques ne semblent pas à l'origine de grandes
nouveautés évolutives. Par sommation de plusieurs mutations, elles pourront sans
doute engendrer progressivement de nouvelles variétés et quelquefois de nouvelles
espèces. Provoquant l'apparition de nouveaux allèles, ces mutations ponctuelles sont
responsables d'une augmentation du taux d'hétérozygotie, dont l'importance sera
précisée avec l’étude de la diploïdie. Si le nouvel allèle muté s'exprime, un nouveau
phénotype apparaît ; et, s’il est toléré par la sélection, le polymorphisme de l'espèce,
c'est-à-dire le nombre d'individus reconnaissables par un caractère de leur phénotype,
augmente.
- Les mutations des gènes de régulation
Des gènes dirigent la croissance de l'individu grâce à la synthèse de protéines
régulatrices. Même si leur rôle dans les phénomènes évolutifs est encore mal connu,
on commence à comprendre qu'il est prépondérant pour certains d'entre eux.
Tel est le cas des gènes homéotiques, qui contrôlent le développement
embryonnaire des Invertébrés comme celui des Vertébrés. Leur importance est telle
que le prix Nobel de médecine 1995 a été attribué à trois chercheurs américains,
Edward LEWIS, Christiane NUESSLEIN-VOLHARD et Eric WIESCHAUS, pour leurs travaux sur
l'identification des gènes homéotiques qui déterminent l'organisation antéro-
postérieure et dorso-ventrale des Animaux. Le terme « homéotique » est dû à
William BATESON qui, à la fin du XIXe siècle, a qualifié d'homeosis le remplacement d'un
organe par un autre au cours de l'ontogenèse. Quelle que soit l'espèce, ces gènes
homéotiques assurent la synthèse de protéines de régulation qui vont se fixer sur des
gènes cibles ; certaines protéines homéotiques se terminent par une même séquence
de 60 acides aminés : l'homéodomaine, responsable de la fixation de la protéine sur
l'ADN. Le domaine d'une protéine est une région interne de la molécule qui assure une
fonction spécifique, site de fixation d'un substrat, par exemple, ou bien qui constitue
une unité structurelle facilement reconnaissable. On parle dans le premier cas d'un
domaine fonctionnel et dans le deuxième cas d'un domaine structurel.
L'homéodomaine fonctionnel de la protéine homéotique est codé par une homéobox,
portion génique terminale de 180 paires de nucléotides, dont les séquences de
plusieurs espèces sont comparées ci-après dans la section : « Le brassage génique,
la duplication génique ».
Deux observations s'imposent :
- Les homéobox des espèces étudiées (Drosophile, Xénope, Souris, Homme...)
sont très semblables les unes aux autres.
153
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
1
/
30
100%