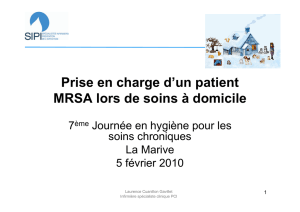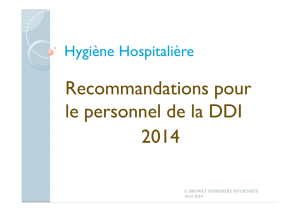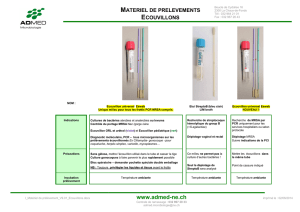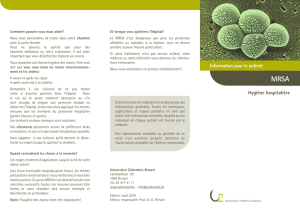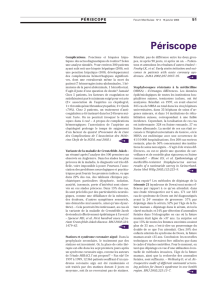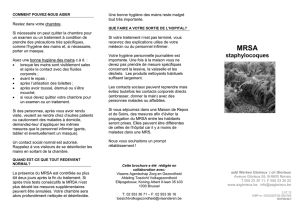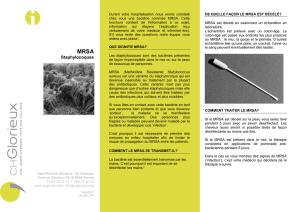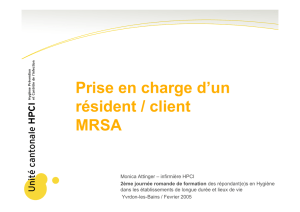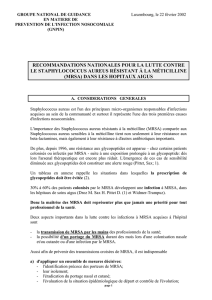Synthèses des principales recommandations

S
YNTHESE DES PRINCIPALES
RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES POUR LA
LUTTE CONTRE LE STAPHYLOCOQUE DORE RESISTANT A LA
METHICILLINE
M. Mickaël BASSON
Direction Générale de la Santé
Sous-direction de la prévention des risques infectieux
(Octobre 2009)

2
Préface
EDITORIAL du Pr. Didier HOUSSIN, directeur général de la santé
Depuis la parution du « Guide sur la maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes »
publié en 1999 par le ministère chargé de la santé, la politique de la France s’est concentrée
sur deux objectifs prioritaires : prévenir la diffusion des bactéries multi-résistantes par
transmission croisée et réduire la pression de sélection exercée par les antibiotiques.
Au cours de cette décennie, des résultats probants ont été obtenus sur la diffusion des
SARM, mesurés par une réduction significative de leur pourcentage dans l’espèce.
Afin de poursuivre ces progrès et de les amplifier, il est apparu utile de passer en revue les
recommandations et programmes similaires dans des pays comparables à la France en
termes de développement sanitaire. Ce travail, retracé dans le présent rapport, révèle la
diversité des approches, mais aussi un certain nombre de constantes sur des aspects encore
peu explorés dans notre pays. Ce constat appelle deux réflexions.
La première est relative à l’approche des problèmes posés par les SARM, plus large dans les
pays considérés qu’en France. Certes, tous ces pays mettent en œuvre des mesures de
prévention de la transmission croisée et, dans une moindre mesure parce qu’ils sont moins
concernés que la France en termes de volume de consommation, une politique de bon
usage des antibiotiques. Néanmoins, au-delà de ces mesures, ils complètent leurs objectifs
par une prévention de la morbidité-mortalité chez les porteurs sains et inscrivent leur
action dans une approche médico-économique mettant en avant l’enjeu de réduction des
souffrances (séquelles, durée de séjour hospitalier, décès) et de leur coût pour la
communauté.
L’institut national de santé publique du Québec estime que 30 à 60% des porteurs de SARM
non traités vont développer une infection au cours d’un séjour hospitalier, avec un
allongement de la durée de séjour estimé à près de deux semaines et un coût de la prise en
charge multiplié par dix. Un tiers de ces auto-infections, donc peu sensibles aux mesures de
prévention de la transmission croisée, seraient potentiellement létales, les taux de mortalité
pouvant ainsi atteindre 10 à 15%.
C’est pourquoi nombre de ces pays envisagent ou recommandent fortement le dépistage
des patients présentant des facteurs de risque de colonisation, suivie d’infection. Ces
facteurs de risque peuvent être liés aux caractéristiques du patient ou à la nature des soins
prodigués, notamment certaines interventions chirurgicales. Comme il s’agit de prévenir les
infections, un dépistage positif est logiquement suivi d’une décolonisation du patient. Cette
démarche, non justifiée au titre de la seule maîtrise de la transmission croisée, peut avoir
son intérêt pour réduire les infections secondaires, les décès, les durées de séjour et les
surcoûts évitables.
En France, cette approche n’est mise en œuvre que localement, certes par un nombre
croissant d’établissements de santé, mais selon des critères qui ne sont pas toujours
harmonisés. Il serait probablement utile de faire le bilan de ces initiatives. La direction

3
générale de la santé va s’y engager.
La seconde réflexion que suscite le passage en revue des politiques menées dans d’autres
pays a trait à la nécessité d’une démarche plus globale de prévention du risque infectieux.
Un staphylocoque doré est un danger potentiel, qu’il soit résistant ou non aux antibiotiques.
Ses conséquences, notamment de type bactériémie, peuvent être tout aussi dramatiques
quand il s’attaque au système cardiaque, à l’appareil ostéoarticulaire ou au système nerveux
central. En outre, les staphylocoques dorés ne sont que le deuxième germe mis en cause
dans les bactériémies. Le sujet est donc plus large que celui des SARM et plus large que celui
des seuls staphylocoques dorés. Les enjeux de prévention sont également majeurs puisque,
pour mémoire, environ la moitié des bactériémies est d’origine nosocomiale.
La progression des bactériémies en France (+ 21% entre les enquêtes nationales de
prévalence de 2001 et 2006), tandis que le taux de SARM dans l’espèce diminue, semble
indiquer que, si le phénomène de résistance est en régression, il n’a pas d’impact direct sur
le phénomène infectieux, lui-même en augmentation.
Un travail doit s’engager sur les contours de cette politique de santé publique, dans ses
différentes dimensions : prévention de la morbidité et de la mortalité, amélioration du
rapport bénéfice-risque, réduction de la transmission croisée et prise en compte des
déterminants, dont le bon usage des antibiotiques.

4
Tables des matières
A - Introduction ......................................................................................................................... 5
Sources d'information............................................................................................................ 6
Notes de traduction ............................................................................................................... 8
B - Mesures par pays ................................................................................................................. 9
1 Québec .............................................................................................................................10
2 - États-Unis ........................................................................................................................ 17
3 - Royaume-Uni................................................................................................................... 22
4 - Irlande .............................................................................................................................29
5 - Nouvelle-Zélande ........................................................................................................... 33
6 - Belgique...........................................................................................................................37
7 - Pays-Bas........................................................................................................................... 41
8 - Danemark ........................................................................................................................49
C - Mesures par type d'établissement et par pays..................................................................57
1 - Centres hospitaliers.........................................................................................................58
2 - Centres de soins de longue durée................................................................................... 82
3 - Établissements médico-sociaux ...................................................................................... 97
4 - Dans la communauté .................................................................................................... 111
D - Appendices.......................................................................................................................119
1 - Contextes nationaux et justifications............................................................................120
2 - Définitions des termes employés et acronymes........................................................... 125
E - Bibliographie.....................................................................................................................126

5
A
-
I
NTRODUCTION
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
1
/
129
100%