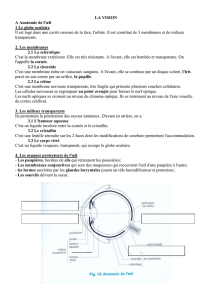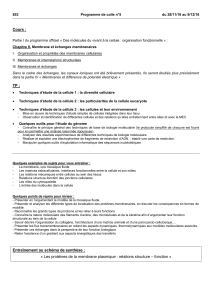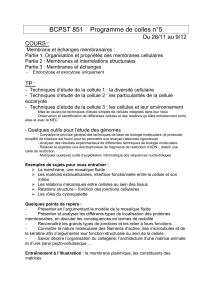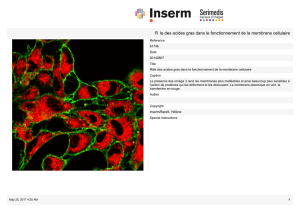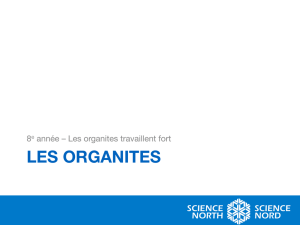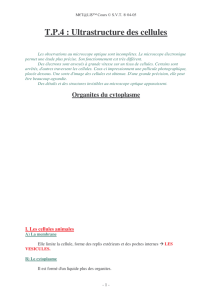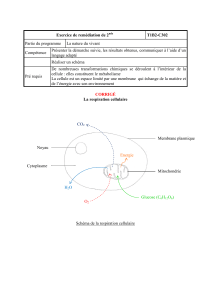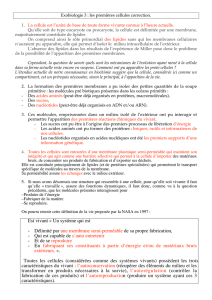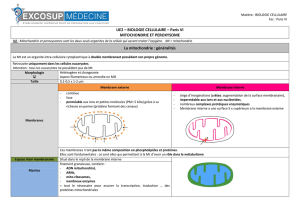Membranes greffées : place dans la prise en charge de l

Le
CNHIM
est
une
association
indépendante
à
but
non
lucratif
(loi
1901)
dont
la
vocation
est
de
réaliser
et
diffuser
une
information
rigoureuse
et
scientifique
sur
le
médicament. Tous
les
articles
publiés
dans
Dossier
du
CNHIM
sont
le
fruit
d'un
travail
collectif,
sur
le
fond
et
sur
la
forme,
entre
les
rédacteurs
signataires,
le
comité
de
rédaction,
et
la
rédaction
du
CNHIM
d'une
part,
le
comité
de
lecture
et
certains
experts,
spécialistes
du
sujet
traité,
d'autre
part.
Sur
chaque
sujet,
Dossier
du
CNHIM
ne
publie
donc
pas
les
opinions
de
tel
ou
tel,
mais
réalise
une
analyse
scientifique
critique,
la
plus
objective
possible.
Malgré
tout
le
soin
apporté
à
l’élaboration
de
Dossier
du
CNHIM,
une
erreur
peut
se
glisser
dans
les
informations
diffusées.
Les
lecteurs
doivent
donc
conserver
la
plus
grande
vigilance
dans
l’exploitation
des
données
à
leur
disposition.
Directeur
de
la
Publication
: Xavier Dode
Rédaction
Rédactrice
en
chef
: Marie
Caroline
Husson
Comité
de
rédaction
: Dominique
Dardelle
(Suresnes),
Albert
Darque
(Marseille),
Bérangère
Gruwez
(Berck),
Isabelle
Fusier
(Paris),
Isabelle
Jolivet
(Paris),
Véronique
Lecante
(Paris),
Nathalie
Le
Guyader
(Paris),
Emmanuelle Radideau (Créteil), Déborah Schlecht-
Bauer (Tours),
Corinne
Tollier
(Paris).
Comité
de
lecture
: A.
Baumelou
(Paris),
P.
Beaufils
(Paris),
P.
Faure
(Paris),
J.E.
Fontan
(Paris)
C.
Guérin
(Paris),
S.
Limat
(Besançon),
C.
Montagnier-Pétrissans
(Paris),
M.
Ollagnier
(St
Etienne),
G.
Vedel
(Paris),
J.M.
Vetel
(Le
Mans),
T.
Vial
(Lyon).
Experts pour ce numéro : P. Bories (Toulouse), B.
Canaud (Montpellier), J. Chanard (Reims), A. Kolko
(Foch).
Rythme
de
parution
: 6
numéros
par
an
N°
ISSN
0223.5242.
N°
de
commission
paritaire
: G
82049
IMPRESSION
: CPI – Imprimerie France Quercy
ZA des Grands Camps, 46090 Mercuès.
CENTRE
NATIONAL
HOSPITALIER
D’INFORMATION
SUR
LE
MEDICAMENT
www.cnhim.org
Hôpital
de
Bicêtre
–
78,
rue
du
Général
Leclerc
B.P.
11 - 94272
Le
Kremlin
Bicêtre
cedex
Tél.
: 01
46
58
07
16
–
Fax
: 01
46
72
94
56
Courriel
: secretariatcnhim@wanadoo.fr
Président
: Xavier Dode
Président
fondateur
: André
Mangeot
Secrétariat
abonnement
: Zohra
El
Hadaoui
Conseil
d’Administration
: F. Ballereau (Nantes), G.
Benoit (Paris), H. Bontemps (Villefranche/Saône), O.
Bourdon (Paris), E. Boury (Lomme), J. Calop
(Grenoble), B. Certain (Paris), M. Courbard-Nicolle
(Paris), D. Dardelle (Suresnes), X. Dode (Lyon), E.
Dufay (Lunéville), J.E. Fontan (Bondy), D. Goeury
(Paris), C. Guérin (Paris), M.C. Husson (Paris), J.F.
Latour (Lyon), N. Le Guyader (Paris), A. Lepelletier
(Nantes), P. Passe (Paris), P. Paubel (Paris), F. Pinguet
(Montpellier), C. Rieu (Longjumeau), D. Roncalez
(Colmar), J.M. Trivier (Lille).
Echos
du
CNHIM Marie-Caroline Husson 3
Membranes greffées : place dans la prise
en charge de l’insuffisance rénale chronique
terminale
S. Bauer, V. Lecante et la participation du comité de rédaction
Editorial Bernard Canaud 5
En bref Marie-Caroline Husson 6
1. Introduction 7
2. L’insuffisance rénale chronique terminale 8
2.1. Définition 8
2.2. Physiopathologie 9
2.3. Traitements substitutifs de l’insuffisance rénale 12
chronique terminale
3. Les membranes de dialyse 12
3.1. Principes physiques 12
3.2. Caractéristiques d’une membrane de dialyse 16
3.3 Evaluation clinique des hémodialyseurs 19
4. Les membranes greffées 19
4.1 La membrane greffée à l’héparine, H
EPR
AN
®
19
4.2. La membrane greffée à a vitamine E, VI
TABRAN
E
®
27
5. Conclusion 33
Références bibliographiques 33
Interactions médicamenteuses :
actualités du thesaurus de l’Afssaps
(version du 17 décembre 2010)
Isabelle Fusier et Marie-Caroline Husson 37
Résumés
des
derniers
numéros
parus 67
Au
sommaire
de
Dossier
du
CNHIM 68
Bulletin d’abonnement 2011 69
Dossier
du
CNHIM
participe
à
l’ISDB,
réseau
international
de
revues
indépendantes
de
formation
thérapeutique.
Le
CNHIM
a
la
propriété
des
textes
publiés
dans
ce
numéro
et
se
réserve
tous
les
droits
de
reproduction
(même
partielle),
d’adaptation,
de
traduction,
pour
tous
les
pays
et
par
quelque
procédé
que
ce
soit
(loi
du
11
mars
1957,
art.
40
et
41
du
Code
Pénal
art.
425).
Les
articles
de
Dossier
du
CNHIM
sont
indexés
dans
bibliopch.
D
D
D
o
o
o
s
s
s
s
s
s
i
i
i
e
e
e
r
r
r
d
d
d
u
u
u
C
C
C
N
N
N
H
H
H
I
I
I
M
M
M
2011
Tome
XXXII,
2
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
F
i
c
h
e
s

-
2
-
Dossier
du
CNHIM,
2011,
XXXII,
2

-
3
-
Dossier
du
CNHIM,
2011,
XXXII, 2
Echos du CNHIM
Enfin... le deuxième plan maladies rares
2011- 2014 est lancé !
Le 28 Février dernier, à l'occasion de la journée
internationale des maladies rares, qui
concernent plus de 3 millions de Français, les
grandes lignes du deuxième ‘plan national
maladies rares’ ont été annoncées. Ce deuxième
plan sera doté d'un peu plus de 180 Millions
d'Euros pour la période 2011-2014, soit 86,4
Millions de plus que le précédent, afin de
financer des mesures nouvelles, les autres
actions étant reconduites.
Le contexte de ce deuxième plan
Grâce au premier plan, le budget consacré au
financement des projets de recherche sur les
maladies rares a été multiplié par 4 entre 2002
et 2008.
Plus de 250 projets de recherche, en génétique
moléculaire, physiopathologie, thérapeutique
préclinique, et recherche clinique ont été
financés par l’Agence nationale de la Recherche
(ANR), le programme hospitalier de recherche
clinique (PHRC) et le Téléthon.
L’accès au diagnostic et à la prise en charge ont
également été améliorés, avec la mise en place
de 131 centres de références labellisés
regroupant des équipes hospitalo-universitaires
très spécialisées, et 501 centres de compétences
actifs en matière de prise en charge.
L’information des professionnels de santé, des
malades et du grand public a également été
améliorée, avec le développement de la base de
données Orphanet http://www.orpha.net.
Le deuxième plan se décline en trois axes, 15
mesures et 47 actions.
- Le premier axe vise à améliorer la qualité
de la prise en charge du malade.
Pour cela le dispositif des centres de référence et
des centres de compétences, et leur évaluation,
sera revu ; son financement sera plus ciblé sur
les actions menées. La production des protocoles
nationaux de diagnostic et de soin sera
accélérée. Des plateformes de diagnostic
biologique approfondi seront identifiées au
niveau national. La télémédecine sera
développée pour permettre à chacun, quelle que
soit sa localisation sur le territoire, d'accéder à la
meilleure expertise.
La prise en charge médicamenteuse sera
garantie pour les médicaments orphelins et pour
les indications hors AMM, fréquentes dans les
maladies rares.
L’occasion est ainsi donnée de valoriser le
champ d’activité de l’Etablissement
Pharmaceutique des Hôpitaux de Paris (EP-HP)
qui se situe exactement dans cet axe.
L’EP-HP
est l’un des deux pôles de l’Agence Générale des
Equipements et Produits de Santé (AGEPS),
APHP.
Pour répondre à un besoin thérapeutique qui ne
peut être comblé par les médicaments de
l’industrie pharmaceutique - traitement de
certaines maladies rares, ou formes galéniques
spécifiquement adaptées au nouveau-né ou à
l’enfant, et dans certains cas aussi à la personne
âgée (dosage unitaire, forme pharmaceutique) -
cet Etablissement dispose de la capacité
réglementaire pour développer, produire,
contrôler et commercialiser ces médicaments
qualifiés d’«indispensables».
E c h o s
d u
C N H I M
Dr Marie-Caroline Husson
Pharmacienne - praticien hospitalier
Rédactrice en chef

-
4
-
Dossier
du
CNHIM,
2011,
XXXII,
2
Echos du CNHIM
Les modèles de développement sont divers et
dépendent essentiellement du médicament, de
l’indication et de la population de malades.
L’établissement gère actuellement environ
soixante dix préparations hospitalières et une
dizaine de spécialités, vendues dans toute la
France voire en Europe grâce à des partenariats
conclus avec des industriels.
Enfin Orphanet sera positionné comme un outil
de référence pour l'information et la recherche.
La mesure phare nouvelle est la création d'une
banque de données nationale ‘maladies rares’,
dotée d'une vingtaine d'assistants de recherche
clinique, qui aura pour vocation de regrouper
toutes les données cliniques médico-
économiques disponibles et, en suivant les
malades dans le temps, de mieux connaître les
spécificités des maladies rares.
- Le deuxième axe concerne la Recherche.
Le rôle clé de l'AFM a été salué, et les donateurs
du Téléthon qui ont permis de co-financer de
nombreux projets de recherche ainsi que des
infrastructures stratégiques, ont été remerciés.
L'intention maintenant est de renforcer le
partenariat entre les acteurs publiques,
industriels et associatifs et mieux coordonner les
financements pour un vrai continuum du
laboratoire au chevet du malade. Telle est la
mission qui va être confiée à la Fondation de
Coopération Scientifique (FCS) ce qui lui
permettra aussi de définir des axes stratégiques
communs concernant notamment les
biothérapies, les thérapies innovantes et les
approches pharmacologiques.
Par ailleurs des moyens exceptionnels seront
attribués à des projets plus spécifiques maladies
rares, tel le projet de cohorte RADICO.
- Le troisième axe vise à amplifier les
coopérations européennes et internatio-
nales, pour promouvoir le partage de l'expertise
au niveau international, améliorer la capacité à
conduire des essais cliniques multinationaux et
améliorer l'accès au diagnostic, aux soins et à la
prise en charge des 7000 maladies rares
recensées.
Pour garantir la bonne exécution du plan, un
comité de suivi et de prospective va être mis en
place, présidé par Mme Annie Podeur, directrice
de la DGOS. Ce comité aura aussi pour mission
de prioriser les actions, de suivre leur
implémentation et d'en proposer de nouvelles si
nécessaire, la volonté exprimée étant que ce
plan devait vivre et ne pas être figé. La
secrétaire d’Etat a assuré qu’il sera décliné dans
les plans stratégiques des ARS et qu’un
interlocuteur dédié sera nommé dans chaque
ARS. L’ambition affichée de ce plan est de faire
en sorte que les maladies rares soient prises en
compte comme les autres maladies chroniques.

-
5
-
Dossier
du
CNHIM,
2011,
XXXII, 2
Membranes greffées dans la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale
Membranes greffées : une évolution technologique majeure
dont l’impact clinique reste à évaluer
Au cours de ces dix dernières années, la
technologie de fabrication des dialyseurs et des
membranes de dialyse a considérablement évolué,
leur conférant des performances nettement
accrues et permettant d’apporter une réponse plus
adaptée et mieux ciblée aux besoins métaboliques
des malades urémiques.
Les membranes de dialyse sont devenues
progressivement plus perméables à l’eau et aux
solutés, facilitant ainsi l’élimination de toxines
urémiques de bas et de haut poids moléculaire
(membrane de haute perméabilité).
Le recours aux polymères synthétiques
(polysulphone, polyacrylonitrile,
polyéthersulphone, polyamide…) a amélioré
notablement la biocompatibilité des membranes.
L’extrusion raffinée des fibres capillaires a permis
de réduire considérablement le volume des
dialyseurs.
Les membranes bioactives
Les modifications géométriques internes des
dialyseurs ont également permis d’accroître les
performances et les échanges de solutés par
diffusion et convection. Dans ce contexte, il ne
restait plus qu’à apporter de nouvelles
fonctionnalités aux membranes de dialyse, non
couvertes par les propriétés d’échange classiques
diffusives et convectives, ce qui a été fait avec les
membranes bioactives.
Sous ce terme sont en fait regroupées les
membranes de dialyse qui offrent, en plus de leur
perméabilité habituelle, une propriété
supplémentaire :
- soit une capacité d’adsorption accrue du fait de
charges électriques ou d’affinités particulières pour
certaines molécules : tel est le cas du
Polyméthylmétacrylate ou du Polyacrilonitrile 69 ;
- soit une capacité d’échange spécifique ou de
prévention ciblée, tels sont les cas des membranes
greffées avec de l’héparine (H
EPR
AN
®
) réduisant le
risque thrombotique, ou avec de la vitamine E
(VI
TABRAN
E
®
) réduisant le stress oxydatif des
malades hémodialysés.
Cet article de Dossier du CNHIM fait de façon très
intéressante le point sur ces nouvelles membranes
greffées avec des composants biologiquement
actifs, en analysant leurs caractéristiques
fonctionnelles et les études qui supportent leur
utilisation clinique.
Impact chez les malades dialysés
De façon évidente, les études cliniques sont
encore largement insuffisantes pour indiquer ces
membranes en première intention dans le
traitement de l’insuffisance rénale chronique. Les
travaux rapportés sont pour la plupart de courte
durée, sur des effectifs limités, avec des objectifs
intermédiaires ciblés et n’abordent en aucun cas
les effets au long cours sur la morbi-mortalité des
malades dialysés.
Des études complémentaires ayant pour objectif
principal d’analyser l’impact sur la morbi-mortalité
des malades dialysés sont donc nécessaires.
Néanmoins, les propriétés rapportées dans les
différentes études tendant à prouver la réduction
du risque thrombotique et des besoins
hépariniques avec l’H
EPR
AN
®
ou la baisse des
marqueurs du stress oxydatif et de l’inflammation
avec VIE
®
et sont de nature à faire recommander
ce type de membranes dans des populations
sélectionnées et à risques particuliers, ou en
seconde intention.
Ces membranes greffées s’inscrivent bien dans
l’évolution de la compréhension de la physio-
pathologie complexe de l’insuffisance rénale
chronique et augure de nouveaux développements
dans la technologie des membranes et des
dialyseurs.
Pr Bernard Canaud
Néphrologie, Dialyse et Soins Intensifs – Hôpital Lapeyronie – CHRU Montpellier
Membranes greffées :
place dans la prise en charge de
l’insuffisance rénale chronique terminale
Editorial
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
1
/
72
100%