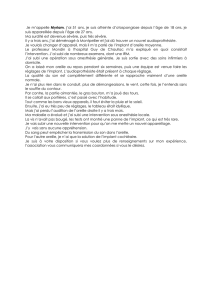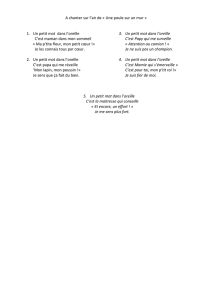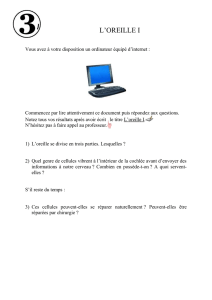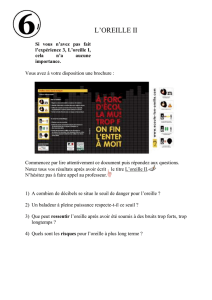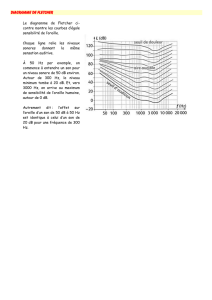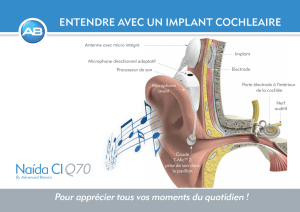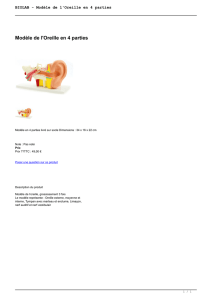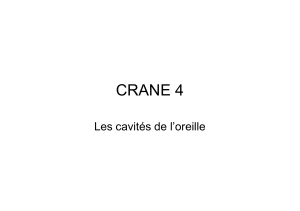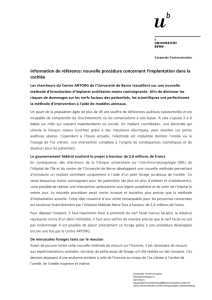E Les sites d’histoire de la médecine I

E
ncore un sujet sur lequel il serait vain de prétendre
atteindre l’exhaustivité dans le cadre d’une seule chro-
nique. Voici donc un choix subjectif où notre spécialité
occupe une place respectable.
Les sites d’histoire de la médecine sont nombreux et
diversifiés. Ils sont répartis par région et/ou par spécialité. Cer-
tains sont des sites généralistes, comme le site spécialisé dans
les anecdotes et les anciens matériels chirurgicaux, dont on
peut trouver les références sur www.medpict.com/index.asp.
Medpict se définit comme la cité virtuelle de la santé. Un site
d’histoire généraliste de la médecine dû aux efforts de M. Valen-
tin Daucourt se trouve sur la page members.aol.com/ldaucourt/
Histmed.htm. Il s’agit d’un panorama de la médecine de l’Anti-
quité à nos jours, avec une description particulièrement réussie
de la médecine antique.
L’histoire de la radiologie est décrite sur le site des Pr Fran-
çois et Georges Terrier, du département d’imagerie médicale des
hôpitaux universitaires de Genève. Sur la page www.montchoisi.
Les sites d’histoire de la médecine
ch/radiologie/histoirerad.html, on trouve décrites les grandes
étapes de l’imagerie médicale avec des chapitres dont les titres
ne manquent pas d’humour : Un crâne rempli d’air, Le chercheur
cobaye ou Un Américain à Berlin, L’œuf de Colomb.
La bibliothèque interuniversitaire médicale de Paris
(BIUM) s’enorgueillit d’une collection d’ouvrages historiques
de grande qualité. On trouve une présentation du catalogue et du
fonctionnement de la BIUM sur le site www.bium.univ-paris5.fr/.
Depuis le 5 mars 2002, l’ensemble des services d’histoire de la
médecine de la BIUM ont été regroupés sur la nouvelle page
www.bium.univ-paris5.fr/histmed/debut.htm.
Le nouveau site utilise abondamment les fonctionnalités des
feuilles de style et du DHTML, sa compatibilité n’est donc garan-
tie qu’avec les versions récentes des navigateurs. Le fonction-
nement optimal n’est atteint qu’avec Microsoft Internet Explo-
rer versions 5.5 et supérieures. Le site peut également être
consulté avec certaines versions antérieures d’Internet Explorer
(4 ou 5) ou de Netscape Navigator (4.7 et 6.2, mais pas 6.0 ou
6.1) mais certains aspects de la présentation sont perdus, voire
incorrectement affichés (problème de taille des caractères, en
particulier). Ce site possède une magnifique “boussole”. La
“boussole” est un menu hiérarchique dynamique de l’ensemble
du site permettant d’accéder directement à n’importe laquelle
de ses pages. Cette boussole est accessible sur toutes les pages
du site et se trouve automatiquement positionnée en haut à
20
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no277 - novembre 2002
La Lettre d’ORL
INTERNET
R. Marianowski*
La Lettre d’ORL : http://www.vivactis-media.com
* Service ORL, hôpital Morvan, 5, avenue Foch, 29609 Brest Cedex.
Les sites d’histoire de la médecine

gauche de l’écran, même lorsque les barres de défilement sont
actionnées.
Ont été regroupés : le catalogue ancien (ouvrages antérieurs à
1952, accès par auteur et date, visualisation des fiches anciennes
numérisées), le catalogue des manuscrits, la partie ancienne du
catalogue des périodiques (titres créés avant 1920) en une base
de données unique interrogeable de façon transparente pour
l’utilisateur.
En outre, à partir des réponses, vous pourrez accéder (le cas
échéant) à :
– la fiche bio-bibliographique de l’auteur ;
–la reproduction des portraits de l’auteur, issus de la banque
d’images et de la collection iconographique de portraits ;
–la reproduction des planches numérisées de l’ouvrage choisi
(issues de la banque d’images) ;
– l’ouvrage intégralement numérisé.
Les liens concernant les deux premières possibilités ne sont pas
encore tous établis, mais vous pouvez en avoir un avant-goût en
consultant les fiches “Bichat”, “Porta” ou “Brunschwig”...
De même, à partir d’une recherche dans la base des biographies,
vous pourrez avoir accès directement aux ouvrages et aux portraits.
Si vous recherchez des éditions d’ouvrages anciens, vous pou-
vez vous connecter sur www.bium.univ-paris5.fr/livres/editions_
3.htm.
•On peut ainsi consulter le Traité des maladies de l’oreille (1848).
Après la préface et l’introduction, on trouve les chapitres consa-
crés aux maladies de l’oreille externe, de l’oreille interne et de
l’oreille moyenne, au degré de curabilité des maladies de l’oreille,
et des considérations sur la physiologie de l’oreille humaine, celle
des sourds-muets, etc.
•On trouve également le Traité pratique des maladies du larynx,
précédé d’un traité complet de laryngoscopie (1876). La laryn-
goscopie comporte : un historique, une description des appareils
nécessaires à sa pratique, la méthode laryngoscopique, celle de
l’image laryngoscopique, l’autolaryngoscopie, les méthodes
d’enseignement, l’arsenal chirurgical de la laryngoscopie ; laryn-
goscopie, pathologie...
•Vous pourrez tout savoir Du laryngoscope et de son emploi en
physiologie et en médecine (1860). L’ouvrage consultable com-
prend un historique, une description de la méthode exploratrice
Liston et Garcia, des instruments laryngoscopiques et de leur
emploi : du miroir laryngien, de l’éclairage, de l’autolaryngo-
scopie, de l’examen fait sur autrui, de la rhinoscopie...
•Vous pourrez lire un Essai sur le cancer (1842). L’expérience
clinique, l’administration, les effets secondaires, les précautions
pour le personnel de santé et les visiteurs, les recommandations
et les références bibliographiques sont traités.
Le site de la BIUM propose actuellement une exposition virtuelle
consacrée aux frontispices des livres médicaux sur la page
www.bium.univ-paris5.fr/expo/intro.htm.
Le mot “frontispice” s’appliqua d’abord à l’architecture, et sa
définition n’est pas facile à établir : façade principale d’un édi-
fice, en particulier religieux, ou certaines des parties de cette
façade. Aujourd’hui, “frontispice” ne s’emploie plus guère que
dans le domaine du livre ancien, où il recouvre plusieurs réalités
différentes :
–titre d’un livre imprimé, placé en première page, et entouré
d’ornements ;
–certains de ces ornements, une vignette gravée, par exemple ;
–image occupant une pleine page placée en avant ou en regard
du titre du livre, et dont le sujet résume et illustre la matière
de l’ouvrage.
L’évolution de sa forme et de sa fonction intéresse l’histoire du
livre. L’histoire de l’art se reflète dans le passage des descrip-
tions vivantes et empreintes de fantaisie du XVIesiècle aux images
solennelles caractéristiques du XVIIesiècle, puis aux brillantes
représentations pourvues de thèmes plus légers du XVIIIesiècle.
Et, bien sûr, c’est toute l’histoire de la médecine qui s’inscrit
dans ces frontispices, tant ils furent de plus en plus souvent
conçus pour symboliser à eux seuls l’essence même de l’œuvre.
Cent frontispices, choisis parmi les très riches collections
anciennes de la BIUM, couvrant tous les siècles et tous les pays,
nous donnent l’occasion d’une promenade en images pleine
d’enseignements.
Sur le site de la bibliothèque de France on trouve un cer-
tain nombre d’ouvrages relatifs aux spécialités disparues, telle la
phrénologie, sur la page gallica.bnf.fr/scripts/ConsultationTout.
exe?O=N028499&E=0.
Ainsi, sur la page html/nl/07/007983.html, vous pourrez lire
La physiognomonie et la phrénologie ou connaissance de
l’homme d’après les traits du visage et les reliefs du crâne (1842).
Avec : Pensées préliminaires au sujet de la physionomie, Existe-
t-il un art de la physionomie ? De la physionomie des différentes
races de l’espèce humaine, De la physionomie des différentes
nations, différence de la physionomie dans les deux sexes.
21
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no277 - novembre 2002
INTERNET
La Lettre d’ORL : http://www.vivactis-media.com

INTERNET
Dès 1838, on proposait un cathétérisme tubaire : sur la page
html/nl/07/007821.html, on trouve le Traité du cathétérisme de
la trompe d’Eustachi et de l’emploi de l’air atmosphérique dans
les maladies de l’oreille moyenne (1838), composé des chapitres
suivants : De la présence de l’air dans l’oreille moyenne, Influence
des qualités physiques de l’air sur l’organe de l’ouïe, Des mala-
dies qui nuisent à la circulation de l’air dans l’oreille moyenne,
et de leurs effets sur le sens de l’ouïe.
On peut trouver l’histoire de l’anesthésie-réanimation sur
le site www.histanestrea-france.org/ qui comporte en exergue
cette citation de Claude Bernard : Dans l’histoire de la science,
il ne suffit pas de raconter ce que chacun a pu dire, entaché des
erreurs de chaque temps. Il faut caractériser l’idée de chacun,
la critiquer ensuite, et même rejeter les choses si elles sont mau-
vaises, car la science historique consiste non pas à accumuler
mais à choisir les matériaux utiles et les faire fructifier. Il existe
même un club d’anesthésistes-réanimateurs historiens de leur
spécialité sur la page club/index.html.
Enfin, si toutes ces visites vous ont donné envie de débu-
ter une collection de livres médicaux anciens, le site de la librai-
rie 42eligne est pour vous : 42ligne.free.fr/produits/index.html.
Cette librairie vous propose une sélection de livres et documents
anciens et modernes en toutes langues, aussi bien à l’unité qu’en
ensembles thématiques.
Elle a été créée en 1990 dans le 6earrondisement, à proximité de
Saint-Germain-des-Prés et à 150 mètres du Jardin du Luxem-
bourg. On peut leur communiquer des listes de recherche même
très spécialisées. L’iconographie du site est très agréable et heu-
reusement car, si l’on ne dispose pas d’importants moyens finan-
ciers, seul le plaisir des yeux est abordable !
Pour les amoureux de l’histoire récente, voici un site sur
les implants cochléaires créé et développé par le Pr Chouard, un
des pionniers de cette technique. Sur la page perso.club-internet.
fr/recorlsa/implantcochleaire/historique.html, on retrouvera l’his-
toire de l’implant cochléaire. On peut y lire que “l’implant
cochléaire a été inventé en 1957 à Paris par Charles Eyriès, oto-
logiste et anatomiste parisien, et André Djourno, professeur de
physique médicale à la faculté de médecine de Paris. C. Eyriès
eut l’idée de stimuler électriquement l’oreille interne d’un patient
atteint de cophose par cholestéatome, grâce à une bobine d’induc-
tion que A. Djourno lui fabriqua pour la circonstance. Les résul-
tats immédiats furent satisfaisants, mais, après quelques semaines,
l’appareil tomba en panne, car son étanchéité était défectueuse.
À l’époque, A. Djourno s’intéressait peu à la stimulation senso-
rielle, et les essais ne furent pas repris.
Ce n’est qu’en 1961 que William House, otologiste américain
déjà très célèbre pour les innovations qu’il avait apportées à la
chirurgie des vertiges, reprenant les travaux de C. Eyriès, mit au
point avec l’ingénieur Urban un appareillage implantable et
fiable, qui fut progressivement proposé à des patients de plus en
plus nombreux. Il s’agissait là d’un système à une seule élec-
trode, ne permettant de reconnaître que les rythmes de la parole”.
On peut même trouver la publication princeps de C. Eryiès et
A. Djourno sur la page perso.club-internet.fr/recorlsa/implant
cochleaire/publicationprinceps.html.
Enfin, l’histoire de l’implant français Digisonic se trouve sur
perso.club-internet.fr/recorlsa/implantcochleaire/historicfrancais.
html. On peut également lire, sur ce même site, des conseils aux
malentendants et aux parents d’enfants sourds. Ce site n’est pas
professionnel mais on y retrouve toute l’ardeur de l’équipe his-
torique de Saint-Antoine quant il s’agissait de défendre une
grande cause.
À bientôt, et bon surf !
22
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no277 - novembre 2002
La Lettre d’ORL : http://www.vivactis-media.com
1
/
3
100%