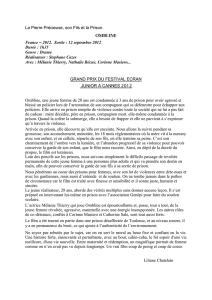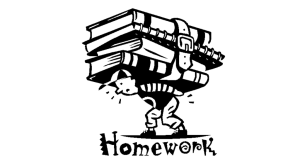Lire l'article complet

L e c t u r e
28
Le c t u r e
La Lettre du Psychiatre - Vol. III - n° 1-2 - janvier-février 2007
Hôpital psychiatrique
Prison
Total
700
600
500
400
300
200
100
1928
1934
1940
1946
1952
1958
1964
1970
1976
1982
1988
1994
2000
Figure.
Enfermement (hôpital psychia-
trique ou prison) entre 1928 et 2000 aux
États-Unis (pour 100 000 adultes).
Les malades mentaux, derrière les barreaux
The mentally ill, behind bars
IP B.E. Harcourt*
Article paru le 15 janvier 2007 dans le New York Times (traduction : Renaud de Beaurepaire)
Commentaire : C. de Beaurepaire (SMPR de Fresnes)
E
n août dernier, dans la prison de
Jackson (Michigan), un détenu
présentant un état psychotique
floride est mort dans sa cellule d’isolement
(autrement dit, au “mitard”, NDLR), nu,
enchaîné à une plaque de béton et baignant
dans son urine, alors qu’il était en attente
d’un transfert pour un établissement
psychiatrique, transfert qui n’a jamais eu
lieu. En novembre dernier, le directeur
du département des services sociaux de
l’État de Floride a démissionné brutale-
ment, après avoir été condamné à payer
80 000 dollars pour n’avoir pas transféré
de la maison d’arrêt à l’hôpital des détenus
souffrant de maladies mentales graves.
Il y a quelques jours, la Cour suprême s’est
engagée à considérer le cas des malades
mentaux dans les couloirs de la mort,
si gravement atteints mentalement que
leur exécution pourrait être constitu-
tionnellement impossible. Parmi eux, un
criminel, vétéran de la Navy, âgé de 48 ans,
diagnostiqué schizophrène. Dans les 10 ans
précédant son crime, il avait été hospitalisé
14 fois pour maladie mentale grave.
Selon une étude du ministère américain de
la Justice, parue en septembre 2006, 56 %
des détenus des prisons d’État et 64 % des
détenus locaux de l’ensemble du pays ont
présenté des troubles mentaux au cours
de l’année précédant l’enquête.
Bien que très inquiétant, rien de tout cela
n’est véritablement surprenant. Au cours
des 40 dernières années, les États-Unis ont
procédé au démantèlement de l’énorme
complexe des structures de prise en
charge des malades mentaux, et recons-
truit, lit par lit, une gigantesque prison.
On peut dire qu’au cours du XX
e
siècle, les
Américains ont eu une véritable relation
schizophrénique avec la déviance.
Après plus de 50 ans de stabilité, les popu-
lations des prisons fédérales et d’État aux
États-Unis ont connu une augmentation
importante, passant de moins de 200 000
personnes en 1970 à plus de 1,3 million en
2002. En 2002, la fréquence des emprison-
nements a dépassé le chiffre de 600 pour
100 000 adultes. Avec l’entrée, au cours de
ces dernières années, de 700 000 détenus
supplémentaires, dans les maisons d’arrêt
les États-Unis ont actuellement plus de
2 millions de personnes incarcérées, déte-
nant ainsi le record mondial du nombre de
prisonniers et de la fréquence des incar-
cérations : 5 fois plus qu’en Angleterre,
12 fois plus qu’au Japon.
Ce que peu de gens réalisent, c’est que, au
cours des années 1940 et 1950, aux États-
Unis, les malades mentaux ont été institu-
tionnalisés avec une fréquence plus grande
encore, mais il s’agissait d’hôpitaux psychia-
triques ou d’asiles. Si bien que, quand on
fait la somme des hospitalisations en
psychiatrie et des emprisonnements entre
1928 et 2000, les chiffres obtenus ne sont
pas très différents de ceux de la “révolution
pénitentiaire” de la fin du XXe siècle.
Le graphique joint à cet article – fondé
sur les statistiques du Federal Census
Bureau, Department of Health and Human
Services et du Bureau of Justice Statistics
– montre la fréquence cumulée des insti-
tutionnalisations pour 100 000 adultes
aux États-Unis entre 1928 et 2000, ainsi
que, durant cette période, la diminution
des hospitalisations dans les services
de psychiatrie et l’augmentation des
détentions en prison (figure).
Ne figurent que les chiffres des hôpitaux
publics. Or, il y avait, aux États-Unis, au
milieu du XX
e
siècle, un grand nombre
d’autres institutions de neuropsychiatrie,
certaines pour “déficients mentaux et
épileptiques”, d’autres pour les retardés
mentaux, ainsi que des pavillons de
psychiatrie dans les hôpitaux de l’armée,
et même des hôpitaux psychiatriques
privés pour “psychopathes”. Si l’on
inclut les résidents de ces structures de
soins, on obtient des fréquences d’hos-
pitalisation de 700 pour 100 000 adultes
aux États-Unis entre 1935 et 1963, avec
des pics à 778 en 1939 et 786 en 1955.
On comprend maintenant très bien
pourquoi il y a actuellement tant de
malades mentaux en prison : ceux que
l’on poursuivait autrefois pour qu’ils aient
des soins psychiatriques se retrouvent
aujourd’hui avec un aller simple pour
la prison.
* Professeur de droit et de criminologie à l’université de
Chicago. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus
récent : Against Prediction: Proling, Policing and
Punishing in an Actuarial Age. Chicago : University of
Chicago Press, 2007,264p.
PSY fevrier 07.indd 28 20/02/07 14:11:03

L e c t u r e
29
Le c t u r e
La Lettre du Psychiatre - Vol. III - n° 1-2 - janvier-février 2007
Bien sûr, les populations ont beaucoup
changé. En 1937, les femmes représen-
taient 48 % des personnes hospitalisées
en psychiatrie. Or, 95 % des incarcéra-
tions actuelles concernent des hommes.
Et les patients des services de psychiatrie
entre 1930 et 1960 étaient en moyenne
plus âgés, et plus souvent des Blancs, que
les prisonniers des années 1990.
Le graphique n’en soulève pas moins quel-
ques questions inquiétantes : pourquoi
les diagnostics de déviance sont-ils si
radicalement différents aujourd’hui et au
milieu du
XXe
siècle ? Est-il vraiment utile
d’incarcérer tant de personnes ? N’avions-
nous pas plutôt raison, il y a 50 ans, de
les hospitaliser ? Pourquoi y avait-il tant
de femmes hospitalisées ? Pourquoi ces
femmes ont-elles été remplacées par de
jeunes hommes Noirs ? L’admission d’un
si grand nombre de personnes dans les
hôpitaux et les prisons ne serait-elle pas
en partie inutile ?
Quelles que soient les réponses à ces
questions, le balancement du pendule
est allé trop loin, peut-être au-delà de
ses gonds.
Il serait naïf aujourd’hui de poser ces ques-
tions sans soulever celle des conséquences
de l’emprisonnement sur le crime. Une
étude très sérieuse a montré que l’aug-
mentation de la population en détention
au cours des années 1990 a fait chuter la
criminalité d’un tiers.
Mais les prisons ne sont pas les seuls
lieux à produire cet effet. Dans une
étude récente, j’ai démontré que les
institutionnalisations elles-mêmes
– y compris dans les hôpitaux psychiatri-
ques – constitueraient l’élément le plus
prédictif de la criminalité entre 1926 et
2000 et pas seulement les détentions en
prison
1
. Cette étude a montré une très
forte relation négative entre homicides et
institutionnalisation (aussi bien dans les
asiles qu’en prison). Les données préli-
minaires d’une autre étude confirment
ces résultats.
Les effets sur la criminalité sont indépen-
dants du mode d’institutionnalisation,
prison ou hôpital psychiatrique. Donc,
même dans une perspective de lutte
contre la criminalité, il est nécessaire de
repenser nos politiques de santé mentale
et de détention. Beaucoup de travail reste à
faire avant de proposer des réponses à ces
questions inquiétantes. Mais la première
étape est de bien réaliser que nous nous
sommes gravement trompés dans notre
approche politique de la déviance, de la
santé mentale et de la prison. ■
COmmENTAIRE DE L’ARTICLE
Ce que Bernard Harcourt dénonce aux
États-Unis est en train de devenir une
réalité en France : le nombre de malades
mentaux incarcérés dans les prisons fran-
çaises monte en flèche depuis une dizaine
d’années, comme l’indique, par exemple,
la progression du nombre des hospitali-
sations d’office des détenus : 100 en 1990,
1 800 en 2005 (données de la Direction
générale de la santé et de la direction de
l’administration pénitentiaire). L’incar-
cération des malades mentaux résulte
du “traitement” judiciaire des infrac-
tions commises, délictueuses et crimi-
nelles, et en est la conclusion “logique”.
En effet, la loi commune prévoyant que
toute infraction donne lieu à une procé-
dure judiciaire, les malades mentaux, qui
sont des citoyens, “ont légitimement droit”
à un procès dès lors qu’ils ont commis
une infraction, délictueuse ou criminelle,
a fortiori depuis que nombre d’esprits
bien-pensants ont fait et font savoir que
l’application de la loi aux malades mentaux
était non seulement salutaire, en leur
épargnant une “stigmatisation” humi-
liante, mais également thérapeutique,
en s’adressant autant aux actes qu’au désir
“inconscient” qui les a inspirés. Sur cette
base, on assiste actuellement en prison à
une véritable déferlante d’incarcérations
de grands malades. En témoigne quoti-
diennement le sens clinique des juges qui
rédigent les ordonnances de placement
en détention, mentionnant systématique-
ment l’existence et la gravité des troubles
mentaux de l’intéressé et recommandant
avec la plus extrême insistance l’adminis-
tration urgente de soins psychiatriques, au
besoin en milieu hospitalier, dès l’entrée
en prison. On pourrait probablement
discuter le bien-fondé de ce phénomène
et des principes qui l’animent, mais le vrai
problème est ailleurs.
Le vrai problème est qu’il est inhumain
d’envoyer des malades mentaux en prison.
Un point, c’est tout. Quiconque connaît à
la fois les conditions de vie dans les prisons
et la clinique des maladies mentales sait
qu’envoyer un malade mental en prison
est en soi un acte d’inhumanité. Soumettre
des malades vulnérables à la vie de la
prison, c’est les jeter en pâture à la violence
pénitentiaire, à celle des codétenus, à
des stress complètement déstructurants
qui rendent tous les malades encore
plus malades, si c’est possible. Or, les
experts psychiatres et les juges, comme le
montrent les recommandations pressantes
de soins inscrites sur les ordonnances
d’incarcération, connaissent aussi bien
la vulnérabilité des malades mentaux que
la nature des conditions de vie en prison.
En d’autres termes, incarcérer en toute
connaissance de cause un malade mental
dans les circonstances actuelles pose le
problème de la responsabilité de l’autorité
judiciaire et sanitaire, qu’il faudra bien
affronter tôt ou tard, comme le relate
B.E. Harcourt dans son article.
Et que l’on n’argumente pas que ce sont
aux services de psychiatrie en prison (les
SMPR) de régler la question : la plupart
des prisons en France n’ont pas de SMPR,
et quand ceux-ci existent, ils ont des
moyens humains et matériels ainsi que
des conditions d’exercice totalement ridi-
cules et inadéquats au regard des besoins,
quand 20 à 40 % des détenus souffrent
de troubles qui justifieraient un traite-
ment dans un service de psychiatrie. Et
ce ne sont pas les UHSA (environ un lit
pour 100 détenus) qui apporteront une
solution.
Il est intéressant que B.E. Harcourt cite
l’exemple d’un haut directeur des services
sociaux qui a été condamné pour n’avoir
pas transféré des malades mentaux dans
un hôpital. De ce point de vue, la France se
distingue des États-Unis. On imagine en
effet mal en France qu’un directeur (que ce
1 www.law.uchicago.edu/les/harcourt/institutionalized-
nal.pdf
PSY fevrier 07.indd 29 20/02/07 14:11:03

L e c t u r e
30
Le c t u r e
La Lettre du Psychiatre - Vol. III - n° 1-2 - janvier-février 2007
soit celui des services sociaux ou d’une
prison) soit poursuivi – et condamné
– pour les mêmes raisons, tout simple-
ment parce que ces directeurs souhai-
tent en général et de manière urgente,
que l’institution sanitaire les décharge
des détenus malades mentaux. C’est
assez triste à dire, mais si le directeur
de la prison de Rouen avait été poursuivi
et condamné à la suite de l’histoire du
prisonnier anthropophage, les choses
évolueraient peut-être. Mais les hauts
responsables des services sociaux et
des prisons n’ont aucune responsabilité
dans le fait que l’on incarcère à tout-
va des malades mentaux, et ils n’ont,
dans l’ambiance générale (il faut punir
les malades) et la misère des hôpitaux
psychiatriques, aucune possibilité
d’imposer quoi que ce soit concernant
le transfert des malades vers le lieu où
ils devraient être soignés. En France, il
n’appartient ni aux services sociaux ni
aux directeurs de prison de transférer un
malade mental à l’hôpital psychiatrique ;
la décision est médicale et signée par
le préfet.
L’autre grand problème est la situation
actuelle des hôpitaux psychiatriques.
Nous assistons tous, impuissants, au
démantèlement des hôpitaux psychia-
triques, dans le silence ahurissant des
soignants, de leurs organisations syndi-
cales, des associations de familles, de
patients et… de victimes. Quelles que
soient les raisons de cette anesthésie
“générale” (et il y aurait beaucoup à
dire), il est évident que ce qui se passe
en prison est directement lié à la situation
des hôpitaux psychiatriques. Rouen n’est
rien d’autre qu’un symptôme de l’état de
la psychiatrie française.
B.E. Harcourt montre, dans son graphique,
que les hôpitaux psychiatriques aux
États-Unis ont commencé à se vider vers
le milieu des années 1950 (l’arrivée des
neuroleptiques) et que, à partir du milieu
des années 1970, le nombre des détenus
s’est mis à augmenter d’une façon verti-
gineuse, alors que le nombre de patients
des hôpitaux psychiatriques continuait à
diminuer. Aujourd’hui, aux États-Unis,
on met systématiquement en prison les
malades mentaux auteurs d’un délit. Et
comme, aux États-Unis, les personnes
démunies ne peuvent pas se procurer
de médicaments (à cause des systèmes
d’assurance), ils cassent les vitrines d’un
magasin ou agressent un policier, parce
qu’il n’y a qu’en prison que les soins sont
gratuits.
La France n’en était pas encore là. En
France, il s’est passé quelque chose d’abso-
lument extraordinaire et unique au monde :
l’invention du “secteur” de psychiatrie.
Si l’on pouvait résumer le secteur en une
phrase, on dirait : tout malade mental est
pris en charge au plus près de chez lui par
une équipe soignante qui ne l’abandonne
jamais. Le pivot, c’est l’équipe soignante.
C’est elle qui connaît le malade, qui connaît
son éventuelle dangerosité, qui sait recon-
naître quand un malade devient inquiétant,
et qui a le pouvoir de prendre des mesures
(l’hospitalisation d’office) quand cela semble
nécessaire. Il s’établissait entre les malades
et les équipes soignantes d’authentiques
relations de proximité, de confiance et de
soin, et il n’y a pas de secret : c’est la seule
façon de faire. Il n’y a qu’une seule atti-
tude à avoir avec un malade mental, c’est
de ne jamais l’abandonner. Il y a d’ailleurs
un principe pour cela, actuellement mis à
mal : c’est la continuité des soins.
La conjonction du choix de graves
restrictions budgétaires et de l’invrai-
semblable dogme de la responsabilisa-
tion des malades mentaux est en train
d’anéantir le dispositif du secteur. La
France commence à ressembler aux
États-Unis, avec 20 ans de retard. Les
restrictions budgétaires ont cassé les
équipes soignantes. Un secteur de
70 000 habitants “contient” 700 schi-
zophrènes (1 % de la population).
Un schizophrène est une personne
qui a perdu le contact avec la réalité,
qui délire, qui est hallucinée, et qui a
besoin d’être en permanence soutenue
dans la vie quotidienne. Suivre et ne
jamais abandonner 700 schizoph-
rènes implique des équipes soignantes
en rapport, c’est-à-dire suffisam-
ment étoffées. Avec des équipes
soignantes exsangues, on ne peut
plus suivre les patients. On les perd.
Ils sont dans la rue, ils errent d’hôtels
en foyers. Ils délirent, de plus en plus,
et un jour ils passent à l’acte. Ils ne sont
pas responsables. Les schizophrènes ne
sont pas responsables de leur schizoph-
rénie. C’est du côté de la destruction
des équipes soignantes qu’il y aurait lieu
de rechercher des responsabilités.
Harcourt termine son article en disant
que l’enfermement, que ce soit en prison
ou dans des hôpitaux psychiatriques,
a pour effet général de diminuer la crimi-
nalité. Les équipes soignantes avaient
précisément ce rôle protecteur vis-à-vis
de la société. Et elles évitaient aux malades
une double peine, leur maladie et la prison,
agissant dans le respect de l’“éthique”
médicale, dont l’institution sanitaire
devrait toujours être le garant naturel et
absolu. ■
PSY fevrier 07.indd 30 20/02/07 14:11:04
1
/
3
100%