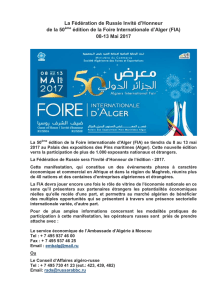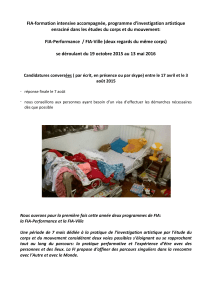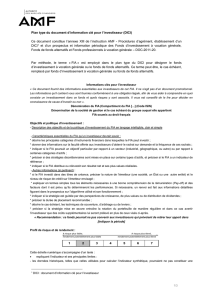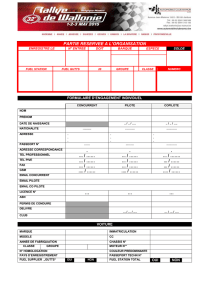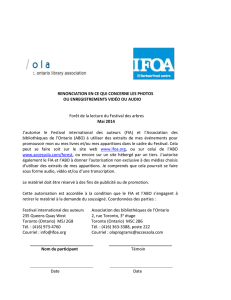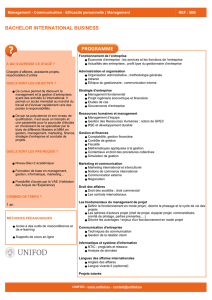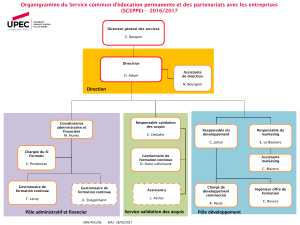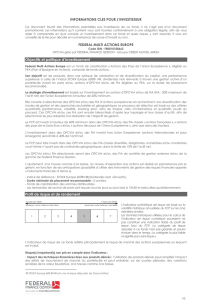Commission européenne, règlement délégué du 19 décembre 2012

FR FR
COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19.12.2012
C(2012) 8370 final
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° …/.. DE LA COMMISSION
du 19.12.2012
complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de
levier, la transparence et la surveillance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

FR 2 FR
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
La directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs1 a instauré des
exigences harmonisées pour les entités assurant la gestion des fonds d’investissement
alternatifs (FIA) commercialisés auprès d’investisseurs professionnels de l’UE2. Par ailleurs,
des normes minimales sont en cours d’instauration pour les gestionnaires de FIA
commercialisés auprès d’investisseurs de détail en vertu de règles nationales.
La directive couvre une large palette de FIA – des fonds investis en actions (equity funds) aux
fonds investissant dans des actifs illiquides (immobilier, capital-investissement,
infrastructures, matières premières ou biens tels que vin ou œuvres d’art) – et de gestionnaires
de tels fonds (ci-après les «gestionnaires»). Elle couvre également toutes les stratégies
d’investissement et formes juridiques possibles de FIA et de gestionnaires.
Pour obtenir un agrément, le gestionnaire doit se conformer aux exigences de la directive, qui
vont notamment d’exigences de fonds propres ainsi qu’en matière de gestion des risques et de
la liquidité, en passant par la désignation d’un dépositaire unique, à des règles concernant les
informations à communiquer aux investisseurs et les comptes à rendre aux autorités
compétentes.
Avec la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, tous les fonds
d’investissement de l’UE tombent dans l’une des deux catégories suivantes: il s’agit soit
d’OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), soit de FIA. Les
OPCVM sont régis par la directive dite «OPCVM» (2009/65/CE), et leur commercialisation
sur le marché de détail est autorisée. Ils ne relèvent pas du présent règlement délégué.
Avec près de 6 000 milliards d’euros d’actifs gérés dans l’UE, le secteur des OPCVM est
quasiment trois fois plus grand que celui des FIA (2 200 milliards d’euros). En 2010, le total
des actifs gérés par les FIA, toutes catégories de FIA confondues, s’élevait à 18 % du PIB de
l’UE. Plus des deux tiers (68 %) de tous les actifs des FIA sont détenus par des investisseurs
institutionnels, dont 70 % de fonds de retraite ou d’entreprises d’assurance.
La directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs prévoit un ensemble
très important de mesures d’exécution («mesures de niveau 2»), couvrant toute une série de
questions, et notamment: le calcul des actifs gérés, la méthode de calcul de l’effet de levier, la
clarification de certaines conditions d’exercice applicables aux gestionnaires, la délégation,
par ceux-ci, de certaines de leurs fonctions, des dispositions spécifiques en matière de gestion
des risques et de la liquidité, la définition plus précise des devoirs incombant au dépositaire et
1 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les
règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:FR:PDF.
2 La directive couvre également la commercialisation de FIA établis dans des pays tiers auprès
d’investisseurs professionnels de l’Union, ainsi que la gestion de FIA établis dans l’Union, mais qui n’y
sont pas commercialisés.

FR 3 FR
de sa responsabilité, des exigences en matière de transparence et des règles concernant les
pays tiers.
Le présent règlement délégué met en œuvre le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu
dans cette directive, créant un corpus de règles unique («règlement uniforme») qui garantira
l’équité des conditions de concurrence pour les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs dans l’Union.
Pour créer un corpus unique édictant des règles uniformes pour tous les gestionnaires, le
règlement est l’instrument juridique approprié. Puisqu’il n’y a pas de transposition de fond à
effectuer, le risque d’application divergente dans les différents États membres est évité.
L’utilisation d’un règlement facilitera ainsi la gestion et la commercialisation transfrontière
des FIA par leurs gestionnaires.
2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L'ACTE
Même si la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ne fixe pas de
délais pour l’adoption des actes délégués susmentionnés, la Commission entend adopter tout
le paquet de mesures d’exécution avant l’échéance de la période de transposition de la
directive (juillet 2013).
Le 2 décembre 2010, elle a adressé au comité européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières (CERVM) une demande d’avis technique sur les mesures de niveau 2.
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF, qui a remplacé le CERVM
le 1er janvier 2011) lui a remis cet avis technique le 15 novembre 2011.
Durant tout le processus de rédaction de son avis, l’AEMF est restée en contact étroit avec les
professionnels du secteur, dans le cadre de réunions bilatérales et de consultations publiques.
Les parties prenantes se sont beaucoup investies, comme en témoigne le nombre de réponses
reçues par l’AEMF à ses consultations écrites.
Outre les consultations écrites, l’AEMF a organisé trois auditions publiques, la première en
janvier 2011, couvrant l’appel à contributions, et les deux autres en septembre de la même
année, sur les deux parties du projet d’avis technique. Entre mars et mai 2011, elle a
également invité une vingtaine d’experts choisis parmi les parties prenantes à participer à une
série d’ateliers ciblés, portant sur les différentes parties de l’avis technique.
La Commission elle-même a eu des discussions approfondies avec les autorités nationales de
surveillance et les parties prenantes (en particulier, des organisations professionnelles, des
gestionnaires de fonds et des dépositaires) à la fois des États membres et de pays tiers, y
compris de centres financiers de premier plan tels que les îles anglo-normandes, les îles des
Caraïbes, les États-Unis et la Suisse.
Conformément à sa politique «mieux légiférer», la Commission a conduit une analyse
d’impact des options envisagées, en termes de politique à mener, sur huit questions
stratégiques relevant de six domaines devant être couverts par le règlement délégué: 1) le
calcul des actifs gérés, 2) la méthode de calcul de l’effet de levier, 3) les fonds propres
supplémentaires, 4) les devoirs et la responsabilité du dépositaire, 5) la fréquence des comptes
rendus à soumettre aux autorités compétentes et 6) l’utilisation de l’effet de levier de manière
substantielle.

FR 4 FR
Le projet de rapport d’analyse d’impact a été examiné par le comité d’analyses d’impact, par
procédure écrite, en février/mars 2012. Il a ensuite été remanié sur la base de l’avis rendu par
ce comité le 16 mars 2012, de façon à tenir compte de celui-ci dans toute la mesure du
possible.
Afin de préciser la portée de l’initiative, on a fourni plus d’informations sur le contexte dans
lequel celle-ci s’inscrit. Dans le chapitre consacré aux options envisagées, les limites fixées
par la directive ont été expliquées de manière plus détaillée. L’analyse des impacts inclut une
discussion de la mesure dans laquelle ceux-ci sont déclenchés par les mesures de niveau 1 et
de niveau 2. La suggestion d’étayer cette analyse de données quantitatives n’a pu toutefois
être suivie, parce ces informations n’ont pu être obtenues ni des professionnels du secteur, ni
des autorités de surveillance, ni d’aucun tiers.
Une comparaison des options envisagées avec le statu quo n’a pas non plus été possible, faute
de point de référence bien défini. Il n’est, en effet, pas simple de définir un point de référence
approprié pour ces mesures de niveau 2: d’un côté, elles couvrent un domaine qui n’a pas
encore été réglementé au niveau de l’Union et, en partie, pas même au niveau national; mais
d’un autre côté, elles seront, de toute façon, influencées par les effets de la directive de
niveau 1. Il est quasiment impossible d’établir un point de référence sensé, qui permettrait de
quantifier les effets, en raison des différences qui existent dans les pratiques actuelles, d’une
part, et de celles qui existeraient dans les modalités de transposition de la directive si aucune
mesure de niveau 2 n’était adoptée, d’autre part. Pour améliorer la présentation du rapport,
certaines de ses parties ont été raccourcies. Les sections consacrées à l’analyse des impacts
ont été modifiées, avec indication de la manière dont les options privilégiées s’écartent de
l’avis technique de l’AEMF.
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ
3.1. Subsidiarité et proportionnalité
Le droit de la Commission européenne et de l’UE à agir est argumenté dans l’analyse
d’impact qui accompagnait la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs. Cette directive vise à mettre en place un cadre clair et cohérent pour la
réglementation et la surveillance des gestionnaires de FIA dans l’UE; elle établit au niveau
européen, conformément à la base juridique sous-tendant la législation de l’UE dans ce
domaine (article 53, paragraphe 1, du TFUE), un mécanisme visant à permettre la création
d’un marché européen unique des fonds d’investissement alternatifs.
La base juridique des actes délégués est fournie (et circonscrite) par le pouvoir d’adopter des
actes délégués et des mesures d’exécution conféré à la Commission par les articles 56 à 58 de
la directive 2011/61/UE. La directive prescrit l’adoption d’actes délégués et de mesures
d’exécution dans certains domaines, afin que ses dispositions soient mises en œuvre de
manière cohérente dans l’ensemble de l’UE.
3.1.1. Choix de la forme juridique
Il est essentiel de mettre en place un corpus de règles unique pour les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs: étant donné la nature transfrontière de leurs activités, il convient,
en effet, qu’ils obéissent à des règles uniformes, par exemple en matière de diligence,
d’avantages ou de conflits d’intérêts pouvant survenir dans le cadre de leurs activités. Il a été
reconnu que, même si les gestionnaires de FIA ont un impact largement positif sur le marché,

FR 5 FR
leurs activités sont également susceptibles d’amplifier les risques du système financier. Aussi
est-il nécessaire que les exigences en matière de gestion des risques et de la liquidité,
d’évaluation et d’investissement dans des positions de titrisation soient uniformes et
appliquées de la même manière par les gestionnaires, quel que soit l’État membre dans lequel
ils sont agréés. Le règlement délégué prévoit en outre des exigences détaillées en ce qui
concerne le calcul des actifs gérés, les méthodes et le calcul de l’effet de levier, ainsi que le
contenu et la fréquence des comptes rendus à soumettre aux autorités compétentes et des
informations à communiquer aux investisseurs. Des règles précises et sans équivoque sur la
délégation et les dépositaires s’imposent également. Les règles prévues délimitent clairement
les tâches et responsabilités incombant respectivement au gestionnaire, à son délégataire, s’il
en désigne un, et au dépositaire. Il convient toutefois de souligner que la famille des fonds
d’investissement alternatifs et de leurs gestionnaires est si diverse qu’il n’est ni possible ni
souhaitable d’essayer de concevoir des règles sur mesure pour chaque type de gestionnaire.
Aussi le présent règlement délégué doit-il nécessairement laisser une certaine latitude,
permettant d’appliquer les règles qu’il prévoit de manière proportionnée, lorsque la taille et
l’organisation du gestionnaire ainsi que la nature, la taille et la complexité du FIA géré le
justifient. Il incombe aux autorités compétentes de contrôler la manière dont les gestionnaires
appliquent le règlement délégué.
Un corpus de règles unique, couvrant tous les aspects de la gestion des FIA, est également
nécessaire pour préparer l’introduction en douceur d’un passeport de commercialisation et
d’exercice pour les gestionnaires des pays tiers. Seul un haut niveau de convergence des
normes de gestion et de qualité serait propre à garantir l’équité des conditions de concurrence
entre les opérateurs basés dans l’UE et ceux établis dans d’autres juridictions.
La forme du règlement est la meilleure garantie possible de conditions de concurrence
uniformes et équitables et de normes de protection des investisseurs les plus élevées possibles.
3.1.2. Subsidiarité et proportionnalité
Le présent règlement délégué devrait garantir le degré d’harmonisation requis, tout en tenant
dûment compte du principe de subsidiarité. Au regard de la nature et de la portée du présent
règlement, il apparaît qu’une action au niveau des seuls États membres ne permettrait pas de
répondre aux enjeux de manière efficace ou efficiente, compte tenu de l’importance centrale
du marché unique et de la dimension transfrontière du secteur des gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs. Une action au niveau des seuls États membres risquerait de
maintenir en place ou de créer des obstacles à une poursuite de l’intégration et de nuire à la
gestion et à la commercialisation efficaces des FIA dans l’UE, avec un alourdissement des
charges administratives, mais aussi une hausse potentielle des coûts et des risques pour les
investisseurs.
En vertu du principe de proportionnalité, toute intervention doit être ciblée et se limiter à ce
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Tout le processus d’élaboration de la
présente proposition, depuis la définition et l’évaluation des différentes options envisagées
jusqu’à la rédaction, a été guidé par ce principe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
1
/
175
100%