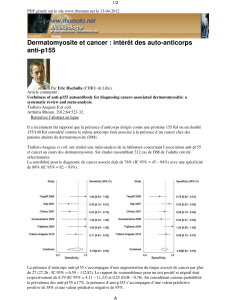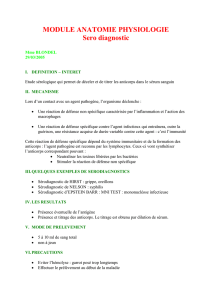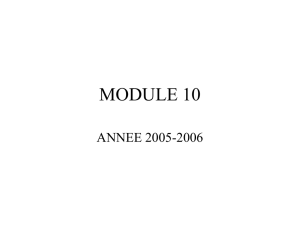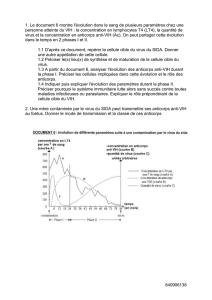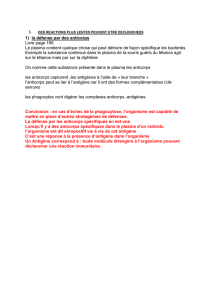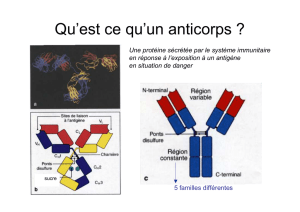178
La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 5 - octobre 1999
e pneumologue est doublement intéressé par cette
branche en pleine évolution de la neurologie. D’une
part, les cancers du poumon, et plus spécialement les
formes à petites cellules (CBPC), représentent environ la moitié
des cancers associés à un syndrome paranéoplasique à expression
neurologique (SP à expression neuro) ; devant un de ces syn-
dromes, de diagnostic souvent ardu, le pneumologue sera impli-
qué dans la recherche du cancer, et dans son traitement une fois
celui-ci identifié. D’autre part, il arrive qu’un SP à expression
neuro se développe au cours de l’évolution d’un cancer pulmo-
naire ; il peut représenter un problème diagnostique délicat,
dominé par la différenciation d’avec une métastase, et il constitue
un facteur pronostique important. De nouvelles avancées patho-
géniques dans ce domaine laissent même espérer des voies théra-
peutiques originales.
DÉFINITION
On parle de SP à expression neuro pour toute affection neuro-
logique, centrale ou périphérique, survenant en association
avec un cancer, et ne relevant ni d’un envahissement local, ni
de métastases, ni de troubles métaboliques, carentiels, iatrogé-
niques ou infectieux (1). Ces diverses causes étant estimées à
plus de 99 % des complications neurologiques des cancers, les
SP à expression neuro restent donc rares en clinique. Il est
néanmoins important de les identifier :
•
•Pour leur intérêt diagnostique, lorsqu’ils précèdent la décou-
verte du cancer (50 % des cas environ) et si la présence d’un
autoanticorps donné oriente la recherche. Il n’est toutefois pas
exceptionnel (plus de 10 % des cas) qu’aucun cancer ne soit
retrouvé malgré des scanners répétés, et même après autopsie
dirigée. On envisage que le cancer a pu alors être “éradiqué” par
l’anticorps pathogène (ou par d’autres acteurs de l’immunité).
•
•Pour leur valeur pronostique (2) : la majorité d’entre eux sont
associés à des cancers de petite taille, non métastasés. Les
CBPC avec anticorps paranéoplasiques seraient davantage chi-
miosensibles.
•
•Pour développer la connaissance des mécanismes de l’immu-
nité antitumorale et de la carcinogenèse (3).
Il faut insister cependant sur le fait que l’absence, pour un syn-
drome donné, de l’anticorps habituellement associé n’exclut
pas qu’il s’agisse d’un SP à expression neuro, de nouveaux
anticorps étant régulièrement décrits.
PATHOGÉNIE
Initialement, on pensait qu’un SP à expression neuro résultait
de la sécrétion d’un facteur “x” par la tumeur, comme c’est le
cas dans certains syndromes endocriniens, ou bien de la com-
pétition entre la tumeur et le système nerveux pour un substrat
donné. Cependant, la plupart des SP à expression neuro ont en
commun le caractère inflammatoire du LCR, avec élévation de
la protéinorachie (rarement au-delà de 1 g/l), lymphocytose
modérée, parfois profil oligoclonal des IgG. Cela a orienté les
recherches, et on a pu démontrer en immunohistochimie la
fixation du sérum de patients au niveau, par exemple, des cel-
lules de Purkinje dans l’atrophie cérébelleuse. Depuis le début
des années 80 (4), sous l’impulsion du groupe de Posner et
Dalmau (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New
York), l’étude systématique des sérums a permis d’établir des
corrélations clinico-biologiques et d’identifier les cibles,
d’abord cellulaires, puis moléculaires, de nombreux anticorps
a priori pathogènes. Il est en effet possible d’utiliser ces anti-
corps pour sélectionner des ADN complémentaires (ADNc)
MISE AU POINT
Les syndromes neurologiques paranéoplasiques
●B.Carlander*
* Service de neurologie B, hôpital Gui-de-Chauliac, Montpellier.
L
POINTS FORTS
POINTS FORTS
●
●Les syndromes neurologiques paranéoplasiques sont rares, mais très caractéristiques.
●
●Plusieurs anticorps spécifiques et très vraisemblablement pathogènes ont été identifiés, ainsi que les protéines neuronales et
tumorales contre lesquelles ils sont dirigés.
●
●Ils touchent entre autres, par ordre de fréquence décroissante, les neurones sensitifs, le cervelet, le système limbique, la
jonction neuro-musculaire…
●
●Ils peuvent mener à un diagnostic précoce de la tumeur, laquelle est le plus souvent un cancer pulmonaire à petites cellules.
●
●Un pronostic relativement favorable sur le plan cancérologique leur est associé.
●
●Ils peuvent cependant évoluer pour leur propre compte, avec un pronostic fonctionnel péjoratif.
●
●Les anticorps impliqués, notamment l'anti-Hu, pourront faire envisager dans un proche avenir une immunothérapie spécifique.

codant pour des antigènes onconeuraux jusque-là inconnus,
lesquels constituent vraisemblablement la cible même de
l’attaque auto-immune. Celle-ci ne fait pas appel uniquement à
l’immunité humorale (3, 5) : ainsi, dans l’atrophie cérébel-
leuse, un ADNc nommé cdr2 code pour un peptide se liant à
des molécules HLA de classe I, et des lymphocytes T cyto-
toxiques spécifiques ont été mis en évidence. Il est possible
que ces cellules soient utilisées par l’organisme pour com-
battre la croissance de la tumeur, tout en endommageant les
cellules cérébelleuses. Toutefois, on ne s’explique pas encore
les mécanismes qui déclenchent la destruction neuronale chez
une infime minorité de sujets alors que, par exemple, tous les
CBPC expriment l’antigène Hu. Il en est de même pour de
nombreuses tumeurs gynécologiques qui expriment l’antigène
cdr2, sans SP à expression neuro. Des études indiquent cepen-
dant une fréquence non négligeable d’anticorps chez des sujets
atteints de cancer et neurologiquement indemnes (15-20 %
d’anti-Hu dans le CBPC) (6). La question d’un rôle bénéfique
éventuel de ces anticorps dans l’évolution du cancer n’est pas
encore résolue, mais une grande fréquence des métastases
(50 %) a été notée quand l’anti-Hu est absent au moment du
diagnostic (7). De plus, l’injection d’anticorps anti-Hu est
capable, chez l’animal, d’inhiber la croissance de certaines
tumeurs (neuroblastome, qui exprime l’antigène Hu) (8).
CLASSIFICATION PAR ANTICORPS
DES PRINCIPAUX SYNDROMES
●
●Anti-Hu : encéphalomyélonévrite paranéoplasique (EMP) et
neuronopathie sensitive subaiguë (NSS, syndrome de Denny-
Brown)
Cet anticorps (ainsi nommé d’après le patient princeps) est res-
ponsable de deux affections cliniquement bien différentes,
mais souvent intriquées chez un même patient. Dans 75 % des
cas, un CBPC est en cause (9), et beaucoup plus rarement
d’autres tumeurs, notamment gynécologiques et testiculaires.
Ces deux syndromes ont en commun une évolution subaiguë,
sur quelques semaines ou quelques mois.
L’EMP présente une sémiologie polymorphe, comme son nom
le suggère, pouvant toucher le système limbique (amnésie
antérograde sévère, hallucinations, troubles du comportement),
le cervelet, les nerfs crâniens (ophtalmoplégie, nystagmus,
troubles de la déglutition), la moelle (paraplégie) ou la corne
antérieure (amyotrophie). Des crises comitiales, de type partiel
complexe (temporales), sont possibles.
Le tableau de NSS est plus univoque, avec des paresthésies
ascendantes souvent douloureuses, à tendance asymétrique, et
une atteinte sensitive profonde, ataxiante, pouvant aboutir à
une impotence fonctionnelle notable, avec parfois des mouve-
ments pseudo-athétosiques, reptatoires, des mains. Les réflexes
tendineux sont précocement abolis ; des déficits moteurs et une
amyotrophie sont plus inconstamment retrouvés. C’est au
niveau des ganglions rachidiens que s’exerce la destruction
neuronale (d’où le terme de neuronopathie), avec un net carac-
tère inflammatoire en anatomopathologie. Cliniquement, ce
tableau évoque d’emblée une neuropathie anti-Hu, mais il peut
aussi se rencontrer dans le cadre du syndrome de Gougerot-
Sjögren. Électriquement, on met en évidence l’abolition des
potentiels sensitifs, l’atteinte motrice (vitesses de conduction
et signes de dénervation) étant beaucoup plus discrète.
Les anti-Hu sont des IgG polyclonales reconnaissant une pro-
téine de 35-40 kDa commune au noyau neuronal et à celui du
CBPC. Plus précisément, il s’agit d’une famille de protéines
nucléaires (exclusivement neuronales chez le sujet sain) fixant
l’ARN. On considère qu’elles interviennent dans la régulation
post-transcriptionnelle de gènes de développement et de survie
des neurones. Cela est conforté par une forte homologie de la
famille Hu avec une protéine de la mouche drosophile interve-
nant dans le développement de l’œil et du système nerveux
central. Les anti-Hu semblent, comme on l’a vu, pouvoir limi-
ter la croissance tumorale.
●
●Anti-Yo : dégénérescence cérébelleuse paranéoplasique (DCP)
La DCP se rencontre avant tout dans les cancers ovariens, mais
également dans le CBPC, le cancer du sein ou la maladie de
Hodgkin. Elle réalise un syndrome cérébelleux subaigu
(quelques semaines), rapidement invalidant, contrastant avec
une imagerie négative, sauf en fin d’évolution (atrophie).
Les anticorps anti-Yo, que l’on retrouve uniquement dans les
DCP d’origine gynécologique, se fixent sur le cytoplasme des
cellules de Purkinje, avec des cibles protéiques apparemment
impliquées, elles aussi, dans les mécanismes de transcription.
De plus, une de ces protéines se combine avec l’oncogène c-
myc, l’inhibant vraisemblablement (10). L’anti-Yo serait alors
un facteur pro-oncogène, au contraire de l’anti-Hu, mais on a
vu que les lymphocytes T sont ici plus probablement en cause
dans la destruction des cellules cérébelleuses.
L’association des cancers ovariens avec anti-Yo est assez forte
pour que l’on recommande (10) une hystérectomie-ovariecto-
mie de principe, même si l’imagerie du petit bassin est nor-
male (et si la mammographie est également négative).
●
●Anti-Ri : opsoclonus-myoclonus (OM)
Il s’agit d’un syndrome clinique rare, spectaculaire et invalidant,
qui n’est paranéoplasique que dans 20 % des cas chez l’adulte
(plus souvent chez l’enfant, où il est moins exceptionnel, et
évoque en premier lieu un neuroblastome). Le cancer du sein
mais aussi le CBPC peuvent être en cause. Les autres cas sont
parfois rattachés à une origine infectieuse ou auto-immune.
L’opsoclonus consiste en des mouvements incessants des deux
yeux, anarchiques, plus ou moins conjugués, empêchant la sta-
tion debout ; il s’associe à des myoclonies du tronc ou des
membres, et parfois à une DCP ou à une encéphalopathie.
Les anticorps anti-Ri, retrouvés seulement en cas de cancer du
sein, se fixent sur un antigène appelé NOVA, impliqué dans
l’épissage de l’ARN. Comme pour l’anti-Hu, la présence de
cet anticorps est un élément de bon pronostic en cas de neuro-
blastome.
●
●Anti-VGCC : syndrome myasthénique de Lambert-Eaton
(SMLE)
Ce syndrome classique, décrit à la Mayo Clinic à la fin des
années 50, est très majoritairement associé au CBPC, avec une
prévalence estimée à 3 %. Cependant, ce n’est que dans 60 %
des cas de SMLE qu’on pourra identifier un cancer ; un contexte
auto-immun est fréquent pour ces formes non néoplasiques. En
revanche, les anticorps anti-VGCC (voltage-gated calcium
channels, canaux calciques voltage-dépendants) sont présents
179
La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 5 - octobre 1999

dans 85 % des cas de SMLE. Ces canaux ioniques sont, pour
certains de leurs sous-types, communs aux neurones et aux
cellules cancéreuses, et la pathogénie apparaît donc clairement
expliquée par cette immunité croisée. Il est possible ainsi,
contrairement aux autres SP à expression neuro, de reproduire
la maladie chez l’animal par transfert passif. Les anticorps blo-
quant la transmission de l’influx nerveux au niveau de la ter-
minaison axonale, il s’agit d’un trouble présynaptique, au
contraire de la myasthénie, dans laquelle c’est la partie post-
synaptique de la jonction neuro-musculaire qui est attaquée.
Cliniquement, la confusion n’est en fait guère possible. Il s’agit,
certes, d’une fatigabilité musculaire, mais celle-ci est essentiel-
lement proximale, et ne touche que rarement les muscles oculo-
moteurs ou bulbaires. Elle s’associe à une aréflexie tendineuse
des membres inférieurs, et fréquemment à une dysautonomie
(sécheresse de bouche, anomalies pupillaires). Une particularité
du SMLE réside dans le phénomène de facilitation : la poursuite
de l’effort peut améliorer transitoirement le déficit et l’aréflexie.
C’est surtout à l’examen électrique que cela pourra être mis en
évidence, avec un incrément des potentiels d’action lors de la
stimulation à haute fréquence (laquelle est assez mal tolérée),
contrastant avec un décrément à basse fréquence. L’élément dia-
gnostique majeur est en fait constitué par l’élévation du titre des
anti-VGCC. On doit également rechercher l’anti-Hu, qui est par-
fois associé, avec ou sans signes cliniques évocateurs.
Sur le plan thérapeutique, l’intérêt des immunoglobulines
intraveineuses semble démontré. Il est également possible
d’améliorer les symptômes par un médicament agissant sur les
canaux ioniques, la 3-4 diaminopyridine, disponible dans les
pharmacies hospitalières.
Cette liste de syndromes et d’anticorps n’est pas limitative. On
décrit ainsi des rétinopathies paranéoplasiques très sévères,
également associées au CBPC, par atteinte des photorécep-
teurs, dues à des anticorps (anti-CAR, pour cancer associated
retinopathy) qui se lient à une protéine intervenant dans la
phototransduction. La dermato-polymyosite est un autre
exemple classique, même si elle n’est paranéoplasique que
dans 10 % des cas environ (davantage si les signes cutanés
sont présents). Enfin, la liste d’anticorps s’allonge régulière-
ment (anti-Ta, anti-Ma, anti-amphiphysine, anti-CV2), en
même temps que se compliquent les associations à divers
sièges néoplasiques.
DIAGNOSTIC
Lorsque le SP à expression neuro est révélateur, la tâche du
neurologue n’est pas toujours aisée, mais on est désormais
grandement aidé par le dépistage des anticorps.
Chez un patient porteur d’un cancer connu, la difficulté varie
selon le SP à expression neuro présenté. Ainsi, il est relativement
aisé de rattacher un syndrome cérébelleux à une métastase de la
fosse postérieure par un scanner avec injection (l’IRM étant
généralement superflue, sauf pour de rares cas de méningite car-
cinomateuse non visualisée au scanner). Le SMLE est en
revanche souvent méconnu, s’il est noyé dans l’altération de
l’état général, ou si l’aréflexie est attribuée aux drogues neuro-
toxiques. Celles-ci peuvent donner un tableau proche d’une NSS,
mais l’intensité de l’ataxie et l’asymétrie des troubles sont des
éléments d’orientation ; surtout, la NSS se développe rarement en
cours de chimiothérapie et de réduction de la masse tumorale.
ASPECTS THÉRAPEUTIQUES
Jusqu’à présent, seuls une minorité de patients ont tiré bénéfice
des thérapies immuno-suppressives mises en œuvre, qu’il s’agisse
des médicaments classiques, des plasmaphérèses ou des immuno-
globulines intraveineuses (11). On postule que les lésions neuro-
nales sont déjà irréversibles au moment du diagnostic. La préco-
cité du traitement (IgIV par exemple) apparaît d’ailleurs comme
un facteur important du succès possible de ces thérapeutiques.
Leur danger potentiel serait cependant de déprimer aussi l’immu-
nité de lutte antitumorale, les options du neurologue risquant
d’aller à l’encontre de celles du cancérologue. Citons cependant
le cas de l’opsoclonus-myoclonus, qui justifie une corticothéra-
pie, peut-être du fait d’une intense réaction inflammatoire.
Un traitement agressif du cancer apparaît prioritaire, d’autant
que, comme il a été dit, certaines données suggèrent un
meilleur pronostic lorsqu’un cancer est associé à un SP à
expression neuro.
Chez les sujets anti-Hu symptomatiques gardant un bilan néo-
plasique négatif, on peut observer une survie prolongée si le
nursing permet d’éviter les conséquences de la neuronopathie
ou de l’encéphalite.D’ores et déjà, des essais de vaccination
anti-Hu sont envisagés chez l’homme, après des résultats posi-
tifs sur la croissance tumorale chez l’animal (8).■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Dubas F., Letournel F. Syndromes neurologiques paranéoplasiques. Encycl
Méd Chir Neurologie. Elsevier, Paris 1998 ; 17-162-A-10, 6 p.
2. Voltz R.D., Posner J.B., Dalmau J., Graus F. Paraneoplastic encephalomye-
litis : an update of the effects of the anti-Hu immune response on the nervous
system and tumour. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997 ; 63 : 133-6.
3. Darnell R.B. The importance of defining the paraneoplastic neurologic disor-
ders. New Engl J Med 1999 ; 340 : 1831-3.
4. Graus F., Cordon-Cardo C., Posner J.B. Neuronal nuclear antibody in sen-
sory neuronopathy from lung cancer. Neurology 1995 ; 35 : 538-43.
5. Benyahia B., Liblau R., Merle-Beral H., Tourani J.M., Dalmau J., Delattre
J.Y. Cell-mediated autoimmunity in paraneoplastic neurological syndromes with
anti-Hu antibodies. Ann Neurol 1999 ; 45 : 162-7.
6. Dalmau J.O., Furneaux H.M., Cordon-Cardo C., Posner J.B. Detection of
the anti-Hu antibody in the serum of patients with small cell lung cancer – a
quantitative Western blot analysis. Ann Neurol 1990 ; 27 : 544-52.
7. Dalmau J., Graus F., Cheung N.K. et coll. Major histocompatibility proteins,
anti-Hu antibodies, and paraneoplastic encephalomyelitis in neuroblastoma and
small cell lung cancer. Cancer 1995 ; 75 : 99-109.
8. Carpentier A.F., Rosenfeld M.R., Delattre J.Y., Whalen R.G., Posner J.B.,
Dalmau J. DNA vaccination with HuD inhibits growth of a neuroblastoma in
mice. Clin Cancer Res 1998 ; 4 : 2819-24.
9. Dalmau J.O., Graus F., Rosenblum M.K., Posner J.B. Anti-Hu-associated
paraneoplastic encephalomyelitis/sensory neuronopathy : a clinical study of
71 patients. Medicine 1992 ; 71 : 59-72.
10. Dalmau J.O., Posner J.B. Paraneoplastic syndromes. Arch Neurol 1999 ;
56 : 405-8
11. Blaes F., Strittmatter M., Merkelbach S et coll. Intravenous immunoglobulins in
the therapy of paraneoplastic neurological disorders. J Neurol 1999 ; 246 : 299-303.
MISE AU POINT
180
La Lettre du Pneumologue - Vol. II - n° 5 - octobre 1999
Adresses des deux principaux laboratoires en France recherchant les anti-
corps paranéoplasiques
•
•Laboratoire Inserm U495 (Pr Delattre, Dr Benyahia), La Salpêtrière, 47,
boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris.
•
•Laboratoire Inserm U433 (Dr Honnorat), Hôpital neurologique, 59, boule-
vard Pinel, 69394 Lyon Cedex 3.
Prélèvements sur tube sec 7-10 ml, envoi non express, température ambiante
1
/
3
100%