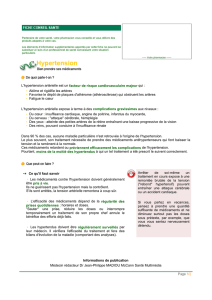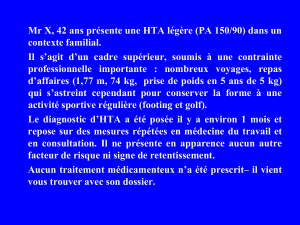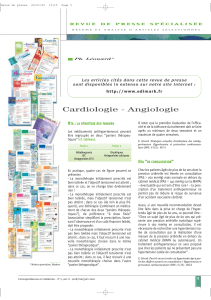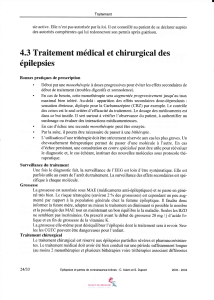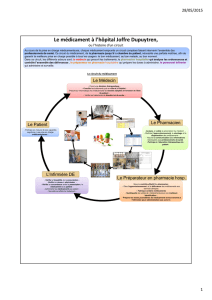Lire l'article complet

Cet échec relatif de la prise
en charge dépend de nom-
breux facteurs liés au
médecin, au patient, mais
aussi aux stratégies théra-
peutiques préconisées et
utilisées. Lorsque, après la
prescription d’une premiè-
re thérapeutique, l’objectif
tensionnel n’est pas atteint,
trois moyens sont préconisés pour améliorer
la baisse de la pression artérielle :
– augmenter la dose du médicament en
monothérapie ;
– substituer un médicament à un autre,
c’est la monothérapie séquentielle ;
– associer les médicaments, c’est la com-
binaison des antihypertenseurs.
Toutefois, dans les dernières recomman-
dations de l’ANAES sur la “Prise en char-
ge des patients adultes atteints d’hyper-
tension artérielle essentielle” (2), il est
indiqué : “Lorsque le premier médicament
est bien toléré, mais l’effet antihyperten-
seur insuffisant, l’addition d’un deuxième
principe actif devrait être préférée, en pri-
vilégiant un diurétique thiazidique si le
premier principe ne l’était pas.”
Les stratégies actuelles d’utilisation des anti-
hypertenseurs sont donc nombreuses, et cet
article se propose de détailler ces données.
L’augmentation de la dose du
médicament en monothérapie
Cette stratégie impose de connaître la rela-
tion dose du médicament/effet hypotenseur
qui dépend de chaque classe thérapeutique.
Avec les antagonistes calciques, l’efficaci-
té hypotensive est plus grande lorsqu’on
augmente la dose. Mais comme les effets
secondaires sont plus fréquents aux fortes
posologies, la commercialisation est pro-
posée à de faibles posologies initiales, ce
qui peut conduire à utiliser les antago-
nistes calciques en sous-dosage chez un
certain nombre de patients.
Pour les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion, les dosages habituels sont
suffisants pour obtenir l’effet antihyperten-
seur maximal. Il n’est donc pas nécessaire
d’augmenter la dose unitaire. En
revanche, la durée de l’action hypotensive
est variable entre les principes actifs. La
durée est la plus courte avec le captopril,
nécessitant au moins une prise toutes les
12 heures et au mieux une prise toutes les
8 heures, alors que la durée est la plus
longue avec le trandolapril, dont l’action
se prolonge au-delà de 24 heures.
Pour les antagonistes des récepteurs de
l’angiotensine II, les dosages recomman-
dés pour le début du traitement apportent
une réponse proche de la réponse maxi-
male. Toutefois, un doublement de la dose
est possible pour tous les médicaments et
une efficacité un peu supérieure peut être
observée. Cependant, l’addition d’une
faible dose de diurétique produit une bais-
se de la pression artérielle qui peut être
plus importante qu’une augmentation de
la dose du médicament. L’usage des com-
binaisons à dose fixée des AT 1 bloquants
avec l’hydrochlorothiazide permet le pas-
sage de la monothérapie à la bithérapie, tout
en conservant le bénéfice
d’une monoprise (un seul
comprimé par jour). Cette
option thérapeutique de-
vrait être privilégiée en cas
de réponse tensionnelle
insuffisante après une
monothérapie.
Pour les diurétiques, il
est montré que l’effet
hypotenseur existe de façon modeste mais
significative pour la dose de 12,5 mg
d’hydrochlorothiazide. Le plateau de l’ef-
fet hypotenseur se situe entre 25 et
50 mg/jour. L’équivalence des doses des
différents thiazidiques entre eux n’est pas
bien documentée. L’action hypotensive du
furosémide prescrit à 80 mg est inférieure
à celle de l’hydrochlorothiazide à 50 mg.
Pour les bêtabloquants, les doses habi-
tuelles suffisent dans le traitement de
l’hypertension artérielle, et il n’y a pas
lieu d’augmenter les posologies en cas
d’inefficacité. Obtenir une bradycardie
n’est en particulier pas un élément indis-
pensable à l’action hypotensive.
Substituer un médicament à un
autre, c’est la monothérapie
séquentielle
Un patient “non répondeur” à un médica-
ment peut être “répondeur” à un médicament
d’une autre famille. C’est en se fondant
sur cette caractéristique que la stratégie de
la monothérapie séquentielle a été proposée.
Elle consiste, en cas d’inefficacité d’une
première monothérapie, à prescrire une
autre monothérapie choisie dans une
famille pharmacologique différente. Plu-
sieurs monothérapies successives sont
ainsi proposées avant la prescription d’une
association d’antihypertenseurs. Cette mé-
451
progrès en
Progrès en thérapeutique
Malgré le fait que les médecins français disposent de
près de 300 médicaments antihypertenseurs, le
contrôle de l’hypertension artérielle reste insuffisant dans
les populations d’hypertendus traités, car seulement 40 %
des sujets traités ont une pression artérielle inférieure à l’ob-
jectif tensionnel fixé par les recommandations (1).
*Service de médecine interne, hôpital
Broussais, Paris.
Stratégies actuelles d’utilisation
des antihypertenseurs
Xavier Girerd*

thode a pour objectif de rechercher la classe
thérapeutique à laquelle le sujet est répon-
deur afin de n’exposer le patient qu’à un
seul principe actif pour le traitement au long
cours de son hypertension artérielle.
L’efficacité de la monothérapie séquen-
tielle a été récemment confirmée par une
étude utilisant la méthode de l’essai croisé
(3). Chez 56 patients hypertendus jamais
traités, l’essai de quatre monothérapies (un
IEC, un bêta-bloquant, un diurétique thiazi-
dique et un antagoniste calcique) a été réali-
sé de façon consécutive sur une période de
un mois. Entre les périodes de traitement, un
arrêt de un mois était organisé afin d’obtenir
un retour au niveau tensionnel initial.
L’étude a montré qu’il existe une variabilité
individuelle dans la réponse à chaque classe
d’antihypertenseurs. Ainsi, si une stratégie
en monothérapie séquentielle est utilisée, le
pourcentage de sujets, dont la pression arté-
rielle est ≤140/90 mmHg, passe de 39 % au
terme de la première monothérapie à 73 %
au terme de la quatrième monothérapie
consécutive. Cette étude montre que la stra-
tégie de la monothérapie séquentielle per-
met d’obtenir un contrôle de l’hypertension
chez trois patients sur quatre.
Il existe plusieurs limitations à l’utilisa-
tion de la monothérapie séquentielle.
Pour normaliser la pression artérielle, cer-
taines monothérapies nécessitent d’aug-
menter les doses du médicament, en parti-
culier pour les diurétiques, les antagonistes
calciques et les alphabloquants. L’apparition
d’effets secondaires dose-dépendants peut
alors limiter l’utilisation optimale du médi-
cament en monothérapie. Chez un “répon-
deur”, les effets secondaires indépendants
de la dose (toux sous inhibiteur de l’enzyme
de conversion) peuvent conduire à stopper
une monothérapie pourtant efficace. Chez
les “répondeurs non contrôlés”, la baisse
tensionnelle induite par la monothérapie est
insuffisante pour obtenir la normalisation
de la pression artérielle. Chez ces sujets, la
combinaison des antihypertenseurs est le
plus souvent le seul moyen d’obtenir le
contrôle tensionnel.
Enfin, un délai de plusieurs mois est par-
fois nécessaire pour obtenir la normalisa-
tion de la pression artérielle après l’essai
de plusieurs monothérapies. Ce délai est
presque toujours perçu comme trop long
par le médecin et par le patient, qui sou-
haitent obtenir un résultat rapide sur le
contrôle de la pression artérielle.
Associer les médicaments,
c’est la combinaison
des antihypertenseurs
Prescrire un traitement en combinaison signi-
fie qu’au moins deux principes actifs hypo-
tenseurs sont donnés pour obtenir la baisse
tensionnelle. Cette stratégie utilisée dans tous
les grands essais de prévention réalisés dans
l’hypertension artérielle a montré son effica-
cité pour induire une baisse durable de la
pression artérielle et une prévention des com-
plications cardiaques et vasculaires. Bien que,
dans ces études, le traitement soit débuté par
une monothérapie, dans le suivi au long cours
des patients, l’association d’un deuxième
médicament était nécessaire chez la majorité
des sujets. Ainsi, l’expérience de l’étude
SHEP indique que le suivi pendant plus de
quatre ans de sujets hypertendus âgés impose
que 75 % des patients soient sous une asso-
ciation de deux médicaments antihyper-
tenseurs pour atteindre l’objectif du traite-
ment (4). De même dans l’étude HOT, 74 %
des patients sont sous une combinaison
d’antihypertenseurs dans le groupe des
patients dont la pression artérielle est en
moyenne de 140/81 (5).
Enfin, un travail des hôpitaux de l’adminis-
tration des Vétérans a suivi une cohorte de
800 hypertendus âgés de 65 ans sur une
période d’au moins deux ans et observé que
les 25 % de patients chez qui l’intensité du
traitement a été la plus importante ont vu leur
pression systolique diminuer de 6,3 mmHg,
alors que les 25 % de patients chez qui
l’intensité du traitement a été la moins
importante ont eu une pression systolique
augmentée de 4,8 mmHg. L’analyse statis-
tique indique que la principale raison du bon
contrôle tensionnel était la prescription d’une
combinaison d’antihypertenseurs (6).
Prescrire une combinaison d’antihyper-
tenseurs est donc une nécessité pour per-
mettre d’atteindre l’objectif tensionnel chez
une large majorité d’hypertendus. Si, le plus
fréquemment, ce sont des combinaisons
“libres” (prescription simultanée de plu-
sieurs médicaments) qui sont réalisées par le
médecin, le développement des “combinai-
sons à doses fixées” offre la possibilité d’une
simplification de la prescription en gardant
un nombre limité de prises médicamen-
teuses. Cette option de prescription de “com-
binaisons à doses fixées” en deuxième inten-
tion devrait être aujourd’hui largement
privilégiée lorsque le traitement initial par
monothérapie ne permet pas d’atteindre
l’objectif tensionnel, et que le premier médi-
cament prescrit a montré sa bonne tolérance.
Le choix de cette stratégie de combinaison
est celui préconisé par l’ANAES dans ses
dernières recommandations (2) : “Lorsque le
premier médicament est bien toléré, mais
l’effet antihypertenseur insuffisant, l’addi-
tion d’un deuxième principe actif devrait être
préférée, en privilégiant un diurétique thiazi-
dique si le premier principe actif ne l’était
pas (accord professionnel).”
Les combinaisons à doses fixées permettent
de simplifier la prescription et l’observance
pour un coût financier plus faible.
La prescription de ces “combinaisons à
doses fixées” devrait s’effectuer dans le mois
au plus tard suivant la prescription initiale
lorsque l’objectif tensionnel n’est pas atteint.
La place des “associations fixes
à faibles doses”
Les “associations fixes à faibles doses”
sont des médicaments utilisables pour
débuter un traitement antihypertenseur.
Cette possibilité leur a été accordée car ils
ont démontré (a) une efficacité hypotensi-
452
Act. Méd. Int. - Hypertension (12), n° 6, juin 2000
progrès en
Progrès en thérapeutique

ve comparable à celle d’une monothéra-
pie, (b) que chaque composant de la com-
binaison participait à l’action hypotensive
totale, (c) que les effets secondaires
n’étaient pas plus fréquents que ceux
observés sous monothérapie.
La question des effets secondaires est un
élément important de l’intérêt porté à ces
associations. Il était déjà bien démontré
avec les “combinaisons à doses fixées”
qu’une diminution des effets secondaires
dose-dépendants, en particuliers métabo-
liques, rencontrés avec les diurétiques
pouvait être obtenue en associant au diu-
rétique un inhibiteur de l’enzyme de
conversion, un AT 1 bloquant ou la spiro-
nolactone. Avec l’association à faibles
doses d’un bêtabloquant et d’un diuré-
tique, c’est en portant la dose du diuré-
tique thiazidique au très faible niveau de
6,25 mg d’hydrochlorothiazide qu’il a été
possible d’annuler les effets métaboliques
du diurétique (7). Cette mini-dose de diu-
rétique ayant en revanche montré qu’elle
augmentait l’efficacité hypotensive d’une
faible dose de bêtabloquant.
Les “associations fixes à faibles doses” s’in-
tègrent logiquement dans une stratégie visant
à obtenir l’objectif tensionnel optimal. Ainsi,
la prescription de ces médicaments, qui va
induire une baisse tensionnelle équivalente
de celle d’une monothérapie, va permettre
d’évaluer d’emblée la tolérance des principes
actifs qui la composent. Si la prescription
d’une “association fixe à faibles doses” ne
permet pas d’obtenir la réponse hypotensive
optimale, il est nécessaire d’augmenter les
doses d’au moins un des principes actifs qui
constituent l’association. Cette augmentation
se fera alors avec un faible risque de voir
apparaître un effet secondaire “dose-indé-
pendant”, car la bonne tolérance des traite-
ments aura été évaluée lors de la période de
prescription à faible dose. La disposition de
différents dosages pour ces associations (des
“gammes” thérapeutiques) apparaît comme
un atout important en faveur de l’utilisation
initiale de cette nouvelle stratégie théra-
peutique.
Les stratégies pour atteindre
l’objectif tensionnel
Atteindre l’objectif tensionnel de façon
progressive
Après avoir débuté un traitement, le suivi doit
s’organiser afin de s’assurer que l’objectif
tensionnel est atteint avec une tolérance opti-
male des thérapeutiques. Un délai de plu-
sieurs semaines est souvent nécessaire pour
atteindre l’objectif tensionnel, et une baisse
trop rapide des chiffres de la pression arté-
rielle n’est pas souhaitable. La première éva-
luation de l’efficacité et de la tolérance du
traitement devra se faire après un minimum
de deux semaines et un maximum de quatre
semaines.
Tolérance et efficacité guident l’adap-
tation des médica-
ments
Si le médicament ini-
tialement choisi ne
permet pas d’at-
teindre l’objectif ten-
sionnel, ou si le trai-
tement est mal toléré,
une adaptation du
traitement est indis-
pensable.
Le tableau I propose
une stratégie d’utili-
sation des médica-
ments lorsque la tolé-
rance du traitement
n’est pas satisfaisante
et/ou que l’objectif
tensionnel n’est pas
atteint après la pres-
cription d’une mono-
thérapie initiale.
Selon l’étude de
Dickerson (3), les
antihypertenseurs
sont regroupés dans
deux “paniers théra-
peutiques”. Le panier
1 comporte : IEC, bêtabloquant, ARA II.
Le panier 2 comporte : antagoniste cal-
cique, diurétique.
– Pour un individu, l’efficacité hypotensi-
ve est comparable pour les médicaments
de chaque panier.
– La tolérance est dépendante de la famil-
le pharmacologique mais pas du “panier
thérapeutique”.
– La bithérapie doit associer un médica-
ment de chacun des “paniers thérapeu-
tiques”.
Les règles pour l’utilisation des médica-
ments sont les suivantes :
Le choix de la deuxième étape du traite-
ment est fondé autant sur la tolérance du
premier traitement que sur son efficacité.
– Lorsqu’une monothérapie est bien tolérée
et que l’objectif tensionnel est atteint, la
monothérapie initiale doit être poursuivie.
453
progrès en
Progrès en thérapeutique
Tableau I. Stratégie pour l’utilisation des antihypertenseurs selon
la tolérance et l’efficacité observée après la prescription d’une
première monothérapie.
Première Première
monothérapie monothérapie
Bonne Mauvaise tolérance
tolérance
Objectif atteint Poursuite de Changer
< 140 et < 90 la monothérapie pour une
initiale monothérapie
du même
“panier
thérapeutique”
Objectif non Bithérapie à Changer
atteint dose fixée pour une mono-
> 140 ou > 90 thérapie dans
l’autre “panier
thérapeutique”
Selon l’étude de Dickerson (Lancet 1999 ; 35 : 2008-13), les antihyper-
tenseurs sont regroupés dans deux “panier thérapeutique”. Panier 1 :
IEC, bêtabloquant, ARA II. Panier 2 : Antagoniste calcique, diurétique.
Pour un individu, l’efficacité hypotensive est comparable pour les médi-
caments de chaque panier. La bithérapie doit associer un médicament de
chacun des “paniers thérapeutiques”.

454
– Lorsqu’une monothérapie est bien tolé-
rée et que l’objectif tensionnel n’est pas
atteint, une bithérapie doit être proposée.
Une association à dose fixée, si elle est
possible, est préférée.
– Lorsqu’une monothérapie n’est pas bien
tolérée mais que l’objectif tensionnel est
atteint, il faut changer la monothérapie
mais garder un médicament du même
“panier thérapeutique”.
– Lorsqu’une monothérapie n’est pas bien
tolérée et que l’objectif tensionnel n’est
pas atteint, il faut changer la monothéra-
pie et choisir un médicament de l’autre
“panier thérapeutique”.
– Lorsqu’une bithérapie ne permet pas
d’atteindre l’objectif tensionnel, il faut
associer les médicaments dans des multi-
thérapies qui doivent toujours contenir un
diurétique. Les associations à dose fixée
sont à utiliser.
– Lorsqu’une hypertension artérielle est
résistante aux traitements, il est utile de
prendre l’avis d’un spécialiste de l’hyper-
tension artérielle.
Utilisation des associations à doses fixées
Si, le plus fréquemment, ce sont des com-
binaisons “libres” (prescription simulta-
née de plusieurs médicaments) qui sont
réalisées, le développement des “combi-
naisons à doses fixées” offre la possibilité
d’une simplification de la prescription en
gardant un nombre limité de prises médi-
camenteuses pour un coût plus faible que
pour une combinaison “libre”. Cette
option de prescription de “combinaisons à
dose fixée” en deuxième intention devrait
être privilégiée lorsque le traitement initial
par monothérapie ne permet pas d’atteindre
l’objectif tensionnel et que le premier médi-
cament prescrit a montré sa bonne tolérance.
La prescription de ces “combinaisons à
doses fixées” devrait s’effectuer dans la
suite de la prescription initiale, lorsque l’ob-
jectif tensionnel n’est pas atteint.
Conclusion
Atteindre, pour chaque patient, la pression
artérielle idéale est un objectif accessible avec
l’utilisation des thérapeutiques modernes.
Pour obtenir de meilleurs résultats, les asso-
ciations de médicaments antihypertenseurs
ont montré leur efficacité et devraient être
envisagées chez la majorité des patients.
Références bibliographiques
1. Programme national de santé publique.
Hypertension artérielle sévère exonérée.
Résultats de l’enquête sur la prise en charge
médicale des malades. Mai 2000.
2. Recommandations pour la pratique clinique
Prise en charge des patients adultes atteints d’hy-
pertension artérielle essentielle. ANAES avril
2000. http://www.anaes.fr/
3. Dickerson JEC et al. Optimisation of anti-
hypertensive treatment by crossover rotation of
four major classes. Lancet 1999 ; 35 : 2008-13.
4. SHEP Cooperative Research Group.
Prevention of stroke by antihypertensive drug
treatment in older persons with isolated systo-
lic hypertension. Final results of the Systolic
Hypertension in the Elderly Program. JAMA
1991 ; 265 : 3255-64.
5. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG et al.
Effects of intensive blood-pressure lowering and
low-dose aspirin in patients with hypertension :
principal results of the Hypertension Optimal
Treatment (HOT) randomised trial. Lancet 1998 ;
351 : 1755-62.
6. Berlowitz DR. Inadequate management of
blood pressure in a hypertensive population. N
Engl J Med 1998 ; 339 : 1957-63.
7. Frishman WH, Bryzinski BS, Coulson LR et al.
A multifactorial design to assess combination
therapy in hypertension : treatment with biso-
prolol and hydrochlorothiazide. Arch Intern
Med 1994 ; 154 : 1461-8.
progrès en
Progrès en thérapeutique
E.mail : [email protected]
Internet : http//www.edimark.fr
62-64, rue Jean-Jaurès, 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 01
1
/
4
100%