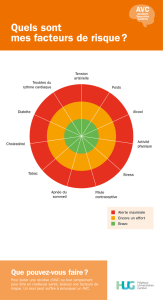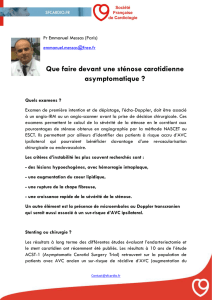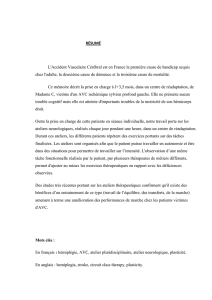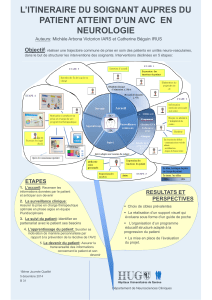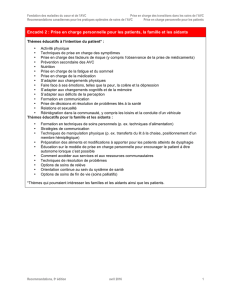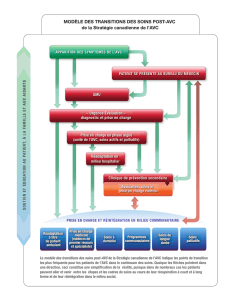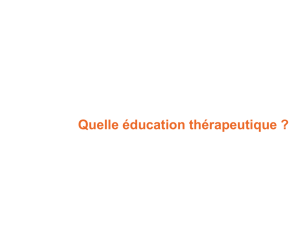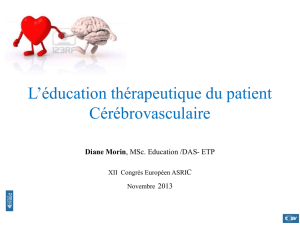Lire l'article complet

Revue de presse
Revue de presse
Dirigée par le Pr P. Amarenco
1,00 CEA
CAS
0,98
0,96
Absence d'événements
0,94
0,92
0,90
0 10 20 30
Nombre de jours post-randomisation
40 50 60 70
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007
22
BANC D’ESSAI :
Étude SPACE
DESIGN
Nom de l’étude : The Stent supported Percu-
taneous Angioplasty of the Carotid Artery versus
Endarterectomy (SPACE)
Pathologie incluse : AVC et AIT dans les
180 jours précédents.
Thérapeutique testée : angioplastie avec
stent versus chirurgie carotide.
Type d’essai : ouvert, contrôlé, contre trai-
tement de référence (chirurgie).
Contexte : la chirurgie (endartérectomie) caro-
tide diminue le risque d’AVC chez les patients
qui ont eu un AIT ou un AVC lié à une sténose
carotide serrée supérieure à 70 %.
Hypothèse testée : évaluer la non-infériorité
du stenting associé à un traitement Plavix® +
aspirine 75 mg/jour comparé à la chirurgie
(sous anesthésie locale ou générale), elle-même
associée à un traitement aspirine 100 mg/jour
sur le risque à 30 jours d’AVC. Pour être non
inférieure à la chirurgie, l’angioplastie-stenting
carotide devait avoir une différence de risque,
avec une borne supérieure de l’intervalle de
confiance inférieure à 2,5 %, pour une hypo-
thèse de risque du critère de jugement primaire
de 5 % dans le groupe chirurgie.
Nombre de patients : 1 183.
Sélection des centres : les centres devaient
comporter un chirurgien vasculaire ayant fait
25 endartérectomies consécutives rapportant le
taux de morbidité et de mortalité périopératoire
(on ne connaît pas le seuil pour être qualifié) ;
un thérapeute endovasculaire ayant pratiqué
25 angioplasties carotides ou stenting (on ne
connaît pas le seuil de morbi-mortalité quali-
fiant) ; un neurologue ayant l’expérience dans
le traitement de l’AVC et dans l’exploration
ultrasonore.
Critères d’inclusion : âge supérieur ou égal
à 18 ans, AVC ischémique 1 à 6 mois avant la
randomisation ; patients ambulatoires, modi-
fication du score de Rankin < 4 ; une sténose
carotide supérieure à 70 % en ultrasons ou 50 %
NASCET ou 70 % ECST.
Critères d’exclusion : antécédent coronaire
symptomatique, FA, embolie d’origine cardiaque,
hémorragie subarachnoïdienne.
Durée de suivi : 30 jours pour cette première
partie de l’étude.
Stenting
(CAS)
n = 599 Chirurgie carotide (CEA)
n = 584 Hazard-ratio
Critères primaires
AVC homolatéral ou décès 41 ( 6, 84 %) 37 (6,34%) 1,09 (0,69-1,72)
AVC homolatéral 39 (6,51 %) 30 (5,14 %) 1,26 (0,77-2,18)
Décès 4 (0,6 %) 5 (0,86 %) 0,78 (0,15-3,64)
Critères secondaires
AVC avec Rankin > 3 ou décès 28 (4,67%) 22 (3,77%) 1,25 (0,71-2,22)
Échec de procédure 19 (3,17 %) 12(2,05 %) 1,56 (0,71-3,56)
COURBE RÉSULTATS
CONCLUSION
Chez les patients ayant eu une sténose carotide symptomatique,
l’étude SPACE n’a pas pu montrer que la tolérance à 30 jours
du stenting carotide était non inférieure à la chirurgie. Par
conséquent, rien ne justifie son utilisation en routine jusqu’à ce
que les résultats du suivi à long terme soient disponibles.
Référence
SPACE Investigators. 30 day results from the SPACE trial of stent-protec-
ted angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients:
a randomized non-inferiority trial. Lancet 2006;368:1239-47.
•
Courbe de Kaplan-Meier.
Différence CAS-CEA
n = 584 Valeur de p
Critère primaire
AVC homolatéral ou décès 6,84 % - 6,34 % = 0,51 % [-1,89 +2,91] 0,09
Critère de jugement principal : première
récidive d’un AVC homolatéral ou décès toutes
causes confondues durant les 30 jours suivant
la randomisation.
Critères de jugement secondaires à
30 jours : AVC avec score de Rankin ≥ 3 ou
décès ; échec de la procédure ; sténose résiduelle
de 50 % ou plus ou occlusion de la carotide à
30 jours.

Revue de presse
Revue de presse
Dirigée par le Pr P. Amarenco
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007
23
Commentaire. La plupart des études qui
ont comparé le stent carotide à la chirurgie
par endartérectomie ont mélangé sténoses
carotides symptomatiques et asymptoma-
tiques, avec souvent une prédominance de
sténoses asymptomatiques (comme dans
l’étude SAPPHIRE).
L’étude CAVATAS, première étude rando-
misée bien conduite, mais avec des tech-
niques utilisées variables, avait conclu que
le risque à 30 jours était équivalent pour le
stenting et la chirurgie. Cependant, ce risque
était de 10 % ! Qui confierait son patient à un
chirurgien dont le risque opératoire à 30 jours
serait de 10 % ?
Récemment, la très belle étude EVA-3S (Mas JL
et al. N Engl J Med 2006) a dû être arrêtée du
fait d’un surrisque dans le groupe stenting. Le
risque de tout AVC ou décès à 30 jours était
de 3,9 % (2,0-7,2) pour l’endartérectomie et de
9,6 % pour le stenting (6,4-14,0), soit un risque
relatif significativement augmenté de 2,2 (1,2-
5,1). À 6 mois, le risque de tout AVC ou décès
était respectivement de 6,1 et 11,7 % (p = 0,02).
La grosse critique faite à EVA-3S a été l’insuf-
fisance des critères de sélection des centres
(les thérapeutes endovasculaires devaient
avoir fait 12 stenting carotides dans leur vie
ou 35 stenting “d’un tronc supra-aortique”, dont
5 au moins avaient porté sur une carotide). On
peut noter que le risque observé dans le bras
»
stenting était similaire à celui constaté dans
l’étude CAVATAS, et que le risque chirurgical
était plus conforme à ce que l’on attend d’un
chirurgien vasculaire entraîné.
Pour Wholley, l’un des grands angioplas-
ticiens de la carotide aux États-Unis, la
courbe d’apprentissage se fait dans les 20 à
50 premiers patients. Dès 1998, il rapportait
à l’AHA de Dallas les chiffres obtenus à partir
de 2 591 stenting carotides pratiqués dans des
centres différents (dont 60 % de sténose symp-
tomatique) [tableau].
Plus tard, au congrès de l’AHA de la Nouvelle-
Orléans en 2000, il communiquait les données
du registre mondial avec une évaluation
neurologique portant sur 5 210 procédures
faites chez 4 757 patients dans 36 centres
expérimentés, dont 63 % des patients étaient
symptomatiques. Le taux combiné de mortalité
et d’AVC était de 3,38 % pour les carotides
asymptomatiques et de 5,76 % pour les caro-
tides symptomatiques. Des chiffres bien infé-
rieurs à ceux de EVA-3S et un peu inférieurs
à ceux de SPACE. On peut évidemment argu-
menter sur la réalité/efficacité de l’évaluation
neurologique dans ce registre.
Dans EVA-3S et SPACE, il aurait fallu exiger
avoir fait au moins 50 procédures, quitte à faire
voyager le patient pour avoir son traitement.
On aurait ainsi pu évaluer le véritable risque
des angioplasticiens “expérimentés”.
Le stenting carotide est-il mort ? Certainement
pas. D’autres études sont en cours, notam-
ment l’essai CREST aux États-Unis, l’essai
CAVATAS-2 en Europe. Et puis quelle est la
place des traitements endovasculaires pour
toutes les sténoses artérielles siégeant dans des
endroits inaccessibles à la chirurgie (sténose
proximale des artères carotides primitives,
sténose au-dessus du bulbe carotide, sténose
sous-clavière ou vertébrale, etc.) ? Beaucoup
de travail et d’essais thérapeutiques sont encore
à faire.
Actuellement, on peut retenir qu’il n’y a pas
d’indication au stenting d’une sténose symp-
tomatique de l’origine de l’artère carotide
interne (et encore moins pour une sténose
asymptomatique), sauf exceptionnellement
au cas par cas.
P. Amarenco,
service de neurologie et centre d’accueil et de traitement
de l’attaque cérébrale, hôpital Bichat, Paris.
Tableau.
AVC/Décès à 30 jours 3,4 %/3,2 % 1,8 %/0,5 % 0,8 %/0,4 % 1,4 %/0,6 %
Nombre de stent carotides posés < 50 51-100 100-200 > 200
Faut-il faire une biopsie
musculaire devant une élévation
isolée des CPK ?
■
La découverte d’une élévation persistante
des créatines phosphokinases (CPK)
chez un patient peu ou pas symptomatique est
un problème récurrent en pratique clinique. On
recherche systématiquement les causes habi-
tuelles toxiques (antihypercholestérolémiants),
traumatiques, infectieuses, endocriniennes
(hypothyroïdie) ou les exercices physiques
répétés, mais le bilan est souvent négatif,
et se pose alors la question de l’utilité d’une
biopsie musculaire pour rechercher une affec-
tion musculaire propre. L’équipe marseillaise
du laboratoire de pathologie musculaire du
Pr Pellissier a récemment publié son expérience
sur 104 patients consécutifs avec une élévation
permanente d’au moins 500 UI/l (N 10 à 170).
La moitié des patients était totalement asymp-
tomatique et l’autre moitié avait uniquement
des symptômes modérés (myalgies, crampes,
fatigue) mais l’examen clinique était toujours
normal, et aucune cause classique de CPK
élevées n’était retrouvée. Ils ont distingué
dans leur population trois catégories d’âge :
13 enfants (4 à 15 ans), 20 adultes jeunes (16 à
30 ans) et 71 adultes. Ils ont également diffé-
rencié trois groupes d’élévation : 50 patients
avaient entre 500 et 1 000 UI, 30 entre 1 000
et 2 000 UI et 24, enfin, plus de 2 000 UI.
Cinquante-sept patients seulement avaient
eu un EMG, dont 23 étaient anormaux.
Un diagnostic final après biopsie musculaire a
pu être obtenu dans 55 % des cas. Le principal
groupe de pathologies était les glycogénoses
avec, entre autres, 15 maladies de Mc Ardle,
puis les dystrophies musculaires identifiées
en termes de protéine déficiente avec 14 cas
(dont 8 dystrophinopathies), et enfin, les
myosites (dont polymyosites et myosites à
inclusions dans 8 cas). La probabilité de faire
un diagnostic après biopsie était très corrélée
au jeune âge des patients (85 % de diagnostic
pour les 4-15 ans [p = 002]), à l’importance
de l’élévation des CPK (> 2 000 UI [p = 0,009])
et au sexe (les femmes plus que les hommes).
Enfin, si les patients étaient symptomatiques
ou si l’EMG était anormal, la chance de faire un
diagnostic était plus élevée mais la différence
n’était pas statistiquement significative.
Commentaire. Il s’agit d’une information
importante sur une très grande série de
patients et qui répond à des questions souvent
posées : à partir de quel taux demander une
biopsie musculaire, qu’est-ce que l’on peut
en attendre et quelle utilité cela a-t-il pour
le patient ?
Cette étude surprend un peu car elle montre
des pourcentages non négligeables de
diagnostic, y compris pour des élévations
modérées de CPK entre (500 et 1 000 UI).
»

Revue de presse
Revue de presse
Dirigée par le Pr P. Amarenco
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007
24
On retrouve les notions classiques de proba-
bilité d’établir un diagnostic chez les enfants
ou en cas de franche élévation (> 2 000 UI).
Il y a également une tendance si le patient est
une femme, s’il est un peu symptomatique ou
si l’EMG est anormal, mais ces éléments ne
sont pas significatifs et ne doivent donc pas
servir de critères pour décider de faire une
biopsie musculaire. On peut être surpris par
l’importance des diagnostics, en particulier
des glycogénoses ou de certaines dystro-
phies musculaires, mais cette étude montre
bien que la morphologie simple de la biopsie
musculaire ne suffit pas, et que c’est sur des
techniques plus complexes et systématiques
(étude myophosphorylasique, HLA1, étude
en western blot des protéines membranaires)
que le diagnostic a souvent pu être posé dans
ce laboratoire. Établir ces diagnostics chez des
patients pré-ou asymptomatiques peut être très
utile pour la prévention cardiaque, la préven-
tion de l’accident de rhabdomyolyse ou pour
un conseil génétique en cas de femme hété-
rozygote (maladie de Duchenne par exemple).
Cette étude semble indiquer qu’une biopsie
musculaire peut, dans plus de la moitié des cas,
montrer une anomalie y compris pour des taux
compris entre 500 et 1 000 UI, mais en réalisant
de façon systématique l’ensemble des techni-
ques actuellement disponibles en routine. Pour
les cas sans diagnostic, un fragment congelé
devra être conservé jusqu’à l’arrivée prochaine
de nouveaux diagnostics.
T. Maisonobe,
Fédération de neurophysiologie clinique,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
Fernandez C, Maues de Paula A, Figarelle-Branger D et al.
Diagnostic evaluation of clinically normal subjects with chronic
hyperCKemia. Neurology 2006;66:1585-87.
Tout est écrit sur l’IRM
■
Les auteurs se sont intéressés dans cette
étude aux facteurs prédictifs de contrôle
à long terme des crises d’épilepsie chez des
enfants souffrant d’une épilepsie temporale
nouvellement diagnostiquée. Soixante-deux
enfants souffrant d’une épilepsie temporale
ont ainsi été suivis sur une période moyenne
de 13,7 ans. Parmi ces enfants (devenus pour
la plupart adultes au terme du suivi), 19 étaient
libres de crises depuis plus de 5 ans et sans
médicaments, 43 présentaient toujours des
crises et, de ce fait, étaient toujours sous traite-
ment. Les facteurs prédictifs de persistance de
»
crises au long cours étaient : l’existence d’une
lésion sur l’IRM (sclérose hippocampique
chez 10, tumeur chez 8, dysplasie chez 7)
[p < 0,001], la présence d’un ralentissement
localisé sur l’EEG (p = 0,05). En revanche, ni
l’âge de début de l’épilepsie, ni les antécédents
familiaux d’épilepsie, ni la disparition précoce
des crises n’étaient prédictifs du pronostic à
long terme.
Commentaire. Cette étude démontre que
l’existence de lésions sur l’IRM initiale de
jeunes patients épileptiques nouvellement
diagnostiqués est facteur de mauvais pronostic
en termes de contrôle ultérieur des crises d’ori-
gine temporale. Cela est important dans l’infor-
mation apportée aux jeunes patients et à leur
famille, notamment sur la durée du traitement
et d’emblée l’éventuelle orientation vers un
bilan préchirurgical. Un petit bémol, toute-
fois : la cohorte est faible et les lésions identi-
fiées ici sur l’IRM sont soit connues comme
étant pourvoyeuses de pharmacorésistance
(sclérose hippocampique ou dysplasies), soit
à potentiel évolutif (tumeurs). Il serait donc
intéressant de mener une étude similaire à plus
vaste échelle pour déterminer ce qui est de
mauvais pronostic : la présence initiale d’une
lésion potentiellement causale sur l’IRM ou le
type de lésions identifié ?
S. Dupont,
clinique neurologique, hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
Paris.
Spooner CG, Berkovic SF, Mitchell LA et al. New-onset tem-
poral lobe epilepsy in children. Lesion on MRI predicts poor
seizure outcome. Neurology 2006;67(in press).
Les personnes âgées aussi !
■
Les auteurs ont analysé rétrospective-
ment les données d’EEG-vidéo enregis-
trées entre décembre 1999 et décembre 2001
chez des patients de plus de 60 ans. L’objectif
était d’estimer la fréquence des événements
pseudo-épileptiques dans cette tranche de
population. Cinquante-huit patients âgés de
60 à 91 ans ont été admis en EEG-vidéo sur
cette période, soit 17 % du total des admissions
en EEG-vidéo sur 2 ans. Dans 57 % des cas, les
patients étaient admis en monitoring continu
pour faire le diagnostic d’événements compa-
tibles avec des crises d’épilepsie, dans 36 % des
cas, il s’agissait d’apporter des informations sur
le type de crises et leur localisation dans des
cas d’épilepsie a priori avérée. Six patients ont
»
»
présenté des pseudo-crises au cours de l’en-
registrement en EEG-vidéo, chez deux de ces
patients le diagnostic était déjà suspecté avant
même l’hospitalisation. Chez 5 des patients
avec pseudo-crises, les manifestations étaient
motrices, chez un autre, il s’agissait de spasmes
abdominaux.
Par ailleurs, un diagnostic différentiel d’épi-
lepsie a été retenu chez 26 patients en moni-
toring (45 %) : confusion non épileptique,
agitation, accident ishémique transitoire (AIT),
syncopes, etc.
Des crises d’épilepsie ont été diagnostiquées
chez 21 patients (36 %), majoritairement des
crises partielles complexes.
Commentaire. L’épilepsie du sujet âgé est
fréquente. Les symptômes critiques sont
parfois trompeurs, ce qui peut amener à
un sous-diagnostic ou, à l’inverse, à un sur-
diagnostic de crises d’épilepsie. Cet article
a le mérite de rappeler que, en cas de doute
clinique, la démarche diagnostique doit être
similaire chez le sujet jeune et plus âgé et que
le recours à l’EEG-vidéo peut s’avérer indis-
pensable pour redresser un faux diagnostic
d’épilepsie avec des conséquences thérapeu-
tiques importantes. On notera également que
le diagnostic de pseudo-crises ne doit pas être
écarté de principe en fonction de la tranche
d’âge, et que des manifestations pseudo-épilep-
tiques peuvent être observées à tout âge.
Il reste bien-entendu le problème (crucial)
de l’accessibilité au monitoring EEG-vidéo,
réservé dans bien des unités uniquement au
bilan préchirurgical de patients épileptiques
pharmacorésistants. Il existe actuellement un
besoin criant de création d’unités de monito-
ring EEG-vidéo à visée diagnostique, c’est à
cette seule condition que l’épilepsie pourra
vraiment être prise en charge de façon opti-
male.
SD
Abubakr A, Wambacq I. Seizures in the elderly: video/EEG
monitoring analysis. Epilepsy Behav 2005;7(3):447-50.
Échec de la stimulation électrique
thalamique dans le traitement
aigu de la crise d’algie vasculaire
de la face (AVF)
■
Les auteurs ont traité par stimula-
tion électrique brève – au maximum
20 mn –, des attaques d’AVF chez 16 patients
»
»

Revue de presse
Revue de presse
Dirigée par le Pr P. Amarenco
La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 1 - janvier 2007
25
(14 hommes, 2 femmes). Tous étaient
porteurs d’un stimulateur hypothalamique,
implanté quelques jours avant pour une forme
chronique d’AVF réfractaire aux traitements
médicaux (lithium, vérapamil et association),
mais non encore fonctionnel. Dans 28 des
136 attaques étudiées, le traitement fut inter-
rompu pour intolérance. Sur les 108 attaques
restantes, il y eut une amélioration de 50 %
au moins de la douleur initiale dans 25 cas
(23,1 %), et une disparition totale de la
douleur dans 17 cas (16 %) avant 20 mn. Par
rapport à une effi cacité estimée à 30 % pour
le placebo (études portant sur le traitement de
l’AVF par les triptans), les auteurs concluent
donc à l’absence d’effi cacité appréciable du
traitement électrique intermittent en
aigu
sur les attaques d’AVF.
Commentaire. Ainsi, si le traitement par
stimulation électrique
continue
(hypothalamus
postérieur ipsilatéral à la douleur) des
AVF
chroniques
(10 % des patients AVF dans leur
ensemble) apporte un bénéfi ce chez 80 % des
sujets opérés avec un recul de 2 ans, son mode
d’action reste inconnu, même par les études
en PET scan chez des malades implantés. La
stimulation hypothalamique dans l’
AVF chro-
nique
agit donc sans doute indirectement et à
long terme sur les voies trigéminales et sur le
“générateur” des crises. La stimulation “aiguë”,
quant à elle, n’apporte pas de bénéfi ce.
Jacques d’Anglejan-Chatillon, Versailles.
Leone M et al. Acute hypothalamic stimulation and ongoing
cluster headache attacks. Neurology 2006;67:1844-5.
»
»
Est-ce qu’une dystonie peut être
due à une maladie du cervelet ?
■
Les dystonies ont des étiologies très
hétérogènes. Les auteurs ont sélec-
tionné des patients avec une dystonie prédo-
minante dans une grande série de cas avec
atrophie cérébelleuse familiale après exclusion
des causes principales hérédodégénératives et
des principaux gènes connus d’ataxies héré-
ditaires. Ils ont identifi é 12 hommes émanant
de 8 familles avec un phénotype dystonie-plus
caractérisé par une dystonie associée à une
atrophie cérébelleuse en imagerie. L’âge de
début moyen était de 27,3 ± 11,5 ans (range
9-42). La durée moyenne de la maladie était
de 14,7 ± 7,7 ans (range 4-30). La dystonie
était focale ou multifocale en début de maladie
touchant le plus souvent les cordes vocales
(n = 8) et les membres supérieurs (n = 2),
avec une généralisation progressive chez
5 malades. La dysphonie était sévère chez
5 malades, pouvant aller jusqu’à une aphonie
(n = 2). L’ataxie cérébelleuse était relativement
discrète et contrastait avec une atrophie céré-
belleuse marquée. Le mode de transmission
est en faveur d’une transmission autosomale
récessive, mais une transmission liée au chro-
mosome X ne peut être exclue. Les auteurs
suggèrent qu’une dystonie pourrait être liée
à une dysfonction cérébelleuse.
Commentaire. Les malades décrits ont une
atrophie cérébelleuse importante en l’absence de
lésions des ganglions de la base ou du thalamus,
reconnues pour entraîner des dystonies. On
ne peut bien sûr exclure une lésion de ces
»
structures qui échappe à l’imagerie. Cepen-
dant, d’autres observations sont parfaitement
compatibles avec la thèse soulevée :
– une excitation pharmacologique du cervelet
entraîne des postures dystoniques chez la
souris ;
– des études d’imagerie fonctionnelle montrent
une hyperactivité cérébelleuse chez des
patients dystoniques ;
– la chirurgie fonctionnelle dans la partie posté-
rieure du noyau ventrolatéral du thalamus rece-
vant des aff érences cérébelleuses peut améliorer
une dystonie. Comment une dystonie peut-elle
résulter de lésions dans des systèmes moteurs si
distincts ? Soit la physiopathologie sous-jacente
du syndrome clinique de la dystonie est très
diff érente, soit la dystonie résulte d’interactions
défectueuses de diff érentes structures à l’inté-
rieur d’un même réseau moteur. Comment une
pathologie cérébelleuse peut-elle expliquer à la
fois une ataxie et une dystonie ? Alors qu’une
lésion aiguë du cervelet entraîne une hypotonie
et une ataxie, le syndrome cérébelleux reste
modéré chez les patients décrits qui ont tous
développé une atrophie cérébelleuse impor-
tante d’installation très progressive dans un
contexte hérédodégénératif. Des mécanismes
compensatoires pourraient alors être à l’origine
d’interactions défectueuses entre le cervelet,
le thalamus et les ganglions de la base.
P. Krack,
département de neurologie, CHU Grenoble.
Le Ber I et al. Predominant dystonia with marked cerebellar
atrophy: A rare phenotype in familial dystonia. Neurology 2006;
67:1769-73.
»
Agenda▶
Journées internationales de la Société
française de neurologie,
présidées par le Pr Michel Clanet
sur le thème :
la sclérose en plaques
Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2007
à l’Institut Pasteur de Paris
Informations disponibles sur :
http://www.b-c-a.fr/sfninter2007
Secrétariat d’Organisation :
BCA
Organisateur professionnel de congrès
6, boulevard du Général-Leclerc
92115 Clichy Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 41 06 67 70
Fax : +33 (0)1 41 06 67 79
1
/
4
100%