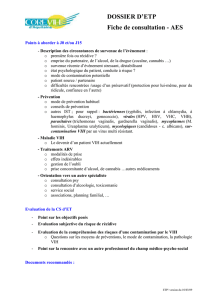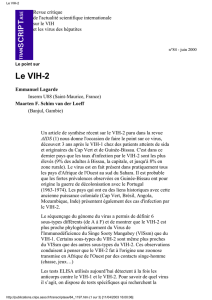Lire l'article complet

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XXI - n° 5 - septembre-octobre 2006
Réunion
Réunion
230
XIIe Congrès des actualités du Pharo*
* 7-9 septembre 2006, Marseille.
Même si les XIIes Actualités du Pharo
étaient en principe dévolues aux ré-
troviroses humaines tropicales, d’autres
sujets tropicaux ont été abordés comme les helminthiases, le
paludisme et le Chikungunya.
HELMINTHIASES : NOUVELLES STRATÉGIES
THÉRAPEUTIQUES
Un symposium a été consacré à la prise en charge des helmin-
thiases.
L
Nouveautés thérapeutiques dans les traitements antihelmin-
thiques (d’après la communication de X. Bohand, Clamart)
L’accent a d’emblée été mis sur le peu de moyens dont bénéfi cie
la recherche de nouveaux traitements contre les helminthiases,
maladies qui concernent pourtant au moins 25 % de la popula-
tion mondiale. Mais un grand progrès a été réalisé avec l’arrivée
de l’ivermectine, du praziquantel et des benzamidazolés. De
nouvelles voies thérapeutiques s’ouvrent en outre avec deux
nouvelles molécules (tribendimidine, nitazoxamide), l’utilisation
d’associations de plusieurs molécules, l’étude de plantes tradi-
tionnelles et l’élaboration de vaccins (ankylostomiase).
L
Alternatives thérapeutiques en cas d’échec d’un premier
traitement dans les helminthiases intestinales (d’après la
communication de P. Rey, Metz)
Parmi les 342 espèces d’helminthes retrouvées chez l’homme,
seules quelques-unes sont pathogènes au niveau intestinal :
ascaris, ankylostomes, oxyures, anguillules, trichocéphales,
schistosomes, tænia, etc. Avant de parler d’échec d’un traitement
antihelminthique (les états d’immunodépression ne sont pas
pris en compte ici), une démarche rigoureuse doit être mise
en œuvre, et il faut répondre à quatre questions :
Le diagnostic parasitaire n’est-il pas erroné ? La confusion
entre un parasite et un élément non pathogène (fi bre alimen-
taire, parasite autre) peut être facile (plusieurs diapositives en
ont témoigné). Par ailleurs, certains parasites, saprophytes et
pathogènes, se ressemblent beaucoup.
La parasitose en cause a-t-elle réellement été identifi ée ? Il
faut se méfi er du polyparasitisme et ne pas hésiter à répéter les
examens (jusqu’à 6 fois !).
Le traitement proposé a-t-il été bien adapté ? L’enquête doit
porter sur la compliance, la prise par rapport aux repas, l’exis-
tence de signes de malabsorption, l’adaptation des doses au
poids du patient.
Une recontamination serait-elle en cause ? En pays d’endémie,
cela peut survenir rapidement.
En tout dernier lieu, on évoquera une résistance parasitaire,
mais rien ne pourra objectiver cette notion.
Les traitements possibles dépendent de l’helminthiase en
cause (mais l’ivermectine et l’albendazole ont un spectre très
large) :
Strongyloïdoses : ivermectine en une seule fois. En cas
d’échec, répéter la dose une fois à J15. En cas d’infection sévère,
traiter à la même dose trois jours de suite (le traitement par
albendazole est plus controversé).
Ankylostomiases : association de mébendazole 500 mg + léva-
mizole 80 mg ou ivermectine 200 μg/kg + albendazole 400 mg
en une prise ; l’effi cacité de l’oxibendazole reste à confi rmer.
Tæniases : pour Taenia saginata et Taenia solium, le prazi-
quantel 10-20 mg/kg en une prise unique (mais hors AMM !)
est effi cace. Sinon, l’albendazole (400 mg/j pendant 3 jours)
ou le niclosamide (2 ou 3 grammes en cure unique) sont des
alternatives effi caces. Seules les graines de courge fraîches (30-
100 grammes) sont possibles en cas de grossesse. Pour Hyme-
nolepsis nana, le praziquantel (25 mg/kg en dose unique) est
effi cace dans 90 % des cas. L’alternative est le nitazoxamide
(3 g/j, en dose unique).
Fascioloses : l’effi cacité du triclabendazole (10 mg/kg par
dose) est augmentée en doublant la dose sur deux jours ; le
nitazoxamide (500 mg/j/7 jours) et le métronidazole (1,5 g/
j/21 jours) off rent une alternative possible.
Schistosomiases : le praziquantel est efficace avec une
seconde cure à J15 ou J21.
MActualités des impasses parasitaires (d’après la communi-
cation de J.F. Magnaval, Toulouse)
Ces pathologies sont émergentes chez les voyageurs. Leur pré-
vention est effi cace et facile : abstention de la consommation
de chairs crues d’invertébrés ou de vertébrés poïkilothermes
(poissons, batraciens, etc.).
Angiostrongyloïdose : seuls Angiostrongylus cantonensis
et Angiostrongylus costaricensis sont en impasse parasitaire,
parmi les 20 espèces d’Angiostrongylus connues. L’homme est
contaminé par A. cantonensis en ingérant des crudités souillées
et mal lavées, ou en consommant des hôtes paraténiques crus
ou peu cuits (crabes, crevettes d’eau douce). Cette parasitose est
endémique aux Antilles, dans les Caraïbes, en Extrême-Orient,
en Océanie et en Amérique centrale. Le tableau caractéristi-
que est celui d’une méningite fébrile hyperéosinophilique. Le
diagnostic sérologique n’est pas performant. Le traitement est
symptomatique (corticoïdes, antihelmintiques controversés).
A. costaricensis est retrouvé des États-Unis à l’Argentine, ainsi
que dans les Caraïbes. La contamination se fait lors d’inges-
tion de crudités souillées et mal lavées, par contacts directs
manuportés avec le mucus des gastéropodes parasités ou par
ingestion accidentelle de ces derniers. Les larves se localisant

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XXI - n° 5 - septembre-octobre 2006
Réunion
Réunion
231
dans la circulation mésentérique humaine se fixent in situ dans
les parois intestinales et provoquent des granulomes à éosino-
philes. Le diagnostic est fait a posteriori sur l’anatomopathologie
postopératoire. La sérologie croise très souvent avec celle des
autres nématodes. L’efficacité des antihelmintiques n’est pas
prouvée. Les cas décrits augmentent.
Anisakiases : ce sont de grands nématodes dont les hôtes
définitifs sont les grands mammifères marins, dont les excré-
ments contaminent des crustacés. Puis la contamination des
poissons pélagiques survient, jusqu’à 50 à 100 % d’entre eux !
Or ces larves se logeront dans la chair du poisson si la découpe
après la pêche n’est pas correctement faite ; elles résistent par
ailleurs à la fumaison, aux vinaigres faibles ou à la conservation
pendant une semaine à - 20 °C. Les manifestations sont d’or-
dre digestif par fixation des larves dans les parois intestinales
(pseudo-ulcère, granulomes et occlusion) ou d’ordre allergique
(présence de paramyosine, allergène thermostable et cryostable)
du simple urticaire au choc, ou sous forme de pseudo-allergie
au poisson. Le diagnostic se fera sur des pièces anatomopatho-
logiques, sur l’identification du parasite et/ou sur des recherches
d’IgE spécifiques. L’albendazole ou l’ivermectine seront prescrits
quelle que soit la manifestation incriminée, éventuellement en
association à de la chirurgie, aux antiallergiques et à l’éviction
définitive des poissons de mer frais consommés crus. Cette
pathologie émergente a justifié l’implantation d’un centre de
recherche (IFREMER) à Boulogne-sur-Mer.
Ancylostoma caninum : il est endémique dans le Nord-Est
de l’Australie, mais a été retrouvé en Louisiane, en Espagne ou
en Égypte. Le passage est transcutané de façon active (pas de
dermatite rampante) et provoque souvent une gastroentérite
à hyperéosinophiles ; le diagnostic est sérologique (quand on
dispose d’un test), endoscopique et anatomopathologique. Le
traitement consiste en l’ablation des vers par voie endoscopique
ou chirurgicale intestinale, associé à la prise d’albendazole ou
de mébendazole.
Gnathostomose : l’aire géographique concernée comprend
quelques pays d’Amérique latine et la zone Indo-Pacifique, Asie
du Sud-Est principalement. L’homme est contaminé en ingérant
les hôtes intermédiaires (poissons, reptiles, oiseaux, crustacés)
non ou insuffisamment cuits. La symptomatologie de la phase
invasive est inconstante et se traduit par des signes généraux
(fièvre, manifestations digestives, allergie) survenant dans les 24
à 48 heures après la contamination. Plus tard, apparaissent dans
la majorité des cas des signes cutanés (cordon cutané induré
serpigineux = dermatite rampante, et/ou un œdème sous-cutané
migrateur = panniculite à éosinophiles, œdème segmentaire de
membres). Tous les organes peuvent être atteints, mais ce sont
les localisations neurologiques qui sont le plus à craindre. Le
diagnostic se fera sur l’anamnèse, l’anatomopathologie (la séro-
logie performante n’est possible, en Europe, qu’à Bâle (Suisse) ;
le centre de référence est le département d’helminthologie de
la faculté de médecine de l’université de Mahidol à Bangkok
(aïlande). Le traitement est l’albendazole à 400-800 mg/j
pendant 21 jours ou l’ivermectine à 200 μg/kg en dose unique
ou répétée un à deux jours plus tard.
Sparganose : elle est due à un cestode (Sparganum) dont le
plus fréquent est Spirometra erinacei-europaei, qui est retrouvé
dans toute l’Eurasie septentrionale et en Asie du Sud-Est.
L’homme est infecté en ingérant la chair crue ou peu cuite des
seconds hôtes intermédiaires (batraciens, poissons d’eau douce,
reptiles). La symptomatologie cutanée s’exprime par des tumé-
factions ou des nodules fixes. Une atteinte des organes profonds
et du névraxe est possible. Le traitement chirurgical permet la
cure et le diagnostic. Le praziquantel est utilisé pour les formes
profondes, sans preuve d’efficacité néanmoins.
L
La lutte contre les filarioses : porte d’entrée pour le contrôle
des autres helminthiases ? [d’après la communication de
M. Boussinesq, Paris]
Les trois programmes de lutte antiparasitaire (deux antifila-
rioses) en cours actuellement dans le monde ont été présen-
tés : contre l’onchocercose, touchant 50 millions de personnes
(programme APOC), contre la filariose lymphatique (visant
40 millions de personnes) et contre les schistosomes et autres
nématodes intestinaux (13 millions de personnes concernées).
Des efforts sont déployés pour associer ces différents program-
mes, soit entre eux, soit à d’autres programmes : distribution de
vitamine A, de moustiquaires, de traitements antituberculeux,
campagnes de vaccination. Néanmoins, de telles associations
ont des limites :
– les différentes pathologies ne se superposent pas de manière
stricte (signes cliniques, lieux géographiques, âges des popu-
lations concernées…) ;
– l’innocuité de la coadministration de l’ivermectine, de l’al-
bendazole et du praziquantel doit être vérifiée ;
– on risque de surcharger le personnel de ces programmes, les
gouvernements, de provoquer des conflits d’intérêts, etc.
RÉTROVIROSES HUMAINES TROPICALES :
VIH, SIDA ET HTLV1
L
L’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites
virales (ANRS) [d’après la communication de J.F. Delfraissy,
Paris]
L’action de l’ANRS s’inscrit dans le panorama de l’infection par
le VIH dans le monde. Fin 2005, 40,3 millions de personnes
étaient séropositives pour le VIH et/ou au stade de sida dans
le monde. L’épidémie pédiatrique se poursuit.
En France, 88 % des patients sont traités, dont 76 % sont en
succès virologique, et la situation est plutôt favorable : limites
connues des traitements antirétroviraux (toxicité, nécessité d’une
compliance parfaite, inefficacité sur l’ADN proviral), perspectives
thérapeutiques (nouveaux inhibiteurs de protéase, d’entrée,
d’intégrase, de maturation du VIH) et perspectives de recherche
(cohorte asymptomatique à long terme ou ALT, qui concerne
1-2 % de la file active des patients séropositifs VIH en France ;
rôle de l’interleukine 2 à préciser).
Il en va tout autrement de la situation dans les pays en déve-
loppement. L’ANRS consacre 20 à 25 % de son budget pour des

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XXI - n° 5 - septembre-octobre 2006
Réunion
Réunion
232
!"#$
%
!&
'
"( ) $!*+ !
*+! %
( &
"#&$
,&
*&,"
-.$
".
$ *
&/&01
)! *
)2
+ %
*1 /1
/1 1 1 3"2
&+$1
/1 /"21
$1 1 "
&&0$1 3"1
&1 &$"2
$"!&,$"
$ *
&/&,"
.
40$
!
!
%
%) "
# #
!# # # $
! # !# %&''!
# (' #)'!*!!#
# +",# -#
.# ,/0 56
7 5567#7&0 8&
7 8787878&78
!7878079//7&0
7-378() &&0
.:-8778&
7 57-!7&0&&
7 8 .0-;#<8=
.0#.
40
>0? 40
>0? @&
81 86- ' A84
(
4 ' *BC*(C*( D"#4@$(
-#<C B=< #! ' <B1 -6A ' <1(
% #&, E
8! E0
FF) G E&
E%1 =9HE1 IH:-1 &8%J
<8;E E&(1 9#B((
5 F-!6 =C=
@0( !
K #,1 @8%
%&,
-5% 4<=>
%0? C+BJL1 /,,
@ A0
recherches en partenariat avec les pays du Sud : efficacité prouvée
de l’association de génériques Triomune
®
(C. Laurent, Lancet
2004), essai TRIVACAN d’interruption thérapeutique des antiré-
troviraux (ARV) même si cette modalité de prise en charge est un
échec (C. Danel et al. Lancet 2006;17,367(9527):1981-9), recher-
che du moment optimal du début des ARV chez des patients
en cours de traitement antituberculeux (essai CAMELIA) au
Cambodge, diminution prouvée de la transmission du VIH après
circoncision, efficacité prouvée des mesures pour diminuer la
transmission materno-fœtale (DITRAME PLUS, F. Dabis, 2006).
Malgré cela, moins de 10 % des femmes enceintes séropositives
bénéficient d’une prise en charge adéquate en Afrique.
LDiversité du VIH : origine, évolution et conséquences
(d’après la communication de F. Barin, Tours)
Du fait des pressions de sélection, le virus VIH présente une très
forte diversité interpatient, mais aussi intrapatient, provoquée
par les capacités importantes de mutations, de réplication chez
les patients non traités et du fait de la chronicité de l’infection.
En outre, les possibilités de recombinaisons entre différents
virus s’ajoutent. Le VIH-1 comprend trois groupes (O, d’abord
au Cameroun et dans les pays voisins, N et M). Le groupe M,
ayant provoqué la pandémie de sida, se divise en 9 sous-types
de A à K. Le sous-type E correspond en fait à des virus “mosaï-
ques” formes circulantes recombinantes (CRF), dont le nombre
dépasse la trentaine. Le VIH-2 présente des sous-types allant de
A à H. L’analyse rétrospective de l’évolution du VIH, menée par
B. Krober (publiée en 2006), conclut à des mutations probables
du SIV dans les années 1930 pour devenir le VIH. Le virus
SIV-cpz (virus infectant les chimpanzés) provient lui-même
de recombinants de deux SIV, infectant les cercopithèques,
proies des chimpanzés. La question demeure de savoir comment
s’est réalisé le passage des différents virus entre le cercopithè-
que, le chimpanzé et l’homme. Les mouvements de population
humaine expliquent la répartition géographique mondiale des
sous-types M du VIH1 : le sous-type C prédomine en Asie,
l’Afrique centrale présente une très grande diversité virale, les
sous-types A, D et C sont majoritaires en Afrique de l’Est. Par
ailleurs, des CRF 02AG (trouvés essentiellement en Afrique
de l’Ouest) ont des capacités réplicatives meilleures que les
sous-types A ou G. Le VIH-2 et le VIH-1-O sont naturellement
résistants aux analogues non nucléosidiques de la transcriptase
inverse. La quantification virale peut par ailleurs être prise en
défaut selon le sous-type concerné.
LLa détection précoce de l’ADN proviral au cours de ciné-
tiques in vitro montre une différence majeure entre VIH-1
et VIH-2 (d’après la communication de F. Simon, Paris)
Les charges virales plasmatiques du VIH-2 sont beaucoup plus
faibles que celles du VIH-1, à stade clinique équivalent. On a
comparé in vitro et in vivo l’ADN proviral et les formes 2LTR
circulaires non intégrées du VIH-1 et du VIH-2. L’étude a eu
lieu à partir de cultures de cellules infectées par du VIH-1 ou du
VIH-2, puis à partir de prélèvements effectués chez 45 patients
naïfs d’ARV séropositifs VIH-1 ou VIH-2. Le pic d’ADN proviral
>>>

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XXI - n° 5 - septembre-octobre 2006
Réunion
Réunion
234
observé après infection des cellules est plus précoce avec le
VIH-1 (6 heures de culture) qu’avec le VIH-2 (72 heures) et,
à 96 heures, la quantité d’ADN proviral est identique chez les
deux virus. Les formes 2LTR sont toutefois plus abondantes
pour VIH-2 que pour VIH-1.
Par ailleurs, l’étude in vivo montre une différence significative
du taux d’ADN proviral VIH-1 par rapport au taux VIH-2 chez
les patients ayant plus de 300 CD4/mm3. L’effectif est insuffisant
pour être concluant chez les patients ayant moins de 300 CD4.
La transcriptase inverse serait-elle moins efficace chez le VIH-2 ? Il
est probable que le VIH-2 s’intègre moins bien dans le génome
cellulaire que le VIH-1, ce qui expliquerait le taux plus important
de formes non intégrées.
LProblèmes nutritionnels et solutions proposées (d’après la
communication de J.C. Melchior, Garches)
La dénutrition protéique provoque une immunodépression. Or
la dépense énergétique de repos des personnes séropositives est
augmentée de 10 % par rapport à la population générale. Qua-
tre-vingt-dix pour cent des patients déclarant une infection au
stade sida en Afrique ont un wasting syndrome (diarrhée et/ou
asthénie et/ou fièvre, sans autre cause inflammatoire et associée à
une perte de poids de plus de 10 %). Cela concerne 15 à 33 % des
personnes sous traitement antirétroviral en 2001 aux États-Unis.
Paton, en Tanzanie (Medicine, 2006), a démontré que les patients
dénutris au moment de la mise sous ARV ont une espérance de
vie moins élevée que ceux ayant un index de masse corporelle
normal. Les possibilités thérapeutiques sont représentées par la
renutrition parentérale pour permettre la récupération de masse
maigre. Sinon un apport nutritionnel équilibré (dénommé RUFT)
de longue conservation, à haute valeur biologique protéique, de
faible coût et bien toléré, a permis la prise de poids et la diminu-
tion de la mortalité dans le groupe d’enfants (séropositifs VIH ou
non) qui en ont bénéficié (Manary MJ et al. J Health Popul Nutr
2005;23[4]:351-7). Peu d’études sont publiées dans ce domaine
chez les adultes séropositifs VIH dans les pays en développement
(résultats prometteurs en attente au Burundi).
L
Le sida en Afrique et l’organisation de la lutte (d’après la
communication de C.A. Diop, Dakar, Sénégal)
L’Afrique comprend 10 % de la population mondiale, mais 72 %
des personnes séropositives VIH et 80 % des femmes séroposi-
tives VIH. L’historique précis de la mise en place des différents
programmes a été relaté : création des Comités nationaux de
lutte contre le sida en Afrique (CNLS) en 1985, ONUSIDA en
1992 et initiatives nationales d’accès aux ARV en 1998. Mais
les investigations doivent se poursuivre afin d’évaluer l’impact
des mesures prises et d’augmenter leur efficacité. Le dépistage
de l’infection par le VIH nécessite d’être amélioré. Deux types
d’enquête sont en cours dans les pays du Sud : les unes, dites
démographiques, sont faites à partir de gouttes de sang sur papier
buvard, avec un taux d’acceptation de 80 % (qui pourrait être
amélioré) ; les autres, dites sentinelles (maternité, donneurs de
sang, consultations pour MST), donnent des taux de prévalence
supérieurs (tableau).
Tableau.
Chires de prévalence de l’infection par le VIH selon le type
d’enquêtes en Afrique en 2001.
Enquête Sentinelles Démographiques
Sénégal donnée manquante 0,7
Kenya 97
Burkina Faso 4,8 1,8
Mali 3 1,7
L
Leucémie-lymphome à cellules T de l’adulte due au HTLV-1
(ou ATL), à propos de 8 observations (d’après la communica-
tion de G. Nieng, Dakar, Sénégal)
Le virus HTLV-1 est endémique au Japon, en Afrique, en Asie,
aux Caraïbes et en Amérique. La transmission se fait par l’allai-
tement, le contact sanguin et les relations sexuelles. La sympto-
matologie est une leucémie à lymphocytes T aiguë, chronique
ou lymphomateuse, une paraparésie spastique tropicale ou
une dermatite infectieuse (5 cas ont été décrits récemment au
Sénégal par A. Mahé). L’ATL est rarement décrite en Afrique,
malgré un fort taux de prévalence du HTLV-1, tandis que
2,5 %/an de leucémie sont décrites parmi les patients porteurs
de HTLV-1 au Japon. Huit patients de Dakar atteints d’ATL sont
décrits. La mortalité à un an est de 62 %, sans chimiothérapie
efficace (dont seul un malade a pu bénéficier). La prévention
de la transmission du HTLV-1 est nécessaire et passe avant
tout par le dépistage des femmes enceintes et l’interdiction,
dans la mesure du possible, de l’allaitement maternel pour
les séropositives.
PALUDISME
M
Paludisme à Plasmodium falciparum dans une zone de
transmission élevée en République de Côte d’Ivoire (d’après
la communication de C. Rapp, Saint-Mandé)
Une étude prospective a concerné initialement des enfants de
moins de 15 ans, consultant pour fièvre. Six cent dix enfants
ont été vus ; 40 % d’entre eux (soit 246) avaient un paludisme
(frottis, et/ou goutte épaisse et/ou test de diagnostic rapide
[TDR] immunochromatographique positif à P. falciparum) et
ont donc été inclus dans l’étude. Soixante-dix-huit pour cent de
ces 246 enfants avaient moins de 5 ans (âge moyen de 37 mois).
Six pour cent d’entre eux avaient une forme grave de paludisme
selon les critères de l’OMS. Les signes cliniques étaient dans
50 à 80 % des cas de la fièvre, des céphalées et/ou des frissons.
On notera une toux présente chez 35 % des enfants avec palu-
disme simple (n = 231). Un traitement en ambulatoire a pu
être conduit pour les 231 enfants ; 14 cas graves ont été traités
par quinine i.v. Un décès est survenu chez un bébé de 6 mois
à J2. Soixante-six pour cent des enfants ont été revus à J28 et
le taux d’échec thérapeutique tardif (dont le décès) est de 4 %.
Le TDR a son importance dans une zone d’endémie intense
pour aider au diagnostic.
>>>

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XXI - n° 5 - septembre-octobre 2006
Réunion
Réunion
235
M
Diversité, multiplicité des infections et résistances aux anti-
paludiques de P. falciparum dans un essai contrôlé de mous-
tiquaires imprégnées d’insecticides en zone de forte endémie
(d’après la communication de H. Bogreau, Marseille)
À Damane, en Côte d’Ivoire, on a constaté un taux d’environ
300 piqûres infestantes/personne/an. Trois groupes de trois villages
chacun ont été constitués : le premier sans intervention, le second
avec distribution de moustiquaire imprégnée à longue durée et le
troisième avec moustiquaire non imprégnée. Plus de 400 isolats de
P. falciparum prélevés de façon aléatoire ont été effectués chez les
enfants des 9 villages à un an d’intervalle, avant et après intervention.
Aucune différence entre les trois groupes concernant la diversité,
la multiplicité des infections et les marqueurs de résistance n’a été
retrouvée avant intervention. On constate une baisse significative du
nombre de piqûres allant de 80 % avec l’utilisation des moustiquaires
simples à 97 % avec les moustiquaires imprégnées. L’incidence du
paludisme a diminué de 50 % avec les premières et de 21 % avec les
secondes. L’analyse génétique des différents loci des P. falciparum
(marqueurs de résistance aux différents antipaludiques et autres
loci microsatellites) a permis de constater l’absence de changement
significatif avant et après l’intervention antivectorielle.
M
Épidémie de paludisme dans un groupe de touristes au
Burkina Faso (d’après la communication affichée de S. Sicard,
Marseille)
Une analyse rétrospective des mesures de prévention antipaludique
chez 26 touristes français concernés (LAV, chimioprophylaxie) a
permis de mettre en évidence le fait que le principal facteur de ris-
que de paludisme (ayant concerné 9 des 26 personnes) était l’absence
de chimioprophylaxie antipaludique adaptée et bien conduite.
MY a-t-il encore du paludisme à Djibouti ? (d’après la com-
munication affichée de S. Gidenne, Djibouti)
Une étude rétrospective, menée de 1998 à avril 2006, confir-
merait la tendance de la disparition du paludisme endémique
en République de Djibouti.
CHIKUNGUNYA
Actualité oblige, l’épidémie de Chikungunya (CHIK) a été à
l’honneur avec une session entière qui a permis de faire le point
sur la situation. Au cours de la discussion, la symptomatolo-
gie douloureuse articulaire persistante, après l’infection par le
virus, a été considérée comme corticodépendante et sensible à la
moindre baisse de dose, mais à un faible niveau. On ne retrouve
pas de réaction croisée entre la sérologie de la dengue et celle
de la CHIK, et leurs symptomatologies ne sont pas aggravées
lors de coïnfection par les deux virus.
MPrévalence et clinique du Chikungunya materno-néo-
natal dans le Sud de la Réunion (d’après la communication
de P. Gérardin, la Réunion)
Toutes les naissances survenues après 22 semaines d’aménorrhée
entre juin 2005 et mars 2006 au groupe hospitalier Sud-Réunion
(GHSR) ont été analysées. Un antécédent de CHIK pendant la
grossesse ou lors de l’accouchement a été confirmé dans 97 % des
cas par RT-PCR ou par sérologie. La prévalence retrouvée chez les
femmes enceintes a donc été de 7 % (251/3441), ce qui est proche
de celle retrouvée dans la population générale. L’analyse des cas
des 19 enfants contaminés permet de comprendre que la trans-
mission virale survient au terme de la grossesse, lorsque la mère
développe une fièvre moins de 7 jours de l’accouchement, ce qui
représente un taux de transmission materno-fœtal (TMF) vertical
de 36 %. En revanche, si l’infection maternelle par le Chikungunya
se manifeste plus de 7 jours avant l’accouchement, il n’y a pas de
TMF. Onze enfants ont développé une forme grave (encéphalite,
sepsis sévère, CIVD), et les signes cliniques apparaissent 3 à 7 jours
en postnatal. Le mode de transmission serait pré-partum, plutôt
que per-partum, plutôt par voie transplacentaire que par voie
basse (Langlet, 2006, sous presse). Aucun enfant n’est décédé,
mais deux auront des séquelles neurologiques à moyen terme et
deux autres en auront probablement. Le tropisme neurologique
du CHIK avec des formes potentiellement sévères fait craindre
des séquelles sur le long terme pour les enfants infectés lors d’une
TMF et nécessite donc une surveillance supplémentaire de ceux
pour lesquels une régression des signes cliniques et d’imagerie
(IRM) a été avérée en postnatal.
MInfection par le virus Chikungunya et cryoglobulinémie
(d’après la communication de M. Oliver, Marseille)
Devant l’existence d’un acrosyndrome et la persistance d’arthro-
pathies, sans présence virale après une infection cliniquement
symptomatique, la recherche de cryoglobulines a été effectuée
grâce à une technique sensible. Cinquante-six patients ayant eu
une symptomatologie évocatrice de CHIK, au retour d’une zone
d’endémie, ont été prélevés et sont suivis. Dix-sept d’entre eux ont pu
être suivis jusqu’à M3 et M6. Pour éviter les erreurs d’interprétation,
les patients ont été prélevés au laboratoire afin que les tubes restent
à 37 °C jusqu’à décantation. Des IgM anti-Chikungunya ont été
retrouvés chez 40 des 56 patients initiaux (âge entre 21 et 78 ans).
Chez 92,5 % de ces derniers, la recherche de cryoglobulines a été
positive, alors que chez les 16 patients sans IgM anti-Chikungunya,
seuls 43,7 % en avaient (âge entre 21 et 75 ans) : la différence est
significative entre les deux groupes. En revanche, aucune différence
significative n’est retrouvée concernant :
– la prévalence de cryoglobuline selon le sexe ;
– la présence de cryoglobuline selon l’âge ;
– la présence de cryoglobuline de type IIA selon le groupe IgM
anti-Chikungunya positif ou négatif ;
– la concentration moyenne de cryoglobuline selon le groupe
IgM positif ou non.
On retrouve un lien significatif entre les ténosynovites lors de
l’infection et la présence de cryoglobuline (p = 0,015), mais
seules 4 personnes ont développé un acrosyndrome, ce qui
ne peut permettre une analyse statistique. On ne retrouve pas
de lien entre efficacité de la corticothérapie et présence de la
cryoglobulinémie.
Les recherches sont à poursuivre quant au rôle que pourrait
jouer la cryoglobuline dans la symptomatologie de l’infection,
 6
6
1
/
6
100%