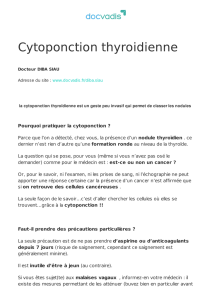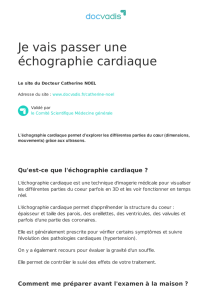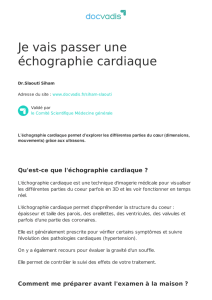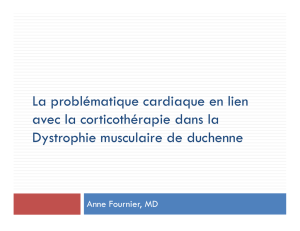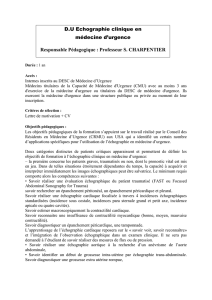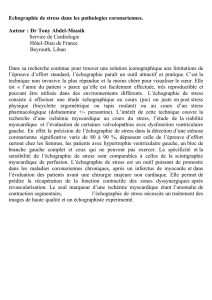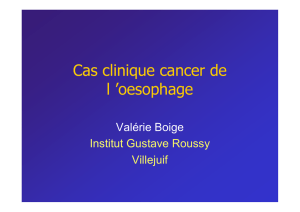Échographie

!
!
Échographie
(Pelvis féminin et pathologie
cardiovasculaire exclus)
J. Tramalloni*, K. Hamida*, P. Safa**
L’échographie interventionnelle peut se définir
comme une méthode de diagnostic (ponctions-
biopsies) ou de traitement (ponctions évacua-
trices, injections thérapeutiques, alcoolisation,
traitement par radiofréquences, pose de dispo-
sitifs intravasculaires) percutané utilisant un
guidage par échographie.
Ses avantages, par rapport aux autres
méthodes de guidage par imagerie, sont sa dis-
ponibilité (utilisation possible au lit du malade)
et son innocuité propre (pas d’exposition aux
radiations ionisantes).
Ses limites sont celles de la transmission des
ultrasons : air et os.
L’échographie interventionnelle fait partie de
l’imagerie interventionnelle avec la radioscopie
télévisée et la tomodensitométrie. Le choix du
mode de guidage (échographique ou radiolo-
gique) dépend de l’organe étudié, du type du
geste interventionnel et du savoir-faire de
chaque opérateur.
G
ÉNÉRALITES
Méthodes de guidage échographique
"
"Avec asservissement de l’aiguille à la sonde :
guide (figure 1).
Un dispositif solidarise l’aiguille à la sonde afin
que celle-ci l’achemine dans le faisceau ultraso-
nore : un collier est fixé sur la sonde et muni
d’un talon incliné percé d’un chenal calibré au
diamètre extérieur de l’aiguille. Le trajet de l’ai-
guille peut donc être matérialisé sur l’écran de
l’échographe. Il suffit de placer la cible sur ce
repère pour l’atteindre. Le biseau de l’aiguille
apparaît sur l’écran comme un écho puncti-
forme dense (tip-echo). Ce système est propre à
chaque sonde ; il peut équiper des sondes
courbes ou linéaires. Ces dispositifs sont soit à
usage unique, soit stérilisables. La sonde peut
être stérilisée (sondes “opératoires”) ou intro-
duite dans une enveloppe stérile à usage
unique. Ce système est bien adapté aux
organes profonds ou aux structures d’accès dif-
ficile. Le trajet étant repéré à l’avance sur
l’écran, le geste est plus sûr. Il présente l’incon-
vénient d’être plus long à mettre en œuvre et de
ne pas permettre de se déplacer de façon
radiaire dans la cible.
"
"Sans asservissement à la sonde : à main libre.
C’est l’opérateur qui guide l’aiguille dans le
faisceau ultrasonore, en estimant au jugé l’in-
clinaison à donner à l’aiguille. Le cheminement
du biseau est suivi en temps réel sur l’écran. La
non-visibilité du tip-echo signifie que l’aiguille
n’est plus dans le faisceau. Un minime mouve-
ment de la sonde permet alors de retrouver le
biseau et de reprendre le cheminement jusqu’à
la cible. Cette technique est bien adaptée aux
organes superficiels (sein, thyroïde…)
(figure 2). Elle est rapide à mettre en œuvre.
Elle permet, en un seul passage, d’aborder la
cible selon plusieurs angles (prélèvements
radiaires). Elle est plus difficile, car elle néces-
site l’acquisition d’un geste précis. Il faut l’utili-
ser souvent pour le conserver.
Contre-indications générales
"
"Troubles de la coagulation.
"
"Patient non coopérant. Le consentement
éclairé du patient doit obligatoirement être
obtenu avant l’examen. Toutes les explications
sur le déroulement de l’examen et son intérêt
doivent être fournies au patient. Une anesthé-
sie locale est réalisée chaque fois qu’elle est
nécessaire. Elle est inutile pour les prélève-
ments à l’aiguille fine.
Complications
"
"Hématomes : toujours possibles, même avec
une coagulation normale. Il faut tenter de les
éviter par une compression efficace du site de
ponction : compression manuelle au décours
du geste, puis pansement compressif. Certains
organes sont plus sensibles que d’autres à ces
hématomes (thyroïde).
"
"Infection : très rare si on respecte les règles
d’asepsie indispensables pour tout geste
sanglant.
43
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
* Service de radiologie adultes,
hôpital Necker, Paris.
** Service de radiologie,
hôpital Avicenne, Bobigny.
Figure 2.
Figure 1.

O
RGANES SUPERFICIELS
Cou
"
"Thyroïde : il s’agit surtout de prélèvements dia-
gnostiques des nodules. Le guidage échogra-
phique est indiqué pour les nodules non pal-
pables ou pour les nodules mixtes (on peut ainsi
ponctionner spécifiquement dans les zones
solides, ce qui améliore l’efficacité du diagnos-
tic). Pour la vidange des kystes ou des hémato-
cèles, le guidage permet également de vérifier la
qualité de l’évacuation du liquide. Certains
auteurs ont proposé l’alcoolisation des kystes et
des nodules chauds comme une alternative à la
chirurgie ou à l’IRAthérapie. Pour les kystes, on
retire d’abord tout le liquide que l’on remplace
par de l’alcool absolu qui est laissé en place
quelques minutes puis retiré (il faut donc ponc-
tionner trois fois). L’injection d’alcool est doulou-
reuse. Le traitement des nodules chauds par
alcoolisation se fait en milieu hospitalier et
nécessite une hospitalisation d’au moins
24 heures car une hyperthyroïdie transitoire est
souvent notée, pouvant nécessiter un traitement.
"
"Adénopathies cervicales : l’échographie est
la technique de détection la plus sensible pour
visualiser les ganglions normaux ou patholo-
giques. Si l’échographie peut apporter d’impor-
tants arguments de suspicion devant l’aspect
arrondi et non structuré d’un ganglion, elle ne
peut à elle seule affirmer qu’il s’agit d’une adé-
nopathie et quelle en est l’origine. Elle permet
alors de réaliser un prélèvement échoguidé, ce
qui permettra souvent de déterminer la nature
du ganglion suspect.
"
"Glandes salivaires : l’échoguidage est parfois
proposé après échec de la ponction-biopsie
sous palpation d’une tumeur palpable. Elle est
réalisée d’emblée sous échographie pour les
nodules parotidiens non palpables.
"
"Nodules cervicaux d’autres origines : après
avoir vérifié en écho-doppler le caractère non
vasculaire d’un nodule cervical, si celui-ci n’est
pas palpable, son diagnostic étiologique peut
être obtenu par prélèvement cytologique écho-
guidé. C’est le cas des lipomes atypiques à
l’échographie ou de tumeurs plus rares :
schwannomes, tumeurs conjonctives…
Sein
Comme pour les nodules thyroïdiens, les
nodules mammaires palpables peuvent facile-
ment être ponctionnés sans le secours de
l’échographie. L’échoguidage est indiqué pour
les nodules solides non palpables et visibles à
l’échographie. Les foyers de microcalcifications
ne sont généralement pas visibles échographi-
quement. Leur ponction ou leur repérage par
harpon est réalisé par mammographie stéréo-
taxique.
Quand un nodule mammaire est très suspect
cliniquement et en imagerie, il est souvent
opéré sans ponction préalable. Les kystes ne
sont ponctionnés que s’ils sont sous tension
(kystes douloureux), ce qui entraîne un soula-
gement immédiat de la douleur, ou si leur
aspect échographique n’est pas typique (ponc-
tion diagnostique). L’échoguidage est alors pré-
férable car il permet, d’une part, de prélever sur
d’éventuelles zones solides intrakystiques et,
d’autre part, de vérifier la qualité de la vidange
du kyste. Les adénopathies axillaires ou mam-
maires internes non palpables sont aisément
ponctionnées sous échographie, comme les
adénopathies cervicales.
Collections des parties molles
L’échoguidage permet des prélèvements cyto-
bactériologiques et la pose de drains.
P
ATHOLOGIE OSTÉO
-
ARTICULAIRE
Les deux gestes pratiqués en échographie inter-
ventionnelle ostéo-articulaire sont la ponction-
aspiration et la ponction-biopsie. Le guidage
échographique en temps réel permet un geste
rapide et des trajets obliques. Ce geste opé-
rateur-dépendant nécessite une grande
expérience.
Les contre-indications à ces gestes sont en rap-
port avec les difficultés, d’abord, des sites de
ponction et, dans certains cas, avec les troubles
de la coagulation. Ces gestes sont effectués
sous asepsie chirurgicale afin d’éviter un ense-
mencement bactérien du site de ponction ou
les souillures des prélèvements. La sonde
d’échographie est stérilisée dans une solution
antiseptique. Le reste du matériel utilisé est à
usage unique. Le couplage entre la sonde et la
peau se fait avec un gel d’échographie ou de
l’eau stérile.
Après repérage échographique du site de ponc-
tion, une anesthésie locale (xylocaïne 0,5 %)
est effectuée.
44
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
dossier

Ponction-aspiration
La ponction-aspiration est effectuée pour ana-
lyse cytobactériologique avec des aiguilles
dont le diamètre est adapté à la viscosité du
liquide à aspirer.
Épanchement articulaire
Le liquide articulaire se traduit à l’échographie
par une collection anéchogène intra-articulaire.
L’augmentation de son échogénicité associée à
un épaississement synovial suggère une
inflammation ou une infection. Tout épanche-
ment articulaire peut être prélevé pour analyse
cytobactériologique du liquide. Ce geste, de
réalisation aisée, est essentiel au diagnostic.
Bourses séreuses
Les affections des bourses séreuses sont fré-
quentes. Elles peuvent être intéressées par un
processus pathologique localisé (traumatique,
tumoral, infectieux) ou général (rhumatisme
inflammatoire ou métabolique). Le diagnostic
de bursite est le plus souvent clinique lorsqu’il
s’agit d’une bourse connue pour être fréquem-
ment atteinte (bursite pré-achilléenne, pré-
rotulienne, hygroma du coude, kyste poplité).
L’échographie est une aide au diagnostic et au
traitement des bursites : elle montre une col-
lection liquidienne et/ou une calcification avec
cône d’ombre postérieur. Le diagnostic écho-
graphique est plus difficile en cas de calcifica-
tion (bursite calcifiante) : c’est la localisation de
la calcification qui fait évoquer le diagnostic.
Le traitement de première intention est la ponc-
tion-aspiration de la collection liquidienne sous
contrôle échographique, avec infiltration d’un
corticoïde retard en fin de geste.
Hématome
Les hématomes se rencontrent en pathologie
traumatique musculaire ou aponévrotique
secondaire à la désinsertion, la déchirure ou la
rupture d’un faisceau ou de la totalité du
muscle. L’hématome peut aussi être isolé,
secondaire à un traumatisme minime, chez les
patients présentant des troubles de la coagula-
tion (traitement anticoagulant, hémophilie,
insuffisance hépatique).
En cas de collection importante, la ponction
guidée par l’échographie permet d’évacuer
l’hématome, de diminuer la symptomatologie
et d’accélérer la guérison.
Calcifications tendineuses
Une ponction-trituration et une aspiration-
lavage des calcifications des tendons de la
coiffe des rotateurs s’effectuent le plus souvent
sous contrôle radioscopique, du fait de la faci-
lité du geste et de la visualisation directe de la
calcification. Cependant, certaines équipes réa-
lisent ce geste sous échographie.
Ponction-biopsie
Une ponction-biopsie d’une masse des parties
molles est effectuée sous échographie, avec
des aiguilles à guillotine (true-cut) ou à aspira-
tion (sure-cut). Les prélèvements réalisés sont
analysés à la recherche de cellules anormales
(tumeurs) ou de germes (abcès, cavités infec-
tées).
L’épaississement synovial d’une synovite peut
également être biopsié sous échographie.
L’étude du prélèvement permettant le diagnos-
tic de l’arthrite.
Conclusion
En pathologie ostéo-articulaire, l’échographie
n’est pas seulement un outil diagnostique mais
également thérapeutique. Cette échographie
interventionnelle nécessite un opérateur
entraîné et expérimenté.
T
HORAX
Pathologie médiastinale
Les biopsies des masses médiastinales kys-
tiques ou solides sont le plus souvent réalisées
par guidage tomodensitométrique (TDM),
mieux adapté à cette localisation.
Pathologie pulmonaire
Seuls les nodules pulmonaires sous-pleuraux
sont visibles à l’échographie et peuvent donc
bénéficier d’un guidage échographique.
Pathologie pleurale et pariétale
Le guidage des ponctions percutanées est sur-
tout échoguidé. C’est également sous échogra-
phie que se réalise l’évacuation ou le drainage
des collections pleurales. En effet, seule l’écho-
graphie permet de ponctionner en position
assise (intérêt dans les épanchements libres).
Toutefois, dans les cas complexes, la TDM per-
met une meilleure analyse anatomique et une
meilleure détermination du siège exact de la
45
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000

lésion. D’une façon générale, l’échographie est
préférée en cas de collection volumineuse.
A
BDOMEN
Biopsies hépatiques
La biopsie hépatique vient en complément des
examens morphologiques, de l’échographie et
de la tomodensitométrie qui ont une bonne
sensibilité dans la détection des lésions mais
restent insuffisants pour les caractériser. La
biopsie hépatique permet souvent d’éviter une
laparotomie exploratrice. Par ailleurs, elle peut
préciser l’état d’évolution de la fibrose lors
d’une hépatite virale chronique.
Réalisation de la ponction
Les trois voies d’abord possibles sont :
– la voie épigastrique pour le lobe gauche ;
– les voies obliques sous-costale et intercostale
pour le lobe droit.
Le site de la ponction doit être le plus proche
possible de la lésion et doit éviter les risques de
perforation des structures anatomiques envi-
ronnantes (gros vaisseaux hépatiques, struc-
tures digestives, vésicule…).
Contre-indications
"
"Les troubles de la crase sanguine : ils doivent
être recherchés dans les 24 heures précédant
l’examen. Un taux de prothrombine inférieur à
50 % et un nombre de plaquettes inférieur à
105/mm3sont des contre-indications à la
ponction.
"
"Les angiomes : leur biopsie est contre-indi-
quée en raison du risque hémorragique après
ponction. Cependant, quand il existe une incer-
titude diagnostique, une ponction à l’aiguille
fine peut être tentée sans risque majeur de
complication hémorragique.
"
"Les kystes hydatiques : les risques de dissé-
mination péritonéale et de choc anaphylactique
contre-indiquent la ponction-biopsie.
Indications
La biopsie hépatique échoguidée est indiquée
devant une lésion focale du foie dans le but
d’obtenir un diagnostic de certitude indispen-
sable pour le traitement.
"
"Dans un contexte carcinologique, la décou-
verte d’une lésion focale correspond le plus
souvent à une métastase. Le prélèvement biop-
sique est indiqué pour confirmer le diagnostic
de tumeur primitive et chimio-sensible avant de
commencer ou de modifier la chimiothérapie.
En revanche, si la tumeur primitive est un can-
cer digestif traité par résection curative et que
la lésion hépatique est résécable, un diagnostic
de certitude sera posé lors de l’intervention.
"
"Dans un contexte de maladie chronique du
foie, toute lésion hépatique focale doit évoquer
en premier lieu un carcinome hépatocellulaire.
Si la lésion est opérable, le diagnostic final sera
posé lors de l’intervention. En revanche, si la
tumeur ne peut être traitée chirurgicalement
(thrombose portale, insuffisance hépato-cellu-
laire, lésion bilatérale), la biopsie échoguidée
est nécessaire pour un diagnostic de certitude.
Autres indications
"
"Les abcès du foie : la ponction échoguidée a
un but diagnostique et sera le plus souvent sui-
vie d’un drainage percutané après mise en
place d’un drain.
"
"Les atrophies hépatiques droites pour les-
quelles la biopsie à l’aveugle comporte un
risque important de perforation d’organe de
voisinage.
Complications
Les méthodes de ponction-biopsie échoguidée
sont d’une grande précision permettant de
réduire les risques liés à la ponction à l’aveugle.
Lorsque les contre-indications sont respectées,
les complications de la biopsie hépatique écho-
guidée sont très rares, leur taux étant inférieur
à 2 %.
Les complications possibles sont surtout l’hé-
mopéritoine ou l’hématome intrahépatique qui
sont en général spontanément résolutifs.
Les autres complications (cholépéritoine ou
pneumothorax) sont exceptionnelles.
Conclusion
La ponction hépatique échoguidée est une
technique comportant peu de risques et fiable
pour le diagnostic de lésions focalisées. Pour
les métastases, la ponction est utile pour les
rapporter à un cancer primitif connu mais reste
le plus souvent non contributive pour identifier
un cancer primitif inconnu avant l’examen.
D
RAINAGE PERCUTANÉ
DES ABCÈS HÉPATIQUES
C’est un acte thérapeutique. Grâce au repérage
des abcès par échographie, il est maintenant
46
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
dossier

possible de mettre en place des cathéters per-
mettant l’évacuation progressive de ces abcès
et leur guérison.
Abcès hépatiques à pyogènes
Les abcès hépatiques à pyogènes répondent
bien au drainage percutané, permettant ainsi
de réduire les indications opératoires. Le plus
souvent, seuls les échecs de la ponction ou les
contre-indications du drainage percutané
seront traités chirurgicalement.
L’ablation du drain est décidée en fonction de
l’amélioration des signes cliniques, de l’aspect
et de la quantité du liquide drainé, et de la
régression de l’image sur les examens écho-
graphiques.
Le drainage percutané comporte cependant un
risque de contamination de la cavité périto-
néale, surtout si la lésion est sous-capsulaire,
ou du dôme hépatique.
Il existe aussi un risque de contamination de la
cavité pleurale. Ces complications sont le plus
souvent dues à une mauvaise position d’un
trou latéral dans le cathéter.
Abcès amibiens
Ces abcès répondent bien au traitement médi-
cal qui en assure la guérison dans 90 % des cas.
Cependant, le drainage est indiqué lorsqu’il
existe :
– une incertitude du diagnostic avec un abcès à
pyogènes ;
– une négativité du test sérologique ;
– un risque de rupture intrapéritonéale ;
– une réponse insuffisante au traitement
médical.
Le drainage des abcès amibiens, lorsqu’il est
indiqué, ne dispense cependant pas du traite-
ment médical.
Cholécystostomie percutanée
Il s’agit d’une technique palliative de drainage
lors du traitement des cholécystites aiguës
chez les patients non opérables, permettant de
retarder provisoirement la cholécystectomie.
Elle est indiquée aussi en cas d’obstruction
basse, lorsque la dérivation biliaire chirurgi-
cale, endoscopique ou transhépatique est
contre-indiquée. La ponction échoguidée de la
vésicule et la mise en place d’un drain se font
par une voie antérieure passant à travers le
bord antérieur du foie et le ligament hépato-
vésiculaire.
Ponction et drainage percutané
des pancréatites
Les collections nécrotiques de la pancréatite
aiguë et les pseudo-kystes rétentionnels de la
pancréatite chronique s’observent dans des
contextes différents. Les premières sont secon-
daires à une inflammation aiguë souvent grave,
mettant en jeu le pronostic vital, notamment en
cas de surinfection. Les seconds se voient chez
les patients porteurs d’une atteinte chronique
et s’expriment par une symptomatologie
algique, compressive, secondaire à une aug-
mentation de leur volume.
Dans les deux cas, la technique de ponction et
de drainage est la même.
Ponction diagnostique
La ponction diagnostique précède le drainage.
Elle permet d’apprécier la surinfection par une
analyse bactériologique. Elle permet aussi le
dosage des enzymes pancréatiques et, éven-
tuellement, d’obtenir une opacification à la
recherche de fistule ou de communication avec
les canaux hépatiques. La ponction échoguidée
ne doit pas avoir un trajet transdigestif afin de
ne pas contaminer le prélèvement ou la collec-
tion. Le drain sera mis en place après le prélè-
vement en cas de signes évidents macrosco-
piques d’infection.
Drainage percutané thérapeutique
Le drainage est effectué après ponction sous
guidage échographique. L’avantage de cette
technique est qu’elle permet de placer le drain
même au lit d’un malade non mobilisable.
La voie d’abord doit permettre un trajet le plus
court possible.
Les collections rétropéritonéales sont drainées
par voie postérolatérale et les collections de
l’arrière-cavité des épiploons sont abordées par
voie antérieure transpéritonéale. Le point d’en-
trée du cathéter doit se situer dans la partie la
plus large de la collection et son extrémité dans
la partie la plus déclive.
R
EIN
:
LA NÉPHROSTOMIE
PERCUTANÉE
(NPC)
Le développement de la radiologie interven-
tionnelle, et en particulier des gestes échogui-
dés, a fait reculer les indications de la chirurgie,
notamment dans les syndromes obstructifs et
les infections suppurées du rein.
47
Correspondances en médecine - n° 2 - octobre 2000
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%