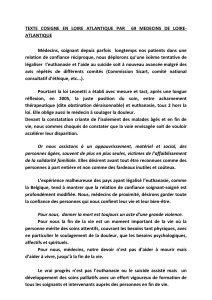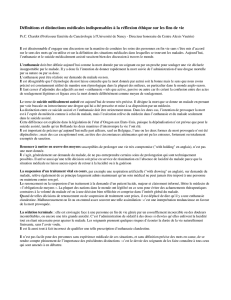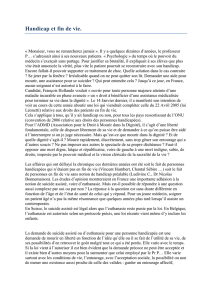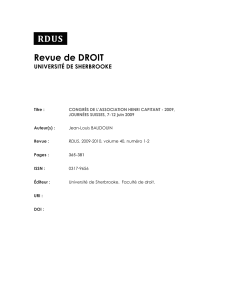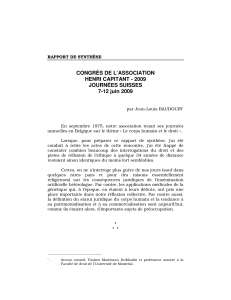Des réglementations concernant les décisions médicales en fin de vie Q

21
La Lettre du Cancérologue - volume VII - n° 1 - janvier-février 1998
QUALITÉ DE VIE
es décisions médicales de fin de vie sont l’objet de
controverses importantes. Depuis plusieurs années et
dans de nombreux pays s’est ouvert un débat sur
l’euthanasie et le suicide médicalement assisté, qui ne résu-
ment pas, à eux seuls, les termes des décisions médicales en
fin de vie, mais qui en sont une expression particulièrement
aiguë.
Ce débat prend des formes différentes selon le pays où il a
lieu. L’écho qui revient de la littérature est particulièrement
passionnel, et parfois idéologique.
Les éléments nouveaux, depuis quelques années, sont les tentatives
de régulation par la loi, apparues dans trois pays en particulier
(Pays-Bas, Oregon, Territoire du Nord en Australie), ou ailleurs
par des avis de cours de justice. L’une des difficultés majeures
vient des différentes définitions données aux actes médicaux en fin
de vie (sédation terminale, aide à la mort, renoncement thérapeu-
tique, suicide assisté, euthanasie) – le choix des mots n’est pas
neutre – et de considérations parfois très techniques, tant sur le
plan juridique qu’éthique.
Ces tentatives de régulation ont en commun trois grands
points, tant pour éviter les abus que pour protéger les profes-
sionnels de la santé. Tout d’abord, l’invitation à ne pas pour-
suivre les médecins lorsque certaines conditions, définies au
préalable, ont été remplies. En ce sens, il ne s’agit pas de léga-
lisation, mais de dépénalisation. En second, la possibilité de
refuser de pratiquer un tel acte est reconnue à tout médecin. Il
doit cependant orienter le patient demandeur vers un autre
confrère. Enfin, et ce point est particulièrement important, le
consentement du malade est obligatoire.
L’acte de fin de vie étant achevé, il doit être déclaré aux auto-
rités judiciaires pour être examiné par une commission, qui
statue sur la validité de la situation au regard des textes en
vigueur et décide de ne pas poursuivre le médecin si les condi-
tions d’application ont été remplies.
Nous allons examiner dans cette tribune les trois tentatives de
régulation par des textes de loi de cette situation complexe
qu’est l’“aide au mourir” faite par un homme-médecin pour un
homme-patient. Nous verrons que ces tentatives de régulation
de conflits éthiques par des réglementations résistent difficile-
ment à l’analyse de leurs applications.
LES PAYS-BAS
En 1973 s’ouvre un débat public autour de “l’affaire Postma”.
Il s’agit d’un médecin ayant abrégé les souffrances de sa mère.
Des réglementations concernant les décisions médicales
en fin de vie
●
E. Lucchi*/**, F. Pochard**/***
*Service d’oncologie médicale, CHU Saint-Antoine, Paris.
**Laboratoire d’éthique médicale et de santé publique, UFR Necker-Enfants
Malades, Paris.
***Service de réanimation médicale, CHU Cochin-Port-Royal, Paris.
L
Le débat sur les décisions médicales en fin de vie ne se résume pas à la question de l’euthanasie, mais peut-être est-ce ce domaine qui
fait naître le plus de conflits.
Dans cette tribune, nous ne discuterons pas de l’euthanasie ou du suicide médicalement assisté en tant que tels. Nous examinerons les
différentes propositions de loi qui ont été acceptées dans trois pays afin de réguler ces pratiques, et nous essaierons de voir, à la
lumière des questions qu’elles ont soulevées et de leurs évolutions, s’il est opportun de légiférer sur ce sujet ou si d’autres mesures
doivent être discutées.
“Euthanasia, as well as the entire field of bioethics, is at
the crossroad of many different disciplines : we as physi-
cians should not be afraid to open our words and our
world to others.” Surbone
E. Lucchi 23/04/04 11:07 Page 21

QUALITÉ DE VIE
22
La Lettre du Cancérologue - volume VII - n° 1 - janvier-février 1998
Durant les dix années qui suivent, dix procès environ ont lieu.
Ils se concluent par des peines légères, malgré la reconnais-
sance de l’acte en lui-même. En 1984, deux procès aux issues
radicalement opposées ont lieu. D’un côté, celui d’un jeune
médecin qui a administré des doses létales de médicaments à
de vieilles personnes dans l’hospice dans lequel il travaillait.
La condamnation est plus lourde, notemment en raison du fait
qu’il a agi seul. De l’autre côté, le Dr Admiraal est reconnu
coupable des mêmes actes sans qu’aucune peine ne lui soit
infligée. Sa notoriété et ses compétences médicales font sans
nul doute partie des motifs de la décision judiciaire. Ce qui est
également reconnu, et mis en avant par la Cour de justice, c’est
la rigueur des critères qu’il utilise dans sa prise de décision :
demande explicite et écrite du patient, maladie incurable et
souffrance intolérable, discussion avec la famille, décision col-
lective (médecin, équipe soignante, autorité spirituelle). Par
ailleurs, ce médecin a été, dans son pays, une voix d’autorité
pour amener le débat en place publique et appeler à une régu-
lation juridique. À ses yeux, les deux plus grandes réticences
qu’il rencontrait étaient la peur que l’euthanasie ne soit pas
volontairement demandée par le patient, ou que les critères,
aussi rigoureux soient-ils, soient appliqués avec laxisme, abro-
geant ainsi les limites dans lesquelles cet acte lui paraissait non
seulement tolérable mais justifié dans certains cas.
À la même époque, on considérait que l’euthanasie représen-
tait aux Pays-Bas 6 à 10 000 demandes par an, et ce malgré
l’existence de soins palliatifs. L’Association pour l’euthanasie,
créée dans les années 70, comptait 26 000 inscrits, dont des
médecins respectés sur le plan médical et jouissant d’une
grande réputation.
Dans une analyse de 1994, les “décisions médicales concer-
nant la fin de la vie” (MDEL) tenaient un rôle dans 38 % des
cas de décès (Blijham, 1994), et l’euthanasie, définie comme
le fait de mettre volontairement un terme à la vie d’un patient
qui le demande, représentait 1,8 % des décès, et 6 % des décès
dans le cours d’une maladie cancéreuse. Cinquante pour cent
des médecins interrogés en Hollande déclaraient avoir déjà
pratiqué un geste de ce type, et seuls 4 % s’y refusaient catégo-
riquement. Dans ce contexte est née une forme de dépénalisa-
tion de l’euthanasie (Groenewoud, 1997). Il s’agit toujours
d’une violation du Code pénal, mais, au travers de certains
arrêts de la Cour de justice et du guide de l’Association médi-
cale hollandaise (DMA), cette pratique est tolérée si certaines
règles sont respectées. Celles-ci sont les suivantes : il doit
s’agir d’un sujet compétent, enfant ou adulte, souffrant de
façon intolérable d’une maladie sans espoir de rémission ; la
demande doit être volontaire, répétée pendant une période rai-
sonnable de temps, et écrite. Deux médecins doivent participer
à la décision.
Ce contexte légal, dont les conditions sont assez larges, devrait
être prochainement révisé devant les problèmes posés par le
consentement, et par le faible taux de déclaration par rapport
aux actes pratiqués (41 % dans un travail réalisé par Van der
Wal, 1996).
LE TERRITOIRE DU NORD EN AUSTRALIE
En juillet 1996 apparaît un texte relatif aux patients en maladie
terminale (Ryan 1996). Les conditions requises sont les sui-
vantes : il doit s’agir d’un adulte (> 18 ans) compétent, souf-
frant de façon intolérable d’une maladie terminale, définie,
après échec de tout traitement efficace. La demande doit être
volontaire, et émaner d’un malade informé de sa pathologie,
des traitements et des soins palliatifs par un médecin com-
pétent en la matière. Le diagnostic doit être confirmé par un
second médecin, et le patient examiné par un psychiatre
confirmant l’absence d’éléments dépressifs. Au total, donc,
4 médecins sont requis. La demande du patient doit être suivie
d’un délai de 7 jours avant qu’il ne signe un certificat de
demande détaillé. Puis 48 heures sont encore requises, et un
médecin peut assister le patient ou administrer lui-même un
produit. Ce médecin doit être présent au moment de l’acte, et
payé en l’absence d’autres gratifications.
Lors de la sortie de ce texte, l’Association médicale austra-
lienne (AMA) a saisi la Cour suprême, en s’appuyant sur le
fait que 80 % des médecins étaient contre une telle loi. Il
s’agissait d’une estimation faite par enquête téléphonique par
l’AMA.
Un vote du parlement australien a suspendu la loi après
quelques mois d’application.
LES ÉTATS-UNIS
En novembre 1995, les citoyens de l’État d’Oregon votent à
une courte majorité (53 % contre 47 %) l’adoption de la Ballot
measure 16 (Annas, 1994), qui propose une dépénalisation du
suicide médicalement assisté, après que deux tentatives eurent
échoué dans d’autres États. Le suicide médicalement assisté y
est défini comme la possibilité pour le médecin de fournir
l’information et de prescrire un médicament à dose suffisante
pour entraîner le décès afin que le patient puisse mettre fin
“dignement” à sa vie. Les conditions requises sont les sui-
vantes : il doit s’agir d’un malade adulte, compétent, souffrant
d’une maladie terminale avec une espérance de vie inférieure à
6 mois. Il doit effectuer deux demandes orales espacées de
deux semaines au moins. Une demande écrite, signée devant
deux témoins, et après une consultation psychiatrique si néces-
saire, est suivie, après 48 heures de délai, de la prescription
médicale et de la délivrance d’informations suffisantes pour
que le patient puisse se suicider. Après la déclaration, une
compliance de bonne foi du médecin sera reconnue par un pro-
cureur si l’ensemble de la procédure a été respecté.
Au moment de la promulgation de cette loi, l’Association
médicale américaine (AMA) a ouvertement déploré cet état de
fait. Cependant, cette prise de position ne semblait pas refléter
l’opinion de l’ensemble de ses membres (Ann Oncol,
“News”, 1995, 6 : 97). À peine quelques semaines plus tard,
cette loi a été suspendue par un appel, jusqu’à l’avis de la Cour
suprême des États-Unis, contre le droit constitutionnel au sui-
cide médicalement assisté. L’accès aux soins palliatifs et la
possibilité de pratiquer une sédation terminale (sédation au
risque de hâter la mort) y sont en revanche soulignés.
E. Lucchi 23/04/04 11:07 Page 22

23
La Lettre du Cancérologue - volume VII - n° 1 - janvier-février 1998
Notons également qu’aux Philippines, une tentative de législa-
tion a avorté en 1997. Au Japon, un projet a été déposé en
1996. Il s’agit d’un pays où la famille occupe une place pré-
pondérante dans les décisions de fin de vie. En Grande-
Bretagne, les sociétés savantes se sont intéressées à différentes
situations et ont proposé des éléments d’encadrement des pra-
tiques de la fin de la vie (arrêt de la nutrition parentérale ou
d’autres thérapeutiques dans tel ou tel cas...), et des avis ren-
dus en cas de procès font jurisprudence. Cet ensemble de don-
nées permet ainsi au praticien d’avoir des “repères”, qui, sans
avoir force de loi, sont néanmoins une forme de régulation.
DISCUSSION
Il n’entre pas dans le cadre de cette discussion de faire le point
des différents arguments pour ou contre la décision médicale
d’euthanasie, qui est néanmoins un acte pratiqué, mais d’exa-
miner les implications et les limites d’une tentative de régula-
tion de cette pratique par la loi. L’exposé des textes ayant tenté
de légiférer sur ces difficiles questions médicales et éthiques
suscite en effet plusieurs réflexions.
La première est que ces lois ont été rapidement suspendues,
sauf aux Pays-Bas, où il est néanmoins question de les adapter.
À partir du moment où un texte légal existe sur le sujet, toute
autre pratique se rapportant à des situations similaires devient
illégale sans pour autant cesser d’exister. Or, si nous reprenons
les termes des textes évoqués, recouvrent-ils entièrement les
situations où se discute un geste actif qui va hâter ou provo-
quer la mort d’un patient ? Tous ces textes font référence à un
acte médical – un agir – provoquant la mort et demandé expli-
citement par un malade en situation de souffrance intolérable.
Les textes se rapportent en effet à “l’euthanasie”, action médi-
cale qui aboutit intentionnellement à la mort, et au “suicide
médicalement assisté”, où l’acteur peut être le patient ou un
membre de son entourage et où le médecin a été le médiateur
d’une prescription entraînant la mort. Cela peut paraître à cer-
tains contraire au credo médical, tout en paraissant normal à
d’autres, et dans une certaine continuité des soins et de la rela-
tion médecin-malade. Ainsi, ce débat porte en lui la diversité
des opinions des hommes-médecins qui se trouvent confrontés
à des situations très diverses, mais toujours dramatiques. Aux
frontières de ces gestes actifs se situent également les absten-
tions thérapeutiques ou les arrêts thérapeutiques. Doit-on, par
exemple, considérer comme “actif” ou “passif” le fait de
débrancher un respirateur en réanimation ? Bien qu’il s’agisse
d’un geste, en soi actif, celui-ci supprime un élément sans
lequel le malade ne peut vivre, et renvoie ainsi à une absten-
tion plus qu’à une euthanasie. Pour certaines autorités, reli-
gieuses comme philosophiques, ce geste est autorisé, voire
obligatoire (Jonas, 1985). Le débat, en fait, est le même, et
seules les connotations sont différentes. Le mot “euthanasie”
renvoie à des épisodes douloureux et inacceptables de l’histoire
humaine, tandis que d’autres termes renvoient davantage à des
sentiments de compassion ou de charité, en même temps qu’ils
déculpabilisent les médecins.
Enfin, s’il n’est pas ici question de brosser un panorama
exhaustif des situations concernées, peut-on statuer de façon
uniforme sur des cas aussi différents que ceux qui surviennent
en réanimation, en réanimation néonatale, en cancérologie ou
en neurologie, s’agissant de maladies dégénératives ou de
démences ? Et au sein même d’une discipline, prend-on la
même décision devant un patient qui souffre, physiquement
et/ou moralement, d’un cancer en phase terminale et devant un
patient qui développe une dyspnée aiguë grave irréversible sur
un cancer avancé ?
Une loi restrictive devient ainsi inapplicable. Nous venons de
voir qu’elle ne recouvre pas toutes les situations qui se présen-
tent au clinicien. Elle est également difficilement applicable
sur le plan pratique (délais exigés entre la demande du patient
et la possibilité pour le médecin d’y répondre, modifications
pouvant intervenir entre temps concernant l’état de conscience
du malade, etc.).
À l’opposé, une loi élargie peut être dangereuse. C’est toute la
question du consentement. Elle se positionne dans un contexte
social et temporel, avec une actuelle mise en avant, au moins
discursive, de l’autonomie du sujet. Cette insistance sur l’auto-
nomie du malade est particulièrement nette dans les pays
anglo-saxons depuis quelques décennies, et se double d’une
obligation de consentement. D’autres concepts, telle la bienfai-
sance, sont alors relégués au second plan. Or, pour que soit
abordée l’euthanasie avec un patient, celui-ci doit être réelle-
ment informé de sa pathologie et de son exact pronostic,
comme le soulève Surbone (1994). Le “droit de mourir” ne se
dissocie donc pas d’un droit à la vérité. Où en est-on réelle-
ment à ce sujet dans certains pays où une tradition paternaliste
de la relation médecin-malade prévaut peut-être encore, ou en
tout cas cohabite avec de nouvelles façons de l’envisager ? Il
ne nous appartient pas ici de développer ce sujet, mais il faut
se garder de “réponses trop rapides à ces questions qui prouve-
raient qu’on est insensible à leur complexité et à l’imprécision
de leurs frontières” (Jonas, 1985). C’est ici également que sur-
gissent les questions relatives à des patients ne pouvant pas ou
plus donner leur consentement, comme tel est bien souvent le
cas en réanimation lorsque la question se pose, ou en néonato-
logie. Cependant, condamnerait-on un réanimateur pour avoir
arrêté la vie dans certaines situations ? La peur d’abus, commis
sur des enfants ou des sujets n’ayant pas compétence pour
donner un avis éclairé, ou sur des sujets dépressifs, ou la peur
d’un pouvoir de suggestion par un tiers retiennent à juste titre
de statuer sur les cas limites de consentement, sans toutefois
qu’ils soient éthiquement exclus. Un certain nombre de protec-
tions ont été proposées. Tel est le cas par exemple des “testa-
ments de vie” (ou “living will” des Anglo-Saxons), écrits par
un sujet “en pleine conscience et en toute liberté”, c’est-à-dire
en général indemne de maladie ou à un stade plus précoce
d’une maladie. Dans de nombreux États des États-Unis, ces
textes ont une valeur légale. Il est toujours néanmoins possible
de leur opposer le fait que les processus mentaux qui condui-
sent à envisager de demander ou de refuser l’euthanasie dans
une situation donnée ne sont pas forcément les mêmes que
lorsque la situation est présente. Quelle valeur peut-on alors
leur accorder ? Telles sont également les dispositions prises en
Australie et en Oregon relatives aux symptômes dépressifs du
patient qui demande l’euthanasie. Plusieurs travaux ont insisté
sur ce point (Emanuel, 1996 ; Ganzini, 1997) et ont fait état
E. Lucchi 23/04/04 11:07 Page 23

24
La Lettre du Cancérologue - volume VII - n° 1 - janvier-février 1998
QUALITÉ DE VIE
d’une plus grande demande lorsqu’il existe des signes dépres-
sifs. Bien que cet argument soit important, et qu’il soit essen-
tiel d’éviter les abus, dont au moins un cas a été rapporté (le
cas Chabot), il est opportun de se poser la question des modifi-
cations psychiques qui surviennent chez les patients atteints de
maladie incurable. Pour certains d’entre eux, les “signes
dépressifs” peuvent-ils être médicalement résolus alors que la
maladie qui les envahit ne peut plus l’être ? Notons par ailleurs
une étude menée en 1994 (Hanson), qui met en évidence une
plus grande fréquence des arrêts de réanimation cardiorespira-
toire pratiqués chez des patients jugés incompétents pour le
consentement (troubles de conscience, troubles cognitifs
sévères, psychoses). Ces résultats, qui ne sont pas forcément
reproductibles à d’autres équipes, devraient néanmoins inciter
à une évaluation plus précise des pratiques et de leurs motiva-
tions. Si les pratiques de la fin de la vie deviennent une “disci-
pline émergente” (Lancet, éditorial, 1996 ; 347 : 1 777), il est
crucial d’étudier tous ces nouveaux paramètres et d’évaluer les
pratiques “telles qu’elles sont”.
Toutefois, accorder légalement une assistance médicale dans
ces cas-là peut effectivement ouvrir la porte à des abus.
L’application de la loi se retrouve une fois de plus soumise à
l’art médical compris dans son entièreté.
Un autre élément d’importance est le degré de subjectivité et
d’expérience qui entre en ligne de compte dans l’appréciation
de la situation. Dès le diagnostic d’incurabilité ou d’irréversi-
bilité, les différents textes exposés ne sont pas semblables :
l’un fait état d’une maladie “terminale” (sans délai précis),
l’autre d’une espérance de vie inférieure à 6 mois, le troisième
n’en parle pas. Le consensus diagnostique et pronostique doit
être recherché, tout en sachant que les données évoluent, et
que l’âge du médecin (certaines propositions de loi exigent
d’ailleurs un certain nombre d’années d’exercice avant qu’un
médecin puisse accéder à la demande des patients selon le
cadre légal) tout autant que son savoir peuvent modifier son
appréciation de ce paramètre temporel. Il en est de même du
degré de souffrance exprimé par le patient. La douleur – ou
souffrance physique – entre moins dans les demandes d’eutha-
nasie (Emanuel E.J., 1996 ; van der Maas P.J., 1991 ; Back,
1996) que la perte du sens de la vie, par exemple, ou un état
physiquement très diminué et dépendant (le “functional debili-
ty” anglo-saxon), ou encore le fait d’être un poids pour les
proches. Or, ces paramètres sont de l’ordre de la subjectivité
du malade. Les médecins interrogés ont plus facilement ten-
dance à accepter le suicide médicalement assisté ou le “mercy
killing” (mort donnée par compassion) devant des douleurs
intolérables, dont nous avons vu qu’elles sont inscrites à part
entière dans les lois. Peut-être évaluent-ils moins précisément
la souffrance, comme le souligne Susan Wolf (1997).
Les textes présentés dans cette discussion sont encore, à deux
égards, une prise de position exclusive qui peut être criti-
quable. Tout d’abord, ils ne font pas état du contexte dans
lequel se situe le patient : famille, proches, voire médecin trai-
tant. Il n’est aucunement fait mention de l’implication de la
famille, ni des conséquences que cela peut avoir pour elle en
termes psychologiques par exemple. Rappelons qu’aux Pays-
Bas, la demande d’un enfant peut être recevable alors même
que les parents s’y opposent.
Ensuite, ils statuent sur un acte, considéré symboliquement au
même titre qu’un traitement : temporalité, brièveté, précision.
Les soins donnés à un patient sont, tout au contraire, continus.
Leur notion implique une prise en charge plus globale, phy-
sique, psychologique, sociale et, au mieux, également spiri-
tuelle de la personne malade. Dans cette démarche, les arrêts
thérapeutiques sont évoqués tout au long de la maladie, mais
dans un avenir plus ou moins lointain et plus ou moins hypo-
thétique. La connaissance du patient, l’approche de ses convic-
tions tout autant que de ses demandes et leur déchiffrement y
sont inscrits.
Enfin, une loi s’applique à toute la population. En ce sens,
concernant le sujet qui nous occupe, elle intervient auprès du
public, des patients, mais aussi des médecins concernés. Or,
plusieurs études montrent une discordance franche entre le
point de vue des patients et/ou du public et celui des médecins.
Ainsi, Emanuel et coll. (1996) ainsi que Suarez-Amazar et
coll. (1997), dans des enquêtes récentes, ont mis en évidence
que les médecins qui trouvent acceptable un suicide assisté
sont beaucoup moins nombreux que les patients ou le public.
Pour Emanuel et coll., les chiffres sont encore plus éloignés
lorsqu’il s’agit du terme “euthanasie”, alors qu’ils restent les
mêmes pour les patients et le public. De la même façon, les
malades et le public pensent qu’une discussion autour des
soins de fin de vie, incluant une mention explicite de l’eutha-
nasie ou du suicide médicalement assisté, pourrait majorer la
confiance qu’ils ont en leur médecin (pour respectivement
41,6 % et 32,8 % d’entre eux). Peu d’entre eux (respective-
ment 19 % et 26,5 %) seraient enclins à changer de médecin si
celui-ci avait pratiqué l’euthanasie ou le suicide médicalement
assisté avec d’autres patients. Ces données proviennent surtout
de gens ayant une appartenance religieuse, ce qui est concor-
dant avec les résultats d’autres études. En revanche, les
réponses des oncologues interrogés sont aux antipodes de
cela : 15,6 % estiment que la relation médecin-malade gagne-
rait en confiance (et 53 % estiment qu’elle y perdrait) si ce
sujet était explicitement évoqué, et 80 % pensent que le patient
changerait de médecin s’il savait que celui qui le suit a déjà
pratiqué ce type d’acte. Il existe des différences selon les disci-
plines médicales également, les médecins les plus exposés à
devoir prendre ce type de décision (les oncologues dans
l’étude de Bachman, 1996) étant les moins favorables à une
réglementation.
Dans le même ordre d’idées, les effets de la dépénalisation
dans le Territoire du Nord en Australie ont été évalués chez les
aborigènes (Collins, 1997), où ils ne peuvent être vécus de la
même façon que pour le reste de la population.
La discordance entre les différents groupes composant un pays
et les disparités existantes peuvent amener à cristalliser des
positions si une loi intervient.
Enfin, d’autres questions viennent à l’esprit : comment envisa-
ger de “bonnes pratiques” (études, suivi d’une AMM pour la
prescription...) en ce domaine, où un médicament aurait, dans
ses indications, la mort ? Quelles seraient les conséquences
financières (actions des assurances...) pour la famille d’une
personne qui aurait demandé un suicide médicalement assisté ?
Toutes les données que nous avons parcourues plus haut sont
E. Lucchi 23/04/04 11:07 Page 24

25
La Lettre du Cancérologue - volume VII - n° 1 - janvier-février 1998
valides dans le pays dans lequel ont été faites les études, et ne
peuvent aisément être exportées. En Hollande, par exemple,
l’acceptation sociale, y compris par les médecins, semble dif-
férente (van der Maas, 1995, 1996).
Des études ont essayé de cerner, dans différents pays (asia-
tiques, anglo-saxons, européens), les différentes attitudes du
public, des médecins (éventuellement selon leur discipline), et
de certaines catégories de patients (le plus souvent cancéreux
ou neurologiques). Où en est-on en France ? Dans le Code de
déontologie, le médecin n’a “pas le droit de provoquer délibé-
rément la mort” (article 38), mais il “doit éviter toute obstina-
tion déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique”
(article 37). De ceci se rapprochent les avis rendus par le
Comité consultatif national d’éthique (CCNE), qui enjoint à
apaiser les souffrances du patient sans acharnement thérapeu-
tique, et à développer les soins palliatifs. L’euthanasie, active
ou passive cette fois, demeure un crime au regard de notre
Code pénal (abstention fautive, non-assistance à personne en
danger, homicide volontaire prémédité sur personne en incapa-
cité de se défendre). Cependant, il serait illusoire d’en nier la
pratique, que certains médecins ne cachent d’ailleurs pas. Des
propositions de régulation par des textes légaux ont été faites,
par des juristes et l’ADMD (Association pour le droit de mou-
rir dans la dignité) en particulier.
Donner intentionnellement la mort à un homme malade reste
sans doute, dans les pays latins, une transgression fondamen-
tale. Légiférer peut sembler un moyen de justifier l’existence,
dans la pratique, d’une telle transgression. Pour autant, s’agit-il
de créer de nouveaux textes de loi, dont nous avons vu les
limites d’application autant que les risques potentiels, ou plutôt
d’utiliser autrement les textes existants, afin que la société
s’approprie en quelque sorte des pratiques qui appartiennent à
sa “part d’ombre”, et qu’un large débat ait réellement lieu ?
Dans ce débat, les sociétés savantes (regroupant des spécia-
listes confrontés aux difficiles décisions de fin de vie de leurs
patients, tels les oncologues, les neurologues, les réanimateurs)
pourraient prendre position, en créant un corpus de connais-
sances et de situations consensuelles. ■
❏Annas G.J. Death by prescription, the Oregon initiative. N Engl J Med 1994 ;
331 : 1240-4.
❏Bachman J.G., Alcser K.H., Doukas D.J. et coll Attitudes of Michigan
physicians and the public toward legalizing physician-assisted suicide and
voluntary euthanasia. N Engl J Med 1996 ; 334 : 303-9.
❏Back A.L., Wallace J.I., Starks H.E., Pearlman R.A. Physician-assisted
suicide and euthanasia in Washington State. Patients requests and physicians
responses. JAMA 1996 ; 275 (12) : 919-25.
❏Blijham G.H. Euthanasia, the Dutch perspective. Ann Oncol 1994 ; 5 (S8) : 215.
❏Collins J.J., Brennan F.T. Euthanasia and the potential adverse effects for
Northern Territory aborigines. Lancet 1997 ; 349 : 1907-8.
❏Emanuel E.J., Fairclough D.L., Daniels E.R., Clarridge B.R. Euthanasia and
physician-assisted suicide : attitudes and experiences of oncology patients,
oncologists, and the public. Lancet 1996 ; 347 : 1805-10.
❏Ganzini L., Lee M.A., Heintz R.T. et coll. Psychiatry and assisted suicide in
the United States. N Engl J Med 1997 ; 336 : 1824-6.
❏Groenewoud J.H., Van der Maas P.J., Van der Wal G. et coll. Physician-
assisted death in psychiatric practice in the Netherlands. N Engl J Med 1997 ;
336 : 1795-801.
❏Hanson L.C., Danis M., Mutran E., Keenan N.L. Impact of patient
incompetence on decisions to use or withold life sustaining treatment. Am J Med
1994 ; 97 (3) : 235-41.
❏Jonas H. Techniken des Todesaufschubs und das Recht zu sterben. Insel
Verlag (eds), 1985. Trad. Payot et Rivages (eds), 1996.
❏Ryan C.J., Kaye M. Euthanasia in Australia : the Northern Territory rights of
the terminally ill act. N Engl J Med 1996 ; 334 : 326-8.
❏Suarez Amazar M.E., Belzile M., Bruera E. Euthanasia and physician-
assisted suicide : a comparative survey of physicians, terminally ill cancer
patients and the general population. J Clin Oncol 1997 ; 15 (2) : 418-27.
❏Surbone A. More on euthanasia. Ann Oncol 1994 ; 5 : 378.
❏Van der Mass P.J., van Delden J.J.M., Pijnenborg L., Looman C.W.N.
Euthanasia and other medical decisions concerning the end of life. Lancet
1991 ; 338 : 669-74.
❏Van der Mass P.J., Pijnenborg L., van Delden J.J. Changes in Dutch opinions
on active euthanasia, 1966 through 1991. JAMA 1995 ; 273 :
1411-4.
❏ Van der Mass P.J., van der Wal G., Haverkate I., de Graaf C.L.M. et coll.
Euthanasia, physician-assisted suicide, and other medical practices involving
the end of life in the Netherlands, 1990-95. N Engl J Med 1996 ; 335 :
1699-705.
❏Van der Wal G., Van der Mass P.J., Bosma J.M. et coll. Evaluation of the
procedures for physician-assisted death in the Netherlands. N Engl J Med
1996 ; 335 : 1706-11.
❏Wolf S.M. In “Ethics round”. JCO 1997 ; 7 (12) : 1518.
pour en savoir plus
1998, EDIMARK “les lettres” et MEDICA-PRESS
“les actualités”, sous le signe d’un véritable
engagement humanitaire. 1 % du chiffre d’affaires brut HT de l’achat
d’espace hors remises sera offert à des associations de malades
sélectionnées par les comités scientifiques des publications. Ainsi, les
annonceurs, à travers chaque page de publicité, contribueront à cet
indispensable élan de solidarité.
E. Lucchi 23/04/04 11:07 Page 25
1
/
5
100%