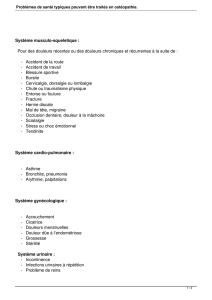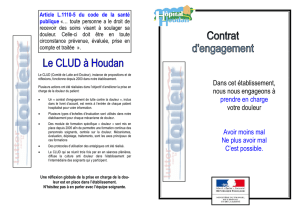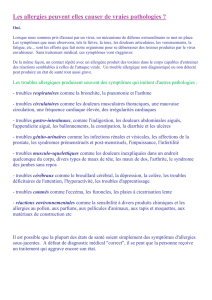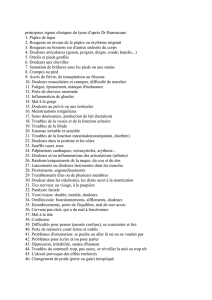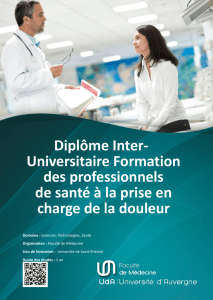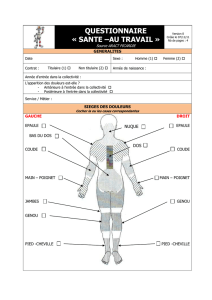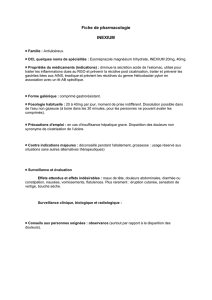L M

MISE AU POINT
11
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
L
a douleur est un symptôme fréquent en cancérologie
(1). Cette expérience désagréable s’accompagne sou-
vent de fluctuations au cours de l’évolution de la mala-
die néoplasique. En outre, le patient cancéreux est susceptible de
présenter, du fait de sa maladie, de nombreux aspects cliniques
douloureux (tableau I). La douleur n’est pourtant pas seulement
le résultat d’un désordre physique, mais le plus souvent la com-
binaison de facteurs modulateurs, physiologiques, émotionnels,
psychologiques, cognitifs, environnementaux et sociaux (3).
Les douleurs ont pu être classifiées selon différents critères : étio-
logiques, anatomiques, syndromiques, physiopathologiques et
temporaux. Dans ce dernier contexte, la douleur peut être aiguë,
subaiguë, incidente, chronique, et survenir à n’importe quel
moment de la vie du patient victime d’une affection maligne
(tableau II). Elle peut survenir très tôt, avec une intensité éle-
vée, et être soulagée par les traitements spécifiques. Lorsqu’elle
survient plus tard dans la vie du patient, elle signe souvent une
évolution de la maladie et s’associe volontiers à une anxiété et à
une souffrance. La clé du succès thérapeutique dans le contrôle
de la douleur réside dans la compréhension du ou des méca-
nisme(s) qui initient le symptôme et/ou qui le pérennisent. Le
contrôle optimal de la douleur passe par des stratégies préven-
tives et actives incluant les médications et les interventions psy-
chologiques.
Les douleurs aiguës liées au cancer sont le plus souvent secon-
daires aux actes thérapeutiques et diagnostiques (4). Elles posent
en général peu de problèmes diagnostiques. Si certaines douleurs
en relation avec la tumeur peuvent avoir un caractère aigu tran-
sitoire (lors d’une fracture pathologique, par exemple), la plupart
d’entre elles persistent jusqu’à ce qu’un traitement efficace spé-
cifique de la lésion soit mis en place. Le mot aigu(ë) prête sou-
vent à confusion. Issu du latin acutus, il signifie “coupant, tran-
chant” et “pénétrant l’esprit”. Le mot français se dit d’une forme
pointue (acérée) puis d’un mal violent, d’une personne ou d’un
caractère violent, d’un son perçant. Il désigne aussi en musique
les sons élevés de l’échelle musicale, en s’opposant à “grave”.
“Aigu” signifie enfin d’apparition brusque et d’évolution rapide
par opposition à “chronique” pour parler d’affections ou de
maladies. Le terme s’inscrit ainsi dans le langage courant tant
pour désigner une intensité élevée qu’une durée plutôt réduite.
La douleur aiguë serait, pour J.J. Bonica et al. (1), une constel-
lation complexe de sensations, d’expériences perceptives et émo-
tionnelles désagréables, associées à des réponses autonomiques,
psychologiques et comportementales. Les douleurs aiguës peu-
vent être iatrogéniques et survenir du fait des actes diagnostiques
et des thérapeutiques mais aussi du fait de la maladie. Dans ce
dernier cas, les accidents douloureux transitoires sont une entité
fréquente qui mérite quelques précisions.
DOULEURS AIGU
Ë
S ASSOCIÉES AUX ACTES
DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
De nombreux traitements et investigations sont associés à des
douleurs prédictibles transitoires.
Douleurs aiguës liées aux actes diagnostiques
Ponction lombaire
Les céphalées après ponction lombaire (PL) caractérisent le mieux
les douleurs aiguës associées à un acte interventionnel diagnostique.
Ce syndrome est caractérisé par l’apparition retardée de céphalées
positionnelles majorées lors de la position debout. La douleur
résulte d’une fuite persistante du liquide céphalo-rachidien (LCR)
par la brèche durale avec réduction du volume du LCR et d’une
vasodilatation intracérébrale algogène secondaire (5). L’incidence
Prise en charge des douleurs aiguës en oncologie
The management of acute cancer pain
© Le Courrier de l’algologie (4), n° 3, juillet/août/septembre 2005.
●
F. Lakdja*, F. Dixmérias*, J.P. Gekière*, Y. Kabbani*
* Département Anesthésie-réanimation-algologie, institut Bergonié,
Centre régional de lutte contre le cancer, Bordeaux.
Patients avec douleur aiguë liée au cancer :
– en rapport avec le diagnostic du cancer
– en rapport avec le traitement étiologique
Patients avec douleur chronique
liée au cancer :
– en rapport avec la progression du cancer
– en rapport avec le traitement étiologique (chirurgie, chimiothérapie,
radiothérapie)
Patients avec douleur chronique préexistante et liée au cancer
Patients ayant des antécédents de dépendance aux stupéfiants
et une douleur liée au cancer
Patients en phase terminale et douleur liée au cancer
Tableau I. Classification des patients avec douleur cancéreuse (2).

MISE AU POINT
12
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
de la douleur dépend de la taille de l’aiguille utilisée : 0-2 % pour
une aiguille de 27-29 gauges, 10-15 % pour une aiguille de
20 gauges, 20-30 % pour une aiguille de 18 gauges (6).
Il est donc recommandé d’utiliser les aiguilles les plus fines et
d’introduire le biseau de l’aiguille longitudinalement pour
réduire au maximum les lésions des fibres élastiques longitudi-
nales de la dure-mère (5). Les aiguilles à bout conique sont éga-
lement à privilégier car moins traumatiques ; elles écartent les
fibres de la dure-mère et sont associées à un risque plus faible
de céphalées.
Ces céphalées apparaissent dans les heures, voire les jours
qui suivent la ponction. Typiquement postérieures, elles peuvent
s’étendre en avant jusqu’à la région frontale, voire les épaules.
Des nausées ou des vomissements les accompagnent, surtout si
elles sont intenses. Elles persistent de 4 heures à 7 jours. Le trai-
tement repose sur l’hydratation, le repos au lit et les analgésiques
classiques. Cependant, si elles persistent, un blood-patch épi-
dural peut être proposé (7). Lors de céphalées intenses, certains
auteurs utilisent la caféine orale ou intraveineuse (5).
Biopsie transthoracique
La biopsie transthoracique d’une masse intrathoracique réalisée
avec une aiguille fine est en général un acte peu douloureux.
Cependant, en cas de tumeur neurogénique, des douleurs intenses
peuvent être associées (8).
Biopsie prostatique transrectale
Dans une étude prospective, 16 % des patients présentaient une
douleur modérée ou sévère, et 19 % refusaient cette procédure
sans anesthésie (9). Le blocage des nerfs prostatiques par voie
transrectale guidé par échographie est efficace pour limiter la
douleur (10).
Tableau II. Syndromes douloureux aigus liés au cancer (2).
Douleurs aiguës associées aux actes diagnostiques
et thérapeutiques
✓
Douleurs aiguës associées aux actes diagnostiques
– Céphalées après ponction lombaire
– Biopsie transthoracique
– Prélèvement artériel ou veineux
– Biopsie ostéomédullaire
– Ponction lombaire
– Colonoscopie
– Myélogramme
– Biopsie percutanée
✓
Douleurs aiguës postopératoires
✓
Douleurs aiguës associées aux actes thérapeutiques
– Drainage pleural
– Embolisation tumorale
– Cathétérisme vésical suprapubien
– Cathéter intercostal
– Pose de sonde de néphrostomie
– Cryochirurgie
✓
Douleurs aiguës associées aux techniques analgésiques
– Infiltration d’anesthésiques locaux
– Injection de morphinique
– Céphalées des morphiniques
– Syndrome d’hyperalgésie après injection
spinale de morphinique
– Injection péridurale
– Strontium 89
Douleurs aiguës associées au traitement anticancéreux
✓
Douleurs aiguës lors d’une perfusion
de chimiothérapie
– Douleur de la perfusion intraveineuse
Spasme veineux
Phlébite chimique
Extravasation
Réaction aux anthracyclines
– Chimio-embolisation artérielle hépatique
– Chimiothérapie intrapéritonéale
✓
Douleurs aiguës associées à une chimiotoxicité
– Mucites
– Corticoïdes et douleur du périnée
– Arthralgie du Taxol
®
– Pseudorhumatismes des corticoïdes
– Neuropathies périphériques douloureuses
– Céphalées
Syndrome méningé du méthotrexate intrathécal
Thromboses veineuses de la dure-mère associées
à la L-asparaginase
Céphalées de l’acide transrétinoïque
– Douleurs diffuses osseuses
Acide transrétinoïque
Facteurs de stimulation des colonies ostéomédullaires
– Douleurs thoraciques angineuses
du 5-fluorouracile
– Syndrome palmoplantaire
– Gynécomastie postchimiothérapie
– Ischémie digitale aiguë
✓
Douleurs aiguës associées au traitement
par hormonothérapie
– Hormonothérapie du cancer de la prostate
– Hormonothérapie du cancer du sein
✓
Douleurs aiguës associées à l’immunothérapie
– Douleurs de l’interféron
✓
Douleurs aiguës associées aux facteurs
de croissance
– Érythropoïétine
– Facteurs de croissance médullaire
✓
Douleurs aiguës associées à la radiothérapie
– Douleurs incidentes lors de la mobilisation
– Mucites oropharyngées
– Lésions aiguës intestinales et proctologiques
– Plexopathies brachiales précoces
– Myélopathie subaiguë
– Strontium
89
Douleurs aiguës associées à une infection
– Névralgie herpétique aiguë
Douleurs aiguës vasculaires
– Thrombose
– Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs
– Thrombose veineuse profonde des membres supérieurs
– Obstruction de la veine cave supérieure

13
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
Mammographies
La compression des seins lors d’une mammographie est associée
à des douleurs modérées rarement sévères (11).
Douleurs aiguës associées aux actes thérapeutiques
Douleurs postopératoires
Des recommandations pour la prise en charge de la douleur post-
opératoire permettent d’optimiser l’analgésie après une inter-
vention chirurgicale et de limiter sinon d’éviter la chronicisation
de cette douleur aiguë (12).
Douleurs associées à la cryochirurgie
La cryochirurgie du col de l’utérus peut entraîner des douleurs à
type de crampe et de contraction utérine (13).
Douleurs lors d’actes de radiologie interventionnelle
La radiologie interventionnelle est l’une des voies possibles de
la prise en charge antalgique. Lorsque le site ou le point de
départ douloureux a été individualisé, elle permet d’aborder
l’organe en cause par des approches variées : vasculaire,
ponction directe. Le guidage et le repérage utilisent les différents
appareillages radiologiques : radiologie numérisée avec scopie,
scanner, échographie. En cancérologie, elle est devenue une
véritable alternative thérapeutique pour des patients douloureux,
souvent affaiblis, en raison de sa faible morbidité et de son effi-
cacité. Les gestes sont en effet peu invasifs et rapides. Ses prin-
cipales méthodes sont l’embolisation artérielle, l’infiltration de
structures neurologiques (racines, plexus) et les injections
directes intratumorales (alcool, ciment). Cependant, ces actes
nécessitent souvent, pendant leur déroulement, une analgésie
profonde et un suivi postinterventionnel attentif, leur objectif
étant le soulagement de la douleur initiale en évitant toute iatro-
génicité péjorative (14). Lors d’une embolisation tumorale, des
douleurs peuvent apparaître (15).
Douleurs associées aux actes thérapeutiques analgésiques
Infiltration d’anesthésiques locaux
L’infiltration sous-cutanée et intradermique d’un anesthésique
local de type lidocaïne entraîne une sensation brève et intense de
brûlure avant l’installation de l’anesthésie. Des moyens prophy-
lactiques simples ne doivent pas être oubliés en pratique quoti-
dienne, comme l’application du patch Emla®(16) ou, chez
l’enfant, l’inhalation du mélange équimolaire oxygène-protoxyde
d’azote (Kalinox®) (17).
Infiltration d’opioïdes
Les injections sous-cutanées de morphine, très utilisées en
routine, sont douloureuses. Les injections intramusculaires le
sont encore plus et cette voie ne doit plus être utilisée. La dou-
leur dépend du volume injecté et des caractéristiques chi-
miques du morphinique utilisé. Des réactions inflammatoires
peuvent être associées et majorer la douleur, notamment avec
des morphiniques comme la méthadone cependant non utili-
sés par cette voie d’administration en France. L’association
de corticoïdes lors de l’injection pourrait limiter ces réactions
locales (18).
Les injections répétées lors de douleurs incidentes doivent faire
changer la voie d’administration (orale ou intraveineuse).
Céphalées des opioïdes
Les patients développent parfois des céphalées diffuses après la
prise du traitement morphinique. Celles-ci seraient dues à une
libération d’histamine induite par les opioïdes.
Syndrome d’hyperalgésie induit par les opioïdes par voie spinale
L’injection intrathécale ou épidurale de fortes doses d’opioïdes
peut parfois entraîner des douleurs du périnée, de la ceinture pel-
vienne et des membres inférieurs, plus rarement des myoclonies
ou un priapisme (19).
Douleurs des injections épidurales
Des douleurs dorsales, pelviennes ou des membres inférieurs
peuvent être majorées ou déclenchées par une injection ou une
perfusion intrathécale. L’incidence de cette douleur est d’envi-
ron 20 % (20).
DOULEURS AIGU
Ë
S ASSOCIÉES AUX TRAITEMENTS
ANTICANCÉREUX
Douleurs lors des perfusions de chimiothérapie
Perfusions intraveineuses
La douleur au site de perfusion de drogues cytotoxiques est fré-
quente. Quatre situations peuvent être distinguées. Les spasmes
veineux peuvent être limités après l’application de compresses
chaudes ou la réduction du débit de la perfusion. Les phlébites
chimiques peuvent être secondaires à des chimiothérapies cyto-
toxiques (amarsarcine, dacarbazine, carmustine, vinorelbine), à
la perfusion de chlorure de potassium ou de solutions hyperos-
molaires. Une ligne érythémateuse et une douleur apparaissent.
L’extravasation du produit cytotoxique, complication plus
sérieuse, est à l’origine d’une douleur intense, avec desquama-
tion et ulcération (21). Un échauffement bref peut être associé à
l’administration intraveineuse d’anthracyclines, notamment la
doxorubicine. Il peut être contemporain d’une urticaire locale et
certains patients décrivent une douleur (22).
Perfusion de l’artère hépatique
L’infusion cytotoxique au niveau de l’artère hépatique est sou-
vent liée à des douleurs diffuses abdominales (23). Une infu-
sion continue peut amener à une douleur persistante. L’inter-
ruption du traitement fait disparaître la douleur. Un effet dose
est probable, certains patients tolèreront en effet de nouveau
l’infusion à des doses plus faibles par la suite. Chez certains
patients, la douleur est liée à une lésion ulcérée gastrique ou à
une inflammation des voies biliaires.
Chimiothérapie intrapéritonéale
La douleur est une complication fréquente des chimiothéra-
pies intrapéritonéales. Une douleur abdominale brève, asso-
ciée à une sensation de gonflement, de ballonnement, est
décrite chez 25 % des patients (24). Environ 25 % de ces

MISE AU POINT
14
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
patients ont une douleur sévère nécessitant un traitement mor-
phinique ou l’arrêt du traitement. La douleur est due à un
épanchement séreux ou à une infection. Cette complication est
fréquente avec des molécules comme les anthracyclines
(mitoxantrone, doxorubicine) ou le paclitaxel mais elle l’est
moins avec le 5-flurouracile ou le cisplatine.
Chimiothérapie ou immunothérapie intravésicales
Une irritabilité vésicale ou des signes transitoires de cystite peu-
vent apparaître.
Douleurs aiguës liées à une chimiotoxicité
Mucites
Des mucites sévères sont pratiquement systématiques lors d’une
chimiothérapie ou d’une radiothérapie aplasiante. Le plus sou-
vent localisées au niveau de la cavité orale, du pharynx, elles peu-
vent s’étendre vers l’œsophage, l’estomac ou l’intestin, entraî-
nant d’autres types de douleurs (odynophagie, dyspepsie,
diarrhées). Des surinfections à Candida albicans ou Herpes sim-
plex sont fréquentes. Les mucites sévères nécessitent un traite-
ment local mais aussi une analgésie systémique. Récemment,
ont été utilisés l’analgésie autocontrôlée par le patient, la cap-
saïcine orale et le tétrachlorodécaoxyde (25).
Inconfort périnéal secondaire aux corticoïdes
Une sensation brève de brûlure du périnée est décrite par certains
patients après perfusion rapide de fortes doses de dexaméthasone
(20 à 100 mg) (26). L’injection lente évite cet effet.
Pseudorhumatismes des stéroïdes
Le sevrage des corticostéroïdes peut entraîner un syndrome dou-
loureux associant des myalgies et des arthralgies, rapidement ou
de façon plus retardée après l’arrêt du traitement. La prise de cor-
ticoïdes peut être au long cours ou de durée brève. Le mécanisme
physiopathologique est peu connu. Il semble que le sevrage sen-
sibilise les mécanorécepteurs et les nocicepteurs musculaires et
articulaires. Il convient alors de réintroduire le traitement à dose
supérieure puis de l’interrompre plus progressivement (27).
Neuropathies périphériques douloureuses
Des neuropathies périphériques douloureuses aiguës ou subaiguës
peuvent être induites par la chimiothérapie, de façon dose-dépen-
dante. Elles sont habituellement associées au cisplatine, aux vinca-
alcaloïdes (plus particulièrement la vincristine) ou au paclitaxel (28).
D’autres tableaux douloureux aigus probablement neuropathiques
associant des douleurs des membres, des mâchoires, de l’abdo-
men peuvent apparaître et durer quelques heures ou jours. La vin-
cristine peut être à l’origine de douleurs orofaciales trigéminées
ou dans le territoire du nerf glosso-pharyngien chez 50 % des
patients au début du traitement. Dans 50 % des cas, la douleur
est sévère ; elle dure 1 à 3 jours. Elle peut réapparaître, mais elle
est alors moins intense (29).
Céphalées
Le méthotrexate injecté par voie intrathécale entraîne un syn-
drome méningé intense chez 5 à 50 % des patients. Les cépha-
lées sont prédominantes, mais des vomissements, une raideur de
nuque, de la fièvre, des troubles de conscience peuvent apparaître.
Ces symptômes surviennent dans les heures qui suivent l’injec-
tion et persistent plusieurs jours. Les patients les plus à risque
sont ceux ayant déjà eu de multiples injections et ceux présen-
tant des métastases méningées (30).
L’administration systémique de L-asparaginase est à l’origine
d’une thrombose des veines intracérébrales ou des sinus veineux
duraux chez 1 à 2 % des patients (31). Cette complication appa-
raît typiquement après quelques semaines de traitement. Elle est
expliquée par une réduction des protéines impliquées dans la
coagulation et la fibrinolyse. Les céphalées sont donc le pre-
mier symptôme, complété parfois par une hémiparésie, un
délire, une paralysie des nerfs crâniens, des vomissements. Des
examens complémentaires radiologiques sont indispensables
en urgence.
L’acide transrétinoïque peut également provoquer des cépha-
lées intenses transitoires.
Douleurs osseuses diffuses
Elles sont le fait de l’acide transrétinoïque. Elles sont d’intensité
variable et associées à une neutrophilie transitoire. La douleur
serait due à une expansion de la moelle osseuse comme cela a éga-
lement été observé après l’administration de facteurs de stimula-
tion médullaires (32).
Arthralgies et myalgies induites par le paclitaxel
Des myalgies et/ou arthralgies sont observées chez 10 à 20 % des
patients recevant du paclitaxel 1 à 4 jours après l’administration.
Elles persistent pendant 3 à 7 jours (33).
Douleurs thoraciques angineuses induites
par le 5-fluorouracile (5-FU)
Des douleurs ischémiques thoraciques apparaissent après perfu-
sion continue de 5-fluorouracile, d’autant plus que les patients
présentent déjà une pathologie coronarienne connue. Le méca-
nisme le plus probable est un vasospasme (34).
Syndrome érythrodysesthésique palmoplantaire
Après perfusion de 5-FU, peut apparaître, dans 40 à 90 % des
cas, une douleur à type de brûlure, de picotement des paumes
des mains et de la voûte plantaire suivie d’un rash érythéma-
teux de même localisation. Le rash se caractérise par un éry-
thème soudain, intense, bien localisé, puis des bulles, une
desquamation et la guérison apparaissent. La physiopatholo-
gie de ce syndrome n’est pas connue. Des mesures sympto-
matiques suffisent au traitement (35). Ces manifestations peu-
vent survenir également après perfusion de doxorubicine.
Gynécomastie après chimiothérapie
Une gynécomastie peut apparaître après un délai de 2 à 9 mois.
Elle disparaît spontanément après quelques mois. Une pertur-
bation de la sécrétion androgène après cytotoxiques est le méca-
nisme le plus probable. Chez les patients porteurs de cancer
des testicules, elle doit être différenciée des gynécomasties en
rapport avec une récidive précoce (36).

15
La Lettre du Cancérologue - Volume XV - n° 1 - janvier-février 2006
Ischémie aiguë digitale après chimiothérapie
Des phénomènes de Raynaud ou des ischémies transitoires des
orteils sont une complication fréquente lors de la prise de bléo-
mycine, de vincristine ou de cisplatine. Une ischémie digitale irré-
versible avec gangrène a été rapportée après bléomycine (37).
Douleurs aiguës associées à l’hormonothérapie
Ces douleurs sont associées au LHRF (Luteinizing Hormone
Releasing Factor) dans les cancers de la prostate dans 5 à 25 %
des cas : elles se présentent comme une exacerbation de douleurs
osseuses ou de rétention urinaire dans la première semaine de trai-
tement, et durent une à trois semaines. La coadministration
d’antagonistes des androgènes au début du traitement par LHRF
prévient la symptomatologie (38).
Douleurs induites par l’hormonothérapie
dans les cancers du sein
Des douleurs musculaires et osseuses brutales, diffuses, peuvent
débuter dans les heures ou les semaines qui suivent le début du
traitement. Elles peuvent être associées à un érythème autour de
métastases cutanées, à des perturbations de la fonction hépatique,
et à une hypercalcémie (39).
Douleurs associées à l’immunothérapie
Douleurs aiguës de l’interféron
La plupart des patients développent un tableau aigu associant de
la fièvre, des myalgies et arthralgies, des céphalées, des frissons.
Précoce dès le début du traitement, il s’améliore au cours du trai-
tement. La sévérité dépend du type d’interféron, de la voie
d’administration, de la dose et du protocole. Ces symptômes sont
améliorés par l’administration préalable d’acétaminophène.
Douleurs associées aux facteurs de croissance
Elles correspondent aux douleurs musculo-squelettiques des fac-
teurs de stimulation des cellules souches médullaires.
Douleurs lors de l’injection d’érythropoïétine (EPO)
Des douleurs sont associées à l’injection sous-cutanée d’EPO
dans 40 % des cas (40).
Douleurs aiguës associées à la radiothérapie
Des douleurs incidentes peuvent être déclenchées lors du trans-
port ou de la mobilisation pour la radiothérapie.
Mucites oropharyngées
Elles sont fréquentes, parfois suffisamment intenses pour gêner
l’alimentation, et peuvent persister plusieurs semaines après la
fin de la radiothérapie.
Entérites ou recto-anites aiguës
Elles apparaissent chez 50 % des patients lors d’une radiothéra-
pie abdominale ou pelvienne. Les douleurs abdominales sont à
type de crampes et s’associent à des nausées ou des vomissements
et/ou à des douleurs avec ténesmes. Des diarrhées et des saigne-
ments surviennent lors de lésions proctologiques. Le tableau
s’améliore après la fin du traitement parfois en 2 à 6 mois (41).
Plexopathies brachiales précoces
Des plexopathies brachiales transitoires ont été décrites immé-
diatement après radiothérapie de cancer du sein. L’incidence de
ce phénomène est estimée à 1,4 à 20 %. Des paresthésies sont plus
fréquentes que des douleurs ou des troubles moteurs. Leur surve-
nue ne préjuge pas de celle d’une plexopathie chronique (42).
Myélopathie subaiguë postradique
Elle apparaît dans les semaines ou les mois qui suivent la fin du
traitement. Elle disparaît le plus souvent spontanément après une
période de 3 à 6 mois.
Les radioéléments
Le strontium89, le rhenium186 et le samarium153, administrés lors
de métastases osseuses, peuvent aggraver un tableau douloureux
de façon transitoire 1 à 2 jours après l’administration et pendant
3 à 5 jours chez 15 à 20 % des patients (43).
DOULEURS AIGUËS ASSOCIÉES À UNE INFECTION
C’est le cas des névralgies herpétiques aiguës. La douleur pré-
cède en général de plusieurs jours l’éruption et peut parfois sur-
venir sans aucune lésion cutanée. La douleur est lancinante ou
continue et disparaît en deux mois. Au-delà, on parle de névral-
gie postherpétique. Le dermatome est souvent en rapport avec
la localisation initiale du cancer : au niveau lombosacré pour
les tumeurs génito-urinaires, au niveau thoracique pour les can-
cers pulmonaires ou mammaires, au niveau cervical pour les
maladies hématologiques. Le risque de développer une névral-
gie est multiplié par deux en cas d’irradiation antérieure du der-
matome (44).
DOULEURS AIGUËS ASSOCIÉES AUX THROMBOSES
VEINEUSES PROFONDES
Les thromboses sont la complication la plus fréquente et la
deuxième cause de décès chez les patients cancéreux (45). Les
localisations les plus à risque sont les tumeurs du pelvis, les can-
cers du pancréas et de l’estomac, les cancers du sein avancés et
les tumeurs cérébrales. Les thromboses peuvent précéder le dia-
gnostic de plusieurs mois ou années. Le contexte postopératoire,
la chimiothérapie et l’hormonothérapie sont également des fac-
teurs de risques de thrombose.
Les veines des membres inférieurs sont le plus souvent throm-
bosées ; dans 2 % des cas, il s’agit des veines des membres supé-
rieurs. L’obstruction de la veine cave supérieure est le plus sou-
vent en rapport avec une compression extrinsèque par des
adénopathies médiastinales. La thrombose de la veine mésenté-
rique est le plus souvent associée à un état d’hypercoagulabilité.
ACCÈS DOULOUREUX TRANSITOIRES CHEZ LES PATIENTS
DOULOUREUX RECEVANT DES OPIOÏDES
Ces événements ont une prévalence élevée dans différentes études
(64 à 81 %) (46). Le terme “break through” signifie douleur qui
“traverse” l’analgésie.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%