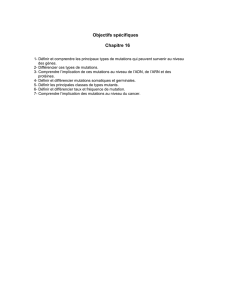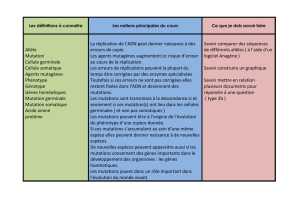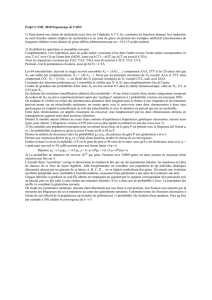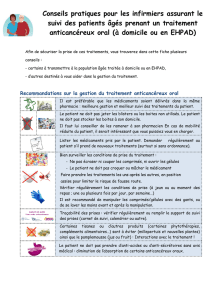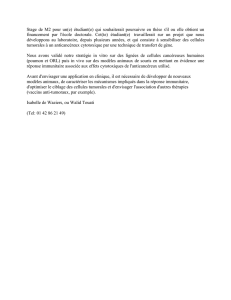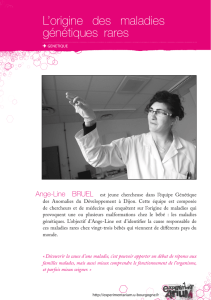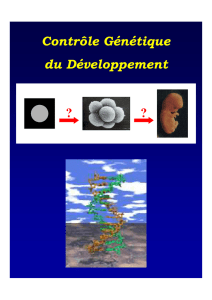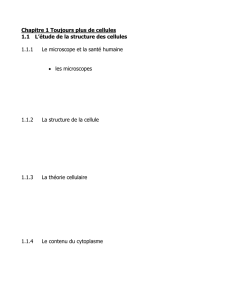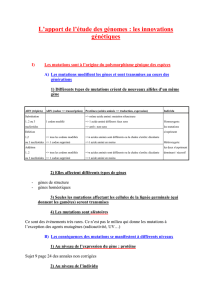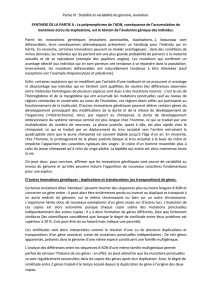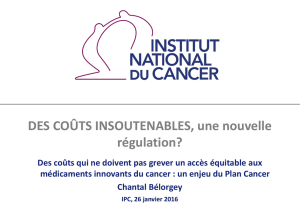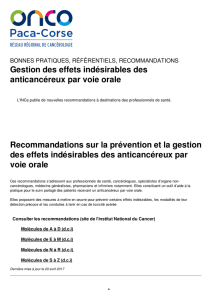Facteurs prédictifs de la réponse à la chimiothérapie : D

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
111
RÉSUMÉ 왘
Le séquençage du génome humain apporte de nouveaux
outils pour l’individualisation de la chimiothérapie des
cancers, d’abord grâce à l’identi cation de polymorphismes
constitutionnels des gènes impliqués dans le métabolisme
ou dans l’activité des médicaments anticancéreux (pharma-
cogénétique), ensuite grâce à l’exploration des mutations
oncogéniques des tumeurs des pro ls d’expression des
gènes tumoraux et de leurs liens avec la chimiosensibilité
et la chimiorésistance (pharmacogénomie). Aux quelques
polymorphismes connus de longue date pour jouer un
rôle dans la toxicité des agents anticancéreux (thiopu-
rine méthyltransférase, glutathion S-transférases) se sont
ajoutés plus récemment des polymorphismes fonctionnels
au niveau des gènes codant pour les protéines-cibles de
certains médicaments (thymidylate synthase), au niveau
des gènes de réparation de l’ADN (XPD) ou au niveau des
protéines de transport (MDR1), qui peuvent jouer un rôle
au niveau de la réponse tumorale. Par ailleurs, la recherche
de corrélations entre pro ls d’expression génique et chimio-
sensibilité a été engagée sur les modèles in vitro du National
Cancer Institute et peut permettre des progrès décisifs
dans l’identi cation des patients pouvant individuellement
béné cier le mieux d’une chimiothérapie spéci que. Des
essais cliniques, d’abord rétrospectifs, puis prospectifs, se
mettent en place pour valider cette approche.
Mots-clés : Métabolisme des agents anticancéreux – Poly-
morphismes génétiques – Pro ls d’expression génique –
Chimiothérapie – Prédiction de réponse.
SUMMARY 왘
Sequencing the human genome brings new tools for the indi-
vidualization of cancer chemotherapy, rstly thanks to the
identi cation of polymorphisms of genes involved in anticancer
drug metabolism or activity (pharmacogenetics), and secondly
thanks to the determination of tumour gene expression pro les
and their relationship to chemosensitivity and chemoresistance
(pharmacogenomics). A few functional polymorphisms have
been identi ed long ago as good predictors of anticancer drug
toxicity (thiopurine methyltransferase, glutathion S-transfer-
ases), but several new ones have been identi ed recently, at
the level of the genes encoding drug targets (thymidylate
synthase), at the level of DNA repair enzymes (XPD) or at the
level of transport proteins (MDR1), and they may play a role
in response to treatment. On the other hand, the research of
correlations between gene expression pro les and chemosensi-
tivity has been performed on the in vitro models of the National
Cancer Institute and may allow crucial improvements in the
identi cation of patients who would best take advantage of
a speci c chemotherapy. Clinical trials, rst on a retrospective
basis, then on a prospective one, are implemented to validate
this approach.
Keywords: Anticancer drug metabolism – Gene polymor-
phisms – Gene expression pro ling – Chemotherapy – Pre-
diction of response.
Facteurs prédictifs de la réponse à la chimiothérapie :
pharmacogénétique et pharmacogénomie1
Predictive factors of response to chemotherapy: pharmacogenetics and pharmacogenomics
●● Jacques Robert*
1 D’après Bull Cancer 2006;hors-série:113-23.
* Laboratoire de pharmacologie des médicaments anticancéreux, université Victor-Segalen
Bordeaux-2, institut Bergonié, Bordeaux.
Il existe en cancérologie une variabilité importante de l’effi -
cacité des médicaments d’un individu à l’autre : les meilleurs
protocoles, dans les cancers réputés chimiosensibles, aboutis-
sent le plus souvent à 50 % de réponses à peine. Cela signifi e que
50 % des patients auront reçu une chimiothérapie lourde, toxique
et coûteuse, sans en tirer d’eff ets bénéfi ques. Il serait donc impor-
tant de pouvoir disposer de paramètres objectifs permettant de
prédire la réponse thérapeutique. Certes, on dispose de facteurs
pronostiques nombreux, tant sur le plan clinique (taille tumo-
rale, envahissement ganglionnaire, conditions de vie) que sur le
plan anatomo-pathologique (grade histopronostique), mais ces
facteurs, s’ils sont utiles au clinicien pour certaines décisions
thérapeutiques, ne lui sont d’aucun secours quant au choix du
protocole susceptible de donner la réponse attendue avec la
plus grande probabilité pour un patient donné.
Les progrès spectaculaires de la biologie moléculaire ont permis
de mettre à la disposition des chercheurs de nouveaux outils très
performants ; parallèlement, notre compréhension des méca-
nismes d’action des médicaments et l’identifi cation des méca-
nismes de résistance ont permis de rechercher les altérations

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
112
des cibles capables de moduler l’activité de ces médicaments.
C’est ainsi que des variations individuelles (polymorphismes) des
gènes codant pour des enzymes comme la thymidylate synthase,
cible du 5-fl uorouracile, ou des protéines de réparation des
lésions de l’ADN causées par les sels de platine comme ERCC1
ont pu être reliées à l’activité thérapeutique de ces molécules.
Par ailleurs, certaines mutations caractérisant la tumeur et
participant au phénomène d’oncogenèse ont pu être reliées
à l’activité de certaines thérapeutiques ciblant le mécanisme
d’oncogenèse en cause. Enfi n, plus globalement, la réalisation
de profi ls d’expression génique de tumeurs a permis d’identifi er
des “signatures moléculaires” de réponse aux médicaments.
Ces nouveaux outils ne sont pas encore intégrés dans la démarche
thérapeutique, et la validation prospective du caractère prédictif
de leur réponse n’a pas encore été réalisée. Ils constituent toute-
fois un domaine de recherche en pleine expansion, car il est
très vraisemblable que certains d’entre eux feront partie, d’ici
quelques années, des bilans préthérapeutiques indispensables
à la décision des cliniciens. La personnalisation des traitements
est un progrès nécessaire, prenant en compte les particularités
individuelles (pharmacogénétique) comme les caractères propres
de chaque tumeur (pharmacogénomie). Nous en présenterons
ici quelques aspects importants et adressons le lecteur à des
revues récentes plus détaillées (1, 2).
POLYMORPHISMES GÉNÉTIQUES
ET PHARMACOLOGIE ANTICANCÉREUSE
Généralités
Le support de la variabilité génétique de la réponse aux médi-
caments réside dans les polymorphismes génétiques observés
au niveau des transporteurs de médicaments, des enzymes qui
les activent ou les détoxiquent et des cibles protéiques de ces
médicaments, comme la tubuline ou le récepteur de l’EGF. Le
séquençage du génome humain permet d’appréhender cette
variabilité génétique, dont le rôle en pharmacologie était suspecté
depuis longtemps et dont seuls quelques exemples avaient été
identifi és. Les polymorphismes génétiques se présentent sous
deux formes principales :
les altérations ponctuelles de séquence (SNP,
✓
single nucleotide
polymorphism),
les altérations plus larges (délétions, insertions, remanie-
✓
ments).
Les SNP sont nombreux dans le génome humain ; on estime
leur fréquence à environ une altération toutes les 1 000 paires
de bases, ce qui en fait environ 3 000 000 dans le génome entier.
Tous n’ont pas des conséquences fonctionnelles, mais plusieurs
milliers ou dizaines de milliers peuvent en avoir. Trois types
d’altérations sont distinguées.
Les altérations majeures 쐌
– Formation d’un codon stop dans une séquence codante ; consé-
quence : pas de protéine ou protéine tronquée et inactive ;
– Mutation au niveau d’une jonction exon-intron nécessaire à
l’épissage ; conséquence : formation d’une protéine de structure
altérée.
Les altérations mineures
쐌
– Mutation au niveau de la séquence protéique ; conséquence :
variable selon la position de l’altération au niveau de la séquence
de la protéine (centre actif, domaine de régulation, etc.) ;
– Mutation au niveau du promoteur ou d’une séquence régu-
latrice ; conséquence : absence, réduction ou stimulation de la
transcription du gène.
Les altérations silencieuses 쐌
– Mutation sans conséquence pour la séquence protéique (en
raison de la dégénérescence du code génétique) ;
– Mutation survenant dans une zone non codante (introns).
Les altérations majeures entraînent la perte de l’activité de la
protéine codée par le gène altéré et peuvent être à l’origine de
maladies héréditaires du métabolisme. En pharmacogénétique,
elles peuvent concerner les enzymes du métabolisme des xéno-
biotiques et ne se manifester que lors du contact du sujet avec ces
xénobiotiques (cytochrome CYP3A5, glutathion S-transférase M).
Les altérations mineures seront les plus importantes pour le
pharmacologue ; généralement sans traduction pathologique,
elles sont à l’origine de la variabilité individuelle des eff ets des
médicaments. Enfi n, les altérations silencieuses ne le sont parfois
qu’en apparence : même sans altération de la séquence protéique,
elles peuvent concerner une zone régulatrice de l’expression du
gène (cas de la mutation C3435T du gène ABCB1).
Recherche et identi cation des polymorphismes
génétiques
Le séquençage du génome a permis la constitution de bases de
données recensant les SNP au fur et à mesure de leur identifi -
cation. Dans les bases publiques et privées, on compte actuelle-
ment 2 500 000 SNP identifi és. Toutefois, rien dans ces bases de
données n’indique la fréquence de ces variants, pas plus que les
conséquences fonctionnelles des variations. En outre, un certain
nombre de ces variants relèvent d’erreurs de séquençage et une
remise à jour périodique des bases de données est nécessaire.
Pour rechercher la présence de polymorphismes dans un gène
d’intérêt, les outils privilégiés seront la polymerase chain reaction
(PCR) suivie d’une coupure sur un site de restriction spécifi que
de l’altération polymorphique, la dHPCL (denaturing high-
performance liquid chromatography) et le séquençage global ou
partiel. Le problème est évidemment diff érent selon que l’on veut
découvrir des SNP au niveau d’un gène, génotyper un individu
ou une population en ce qui concerne des polymorphismes déjà
connus, ou encore rechercher les conséquences fonctionnelles
de certains polymorphismes.
La découverte des polymorphismes fait bien sûr appel essen-
tiellement au séquençage de tout ou partie du gène, éventuel-
lement après PCR réalisée au niveau des exons et des jonctions
intron-exon qui sont les parties les plus “signifi antes” du gène.
Pour éviter la lourdeur du séquençage, la dHPLC off re une
alternative intéressante, car elle permet de détecter, dans un

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
113
fragment obtenu par PCR, l’existence d’une variation allélique.
Les seuls fragments manifestant l’existence d’un polymorphisme
seront alors séquencés afi n de localiser ce polymorphisme. La
technologie de recherche des polymorphismes génétiques a fait
l’objet de revue vers laquelle nous renvoyons le lecteur (3).
Le génotypage rapide de polymorphismes connus a longtemps
fait appel à la technique de PCR suivie de RFLP (restriction
fragment length polymorphism), mais la nécessité que la
variation crée ou supprime un site de restriction rend cette
technique inopérante dans certains cas. Il existe d’autres tech-
niques reposant sur la PCR, telles la CAPS (cleaved amplifi ed
polymorphic sequences) ou l’AFLP (amplifi ed fragment length
polymorphism). Des techniques utilisant des arrays peuvent
être proposées pour des génotypages à grande échelle (variable
detector arrays, VDA).
Enfi n, la recherche du rôle fonctionnel des polymorphismes est
l’étape la plus délicate, car elle ne fait pas seulement appel à des
banques génomiques, mais à des banques tissulaires dont les
échantillons seront utilisés pour évaluer l’expression du gène
ou l’activité de l’enzyme. À défaut, des données plus globales
peuvent être obtenues sur l’individu entier, au niveau phar-
macocinétique (concentration plasmatique d’un métabolite
par exemple) ou au niveau pharmacodynamique (effi cacité et
toxicité).
Quelques polymorphismes intéressants
en oncopharmacologie
Nous ne ferons pas ici l’inventaire de tous les polymorphismes
identifi és parmi les gènes intervenant dans le transport ou dans
le métabolisme des médicaments anticancéreux, car ce sujet est
traité dans d’autres articles de ce numéro. Nous nous limite-
rons aux enzymes cibles de médicaments anticancéreux et aux
protéines de réparation de l’ADN.
La thymidylate synthase 쐌
Elle est la cible du 5-fl uorouracile et de certains analogues foli-
ques. Plusieurs études ont montré que son niveau d’expression
était inversement corrélé à la réponse au 5-fl uorouracile (cf.
par exemple [4]). Un facteur régulant l’expression de l’enzyme
réside dans un polymorphisme situé au niveau du promoteur
(5) : il existe un variant ayant 2 répétitions (au lieu de 3) en
tandem d’une séquence de 28 paires de bases. L’homozygote
commun 3R (3 repeats) présente une expression du gène 3 fois
supérieure à celle de l’homozygote variant 2R (2 repeats) : il
peut en résulter une diff érence d’effi cacité et de toxicité du
fl uorouracile chez les variants. Ce polymorphisme apparaît
particulièrement intéressant en raison de sa prévalence, l’allèle
2R ayant une fréquence d’environ 30 %, ce qui correspond à
environ 10 % de sujets homozygotes variants. Une étude du
groupe de H.J. Lenz à Los Angeles (6) a montré une diff érence
signifi cative de la réponse des patients traités par 5-fl uoroura-
cile pour un cancer colorectal, avec 9 % des répondeurs parmi
les homozygotes 3R, 15 % parmi les hétérozygotes 2R/3R et 50 %
parmi les homozygotes 2R. Ces résultats n’ont pas toujours été
retrouvés, et on s’est aperçu que le troisième repeat pouvait
porter une variation ponctuelle (SNP remplaçant une guanine
par une cytosine), déterminante pour le niveau d’expression
du gène (7). Les allèles porteurs d’un G (génotypes 2R/3G,
3C/3G, 3G/3G) ont un niveau d’expression élevé, les allèles
porteurs d’un C (génotypes 2R/2R, 2R/3C, 3C/3C) un niveau
d’expression faible. Un troisième polymorphisme résulte d’une
délétion de 6 nucléotides dans la région non traduite en 3' et
serait associé à une diminution d’expression du gène (8). Il
apparaît donc nécessaire, si l’on souhaite corréler l’expression
du gène (de laquelle dépend l’activité du 5-fl uorouracile) et
le polymorphisme, de prendre en compte l’ensemble de ces
polymorphismes.
Les protéines de réparation de l’ADN
쐌
La réparation de l’ADN joue un rôle important dans les eff ets
des agents anticancéreux et constitue un déterminant crucial de
l’effi cacité et de la toxicité des agents qui endommagent l’ADN,
directement ou indirectement. Cette réparation est également
impliquée dans celle des lésions induites par les agents cancéro-
gènes, et leurs polymorphismes constituent souvent un facteur
de risque, parfois de protection, de la cancérogenèse liée aux
agents chimiques ou aux radiations. Il est parfois diffi cile de
faire la part des choses entre l’aspect épidémiologique et l’aspect
pharmacologique, et les études cliniques de pharmacogénétique
destinées à identifi er des facteurs de prédiction de réponse ou
de toxicité des agents anticancéreux, et non de simples facteurs
pronostiques indépendants du traitement, doivent être rigou-
reuses.
Un polymorphisme a été identifi é sur le gène ERCC2, codant
pour la protéine XPD, une hélicase impliquée dans le phéno-
mène NER (nucleotide excision repair) : une mutation A > C
conduit à une substitution Lys751Glu, avec une fréquence de
l’allèle variant de l’ordre de 30 %. Dans une étude du groupe de
A.J. Lenz (9), portant sur 73 patients traités pour cancer colo-
rectal en troisième ligne par 5-fl uorouracile et oxaliplatine, les
homozygotes porteurs de la variation ont présenté une survie
signifi cativement plus brève que les homozygotes communs.
Nous avons reproduit ce résultat sur une cohorte de patients
traités en première ligne par 5-fl uorouracile et oxaliplatine, et
montré qu’il s’agissait bien d’un facteur prédictif de réponse et
non d’un facteur pronostique global, car le génotype semble
ne jouer aucun rôle dans la survie des patients traités par 5-
fl uorouracile et irinotécan (fi gure 1).
Le gène ERCC1 est sujet à un polymorphisme “synonyme”, la
protéine, également impliquée dans le NER, conservant la même
séquence d’aminoacides (Asn118Asn) ; mais la traduction utilise
un codon d’usage peu fréquent, ce qui entraîne une diminution
signifi cative de son expression. Ce polymorphisme, de fréquence
allélique également proche de 30 %, a été associé de façon signi-
fi cative à la réponse des patients traités par 5-fl uorouracile et
oxaliplatine pour un cancer colorectal (10) et pourrait être,
comme le polymorphisme de ERCC2, un facteur prédictif de
réponse à l’oxaliplatine. Des résultats analogues ont été obtenus
pour le cancer du poumon non à petites cellules. Dans ce cancer,
un lien très signifi catif a été observé entre la survie de patients

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
114
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0510
mois
WT
Survie sans récidive
par FolFOx
HT + Var
p = 0,0035
15 20 25 30
Probabilité
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0510
mois
WT
Survie sans récidive
par FolFlri
HT + Var
p = 0,888
15 20 25 30
Probabilité
Figure 1. Courbes de survie de patients atteints d’un cancer colorectal et traités en première ligne par une association 5- uorouracile + oxaliplatine ou
5- uorouracile + irinotécan. Les porteurs de la variation Lys751Gln du gène XPD (à l’état homozygote ou hétérozygote) traités par oxaliplatine ont présenté une survie
sans récidive deux fois plus brève que les homozygotes communs. Cette di érence n’est pas observée chez les patients traités par irinotécan. D’après (15, 16).
traités par un sel de platine et l’expression d’ERCC1 obtenue
par immunohistochimie (11). Il est, à l’heure actuelle, diffi cile
de prédire si c’est la recherche du polymorphisme – que l’on
détermine facilement et sans ambiguïté dans un échantillon de
sang – ou la recherche de l’expression du gène – qui nécessite
un prélèvement tumoral et est sans doute plus sujette à inter-
prétation – qui deviendra le test biologique permettant le choix
du traitement par l’oncologue.
La protéine XRCC1 intervient dans la réparation par excision
de base (BER). Le polymorphisme Arg399Gln (fréquence allé-
lique de l’ordre de 30 %) est associé à une augmentation du
risque de cancer du poumon et pourrait jouer un rôle dans la
réponse au traitement par sel de platine. J. Stoehlmacher et al.
(12) ont étudié une population de 61 patients atteints de cancer
colorectal et traités par oxaliplatine. Ils ont observé une propor-
tion de répondeurs plus élevée chez les patients de génotype
homozygote commun (8/25) que chez les autres patients (3/36).
Cette observation est diffi cile à concilier avec l’augmentation
du risque de cancer et nécessite d’être confi rmée.
La cycline D1
쐌
La cycline D1 est le produit d’un gène de réponse aux facteurs de
croissance très anciennement identifi é. L’augmentation de son
expression est le refl et de l’activation de la voie des MAP kinases
en aval de l’action des facteurs de croissance. Un polymorphisme
de ce gène (A870G) a été récemment associé à l’effi cacité du
cétuximab, un anticorps dirigé contre le récepteur de l’EGF qui
bloque cette voie de transduction des signaux (13), les patients
de génotype variant ayant une survie signifi cativement plus
longue que les patients de génotype commun. Il est impossible
de savoir, en l’état actuel des connaissances, si ce polymorphisme
est associé ou non à une modifi cation de l’expression du gène
ou si un autre mécanisme reliant polymorphisme et réponse
au traitement est à rechercher.
Les protéines p53 et MDM2 쐌
Outre les mutations bien connues, dont nous étudierons plus
loin l’impact sur la chimiosensibilité, la protéine p53 présente un
polymorphisme de fréquence allélique d’environ 25 %, variable
selon les ethnies. Ce polymorphisme résulte d’un remplacement
d’une proline par une arginine sur le codon 72. Il a été montré
que le variant Arg
72
était capable d’induire l’apoptose de façon
plus active que le variant Pro72 dans les cellules n’ayant pas de
mutation invalidante de p53. Cela serait dû à une diff érence dans
la capacité de la molécule à induire le relargage du cytochrome c
dans le cytoplasme (14). Dans les modèles in vitro, la réponse à des
médicaments comme le cisplatine ou la doxorubicine est supérieure
pour les cellules exprimant l’allèle Arg
72
par rapport à celles expri-
mant l’allèle Pro72, et cela a été confi rmé chez des patients traités
par cisplatine pour un cancer des voies aérodigestives supérieures,
avec une survie plus brève chez les patients portant l’allèle Pro72
à l’état homozygote lorsque la protéine p53 ne présente pas de
mutation invalidante, le contraire étant observé lorsque la protéine
p53 est mutée. Dans une étude sur les cancers du sein traités par
tamoxifène en situation adjuvante, il a été montré que les patientes
ayant au moins un allèle Pro72 avaient une survie sans récidive
signifi cativement plus longue que celles qui n’en ont aucun.
La protéine MDM2, qui peut entraîner p53 vers le protéasome
lorsque celle-ci n’est pas activée, porte également un polymor-
phisme fonctionnel intronique (T309G) de fréquence allélique

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
115
voisine de 30 % (15). Le gène variant aurait une affi nité supérieure
pour l’activateur transcriptionnel Sp1, ce qui générerait des
concentrations plus élevées de protéine MDM2 et une atténua-
tion de la voie p53 susceptible de conséquences sur le risque de
cancer et la sensibilité des tumeurs au traitement.
Les cytochromes P450
쐌
Les cytochromes P450 constituent une famille d’acteurs fonda-
mentaux dans le métabolisme des médicaments. Certains, comme
le CYP1A1, jouent essentiellement un rôle d’activateur des agents
cancérogènes, alors que d’autres, comme le CYP3A4, jouent un
rôle majeur dans l’activation ou la détoxication d’agents anticancé-
reux. Ce dernier, bien que présentant une variabilité individuelle
extrême, ne porte pas de polymorphismes fréquents suscepti-
bles d’intervenir dans la prescription. Le CYP2D6 mérite une
attention particulière : il a été montré qu’il était responsable de
l’activation du tamoxifène en 4-hydroxy-tamoxifène et 4-hydroxy-
N-desméthyl-tamoxifène. Environ 6 % des Caucasiens et 1 % des
Asiatiques n’ont aucune activité enzymatique décelable, car ils
sont homozygotes pour des variations génétiques invalidant la
protéine ; un petit pourcentage de patients, surtout caractérisé
dans les populations d’Afrique orientale, présente une activité très
élevée (métaboliseurs ultrarapides) due à la présence de copies
surnuméraires du gène, le reste des sujets étant des métaboliseurs
extensifs (génotype commun) ou intermédiaires (sujets hétéro-
zygotes pour l’une ou l’autre des mutations délétères).
L’eff et du génotype 2D6 a été étudié chez des femmes atteintes
de cancer du sein traitées par tamoxifène en situation adju-
vante. Une étude a rapporté une diminution signifi cative de la
survie sans progression chez les patientes ayant un génotype
homozygote pour la variation CYP2D6*4, la plus fréquente chez
les Caucasiens, par rapport aux patientes ayant un génotype
hétérozygote ou homozygote commun (17). Le polymorphisme
pourrait expliquer la résistance au tamoxifène, que l’on observe
lors de récidives très précoces survenant sous traitement. Les
inhibiteurs du CYP2D6 pourraient mimer cette situation et
compromettre l’effi cacité du traitement.
DES VARIATIONS GERMINALES AUX MUTATIONS
TUMORALES
Généralités
Alors que les polymorphismes génétiques sont des variations
constitutionnelles identifi ées au fur et à mesure du séquençage
du génome et présentes à une fréquence appréciable dans les
populations humaines, les mutations tumorales sont des événe-
ments caractéristiques de l’oncogenèse. On sait, depuis le travail
pionnier de l’équipe de R.A. Weinberg, que trois événements
oncogéniques sont nécessaires à la transformation d’une lignée
fi broblastique humaine normale en une lignée cancéreuse et
tumorigène. On pensait que les tumeurs humaines sporadi-
ques contenaient un nombre, certes variable, mais restreint, de
tels événements mutationnels. Le récent travail de l’équipe de
B. Vogelstein a montré qu’un nombre très élevé de mutations
participant à l’oncogenèse pouvait apparaître dans le génome
tumoral : de 4 à 23 dans le cancer du sein, de 3 à 18 dans le cancer
du côlon (18). Le grand projet de séquençage des génomes tumo-
raux (http://www.sanger.ac.uk/genetics/CGP) viendra compléter
ces données et apportera de nouvelles bases de données à la
communauté scientifi que.
La compréhension des mécanismes de l’oncogenèse, commencée
en 1975 avec la découverte des oncogènes, a ouvert, vingt-cinq
ans après, un nouveau champ thérapeutique en oncologie, celui
des thérapeutiques dites “ciblées”, le ciblage en question étant
précisément celui de l’oncogenèse elle-même et non plus de telle
ou telle protéine impliquée dans la prolifération cellulaire. Ces
nouvelles thérapeutiques sont, à l’heure actuelle, représentées
majoritairement par des anticorps ciblant le plus souvent la partie
extracellulaire de récepteurs de facteurs de croissance dont la
surexpression contribue à l’oncogenèse, et par des inhibiteurs
des activités de protéines membranaires ou cytoplasmiques
participant respectivement à la réception ou à la transduction
des signaux mitogènes. L’activité des thérapies ciblées est condi-
tionnée par l’existence et l’activation, dans la tumeur traitée, du
mécanisme oncogénique ciblé. Il n’est donc pas surprenant que
l’activité de ces thérapies soit associée à certaines altérations
oncogéniques et que, dans le futur, on puisse ne les prescrire
que si l’altération oncogénique est bien présente dans la tumeur
à traiter. Nous en verrons ci-dessous plusieurs exemples.
À côté de ces mutations tumorales associées à la fois à l’activa-
tion d’une voie oncogénique et à l’activité d’une thérapeutique
ciblée, des mutations des protéines cibles d’agents anticancéreux
classiques, comme la tubuline ou les topoisomérases, ont été
décrites dans des lignées résistantes sélectionnées. Ces mutations
ne semblent pas jouer un rôle dans la résistance clinique des
patients et ne peuvent pas, en l’état actuel de nos connaissances,
être proposées comme facteurs prédictifs de la réponse théra-
peutique. Nous ne les citerons que brièvement.
Le récepteur de l’epidermal growth factor
Le développement en phase II du gefi tinib, un inhibiteur de
l’activité tyrosine kinase du récepteur de l’EGF, a montré aux
États-Unis, dans le cancer du poumon non à petites cellules, un
taux de réponses relativement faible mais signifi catif d’environ
10 %. Simultanément, les Japonais obtenaient de façon nette un
taux de réponses supérieur, proche de 18 %. Lors des études de
phase III de cette nouvelle thérapeutique “ciblée”, l’eff et attendu
sur la survie des patients recevant du gefi tinib associé à une
chimiothérapie conventionnelle n’a pas été observé. Ce n’est
qu’après cet échec qu’a été découverte la cause de ces observa-
tions : le gefi tinib n’est actif que sur les tumeurs pulmonaires
présentant une mutation oncogénique du récepteur de l’EGF,
au niveau du site catalytique de l’enzyme (19, 20), et ces muta-
tions apparaissent sur un fond génétique particulier : elles sont
plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, chez les
Asiatiques que chez les Occidentaux, chez les non-fumeurs que
chez les fumeurs, et dans les adénocarcinomes que dans les
tumeurs épidermoïdes. Si le lien mécanistique entre le génome
constitutionnel et le génome tumoral n’a pas été établi, il n’en
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%