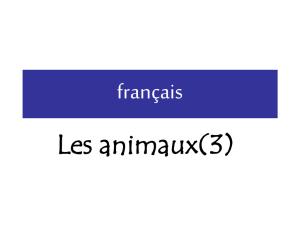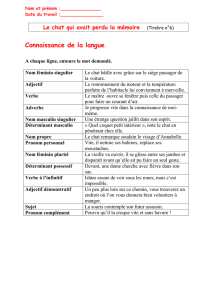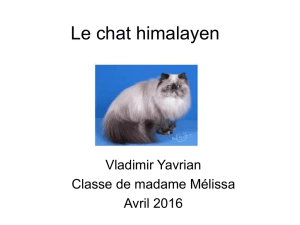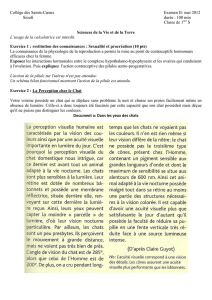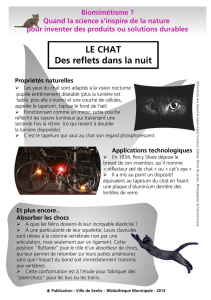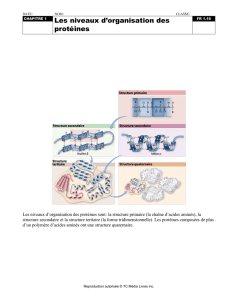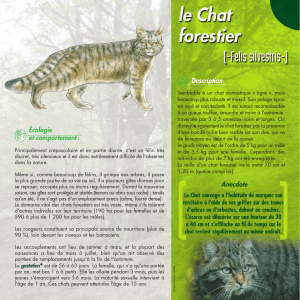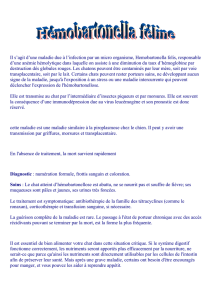M. DIEZ - Zimages

1
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
PROGRAMME GÉNÉRAL NUTRITION - ALIMENTATION - DIÉTÉTIQUE
Le suivi pondéral est évidemment l’outil le
plus pertinent, à condition de disposer d’une
balance suffisamment précise pour l’évalua-
tion du poids corporel (PC), mais le score,
fixé lors de la première consultation pour un
animal présenté adulte est cependant utile. En
effet, ces 25 dernières années, le PC des chats
a eu tendance à augmenter à cause de la sté-
rilisation et de la sédentarité mais également
en raison de la sélection de races plus grandes
et par conséquent plus lourdes. Un « grand »
chat de 5 kg peut dès lors parfois présenter un
score normal alors que ce PC serait excessif
chez un animal de petite taille. Sur l’échelle
de 1 à 9, on considère que 6/9 correspond
à un excès pondéral de moins de 15 % alors
qu’à partir de 7/9, chaque point correspond à
un excès de 10 à 15 %. Un excès pondéral de
6/9 est un signal qu’il convient de prendre en
considération, ce qui signifie concrètement : 1)
revoir le rationnement énergétique (appliquer
notamment le coefficient de stérilisation de
0,7), 2) choisir un aliment riche en fibres de
type « animal stérilisé » ou « chat d’intérieur»,
3) mettre en place un suivi régulier du poids
corporel. En revanche, à ce stade de 6/9, il
n’est pas nécessaire de prescrire un aliment
hypoénergétique destiné à traiter l’excès pon-
déral. On réservera donc ces aliments à des
chats de score corporel égal ou supérieur à
7/9 .
Pourquoi les chats deviennent-ils
obèses ?
Il est nécessaire pour chaque cas de détermi-
ner la ou les causes de l’excès pondéral afin
de donner des conseils individualisés. Les
causes les plus fréquentes sont énumérées
dans le Tableau 1. Dans de très nombreux
cas, plusieurs interviennent. Les corrections
à apporter sont de diverses natures. En effet,
l’intervention ne doit pas être limitée à l’ali-
mentation ; il faut encourager les propriétaires
à s’impliquer dans le développement de l’acti-
vité physique de leur animal de compagnie par
divers moyens ; citons par exemple, des amé-
nagements ou dispositifs permettant au chat
de manger de petits repas, de manger plus
Contenu : Quels nutriments, quels aliments,
quand et comment les distribuer pour optimi-
ser la réussite ?
Introduction
L’objectif pédagogique de l’exposé est de dé-
crire les points clés de la prescription alimen-
taire lors d’obésité chez le chat. Il convient ce-
pendant de présenter largement les différents
aspects de la consultation et la façon d’abor-
der le problème avec le propriétaire avant de
détailler les points les plus techniques de la
prescription. Aborder le sujet et expliquer la
raison de la mise en place d’un rationnement
prend du temps et il est ainsi nécessaire de
consacrer au minimum 30 à 45 minutes à une
consultation qui a pour objectif de mettre en
place un rationnement pratique. De la même
façon, la poursuite d’un objectif pondéral
tenable à long terme nécessite une identifi-
cation des causes de l’obésité, afin de mettre
en place les corrections nécessaires. Un histo-
rique alimentaire complet doit donc être ob-
tenu au préalable. Nous n’aborderons pas ici
le rôle de la prévention mais elle est indispen-
sable pour tous les chats de compagnie stéri-
lisés et sédentaires. Elle consiste à mettre en
place, dès le plus jeune âge, un rationnement
journalier avec un aliment de bonne qualité et
de densité énergétique adaptée aux dépenses.
Quand aborder le sujet ?
En raison d’une fréquence d’obésité féline
supérieure à 35 % (Colliard et al., 2009), il faut
vérifier systématiquement l’alimentation des
animaux présentés en consultation vétéri-
naire (médecine préventive), quel qu’en soit
le motif (Diez et al., 2015). Un chat présentant
un score corporel idéal (5/9, Laflamme et al.,
1994) peut recevoir un aliment inadapté à ses
besoins ; le rôle du vétérinaire est de vérifier
la qualité autant que la quantité. En ce qui
concerne l’embonpoint, l’utilisation des scores
corporels est idéale chez les animaux adultes.
Le système en 9 points (5/9 correspondant
au poids idéal) nécessite un certain entraîne-
ment mais une fois utilisé, devrait systémati-
quement être reporté sur la fiche de suivi.
lentement, d’occuper l’espace dans toutes ses
dimensions, des activités de jeux, voire des
promenades.
Quels sont les arguments les plus
susceptibles de toucher les maîtres ?
De nouveau, ici, le discours doit être individua-
lisé. Les risques liés au surpoids et à l’obésité
sont de 3 types : réduction de la longévité (liée
au développement de comorbidité), inconfort
dans la vie de tous les jours (ostéo-articulaire,
respiratoire, intolérance à la chaleur, à l’exer-
cice, …) et développement (ou aggravation du
risque) de maladies (chroniques) graves dont
l’obésité est la cause. Parmi ces dernières,
le risque de diabète sucré augmente avec le
pourcentage d’excès pondéral et la lipidose
hépatique touche les chats obèses. Le risque
très élevé de diabète sucré est généralement
un argument auquel les propriétaires sont
sensibles. Les chats en excès pondéral sont
également plus susceptibles de développer
des calculs urinaires. Par conséquent, le trai-
tement de cette affection inclut la perte de PC.
Déroulement de la consultation
Une carte conceptuelle sera utilisée pour ex-
pliquer les points clés de l’abord du proprié-
taire.
Alimentation : restriction
énergétique et choix de l’aliment
Restriction énergétique
Chaque cas est unique et il est utile de fixer un
objectif raisonnable et relatif à l’excès pondé-
ral observé. En d’autres termes, imaginons un
chat adulte stérilisé dont le poids normal est
de 4 kg. Si ce chat présente un score corporel
de 7/9 et un poids de 5 kg, son excès pondéral
est de 25 % ; dès lors le rationnement éner-
gétique peut être calculé sur base du poids
idéal, soit 30 à 35 kcal par kg de poids idéal.
Si le même animal a un score corporel de 9/9
(obésité morbide) et pèse, par exemple 8 kg,
son excès pondéral est de 100 %. Dès lors, il
État des preuves en alimentation
Obésité chez le chat
Marianne DIEZ
DV. PhD. Dip. ECVCH
Clinique Vétérinaire Universitaire - Quartier Vallée 2 - Avenue de Cureghem, 3 - Sart-Tilman - 4000 LIÈGE

2
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
est raisonnable de fixer un objectif pondéral
intermédiaire, par exemple de 6 kg pour cal-
culer ses apports énergétiques. Une fois ce
palier atteint, on peut ensuite viser l’objectif
initial, tout en gardant à l’esprit que le but est
atteint quand le score corporel est de 5/9. Si
le chat pèse alors 5 kg à ce stade, on arrête
le régime et on s’oriente vers un objectif de
maintien de PC à long terme.
En raison du risque élevé de lipidose hépa-
tique lors d’un régime, un grand soin doit être
accordé aux transitions. On peut réaliser en
même temps une transition énergétique et
alimentaire qui consiste à diminuer les quan-
tités tout en modifiant graduellement les pro-
portions des aliments. Chez le chat, une telle
transition peut durer de 10 à 15 jours. Les ins-
tructions précises doivent être écrites. D’un
point de vue pratique, un chat nourri à volonté
(et dont le PC idéal serait de 4 kg) peut ingé-
rer jusqu’à 2 à 3 fois la quantité nécessaire
pour le maintien de son poids idéal (50 g d’un
aliment sec), soit de 100 à 150 g. Par consé-
quent, ces animaux ont d’autant plus besoin
d’une restriction progressive et lente en début
de régime. Le protocole est donc à adapter au
cas par cas. Enfin, la situation idéale consiste-
rait à connaître précisément les apports éner-
gétiques journaliers de l’animal obèse afin de
les restreindre graduellement ; c’est très rare-
ment le cas en pratique.
Choix de l’aliment de régime
Comme nous l’avons expliqué précédem-
ment, il faut réserver les aliments dits à
«objectifs nutritionnels particuliers » (Direc-
tive 2008/38/CE) aux animaux présentant
un score corporel égal ou supérieur à 7/9. Ils
se distinguent des aliments d’entretien par
diverses caractéristiques ou par la présence
d’ingrédients particuliers (Tableau 2).
Causes Corrections proposées
1. Stérilisation Alimentation, environnement (activité)
2. Sédentarité (vie en espace restreint) Alimentation, environnement (activité)
3. Alimentation à volonté (gamelle
toujours remplie) -Alimentation restreinte, enrichissement du
milieu (nourriture cachée pour stimuler
l’activité)
-Séparation des animaux dans les cas où
plusieurs chats cohabitent
4. Age Alimentation adaptée à l’âge et l’activité
5. Distribution de friandises ou de restes
de table Alimentation, activités de substitution pour les
maîtres
6. Facteur racial : chat européen
7. Sélection (Corbee, 2014) Education des juges de concours
8. Appréciation des « gros chats » Education à la santé
(1)Chat adulte
BCS = 5/9 (2)Chat stérilisé
BCS = 6/9 (3)Chat obèse
BCS = 7,8 et 9/9
Protéines brutes, % MS (% énergie) 35 39 45
Lipides, % MS (% énergie) 17 11 11
Glucides digestibles, % MS (% énergie) 30 30 21
Fibres brutes, % MS 6,8
Fibre totale, % MS 11,2 11,6 15,6
Cendres brutes 7,1 8,8
Energie Métabolisable, kcal/100g 419 385 379
Calcium, % MS 1,1 1,2 1,4
Phosphore, % MS 0,9 1,1 1,3
Ingrédients particuliers - fibres Idem (2) + MOS Fibres végétales,
Pulpes bett,FOS Idem (2) +
psyllium,
Ingrédients particuliers - autres Lutéine Lutéine
Chondroïtine,
Glucosamine
(Carnitine)
Tableau 1. Causes de surpoids et d’obésité chez le chat (et correction à apporter, le cas échéant)
Tableau 2. Comparaison des compositions d’aliments secs pour chat
BCS : Body Condition Score, FOS : fructooligosaccharides, MOS : Manno-oligosaccharides

3
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
En comparaison avec des aliments d’entre-
tien, les aliments à objectifs nutritionnels sont
généralement :
- plus riches en protéines afin de prévenir les
carences et limiter la perte de masse muscu-
laire et induire une meilleure satiété,
- à teneur moindre en lipides et/ou plus riches
en fibres pour limiter leur concentration éner-
gétique,
- plus riches en minéraux et oligo-éléments
afin de prévenir les carences,
- riches en ingrédients particuliers tels que
la carnitine (Blanchard et al., 2002), des an-
tioxydants, des prébiotiques ou des chondro-
protecteurs.
A côté d’une approche classique, de type
« aliment peu énergétique riche en fibres et
pauvre en lipides », une autre approche existe:
un aliment très pauvre en glucides, riche en
protéines et en lipides. Le terme d’approche
«métabolique » est parfois utilisé. Les intérêts
de ce concept seront discutés, mais ce type de
régime est peu adapté à des chats extrême-
ment obèses (score de 9/9).
Chez le chat, l’utilisation des aliments hu-
mides est préconisée, même partiellement,
afin d’augmenter les quantités distribuées et
obtenir une meilleure satiété.
Notons qu’il est tout à fait possible de formu-
ler une ration ménagère destinée à l’amai-
grissement pour un animal particulier, tenant
compte de ses préférences alimentaires,
du budget du propriétaire et de la mise sur
le marché de complexes minéro-vitaminés
adaptés à ce type de ration. Cette méthode
permet en outre l’incorporation de légumes
à fort effet satiétogène en raison de leur ri-
chesse en fibres et en eau.
Modalités alimentaires et satiété
au cours du régime
La multiplication des repas (au minimum 3)
et leur ralentissement est souhaitable pour
diverses raisons : augmentation de l’activité
journalière, augmentation des dépenses éner-
gétiques sous forme d’extra-chaleur, augmen-
tation de la consommation d’eau et augmen-
tation de la satiété.
La mise en place du suivi et la fin
du régime
Lors des deux premières semaines, le suivi
est très important pour s’assurer que l’ani-
mal mange suffisamment, ce qui est le cas
si la transition alimentaire a été bien conçue.
Ensuite, un suivi hebdomadaire du PC est
nécessaire durant tout le régime. Soit le chat
est pesé à la maison et le PC reporté sur une
courbe, soit le chat est pesé à la clinique. Les
propriétaires doivent recevoir des instructions
écrites et on doit s’assurer que ces instruc-
tions ont été comprises. En effet, ils doivent
être conscients de l’objectif à atteindre et pré-
venir en cas de perte trop rapide ou trop lente,
sachant qu’une perte hebdomadaire de 0,5 à
1 % du PC initial (obèse) est conseillée chez le
chat. Au minimum un rendez-vous de contrôle
avec examen clinique doit être planifié dès la
mise en place du régime, en plus du simple
contrôle du PC.
Le régime est terminé lorsque le score corpo-
rel est de 5/9, et ce, quel que soit l’objectif de
départ. En effet, à ce moment, on utilise une
alimentation de transition, et on continue à
surveiller le PC qui doit rester dans des limites
étroites. Les 6 mois suivant un régime sont
une période cruciale.
Les échecs
Les causes d’échec les plus fréquentes sont
les suivantes :
1. Le propriétaire ne veut rien changer à ses
habitudes ou considère le problème comme
insoluble pour diverses raisons. Par exemple
: le chat est stérilisé, donc forcément en
surpoids ; plusieurs chats cohabitent à la mai-
son et il est impossible de les séparer ou le
chat est nourri par les voisins. Il est bien en-
tendu possible de répondre à la plupart de ces
« excuses » par des moyens simples : prévenir
les voisins (ou mettre un mot sur le collier) ou
séparer les animaux. En revanche, le problème
de la satiété est réel ; un animal insuffisam-
ment rassasié peut miauler sans cesse, ce qui
ne laisse aucune chance de réussite.
2. Le vétérinaire ou la structure ne sont pas
suffisamment impliqués ; il existe dès lors un
manque de motivation du propriétaire dans la
mise en place ou dans le suivi, par exemple si
les instructions ne sont pas claires ou si les
propriétaires ne se sentent pas constamment
soutenus dans cette période qui peut être
longue.
Les réussites
Les chats les plus susceptibles de perdre du
poids et de conserver un poids idéal à long
terme appartiennent à des propriétaires
consciencieux, ont fait l’objet d’une consul-
tation initiale et d’un suivi personnalisé et
ont souvent été présentés avec une maladie
nécessitant une perte de PC comme une into-
lérance à l’effort ou un diabète débutant. Le
choix de l’aliment est aussi déterminant pour
la réussite car le critère de satiété prime pour
les propriétaires.
En conclusion, le traitement du chat obèse
nécessite une approche globale, individualisée
et systématique, à long terme. Bien qu’il existe
un large choix d’aliments sur le marché, le cri-
tère de satiété est primordial pour le succès
du régime.
Bibliographie
Blanchard G, Paragon BM, et al. (2002) Dietary L-car-
nitine supplementation in obese cats alters carnitine
metabolism and decreases ketosis during fasting and
induced hepatic lipidosis. J Nutr. 132: 204-210.
Colliard L, Paragon BM, et al. (2009) Prevalence and
risk factors of obesity in an urban population of heal-
thy cats. J Feline Med. Surg. 11 :135-140.
Corbee RJ. (2014) Obesity in show cats. J Animal Phy-
siolol. Animal Nutr. 98:1075-1080.
Diez M, Picavet P, et al. (2015) Health screening to
identify opportunities to improve preventive
Déclaration publique d’intérêts sous la
responsabilité du ou des auteurs :
•Aucun conflit d'intérêt

4
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
PROGRAMME GÉNÉRAL DERMATOLOGIE - NUTRITION - ALIMENTATION - DIÉTÉTIQUE
d’acides aminés soufrés (AAS : cystéine et
méthionine) indispensables à la pousse du
poil (élaboration de la kératine). Ces acides
aminés sont présents dans les protéines d’ori-
gine animale et les carences sont rares chez
les carnivores (Le chien y est moins sensible
que le chat). [3]
Les acides aminés aromatiques (AAA : tyro-
sine, phénylalanine) interviennent avec le
cuivre dans la synthèse des mélanines res-
ponsables de la pigmentation des poils : phéo-
mélanine (rouge, brun) et eumélanine (noire).
Une carence d’apport provoque un éclaircis-
sement du pelage ou un roussissement des
poils noirs. Les niveaux de PHE et de TYR
nécessaires pour garantir une pigmentation
du pelage étant très élevés, une supplémenta-
tion en tyrosine des aliments pour augmenter
l’intensité de la coloration du pelage, peut être
envisagée. [3]
Un apport de glutamine et d’arginine est
conseillé pour les animaux souffrant d’un
déficit d’apport (ex : lors d’un jeûne dû à une
chirurgie) et éviter un retard de cicatrisation.
L’histidine, associé à des vitamines B, inter-
vient dans l’intégrité du revêtement cutané.
[4]
La qualité des matières premières et du pro-
cessus de fabrication peut être impliquée :
La faible digestibilité des protéines ou leur
traitement dans les processus de fabrication
augmente le risque d’apparition d’une hyper-
sensibilité alimentaire.[4]
Acides Gras Essentiels (AGE)
Les acides gras des familles oméga-6 et omé-
ga-3 sont indispensables chez les carnivores.
Ils ne peuvent être synthétisés et doivent être
trouvés dans les aliments. Les précurseurs
vont, théoriquement, permettre la synthèse
d’acides gras à longue chaine (AGPI-LC).
Cette biosynthèse ayant un faible rendement
(chez l’homme et le chien, très faible voire
inexistant chez le chat), il est nécessaire d’ap-
porter des AGPI-LC dans l’alimentation. En
utilisation thérapeutique, leur usage est indis-
pensable. [5]
Dermatologie
et alimentation
La peau est un organe important par sa sur-
face (1 m2 pour un chien de 35 kg) et ses
fonctions : ses besoins sont très dépendants
des apports nutritionnels, tout déséquilibre de
la ration pouvant avoir des conséquences sur
sa structure et son fonctionnement. C’est l’un
des premiers témoins de la santé d’un animal.
Quels nutriments interviennent dans le
bon fonctionnement de la peau ?
Parmi les 6 groupes de nutriments, 4 inter-
viennent directement (protéines, lipides, mi-
néraux, vitamines) seul le groupe des glucides
(ENA et fibres) n’a pas de rôle dans le méta-
bolisme cutané.
Protéines : l’apport protéique doit couvrir des
besoins qualitatifs et quantitatifs.
Les poils sont composés à 90 % de protéines.
Chez les animaux à pelage dense, la quantité
de poils peut consommer jusqu’à 35 % des
apports protéiques quotidiens [1]. Un apport
suffisant en acides aminés essentiels (dont les
acides aminés soufrés) est indispensable à la
maturation des kératinocytes.
L’apport quotidien de protéines doit être suffi-
sant pour couvrir les besoins en acides aminés
essentiels. Des carences peuvent être rencon-
trées lors de maladie chronique débilitante
avec un apport alimentaire inadapté ou en
fonction de besoins accrus liés au statut phy-
siologique. La quantité ne doit pas primer sur
la qualité, des taux élevés en protéines sur les
étiquettes ne garantissent pas d’apporter les
acides aminés essentiels à l’animal (notion de
facteur limitant).
Le chien a besoin de 10 acides aminés essen-
tiels (11 pour le chat, 8 pour l’humain) [2].
Plus un animal a des besoins élevés en acides
aminés essentiels, plus il est dépendant d’ali-
ments riches en protéines.
Certains régimes avec un taux de protéines
bas (comme un régime végétarien), peut pro-
voquer des carences par apport insuffisant
Dans la série oméga-6, le précurseur de la
famille est l’acide linoléique (LA), à partir
duquel seront synthétisés : l’acide gammali-
noléique (GLA), l’acide dihomo-gammalino-
léique (DGLA) et arachidonique (AA). Le LA
est incorporé dans les céramides du stratum
corneum, il joue un rôle dans l’adhérence
intercellulaire et le maintien des propriétés
de barrière normales de la peau, empêchant
la déperdition d’eau et de nutriments. Lors
de carence, apparaissent : séborrhée sèche,
pelage terne et sec, réduction de l’élasticité,
hypertrophie des glandes sébacées, augmen-
tation de la viscosité du sébum et de la perte
d’eau, une accélération de la prolifération des
cellules épidermiques. Un apport en LA fait
rétrocéder ces signes.
Dans la série oméga-3, le précurseur de la
famille est l’acide alpha-linolénique (ALA)
à partir duquel l’organisme va synthétiser :
l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et docosa-
hexaénoïque (DHA). Le rendement est quasi-
nul chez le chat, d’où l’apport nécessaire de
DHA dans cette espèce et fortement conseillé
chez le chien (rendement faible).
Un équilibre entre les 2 familles est indispen-
sable : le rapport doit être inférieur ou égal à 4.
En utilisation thérapeutique en dermatologie,
une augmentation des apports des 2 familles
est souhaitable tout en respectant un rapport
entre 1 et 4, si un rôle anti-inflammatoire est
recherché le rapport oméga-6/oméga-3 sera
abaissé en augmentant l’apport d’omega-3
Outre leur fonction dans le maintien de l’inté-
grité de la peau, les AGE jouent un rôle dans
l’inflammation de la peau et de l’organisme.
Un apport nutritionnel permet de réguler les
phénomènes inflammatoires : les AGE impli-
qués sont : DGLA, AA (omega-6) et EPA,
DHA (omega-3).
Les oméga-6 sont globalement pro-inflam-
matoires et les oméga-3 anti-inflammatoires.
Toutefois leur implication dans l’inflammation
est plus complexe : le DGLA (oméga-6) ayant
une action anti-inflammatoire, par exemple. A
partir de ces AGE sont synthétisés les eicosa-
noïdes de la série 2 (dérivés de l’AA et pro-
inflammatoires) et les eicosanoïdes des séries
État des preuves en alimentation
Dermatologie et alimentation
Claude PAOLINO
DV, CES de Diététique canine et féline (ENVA), DU Psychiatrie Vétérinaire (ENVL-VetAgrosup – FML), DE d’Expertise Vétérinaire (ENVT)
Clinique Vétérinaire Holos Bios - 501, avenue Maréchal Juin - 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

5
24>26 novembre 2016
LILLE GRAND PALAIS
1, 3 et 5 (dérivés du DGLA et de l’EPA : non ou
légèrement inflammatoires).[6]
Les oméga-3 possèdent des propriétés anti-
inflammatoires directes et peuvent modifier
l’expression génique impliquée dans le pro-
cessus inflammatoire. [6]
Les AGE sont intégrés dans les membranes
cellulaires et seront utilisés plus tard dans la
synthèse des eicosanoïdes. L’alimentation
pour modifier le rapport membranaire en AGE
oméga-3/oméga-6 et/ou le rapport DGLA/
AA. La formation résultante des divers eico-
sanoïdes induira une diminution des phé-
nomènes inflammatoires. Inversement, la
réponse inflammatoire sera intensifiée si les
apports alimentaires en oméga-6 sont aug-
mentés. Le DHA (oméga-3) a une action es-
sentielle dans la résolution de l’inflammation.
[5] Chez les animaux souffrant d’affections
cutanées allergiques, un apport complémen-
taire en AGE oméga-3 a pour conséquence
une amélioration des signes cliniques : dimi-
nution de l’intensité du prurit et autres mani-
festations (érythrodermie, œdème de la peau)
[6]. L’utilisation des AGE est un processus
lent qui doit se faire au long cours pour leur
permettre d’être intégrés dans les membranes
cellulaires.
Les minéraux
Contribuent à la croissance et la cicatrisation
de l’épiderme, sur le derme, le collagène et la
pigmentation. L’absorption des minéraux est
en compétition avec celle du calcium : atten-
tion aux aliments bas de gamme souvent très
riches en calcium. L’absorption des minéraux
est souvent inférieure à 30 % (peut être amé-
liorée s’ils sont chélatés avec des acides ami-
nés)
Les carences d’apport en zinc sont principa-
lement rencontrées dans des aliments riches
en phytates. (aliments de mauvaise qualité
riches en son de céréales, « Generic Dog Food
Desease») et/ou contenant un excès de cal-
cium. [7]. Il existe un défaut d’absorption in-
testinale du zinc dans certaines races : chiens
nordiques, Beauceron, Berger allemand, Bos-
ton Terrier, Bull-Terrier, Dogue allemand... Les
lésions cutanées se situent aux zones pério-
rificielles et aux doigts : érythème au début,
puis squames et des croûtes très adhérentes
[4] (type 1). Des lésions cutanées non dues
à une carence mais améliorées par le zinc ont
été décrites chez les chiots à croissance ra-
pide et quelquefois chez des adultes. De nom-
breuses races peuvent être atteintes, parmi
lesquelles le Dogue allemand, le Doberman,
le Berger allemand, le Beagle et le Labrador.
(type 2)
Le cuivre entre dans la composition de nom-
breuses enzymes. Une compétition existe
entre l’absorption du cuivre, du zinc, du cal-
cium ou du fer. La carence entraîne des modi-
fications du pelage : décoloration débutant au
niveau de la face, pelage clairsemé avec des
poils ternes et secs
Le fer est impliqué (avec la vitamine C) dans le
métabolisme de la proline, acide aminé majeur
dans la structure du collagène. Une carence
en fer nuit à la qualité du tissu cicatriciel.
L’iode : impliqué dans le métabolisme thyroï-
dien et ses conséquences cutanées (rare)
Les vitamines interviennent au niveau
de la peau
La vitamine A (rétinol, acide rétinoïque) inter-
vient dans la différenciation des cellules épi-
théliales et affecte la kératinisation. [7] Le
chat ne peut pas transformer le ß-carotène
en rétinol, il doit trouver la forme animale de
la vitamine A dans son alimentation. Par son
action sur la production de sébum, elle lutte
contre la séborrhée et les pellicules qui se for-
ment après du prurit. Son action intervient en
synergie avec le zinc et les acides aminés sou-
frés. Une carence est rare chez le chien, plus
courante chez le chat (régime végétarien par
exemple). L’excès de vitamine A peut aussi
être néfaste (spondylarthrite ankylosante
chez le chat due à un excès de consommation
de foie, utilisation d’huile de foie de morue…)
L’hypothèse de l’action de la vitamine D dans
le traitement de la DAC a été évoquée, au vu
des résultats insuffisants sur le prurit, cette
solution thérapeutique n’est pas retenue [8]
[9]
La vitamine E possède une activité antioxy-
dante et joue un rôle dans les membranes cel-
lulaires. Les carences sont rares (aliment de
faible qualité) et ont été décrites chez le chat
[7]. Une carence expérimentale chez le chien
provoque : séborrhée sèche, alopécie diffuse,
érythrodermie et pyodermite secondaire. Des
taux élevés de vitamine E ont diminué les
signes cutanés sur les chiens atopiques [10]
[11]. Ses besoins sont liés à la teneur en AGPI
de la ration [7].
Les vitamines du groupe B jouent un rôle de
coenzyme pour des enzymes cellulaires. Elles
sont fournies par l’alimentation et la flore
digestive. Les carences sont exceptionnelles
(aliments bas de gamme, rations ména-
gères non contrôlées…). Ces vitamines inter-
viennent dans le métabolisme des AGE. Un
défaut d’apport ou de synthèse par la flore
digestive (suite à une diarrhée chronique ou
une antibiothérapie) peuvent provoquer une
carence en AGPI.
Une carence en riboflavine (B2) donne les
signes suivants : xérose cutanée (zone périor-
bitaire et abdomen) et une chéilite. [7] Pour la
vitamine B3 (niacine, nicotinamide, vitamine
PP), une carence est susceptible d’apparaître
avec une alimentation pauvre en nutriments
d’origine animale : dermatite prurigineuse
de l’abdomen et des membres postérieurs,
accompagnée d’ulcères des muqueuses. La
vitamine B5 (acide panthoténique) inter-
vient avec la vitamine B3, la choline, l’inositol
et l’histidine ; elle favorise la synthèse des
lipides cutanés (céramides) et limite la dés-
hydratation de l’épiderme. La vitamine B8
(biotine, vitamine H) peut manquer chez les
animaux nourris avec des blancs d’œuf crus
(l’avidine du blanc d’œuf complexe la biotine
et empêche son absorption). Les signes sont:
érythème, alopécie de la face et de la zone
périorbitaire, squamosis, leucotrichie, pelage
terne et cassant et une desquamation géné-
ralisée.
Des recherches sur les antioxydants ont
monté qu’en diminuant le stress oxydatif, ils
inhibent les voies métaboliques liées à l’hista-
mine et la production de prostaglandines. De
même pour les polyphénols (présents dans
le romarin, le thé vert, les pulpes d’agrumes
[12], qui forment des complexes insolubles
avec les protéines allergéniques et inhibent
l’activité des lymphocytes, la prolifération des
lymphocytes T, la production de cytokines, la
production d’anticorps par les lymphocytes B,
le relargage des médiateurs inflammatoires
par les mastocytes.
Récemment, l’implication du microbiote a été
mise en évidence dans le développement des
allergies. Chez l’homme, la naissance par cé-
sarienne, le non-allaitement maternel et l’uti-
lisation d’antibiotique lors des premiers mois
de vie seraient des facteurs favorisants. De
nombreuses études sont en cours sur ce sujet.
Facteurs favorisants les problèmes
cutanés
Les animaux à pelage dense ou de grand for-
mat ont des besoins quotidiens importants
en protéines et en acides gras. Les aliments
« généralistes », négligeant ces particularités,
risquent de ne pas apporter tous les nutri-
ments nécessaires. Deux groupes de derma-
toses nutritionnelles (répondant à l’adminis-
tration de zinc ou de vitamine A) représentent
les causes majeures de troubles de la kérati-
nisation chez les races canines prédisposées.
Les animaux à poils noir ou foncé ont des
besoins supérieurs en TYR et PHE.
Des symptômes de carence nutritionnelle ap-
paraissent plus fréquemment lors d’exigences
nutritionnelles supérieures aux besoins
 6
6
1
/
6
100%