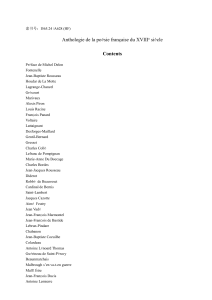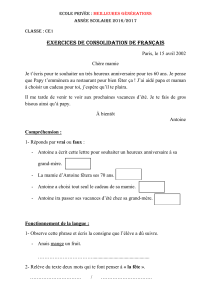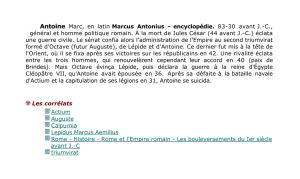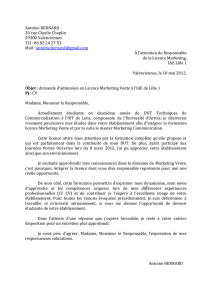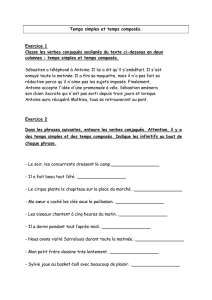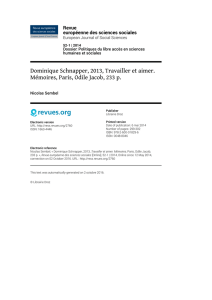L`histoire de l`art selon Antoine Schnapper

L’histoire de l’art
selon Antoine Schnapper
CHRISTINE GOUZI
Ce texte est issu d’une communication qui a eu lieu lors du colloque « Artistes, collec-
tions et musées. », le 19 juin 2009 à l’Institut national d’histoire de l’art. Ce colloque
était organisé en hommage à Antoine Schnapper. En publiant cet article notre revue
se joint à cet hommage et témoigne de sa fidélité à l’un de ses fondateurs et de ses
plus précieux amis. COMMENTAIRE
AUTEUR de nombreux livres sur la pein-
ture française et sur les collection-
neurs de l’Ancien Régime, Antoine
Schnapper contribua à redéfinir la discipline
d’histoire de l’art dans le champ des sciences
humaines. Cet aspect de sa carrière n’a pas
fait l’objet de publications théoriques de sa
part, sans doute par horreur de la
« doctrine ». Il n’en reste pas moins que de
son œuvre entier se dessine une méthode,
dont il précisa lui-même quelques points dans
un article de jeunesse (1) et dans un entretien
avec Henri Mercillon, paru deux ans avant sa
mort, en 2002 (2).
Histoire de l’art
et « Belles Lettres »
Étudiant, Antoine Schnapper n’avait pas
choisi l’histoire de l’art, mais l’histoire. Dans
les années 1950, l’histoire de l’art était de
toute façon une discipline à la fois minoritaire
et mineure au sein de l’Université française.
Enseignée le plus souvent par un professeur
unique, qui devait couvrir un programme
allant de l’Antiquité à l’époque contempo-
raine, elle s’apparentait à une discipline
d’agrément, qui ne permettait pas d’obtenir
une licence d’enseignement. On comprend
que la licence d’histoire de l’art ait été un
diplôme annexe, que l’on préparait en paral-
lèle avec un autre, pour le plaisir d’étoffer sa
culture générale en quelque sorte, et sans
volonté de spécialisation particulière. Dans les
années 1960, lorsque des chaires de profes-
seurs d’histoire de l’art se multiplièrent, la
situation s’améliora sensiblement, mais sans
changer fondamentalement le statut de l’his-
toire de l’art : encore considérée comme une
« récréation » dans le cursus des Humanités,
celle-ci était plus destinée à éprouver les
qualités culturelles et littéraires des étudiants
que leur rigueur historique.
En France, l’histoire de l’art était en effet
une discipline qui, par tradition, dépendait
étroitement des Belles Lettres. Sans revenir
COMMENTAIRE, N° 129, PRINTEMPS 2010 151
(1) « Les tâches de l’historien de l’art », Contrepoint, n° 2, 1973,
p. 161-172.
(2) Henri Mercillon, « Un pionnier dans l’histoire de l’art.
Conversation avec Antoine Schnapper », Commentaire, n° 99,
automne 2002, p. 653-661.

au Génie du christianisme de Chateaubriand,
qui, déjà, dans une langue exaltée, chantait le
patrimoine ruiné ou vandalisé de l’Ancien
Régime, on peut noter que les premiers histo-
riens de l’art nés au XIXesiècle étaient agrégés
de littérature ou de philosophie. Émile
Mâle (3) était l’un d’entre eux, de même que
Louis Dimier (4), pour ne citer que ces noms
emblématiques, qui marquèrent tous deux de
manière très différente l’histoire de la disci-
pline (5). Après la Seconde Guerre mondiale,
Henri Focillon (6), puis André Chastel (7)
étaient eux aussi des littéraires qui avaient
choisi de se consacrer à l’art. Il est donc
logique que l’histoire de l’art française ait
d’abord été une science iconographique,
voire, sur le modèle proposé par Aby
Warburg (8), une science iconologique. Elle
était d’abord un discours qui décryptait
l’image en s’aidant des sources textuelles
contemporaines de sa création, et, par-delà,
un logos codifié, capable d’expliquer, par un
substrat culturel retrouvé, le choix des sujets
et la façon de les traiter. Car cette attention
à l’iconographie avait un double but : mettre
en évidence la nouveauté de certaines repré-
sentations, de même que mesurer, à l’aune de
ces changements, l’évolution des « formes »,
autrement dit du style. Dans ses meilleures
productions, l’histoire de l’art avait donc mis
en œuvre une herméneutique digne de ce
nom, qui n’analysait pas seulement l’œuvre en
termes esthétiques.
Les limites de l’iconographie
C’est pourtant cette herméneutique que
refusa Antoine Schnapper lorsqu’il eut
terminé ses études d’histoire et qu’il
commença en 1964 sa thèse de troisième cycle
sur les tableaux du Trianon de Marbre de
Versailles. L’originalité de sa démarche tint
alors à l’articulation nouvelle qu’il opéra entre
la discipline historique et l’art. On touche ici
au rapport entre le déroulement historique et
la création artistique qu’avaient tenté de clari-
fier certains historiens des Annales, tel Lucien
Febvre (9), sans que jamais leurs écrits modi-
fient profondément la marche de l’histoire de
l’art, qui se développa selon une ligne paral-
lèle à celle de l’histoire. Analysant en 1950 la
thèse de François-Georges Pariset sur
Georges de La Tour (10), Lucien Febvre expli-
quait que « l’étude du milieu spirituel de la
Contre-Réforme lorraine (11) » aurait dû
présider à l’analyse de l’art du peintre. Or
cette étude, écrivait-il, n’était hélas que « la
basse continue (12) » de l’analyse des œuvres,
analyse du reste iconographique pour une
bonne part, dont la pertinence était précisé-
ment suspecte pour Lucien Febvre : elle aurait
dû d’abord se nourrir d’un substrat historique
avant de servir de caution à de nouvelles data-
tions et attributions. Cette réticence de
Lucien Febvre à l’égard de la méthode
employée par François-Georges Pariset,
Antoine Schnapper l’aurait sans doute
trouvée légitime : pour lui, l’iconographie ne
pouvait en aucun cas être un point de départ
à la compréhension de l’œuvre, même si elle
procédait de recherches érudites et parfois
éclairantes. Parce qu’elle est un discours fata-
lement extrinsèque aux conditions de création
de l’œuvre, parce qu’elle dérive souvent de
prémisses textuelles extérieures au champ
disciplinaire de la peinture, de la gravure ou
du dessin, la méthode iconographique ne rend
pas compte de la réalité de l’œuvre. A fortiori,
elle ne peut avoir l’ambition de donner de
certitude sur sa date ou son auteur.
Mais la méthode que préconisait Lucien
Febvre engendrait une autre difficulté selon
Antoine Schnapper. Considérer prioritaire-
ment les événements historiques contempo-
CHRISTINE GOUZI
152
(3) Émile Mâle (1862-1954) est connu pour ses livres sur l’ico-
nographie de l’art du Moyen Âge, il est aussi l’auteur de L’Art reli-
gieux de la fin du XVIesiècle, du XVIIesiècle et du XVIIIesiècle. Étude
sur l’iconographie après le Concile de Trente, Armand Colin, 1932
(2eéd. revue et corrigée, Armand Colin, 1951), qui était une réfé-
rence dans les années 1960.
(4) Le cas de Dimier (1865-1943) est très différent de celui
d’Émile Mâle car son approche de l’art n’est pas iconographique.
(5) Ce n’est pas le lieu ici de faire une analyse de l’évolution de
l’histoire de l’art en France, qui demanderait une étude à par
entière. Aussi, les noms que nous citons n’ont d’autre valeur que
de repères.
(6) Sur Henri Focillon (1881-1943), voir les actes du colloque
Henri Focillon (2004), éd. Kimé, 2007.
(7) Sur André Chastel (1912-1990) qui dirigea la thèse d’Antoine
Schnapper sur Jouvenet, voir le numéro spécial de la Revue de l’art,
hommage à André Chastel, n° 93, 1991.
(8) Aby Warburg (1866-1929) avait été l’un des fondateurs de la
méthode iconographique en histoire de l’art en Allemagne avant
et après la guerre de 1914-1918.
(9) Voir « Penser l’histoire de l’art », Annales, économies, socié-
tés, civilisations, t. 5, 1950, n° 1, p. 134-136.
(10) Lucien Febvre, « Résurrection d’un peintre : à propos de
Georges de La Tour », Annales, économies, sociétés, civilisations, t. 5,
1950, n° 1, p. 129-134. Rééd. par Brigitte Mazon dans Lucien
Febvre. Vivre l’histoire, Robert Laffont/Armand Colin, 2009, p. 260-
265.
(11) Ibid., p. 263.
(12) Ibid., p. 265.

rains de l’œuvre, faire de cette dernière l’éma-
nation de l’histoire, manquait aussi le but que
s’était assigné l’historien de l’art : éclairer les
circonstances d’une commande particulière,
reconstituer la clientèle de l’artiste, recoller
un corpus et comprendre sa réception au
cours du temps. Impossible donc d’appliquer
à l’histoire de l’art la recette, pourtant réussie
lorsqu’il s’agissait d’histoire, de la Méditerra-
née au temps de Philippe II de Fernand
Braudel. L’histoire générale devait bien être
convoquée, certes, mais pas seulement pour
lui rattacher artificieusement l’histoire de l’art
et la considérer alors comme un terrain d’ap-
plication privilégié de la noble histoire.
Au contraire, l’histoire de l’art devait acqué-
rir son autonomie et se comporter elle-même
comme une discipline historique, en adaptant
ses méthodes et la recherche de ses sources à
son objet. Ainsi, en tant que discipline histo-
rique, l’histoire de l’art est avant tout, à l’ins-
tar de l’histoire, l’observation des « traces du
passé (13) ».
Or cette « observation », dont les modalités
ont été décrites par de nombreux historiens
ou philosophes de l’histoire (14), avait disparu
du domaine de l’étude de l’art dans les années
1950. Que l’on se consacrât à l’interprétation
de l’iconographie ou du style comme le faisait
brillamment et avec une grande érudition
André Chastel, ou bien que l’on s’oubliât à
discourir sur les œuvres et les sentiments
qu’elles suscitent, comme l’osait André
Malraux, on s’empêchait toute construction
d’objectivité historique. C’est pourquoi
Antoine Schnapper voulut revenir au docu-
ment, c’est-à-dire à la source spécifique de
l’œuvre. Les archives de la Maison du Roi, les
guides anciens, les mémoires, les actes nota-
riés (testament, inventaires après décès,
contrats de commandes, d’apprentissage…) :
toutes sources potentielles pour qui a la
charge de déceler des indices, des « traces »
de l’objet artistique et pour qui a le devoir de
le connaître ou même de le reconnaître dans
la masse souvent indistincte que le hasard a
laissée parvenir jusqu’à nous. On s’explique
mieux de la sorte ce qui pouvait paraître une
incongruité dans les années 1960 : Antoine
Schnapper avait une prédilection certaine
pour les œuvres disparues, détruites ou non
attribuées (ce qui est une autre forme
d’« absence »).
Le XVIIesiècle
d’Antoine Schnapper
Sa thèse sur les commandes picturales pour
le Trianon de Marbre (15) a pu ainsi sembler
l’entreprise d’un dom Quichotte illuminé par
la grâce de peintures jugées alors malheureu-
sement « classiques », pompeuses d’être
influencées par Le Brun ; en sus éparpillées,
voire oubliées dans les réserves de musées,
ayant perdu au cours de leurs pérégrinations
leur nom d’auteur, leur titre et même parfois
leur couche picturale ! La même « bizarrerie »
entraîna Antoine Schnapper à choisir pour sa
thèse d’État l’étude d’un peintre alors peu
considéré, Jean Jouvenet (1644-1717), qui
avait le double défaut d’avoir travaillé pour
Louis XIV et d’avoir essentiellement été un
peintre religieux, dont le corpus était alors
très mal connu et non recensé (16). À l’occa-
sion de ses recherches, et grâce aux sources
mises au jour par ses soins, Antoine Schnap-
per démontra que plus de 80 % des décors
plafonnants peints par Jouvenet avaient été
détruits. Or, c’était précisément un des
apports de sa méthode de tenir compte de
cette « connaissance par traces documen-
taires » d’œuvres désormais inaccessibles pour
analyser l’œuvre entier de l’artiste. Les histo-
riens de l’art se contentaient alors le plus
souvent des œuvres parvenues jusqu’à eux. En
bon historien, Antoine Schnapper affirma par
le sujet même de ses ouvrages que l’histoire
de l’art devait de préférence choisir pour objet
d’étude des œuvres à jamais disparues : c’est
à cette seule condition que la reconstruction
d’une période artistique ou de l’art d’un créa-
teur pouvait être totalement « objective ».
Cette nouvelle méthode redonnait évidem-
ment ses lettres de noblesse à l’histoire, alors
que la discipline était surtout tournée vers
l’art ; elle impliquait encore de remettre à
L’HISTOIRE DE L’ART SELON ANTOINE SCHNAPPER
153
(13) L’expression est de Simiand, mais elle fut redéfinie, notam-
ment par Lucien Febvre et Marc Bloch, dès les années 1930. La
méthode critique qu’elle induisait était encore au cœur des préoc-
cupations des historiens dans les années 1950.
(14) Antoine Schnapper cite le nom de Paul Veyne dans ses
premiers écrits et plus précisément Comment on écrit l’histoire,
Seuil, 1971.
(15) Tableaux pour le Trianon de Marbre (1688-1714), Paris et
La Haye, Mouton, 1967. Une réédition par Nicolas Milovanovic est
en cours.
(16) Jean Jouvenet (1644-1717) et la peinture d’histoire à Paris,
Léonce Laget, 1974. Une réédition augmentée et préfacée par nos
soins paraîtra en 2010 aux éditions Arthena.

l’honneur le catalogue, conçu, non comme
l’énumération d’œuvres choisies, mais comme
la reconstitution exhaustive et raisonnée d’un
corpus entier. Alors seulement une « vérité »
historique pouvait se faire jour : vérité qui
n’avait rien à voir avec une affirmation
gratuite de telle ou telle théorie préconçue,
mais avec une légitime entreprise de recons-
titution historique. Comparée aux envolées
lyriques de certains littérateurs, jugée même
à l’aune des synthèses transversales sur un
thème, un siècle, ou un style, le but d’Antoine
Schnapper peut paraître modeste. Au moment
où il soutint sa thèse, il apparut au contraire
d’une rigoureuse intransigeance. Plus tard, il
sembla à certains d’une ambition justifiée,
mais aride.
Le conflit des interprétations
Ainsi de l’article sur la population des pein-
tres à Paris au XVIIesiècle paru en 2001 (17),
qui cherche à donner une fourchette fiable du
nombre des peintres qui exerçaient dans ce
laps de temps. Pour mener à bien cette
enquête, Antoine Schnapper explique d’abord
le choix de ses sources et expose les chiffres
qu’on peut en extraire. Loin d’être considérés
comme un résultat acquis, ces chiffres sont
analysés comme des leurres potentiels et
minorés ou majorés grâce à des mises en pers-
pective démographiques. Les chiffres finale-
ment proposés à la fin de l’article ne font
l’objet d’aucune conclusion qui ne soit compa-
rative : la situation de la capitale de la France
est appréciée à l’aune de celle des Pays-Bas.
L’augmentation du nombre des peintres,
observée dans les deux pays pour une période
similaire, est alors comprise comme la consé-
quence possible d’un faisceau de causes,
économiques, sociales, ou politiques, dont
aucune n’est préférée à l’autre. Le lecteur,
seul juge de leur pertinence, doit aussi exercer
sa subjectivité, à laquelle le conduit la
démarche historique « documentaire » raison-
née. Les ouvrages d’Antoine Schnapper en
ont ainsi déconcerté plusieurs. D’autant plus
qu’il s’y glissait parfois un peu de malice :
nombre de ses écrits ont l’apparence des
ouvrages quantitatifs ou statistiques des histo-
riens des Annales. Mais, à l’inverse d’eux, ils
ne proposent aucune conclusion ferme. Il peut
sembler qu’en agissant ainsi, Antoine Schnap-
per refuse de donner un avis, de s’engager,
voire d’expliquer. Le document paraît un
paravent commode qui empêche l’idée par le
fait. C’est pourtant mal comprendre sa
démarche, qui pousse jusqu’à ses extrêmes
limites la méthode historique en histoire de
l’art : d’une part, le fait est déjà idée puisqu’il
ne peut acquérir son statut de fait que par
celui qui le choisit pour tel. D’autre part, la
manière dont on interroge un document, si
factuel soit-il, lui donne déjà une orientation
subjective. Mais cette subjectivité-là est légi-
time car elle découle du document et s’appuie
sur cette « trace » que doit traquer l’historien.
Elle ne cherche pas à phagocyter le passé en
le considérant comme un autre présent. Cette
différence entre passé et présent est évidem-
ment nécessaire, même si elle est toujours
« déniée » comme l’écrit Michel de Certeau,
car mouvante, « posée » dès le début de la
recherche, mais ne pouvant jamais être vrai-
ment « tenue »(
18). Antoine Schnapper, qui,
en tant qu’historien, en était toujours
conscient, a pourtant tenté de rigidifier cette
limite, de l’éloigner le plus possible d’un
présent « anachronique ». Il s’est sans doute
ainsi empêché des développements qui
auraient été légitimes et que sa sensibilité
artistique, toujours savamment bridée dans
ses écrits, aurait rendus très intéressants. Mais
cette rigueur avait sa récompense : la légiti-
mité de la discipline d’histoire de l’art dans le
cercle des sciences humaines. Enfin, le résul-
tat de l’enquête historique n’est jamais
présenté comme infrangible. La tâche de l’his-
torien de l’art n’est pas d’affirmer, mais de
suggérer, d’empêcher la surinterprétation en
laissant ouvert le sens, en multipliant même
des interprétations auxquelles le lecteur est
libre d’adhérer ou non.
Du bon usage du document :
Le Trianon de Marbre
Ainsi, la méthode d’Antoine Schnapper se
démarque de celle, positiviste, des « docu-
mentaires » du XIXesiècle : rassemblant des
archives inédites, qu’ils publièrent et diffusè-
rent, les « documentaires », tel Philippe de
Chennevières, avaient certes bien compris
CHRISTINE GOUZI
154
(17) « La population des peintres à Paris au XVIIesiècle »,
Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg, RMN, 2001, p. 422-426. (18) Michel de Certeau, L’Écriture de l’histoire, Gallimard, 1975.

l’importance des « traces du passé ». Les arti-
cles des Archives de l’art français, revue qui
produisit à partir de 1872 un lot impression-
nant de sources inédites tirées de papiers
anciens consultés aux Archives nationales ou,
plus précieux encore, possédés par les auteurs
eux-mêmes et depuis disparus, étaient sans
doute des modèles : le métier d’historien de
l’art passe certainement en premier lieu par
cette chasse ingrate et peu spectaculaire du
document, si insignifiant semble-t-il. Mais les
documentaires recherchaient surtout les
archives pour démontrer des idées forgées a
priori (en l’occurrence, en ce qui concerne
l’histoire de l’art, les conséquences désas-
treuses de la centralisation opérée par
Louis XIV sur l’art provincial) ; Antoine
Schnapper laisse quant à lui l’interprétation
ouverte.
Cela ne l’empêcha pas de tenter des
démonstrations, qui pour n’être volontaire-
ment pas didactiques, n’en furent pas moins
efficaces. Depuis l’étude publiée en 1967 sur
le Trianon de Marbre, il est devenu impossi-
ble d’affirmer que le style des peintures
commandées par Louis XIV changea totale-
ment de nature dans les années 1690. Au
contraire, les tableaux retrouvés grâce au
travail documentaire montraient qu’un « clas-
sicisme tardif » perdura jusqu’au début du
XVIIIesiècle et que ce style eut certainement
des répercussions sur la manière de plusieurs
artistes du règne de Louis XV. Antoine
Schnapper récusait aussi l’influence de
Madame de Maintenon (dont aucune source
n’indique du reste qu’elle se mêla des
commandes aux artistes) dans l’allégement de
la pompe décorative versaillaise à Trianon :
Antoine Schnapper ne manque pas de remar-
quer ironiquement qu’on définissait comme
« épuré » l’esthétique tout de blancheur de
Trianon si elle était attribuée à l’intervention
de la dévote Maintenon ; mais qu’on le disait
« gracieux » et « léger » s’il devenait la consé-
quence de la mort de Le Brun, peintre « offi-
ciel », qui ne pouvait qu’être obsédé de
marbres colorés et de riches agencements. Le
changement de style ne découlait pas non plus
de façon avérée des difficultés dues à la guerre
de la ligue d’Augsbourg : le manque d’argent
avait bien interrompu le chantier du décor de
Trianon pendant quelques années, mais la
rigueur financière n’avait rien à voir avec un
prétendu « rigorisme » formel, ou au contraire
avec une « simplicité » nouvelle qui confinait
àla légèreté rococo (ces deux dénominations
stylistiques étant du reste, au final, parfaite-
ment contradictoires).
Le décor reconstitué dans son entier
montrait plutôt un éclectisme de style qui s’ex-
pliquait par la destination même de Trianon :
palais de repos d’un roi exalté en union avec
la nature, il avait été édifié dans le but de
prolonger les jardins attenants ; son décor
devait donc s’accorder avec une des mytholo-
gies royales, celle d’un souverain régnant sur
la flore, qu’il renouvelle et dont il change à
volonté le cours naturel. Cette interprétation
paraît aujourd’hui banale. En 1967, sévissait
encore une histoire de l’art « causale » dont
le but était de démontrer que le décor du
Trianon n’était qu’une transition entre deux
styles également condamnables : le pesant
classicisme versaillais déterminé par un roi
absolu et le futile rococo de la Régence, qui
conduisait directement à l’avènement du
« petit goût » dans la peinture du XVIIIesiècle.
Le premier chapitre du Trianon de Marbre,
intitulé « Méthode historique et historique de
la décoration », permettait au contraire de
comprendre, grâce aux documents, aux
œuvres elles-mêmes, autre forme de docu-
ments spécifiques à l’histoire de l’art, que
cette « transition » des années 1690 était aussi
un accomplissement de l’art versaillais.
Antoine Schnapper déjouait de la sorte les
pièges de l’approximation, de l’affirmation
gratuite ou des a priori motivés par des visions
politiques simplistes.
La méthode critique au défi
des œuvres : un pragmatisme
On a souvent considéré, à juste titre, qu’An-
dré Chastel avait permis à l’histoire de l’art
française de trouver sa place sur la scène inter-
nationale. Avec le recul que donne le passage
du temps, on se rend compte qu’Antoine
Schnapper ne fut pas en reste, mais d’une autre
façon. Sa méthode critique, qu’il affina de plus
en plus au cours de ses recherches, était en effet
très proche de celle de certains historiens de
l’art anglo-saxons, notamment de celle de
Francis Haskell (19), avec qui il se lia par la
suite. Loin d’être isolé, Antoine Schnapper peut
L’HISTOIRE DE L’ART SELON ANTOINE SCHNAPPER
155
(19) Francis Haskell (1928-2001) avait lui aussi fait des études
d’histoire avant de devenir historien de l’art.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%