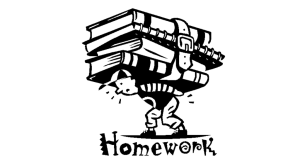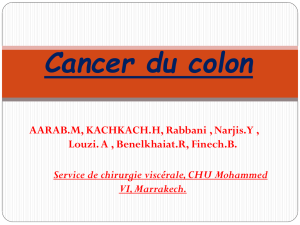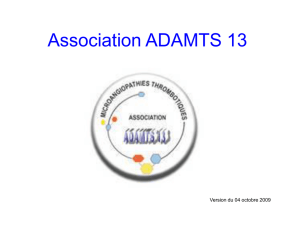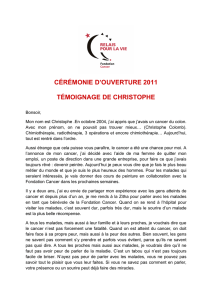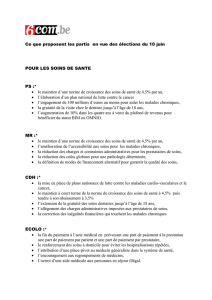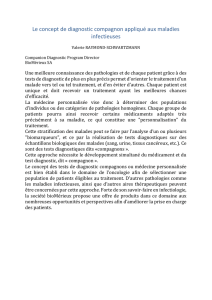Lire l'article complet

Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (13), n° 6, juin 1999 124
Éditorial
L’indication d’une intervention chirurgicale chez un malade âgé est souvent controversée, bien que la
proportion de personnes âgées de plus de 75 ans soit en progression constante (1). En France, l’espé-
rance de vie est passée de 69 ans en 1950 à 82 ans actuellement pour les femmes et de 63 ans à 74 ans
pour les hommes. Cette espérance de vie risque d’atteindre respectivement 90 et 82 ans en 2050. La
proportion de personnes âgées de plus de 75 ans est donc actuellement de 8 % et sera de 18 % en 2050 (2).
Un quart des personnes âgées de 65 à 80 ans et la moitié des plus de 80 ans souffrent d’une incapacité.
En outre, la moitié des malades hospitalisés a plus de 65 ans et un quart plus de 80 ans (3).
Ces notions démographiques expliquent l’augmentation des indications opératoires chez ces malades
âgés dont l’état général est parfois difficile à évaluer. La question qui se pose à nous est la suivante :
“À la fin du XXesiècle, y a-t-il une limite d’âge pour la chirurgie ?” Dans la littérature, la mortalité
opératoire semble s’accroître avec l’âge, et il est difficile de sélectionner les malades âgés candidats
à la chirurgie, c’est-à-dire à faible risque opératoire (4). Ce sont les examens cliniques et complé-
mentaires qui permettent de distinguer l’âge phy-
siologique de l’âge réel, puisque, par exemple, un
malade de 40 ans alcoolo-tabagique, diabétique
et insuffisant rénal peut avoir un âge physiologique
de 80 ans, et à l’inverse un malade de 80 ans un
âge physiologique de 40 ans. Par ailleurs, un
aspect général globalement “médiocre” du
malade âgé ne signifie pas forcément qu’il existe
une perturbation des grandes fonctions vitales. Les
malades âgés ont plus souvent des maladies tumo-
rales que les plus jeunes, qui nécessitent des trai-
tements spécifiques en raison de leur âge élevé (5).
Les facteurs de risque de mortalité et de morbidité
après chirurgie doivent être définis de manière à proposer une attitude thérapeutique adaptée à l’état
général du malade. Par exemple, selon le risque opératoire, un malade peut être opéré ou surveillé
après traitement médical. Le meilleur exemple en est la pathologie biliaire : un malade atteint d’une
cholécystite aiguë peut être opéré immédiatement ou bien être traité par antibiothérapie exclusive si
nécessaire.
L’objectif de cette sélection commune à toute décision chirurgicale est donc triple :
– diminuer la mortalité et la morbidité postopératoires ;
– adapter l’attitude thérapeutique chirurgicale ou médicale aux risques encourus ;
– choisir le meilleur moment de l’intervention après correction éventuelle des pathologies associées,
potentiellement curables ou améliorables.
• La mortalité postopératoire publiée pour les malades âgés varie de 5 à 30 % (6-8). Le score pré-
dictif de mortalité habituellement utilisé est celui de l’American Society of Anesthesiology (ASA).
Ce score n’est pas spécifique des malades âgés et prend surtout en compte les pathologies cardio-
respiratoires, responsables de 14 à 37 % de la mortalité postopératoire des malades âgés (6-9).
Dans une étude prospective multicentrique française, portant sur 1 199 malades opérés dans des
services de chirurgie générale, un score prédictif de mortalité a été obtenu après étude multivariée,
lequel comportait les facteurs indépendants de risque opératoire suivants : l’existence d’une démence,
d’une pathologie septique, d’une maladie vasculaire ou d’une cirrhose. En ce qui concerne la morbi-
Chirurgie du troisième âge
et du quatrième âge :
domaine de l’exploit
ou de la raison ?

125
dité, le score prédictif comprenait l’existence d’une pathologie septique, d’une maladie vasculaire,
d’une longue durée opératoire (> 3 heures) ou d’une démence. Le problème essentiel des compli-
cations postopératoires chez le malade âgé est le risque de perte d’autonomie du malade, respon-
sable d’un surcoût médical et social, et le risque d’aggravation des pathologies préexistantes (10,
11). Au total, trois analyses multivariées ont étudié les facteurs de risque de mortalité postopéra-
toire des malades âgés (6-8). Les maladies psychiatriques, rarement étudiées malgré leur fréquence
chez les personnes âgées, représentent pourtant un facteur de risque majeur, probablement à cause
de la perte d’autonomie et de la moindre participation du malade aux soins postopératoires parfois
lourds. Les maladies septiques augmentent la mortalité, car l’anesthésie et surtout la chirurgie favo-
risent la diffusion bactérienne, responsable de chocs septiques et de décès (12). Les maladies vascu-
laires sont un facteur de risque surtout pour la chirurgie digestive (7). La cirrhose, même asymp-
tomatique, augmente la mortalité, car l’anesthésie et la chirurgie peuvent décompenser l’ascite,
entraînant des infections d’ascite, des complications hémorragiques et des encéphalopathies, par-
fois létales (13). Certaines interventions, comme la chirurgie du pancréas, du foie, de l’œsophage
ou de l’estomac, sont associées à une mortalité élevée (8, 12-14). De même, une laparotomie explo-
ratrice (46 %) ou une chirurgie gastroduodénale (31 %) ont une mortalité plus élevée que la chi-
rurgie colorectale, biliaire, urogynécologique, vasculaire ou pariétale ( 20 %). Ce critère n’est
cependant pas un facteur de risque indépendant, probablement en raison de son interaction avec
les pathologies médicales intercurrentes.
• Une intervention longue, par exemple de plus de trois ou quatre heures, est également connue pour
être responsable de complications postopératoires, en général septiques, cardiovasculaires ou respi-
ratoires, sans toutefois augmenter systématiquement la mortalité (12). Ce constat, qui consiste à dire
que la morbidité n’est pas constamment associée à une augmentation de la mortalité postopératoire,
est en général vérifié en pratique chirurgicale courante chez les malades jeunes. Cependant, la phy-
siologie propre du malade âgé ne lui permet probablement pas de lutter contre les complications post-
opératoires aussi efficacement que le malade plus jeune, même lorsque les examens objectifs ne mon-
trent pas d’insuffisance majeure. Cela est particulièrement observé chez les malades du quatrième âge,
c’est-à-dire au-dessus de 85 ans, et définit ce que l’on pourrait appeler la “réserve” du malade âgé.
La littérature ne permet pas de confirmer cette analyse en raison de la subjectivité de cette donnée.
Mais l’expérience chirurgicale permet quand même de constater que la morbidité grave peut favori-
ser la mortalité chez les malades âgés. La chirurgie du malade âgé doit donc être simple, courte et
sans risque. L’antibioprophylaxie, répétée si nécessaire, doit être systématique et encore plus rigou-
reuse chez les malades âgés pour éviter les complications postopératoires, tout comme la prévention
médicale et/ou le traitement précoce postopératoires des défaillances d’organes.
• Quand une intervention en urgence est nécessaire, le risque opératoire doit être clairement exposé
au malade si possible, ou sinon à la famille (11). En cas de facteurs de risque, l’alternative médicale,
si elle existe, doit être proposée de manière à permettre le traitement premier, ou au pire l’améliora-
tion, des maladies associées. Il en est de même pour la chirurgie élective qui permet, elle, de se don-
ner plus de temps pour corriger les troubles potentiellement réversibles. Dans la littérature, d’autres
pathologies (rénale, respiratoire, neurologique, cardiaque) ou procédures (type d’anesthésie ou chi-
rurgie en urgence) sont associées à un risque plus élevé de morbidité et de mortalité postopératoires
(6-8). Ces études ne comparent pas ces critères à ceux précédemment cités, sauf en ce qui concerne
la cirrhose hépatique.

Éditorial
Act. Méd. Int. - Gastroentérologie (13), n° 6, juin 1999 126
En conclusion, la mortalité postopératoire des malades âgés reste élevée malgré une sélection plus
objective des malades, et ce indépendamment du type d’intervention. Toutes les pathologies médicales
associées doivent être prises en compte pour apprécier au mieux l’état général du malade. Le cas de
figure est simple lorsqu’il existe plusieurs pathologies graves intriquées. Après avoir exposé précisé-
ment les risques au malade et à sa famille, on peut se donner le temps d’améliorer le statut médical
du malade et de proposer une alternative médicale. La décision d’une intervention revient alors plu-
tôt au malade, clairement informé, qu’au médecin, ou bien elle est prise après nouvelle exploration en
cas d’amélioration clinique. L’intervention doit alors être simple, courte et prudente. Quand bien même
le malade âgé peut paraître en bon état général, sans anomalie objective des fonctions vitales, il semble,
en pratique chirurgicale quotidienne, qu’il “lutte” moins bien que le malade jeune contre les compli-
cations postopératoires, qui peuvent alors augmenter l’incapacité et/ou la mortalité postopératoires.
Dans ce cas et surtout pour les malades du quatrième âge, il est également plus opportun de propo-
ser un “geste simple et court”.
M.J. Boudet*
* Département médico-chirurgical de pathologie digestive, institut Montsouris, université Paris VI.
Service de chirurgie digestive, hôpital des Gardiens de la Paix, Paris.
Références
1.
Specer G. Projections of the population of the United States by age sex and race : 1983 to 2080. Washington DC, US Dept. of
Commerce, Bureau of the Census, 1984.
2.
Les chiffres en santé : la démographie. 20/04/1999. Site Internet : http://www.medcost.fr.
3.
Sourty M.J. Enquête sur les hospitalisés 1991-1992. CREDES, 1993.
4.
Boyd J.B., Bradford B., Watne A.L. Operative risk factors of colon resection in the elderly. Ann Surg 1990 ; 192 : 743-6.
5.
Shamburek R.D., Farrar J.T. Disorders of the digestive system in the elderly. N Engl J Med 1990 ; 322 : 438-43.
6.
Reiss R., Haddad M., Deutsch A. et coll. Prognostic index : prediction of operative mortality in geriatric patients by use of stepwise
logistic regression analysis. World J Surg 1987 ; 11 : 248-51.
7.
Hosking M.P., Warner M.A., Lodbell C.M. et coll. Outcomes of surgery in patients of 90 years of age and older. JAMA 1989 ; 261 :
1909-15.
8.
Hessman O., Bergkvist L., Ström S. Colorectal cancer in patients over 75 years of age. Determinants of outcome. Eur J Surg Oncol
1997 ; 23 : 13-9.
9.
American Society of Anesthesiologists. New classification of physical status. Anesthesiology 1963 ; 24 : 111.
10.
Blanche C., Matloff J.M., Denton T.A. et coll. Cardiac operations in patients 90 years of age and older. Ann Thorac Surg 1997 ; 63 :
1685-90.
11.
Reiss R., Deutsch A., Nudelman I. Surgical problems in octogenarians : epidemiological analysis of 1 083 consecutive admissions.
World J Surg 1992 ; 16 : 1017-21.
12.
Belghiti J., Cherqui D., Langonnet F., Fékété F. Esophagogastrectomy for carcinoma in cirrhotic patients. Hépato-Gastroentérol
1990 ; 37 : 388-91.
13.
The Parisian Mediastinitis Study Group. Risk factors for deep sternal wound infection after sternotomy : a prospective, multicenter
study. J Thorac Cardiovasc Surg 1996 ; 111 : 1200-7.
14.
Fong Y., Brennan M.F., Cohen A.M. et coll. Liver resection in the elderly. Br J Surg 1997 ; 84 : 1386-90.
1
/
3
100%