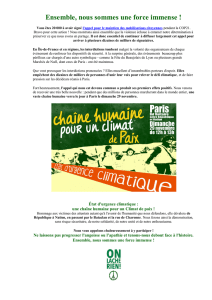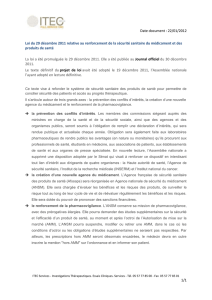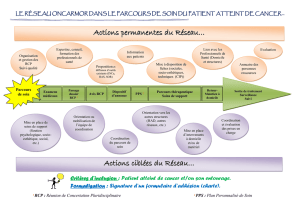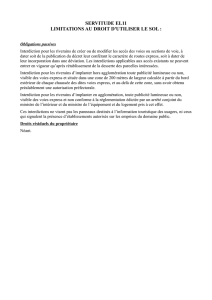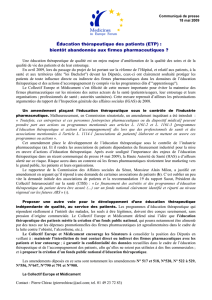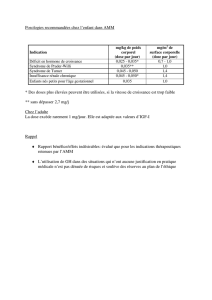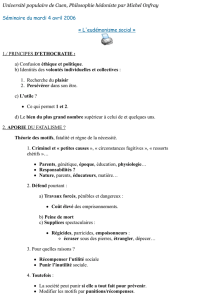Le contrôle de la publicité pour les médicaments :

54
La Lettre du Pharmacologue - Volume 18 - n° 2 - avril-mai-juin 2004
P
U B L I C I T É
L
e contrôle de la publicité pour les médicaments effec-
tuée par les firmes pharmaceutiques auprès des
membres des professions de santé repose en France sur
trois éléments :
✓Une définition large du concept de publicité, qui s’étend à
toute forme d’information sur le médicament, hormis les infor-
mations relatives à la santé ou aux maladies humaines (article
L 5522-1, CSP).
✓L’obligation dans la conception de la publicité du respect des
dispositions de l’AMM (article L 5122-2, CSP) et de la mono-
graphie de la spécialité appelée RCP (article R 5045).
✓L’obligation du dépôt en vue d’examen par l’AFSSAPS de
tous les documents publicitaires (article L 51-22-9, CSP), qui
sont soumis à l’avis d’une commission nationale de contrôle
c h a rgée de proposer au directeur général de l’AFSSAPS
d’éventuelles interdictions.
Le principe général du “contradictoire” est respecté, puisque
ces mesures d’interdiction ne peuvent être prises qu’après audi-
tion par la Commission de la firme pharmaceutique concernée
– si celle-ci le désire. Depuis la loi de financement de la Sécurité
sociale de 2001, ces interdictions sont susceptibles d’entraîner
des conséquences économiques pour les firmes pharmaceu-
tiques qui en ont fait l’objet. Ce système de contrôle a été trans-
posé en 1994 dans le droit français suite à la publication d’une
directive européenne de 1992. Or, il est intéressant de voir que
d’autres pays européens, tels que le Royaume-Uni, ont fait de
cette directive une lecture très différente de celle qui a prévalu
en France.
Le contrôle de la publicité pour les médicaments :
de l’analyse des interdictions
de publicité publiées
de 2001 à 2003 à la perspective
d’une évolution possible
du système français
The control of drug advertising for health professionals:
from an analysis of recent interdictions (2001-2003) to the possible
evolution of the French system of control of drug advertising
●P. Jaillon*
RÉSUMÉ.
Le contrôle de la publicité pour les médicaments destinée aux professionnels de santé a été organisé en France sur un modèle admi-
nistratif centralisateur. L’analyse des 28 interdictions de publicité parues au Journal officiel de janvier 2001 à septembre 2003 montre que le
motif d’interdiction le plus fréquent (58 % des cas) est l’absence de conformité de la publicité avec le résumé des caractéristiques du produit
(RCP). Deux motifs sont également présents : critique sur la méthodologie et/ou la présentation des résultats des essais cliniques (31,6 % des
cas), et discordance entre la publicité et les avis de la Commission de la transparence (10,4 %). Ces observations conduisent à proposer une
pédagogie des services de publicité et de marketing des laboratoires pharmaceutiques.
Ce système de contrôle de la publicité présente des inconvénients et des insuffisances importantes et il est d’un coût élevé. La seule évolution
possible serait de s’approcher d’un modèle anglo-saxon, le contrôle étant confié à une commission de professionnels de l’industrie du médi -
cament, et l’administration ne conservant qu’un rôle de surveillance de bon fonctionnement du système.
Mots-clés :
Médicaments - Publicité - Professionnels de santé.
ABSTRACT.
The control of drug advertising for health professionals has been organized in France on a centralized administrative model
under the control of the Safety Drug A g e n c y . The analysis of 28 recent prohibitions of drug advertising (January 2001 to September 2003) which w e re
published in the Journal officiel shows that the main reason (58%) for this prohibition was the lack of conformity between advertising and
the summary of product characteristics. Two other reasons were: inadequate methodology for clinical trials of drugs (31,6%) and discre p a n c y
between advertising and the recommendations of the official Commission de la Transparence (10,4%). These results should lead to propose
some pedagogic actions towards those persons in charge of marketing and advertising strategies in drug industry. This centralized mode of
c o n t rol of drug advertising shows important limits and deficencies and is not cost-effective. The only possible evolution of the system should be
to give the control of drug advertising to a commission of delegates of the drug industry under the supervision of the public health administration.
Keywords:
Drugs - Advertising - Health professionals.
* Service de pharmacologie, CHU Saint-Antoine, AP-HP et université Paris-VI.

L’objectif de cet article est d’analyser les motifs des récentes
interdictions récentes de publicités pour les médicaments
destinées aux professionnels de santé, et d’envisager, en fonction
de ces observations, une évolution possible, dans les années à
venir, du système de contrôle mis en place en France.
MÉTHODES
Vingt-huit interdictions de publicité médicale auprès des pro-
fessionnels de santé ont été publiées au Journal officiel sur une
période de 32 mois : 13 en 2001, 9 en 2002 et 6 de janvier à
septembre 2003. Ces interdictions ont été classées en fonction
de différents critères :
➀Classement des médicaments par domaine pharmacothéra-
peutique et/ou appartenance à une classe pharmacothérapeu-
tique.
➁Classification des motifs des interdictions en trois groupes
distincts : absence de conformité de la publicité avec le RCP
publié à l’occasion de la mise sur le marché du médicament et
actualisé postérieurement ; existence de critiques sur la métho-
dologie et/ou la présentation des résultats des essais cliniques
venant à l’appui des messages publicitaires ; différences entre
la publicité et l’avis de la Commission de la transparence publié
à l’occasion de l’évaluation du service médical rendu par le
médicament et de la demande de remboursement par les orga-
nismes de Sécurité sociale.
RÉSULTATS
Classement des interdictions par domaine pharmacothéra-
peutique
Le tableau I regroupe par classe pharmacothérapeutique les
médicaments ayant fait l’objet d’une des 28 interdictions. Le
domaine des médicaments cardiovasculaires vient en premier,
avec 9 interdictions sur 28 (32 %), suivi par les médicaments
antirétroviraux, avec 4 interdictions sur 28 (soit 14 %), les
médicaments inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), avec
3interdictions sur 28 (soit 11%), et les médicaments utilisés
dans l’ostéoporose, avec 2 interdictions sur 28 (soit 7 %). Vi e n-
nent ensuite divers médicaments qui totalisent 10 interdictions
sur 28 (soit 36 %).
Les noms des spécialités et des laboratoires pharmaceutiques
exploitants sont les suivants :
✓Domaine cardiovasculaire :
–En 2001 : Actilyse
®
(Boehringer Ingelheim France), Acuitel
®
(Pfizer), Aldalix
®
(Pharmacia SAS), Tanatril
®
(Beaufour).
–En 2002 : Ampecyclal
®
(EREMPharma), Cozaar
®
, Hyzaar
®
,
Fortzaar
®
(Merck Sharp et Dohme-Chibret).
–En 2003 : Detensiel
®
(Merck Lipha Santé), Kredex
®
(Roche),
Voluven
®
(Fresenius Kabi France).
✓Médicaments antirétroviraux :
– En 2001 : Ziagen
®
(GlaxoSmithKline).
–En 2002 : Kaletra
®
(Abbott France), Sustiva
®
(Bristol-Myers
Squibb).
– En 2003 : Epivir
®
(GlaxoSmithKline).
✓Inhibiteurs de la pompe à protons :
– En 2001 : Eupantol
®
(Altana Pharma).
– En 2002 : Eupantol
®
(Altana Pharma).
– En 2003 : Pariet
®
(Janssen-Cilag).
✓Médicaments anti-ostéoporose :
–En 2001 : Caperos
®
D3 (Bouchara-Recordati), Fixical
®
vita-
mine D3 (Expanscience).
✓Médicaments divers :
–En 2001 : Éductyl
®
(Techni-Pharma), Livial
®
(Organon SA),
Niquitin
®
(GlaxoSmithKline Santé Grand
Public), Rhinadvil
®
(Whitehall), Séglor
®
(Schwarz-
Pharma).
– En 2002 : Mediator
®
(Biopharma), Septisept
®
( C h e f a r o - A r d e -
val), Sibutral
®
(Abbott France), Tolexine
®
Gé (Biorga).
– En 2003 : Myocet
®
(Elan Pharma).
Identification et regroupement des motifs d’interdiction
Ces 28 interdictions de publicité sont étayées en fait par
5 7 motifs différents publiés au Journal officiel. Les motifs d’in-
terdiction de la publicité ont été regroupés en trois classes :
✓absence de conformité de la publicité avec le RCP ;
✓critiques sur la méthodologie et/ou la présentation des résul-
tats des essais cliniques venant à l’appui des messages publi-
citaires ;
✓différences entre la publicité et les avis de la Commission de
la transparence.
Les motifs les plus fréquemment rencontrés concernent la non-
conformité de la publicité avec le contenu du RCP,puisqu’ils
sont retrouvés 33 fois sur 57 (soit 58 % des cas). Le tableau II
résume ces différents motifs :
✓non-respect de l’indication thérapeutique retenue par l’AMM
(15,6 % des motifs) ;
✓mise en avant, dans la publicité, de propriétés pharmacody-
namiques non validées dans le paragraphe 5.1 du RCP (14 %
des motifs) ;
✓absence de prise en compte ou minoration délibérée des eff e t s
indésirables (8,8 % des motifs) ;
✓non-respect des contre-indications et/ou des précautions
d’emploi (8,8 % des motifs) ;
✓mise en valeur d’un critère de substitution ( s u rro g a t e -
endpoint) non validé par l’AMM (5,3 % des motifs) ;
La Lettre du Pharmacologue - Volume 18 - n° 2 - avril-mai-juin 2004
55
P
U B L I C I T É
Tableau I. Nombre d’interdictions par classe thérapeutique.
➀Cardiovasculaire 9 (32 %)
➁Anti-VIH 4 (14 %)
➂Inhibiteurs de la pompe à protons 3 (11 %)
➃Ostéoporose 2 (7 %)
➄Divers 10 (36 %)
✓cancer 1 ✓antiseptique 1
✓constipation 1 ✓stéroïde 1
✓diabète 1 ✓anti-tabac 1
✓obésité 1 ✓rhinite 1
✓antibiotique 1 ✓migraine 1
Nombre total : 28

✓revendication d’une efficacité non démontrée par des essais
thérapeutiques, et donc non validée par l’AMM (2 motifs) ;
✓enfin, existence d’une publicité pour une spécialité produite
avant la publication officielle de son AMM et de son RCP
(1 motif).
Viennent en deuxième position, pour la fréquence, les motifs
liés à une critique de la méthodologie et/ou de la présenta-
tion des résultats des essais cliniques utilisés comme arg u-
mentaires dans les messages publicitaires. Le tableau III
résume ces 18 motifs d’interdiction, qui représentent 31,6 %
des 57 motifs identifiés :
✓Les plus fréquents concernent les critiques méthodologiques
des essais (15,6 % des motifs) : absence d’objectifs précis ou
de hiérarchisation entre l’objectif principal de l’essai et ses
objectifs secondaires, imprécision quant aux circonstances du
déroulement de l’essai en simple ou double insu ou essais cli-
niques réalisés en ouvert, inadéquation des méthodes statis-
tiques utilisées dans ces essais ou absence de précision les
concernant.
✓Viennent ensuite la discordance entre le message publicitaire
et les résultats réels des essais cliniques (14 % des motifs), la
discordance entre la population cible définie par l’AMM et la
Commission de la transparence et la population des patients
inclus dans des essais cliniques cités dans la publicité (5,3 %
des motifs), la présentation incomplète des résultats des essais
sur les critères principal et secondaire (un cas), ainsi que l’ab-
sence totale d’article scientifique référencé à l’appui du mes-
sage publicitaire (un cas).
Le non-respect des avis et des fiches de la Commission de
la transparence vient au troisième rang des motifs d’interdic-
tion (10,4 % des motifs). Le tableau IV résume ces 6 motifs :
✓allégation de supériorité d’un médicament sur un autre, dans
le domaine de l’efficacité ou de la tolérance, non confirmée par
la Commission de la transparence (5,3 % des motifs) ;
✓absence de pertinence du médicament pris comme compa-
rateur (2 motifs) ;
✓enfin, présentation du médicament dans une stratégie de prise
en charge des patients qui n’est pas validée par la Commission
de la transparence (un motif).
Analyse de la répartition des motifs d’interdiction selon la
classe pharmacothérapeutique
Cette analyse montre que, dans les différents domaines théra-
peutiques, l’absence de respect de l’AMM et la non-conformité
des messages publicitaires au contenu du RCP viennent le plus
souvent en tête des motifs d’interdiction : 50 % des motifs d’in-
terdiction pour les médicaments cardiovasculaires, 71 % pour
les antirétroviraux, 100 % pour les médicaments anti-ostéopo-
rose et 70 % pour les autres médicaments considérés.
Les critiques méthodologiques sur les essais cliniques viennent
en seconde position dans les motifs d’interdiction pour les médi-
caments cardiovasculaires, les antirétroviraux et les médica-
ments divers, alors qu’elles représentent 80 % des motifs d’in-
terdiction des médicaments IPP.
DISCUSSION
Respect de l’AMM
L’analyse des interdictions de publicité pour les médicaments
confirme tout d’abord que le principal motif des interdictions
concerne l’absence de respect de l’AMM et du RCP. L’infrac-
tion à l’article L.5122-2 du CSP (la publicité doit respecter les
dispositions de l’annexe 1 de l’AMM) constitue bien le motif
le plus fréquent des interdictions (58 % des motifs d’interdic-
tion). Ces manquements visent le plus souvent l’indication thé-
rapeutique et les propriétés pharmacodynamiques du médica-
ment validées par la Commission d’AMM, ou concernent, en
second lieu, une minoration systématique ou un “oubli” des
e ffets indésirables, des précautions d’emploi et des contre-
indications des médicaments. Ce constat nous conduit aux
réflexions suivantes :
✓Les services (publicité, marketing) qui élaborent les mes-
sages publicitaires au sein d’une firme pharmaceutique ne tien-
nent pas assez compte du texte du RCP. L’AMM n’est pas une
simple démarche formelle, et le RCP n’est pas un “chiffon de
papier”. Le RCP est rédigé par la Commission d’AMM à par-
tir des propositions du laboratoire, en considérant les données
56
La Lettre du Pharmacologue - Volume 18 - n° 2 - avril-mai-juin 2004
P
U B L I C I T É
Tableau II. Analyse des motifs d’interdiction.
Non-respect du résumé des caractéristiques du produit (RCP) 33 (58 %)
✓Non-respect de l’indication thérapeutique 9 (15,6 %)
✓Propriétés pharmacodynamiques non validées 8 (14 %)
✓Effets indésirables ignorés ou minorés 5 (8,8 %)
✓Contre-indications des précautions d’emploi non respectées 5 (8,8 %)
✓Critère de substitution (surrogate endpoint) non validé 3 (5,3 %)
✓Efficacité non démontrée 2
✓AMM non encore publiée 1
Tableau III. Analyse des motifs d’interdiction.
Critiques de la méthodologie des essais cliniques 18 (31,6 %)
✓Critiques méthodologiques 9 (15,6 %)
(objectifs, aveugle, statistiques...)
✓Publicité non conforme 8 (14 %)
avec les résultats des essais cliniques
✓Population incluse non conforme 3 (5,3 %)
✓Présentation incomplète 1
des critères principaux/secondaires
✓Absence d’article référencé 1
Tableau IV. Analyse des motifs d’interdiction.
Non-respect des avis et fiches de transparence 6 (10,4 %)
✓Supériorité (efficacité/tolérance) non 3 (5,3 %)
confirmée par la Commission
✓Comparateur non valable 2
✓Place dans une stratégie thérapeutique 1
non validée par la Commission

fournies par celui-ci. Il représente la synthèse des “données
actuelles de la science” concernant la spécialité dans le cadre
de l’indication thérapeutique revendiquée. Le projet de texte
est ensuite amendé par le laboratoire, qui peut y faire apporter
des modifications en s’appuyant sur des éléments du dossier
d’AMM du médicament. Finalement approuvé et diffusé, le
RCP constitue le minimum des informations sur les médica-
ments utiles pour le prescripteur, afin de favoriser le bon usage
du médicament. Ce sont donc ces informations qui doivent figu-
rer en priorité dans les messages publicitaires.
✓Les messages publicitaires doivent “permettre au destinataire
de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du
médicament” (article R. 5047-1, CSP). À ce titre, c’est à partir
des données cliniques d’efficacité et de tolérance apportées par
les essais thérapeutiques qui ont permis l’AMM que les pres-
cripteurs pourront se faire une “idée personnelle” sur la valeur
thérapeutique de la spécialité. C’est pourquoi la présentation
verbale du médicament par les visiteurs médicaux doit être
accompagnée d’une remise en main propre aux professionnels
de santé du RCP et du dernier avis de
la Commission de la trans-
parence le concernant (article R 5047-3,
CSP). La Commission
de la transparence ayant pour mission de comparer le médica-
ment à ceux déjà existants et de préciser l’amélioration éven-
tuelle du service médical rendu qu’il apporte, cet avis permet-
tra aux prescripteurs de compléter leur “idée personnelle” sur
la valeur thérapeutique du médicament et sa place dans la stra-
tégie individuelle de traitement d’un patient.
✓Le respect du RCP pour la conception des messages publi-
citaires est inscrit dans la loi française (articles L.5122-2 et
R.5045 du CSP). Il est donc contraignant pour toutes les firmes
pharmaceutiques qui vendent des médicaments sur le territoire
français, même si certaines de ces firmes, filiales de groupes
étrangers, reçoivent de leurs maisons-mères des directives
publicitaires non forcément conformes au RCP français ou aux
avis de la Commission de la transparence. Des discussions
internes à ces firmes doivent permettre aux dirigeants français
d’expliquer la position de notre pays. Ensuite, c’est aux indus-
triels concernés de prendre leurs responsabilités.
Critiques méthodologiques
Depuis plusieurs années, des exigences de qualité relatives à la
méthodologie des essais cliniques des médicaments ont été expri-
mées et diffusées par la Commission de contrôle de la publicité.
Cela correspond à l’amélioration des standards méthodologiques
des essais dans tous les pays industrialisés. Il est largement admis
aujourd’hui qu’un essai clinique doit être prospectif, compara-
tif, randomisé et réalisé si possible en double insu. L’hypothèse
de l’essai doit être clairement formulée, afin de savoir si l’on
poursuit un objectif de démonstration de supériorité ou d’équi-
valence entre les produits comparés. Le calcul du nombre de
patients à inclure dans l’essai pour rechercher cette supériorité
ou cette équivalence, si elle existe, doit être clairement explicité.
L’analyse des résultats doit être réalisée en intention de traiter à
l’aide de tests statistiques appropriés. La comparaison des résultats
entre les deux (ou plus) groupes de patients (dont on aura montré
qu’ils n’étaient pas significativement différents à l’inclusion dans
l’essai) se fera après une période déterminée de traitement. L’ a b s e n c e
de patients “perdus de vue” dans l’essai est un des critères
majeurs de sa qualité.
Tout ceci est connu des médecins et des évaluateurs. Cependant,
il reste souvent à en expliquer l’intérêt et l’importance aux per-
sonnes qui élaborent les messages publicitaires et choisissent les
articles scientifiques qui viennent à l’appui de leur arg u m e n t a i r e .
Ces personnes peuvent très bien ne pas comprendre les tenants et
les aboutissants de ces contraintes méthodologiques, qui parais-
sent parfois excessives et de nature à compliquer inutilement
leur tâche. C’est là une pédagogie à développer dans les firmes
pharmaceutiques en direction de leurs publicitaires.
Perspectives d’avenir
Le contrôle de la publicité pour les médicaments repose essen-
tiellement en France sur l’administration (AFSSAPS), qui s’en-
toure d’avis d’experts et de rapporteurs et qui, pour les projets
d’interdiction, s’appuie sur les délibérations de la Commission
nationale de contrôle.
Or, ce système centralisé présente les inconvénients suivants :
✓Le contrôle est limité et n’est effectué vraiment que sur les
annonces de la presse médicale, les documents utilisés ou dis-
tribués par les délégués médicaux, les informations affichées par
les firmes pharmaceutiques sur leurs sites Internet et les documents
distribués aux médecins lors des symposiums satellites de
congrès organisés par les firmes pharmaceutiques. Il faut bien
reconnaître qu’un prescripteur de médicaments reçoit aujourd’hui
de nombreuses autres informations par la presse (professionnelle
et grand public), la radio ou la télévision, et a accès via Internet
à toutes sortes d’informations sur les médicaments. Ces diverses
sources d’information échappent au contrôle de l’AFSSAPS.
✓Le nombre d’interdictions de publicité prononcées définiti-
vement par la Commission est faible : 28 en deux ans et demi,
sur plus de 2 0 0 0 documents déposés ou analysés à l’AFSSAPS.
Cela signifie qu’un contrôle interne existe déjà dans les firmes
pharmaceutiques, et qu’il est efficace. Cela signifie aussi qu’on
a institué un contrôle centralisé, lourd et important par les
moyens qu’il met en œuvre, pour prononcer chaque année seu-
lement quelques dizaines d’interdictions.
✓Le contrôle centralisé de la publicité coûte cher aux indus-
triels du médicament, qui paient une redevance (limitée à
460 Ä, article L. 5122-4, CSP) à l’AFSSAPS lors de chaque
dépôt de publicité. Il coûte cher également à l’administration,
qui doit payer des contrôleurs internes et des rapporteurs
externes chargés d’analyser les dossiers déposés.
✓Le contrôle centralisé prend du temps, et la firme pharma-
ceutique est souvent informée d’une mise en demeure de modi-
fication ou d’un projet d’interdiction d’une publicité plusieurs
mois après la fin de la campagne publicitaire incriminée. Donc,
“le mal est fait”, et ce contrôle “à distance” n’a plus grand sens
pour le prescripteur, qui n’est d’ailleurs pas tenu informé de
ces décisions de l’AFSSAPS.
✓Enfin, le fameux débat contradictoire avec la firme pharmaceu-
t ique n’a lieu que pour les projets d’interdiction. Or, un grand nombre
de “mises en demeure de modification de documents” sont envoyées
directement par l’administration sans qu’il y ait débat ou discussion
La Lettre du Pharmacologue - Volume 18 - n° 2 - avril-mai-juin 2004
57
P
U B L I C I T É

devant la Commission nationale. Nombre de ces “mises en
demeure” sont d’ailleurs discutables – et discutées par les firmes
– , et l’administration exerce là un contrôle arbitraire qui ne
repose pas toujours sur une correcte analyse méthodologique
des articles scientifiques contestés. Il en résulte des contentieux
donnant lieu à des échanges de courrier, des demandes de ren-
dez-vous, etc., qui représentent une consommation d’“énerg i e ”
importante pour les firmes et l’administration.
En conclusion, il s’agit d’un système lourd, centralisateur et
dépensier (jacobino-napoléonien), ne concernant qu’une toute
petite partie de la masse d’informations que reçoivent aujour-
d’hui les prescripteurs de médicaments.
Un dernier problème est fréquemment soulevé par les firmes
pharmaceutiques, concernant les résultats des essais cliniques.
L’évaluation de ces résultats par la Commission d’AMM et la
Commission de la transparence prend du temps. Il n’est donc
pas rare que 12 à 18 mois soient nécessaires pour intégrer dans
le RCP ou l’avis de la Transparence les résultats d’un essai
clinique d’un médicament qui a fait l’objet au moment de sa
publication d’un grand battage médiatique. Les médecins, les
pharmaciens et, de plus en plus souvent, les malades eux-mêmes
sont au courant de ces résultats. Or, pendant ces 12 à 18 m o i s ,
les seuls qui ne peuvent officiellement pas parler de cet essai sont
les représentants de la firme pharmaceutique exploitant la spé-
cialité en question (alors que leurs concurrents ne s’en privent pas ! ) .
Ces inconvénients étant identifiés, comment envisager une évo-
lution possible du système français dans le domaine du contrôle
de la publicité ? Une piste à explorer serait de s’inspirer du
modèle britannique (Code of Practice for the Pharmaceutical
I n d u s t ry. Prescription medicines code of practice authority.
2003 edition. ABPI Éditeur, Londres), en confiant en premier
lieu le contrôle de la publicité aux professionnels eux-mêmes,
l’administration n’exerçant qu’un contrôle “en deuxième ligne”
du fonctionnement du système et se réservant le droit d’appli-
quer des sanctions économiques si le “premier contrôle” venait
à défaillir ou s’avérait complaisant. Les principes d’un tel sys-
tème pourraient être les suivants :
✓L’ o r ganisation du contrôle de la publicité serait confiée à une
Association française des firmes pharmaceutiques, qui serait
c h a r gée de nommer un groupe d’experts indépendants en charg e
de ce contrôle (l’autorité de contrôle).
✓Les contestations sur une publicité médicale devraient être
adressées à cette autorité de contrôle et pourraient provenir de
n’importe quelle personne physique ou morale, y compris d’une
firme pharmaceutique concurrente de celle qui est mise en
cause, voire même d’une administration.
✓Le dossier de contestation ferait l’objet d’une instruction
menée par des experts indépendants nommés par l’autorité de
contrôle avant d’être présenté devant cette dernière, qui se pro-
noncerait en première instance. Si la firme pharmaceutique était
déclarée fautive “en première instance”, elle aurait la possibi-
lité de faire appel devant une commission mixte regroupant des
experts médecins et pharmaciens indépendants ainsi que des
représentants de firmes pharmaceutiques. Après un débat
contradictoire entre les “attaquants” et les “défenseurs” de la
firme, la Commission d’appel prononcerait un jugement “en
deuxième instance” qui serait définitif.
✓Si une firme pharmaceutique était sanctionnée pour une
publicité pour un médicament, elle risquerait diverses sanc-
tions : la réprimande publique, l’audit interne visant à amélio-
rer le contrôle interne de la publicité dans cette firme, l’obli-
gation de publication d’un rectificatif, et, au maximum,
l’exclusion de la firme de l’association. Si la firme pharma-
ceutique était exclue de l’association, l’autorité de contrôle de
la publicité informerait l’agence gouvernementale (AFSSAPS)
que cette firme a été sanctionnée et que l’autorité de contrôle
n’est plus responsable du contrôle de la publicité de la firme
en question.
✓Toutes ces décisions seraient communiquées à l’AFSSAPS,
qui vérifierait le bon fonctionnement du contrôle, gardant la
possibilité d’intervenir en cas d’anomalie grave.
✓Le dossier complet de chaque sanction serait rendu public,
ce qui permettrait à tout le monde d’être informé des motivations
de la décision.
Il est facile de dire que ce type de système anglo-saxon n’est
pas adaptable à la France, où les professionnels ne seraient soi-
disant pas capables de se plier à cet autocontrôle. Il faut recon-
naître que cette évolution nécessite un changement culturel très
important, aussi bien pour l’administration que pour les firmes
pharmaceutiques françaises. Elle implique également que soit
modifiée la loi de 1994 sur le contrôle de la publicité, et que la
représentativité de l’instance professionnelle soit telle que le
risque d’exclusion ait un sens, voire même des conséquences
économiques. Mais ne voit-on pas dans la France de 2004 une
évolution dans certains domaines où l’administration confie de
plus en plus aux professionnels eux-mêmes le soin de contrô-
ler leurs pratiques, en se réservant la mission de veiller seule-
ment au bon fonctionnement du système, sans être en “première
ligne” en permanence ? Cette piste de réflexion anglo-saxonne
ne manquera pas de déclencher des réserves ou des réticences,
aussi bien chez les industriels que chez les administratifs. Mais
si cette perspective n’était pas sérieusement envisagée, nous ne
voyons pas comment le système de contrôle de la publicité “à
la française” pourrait réellement s’améliorer sans atteindre des
coûts prohibitifs.
CONCLUSION
Les interdictions de publicité pour les médicaments à l’usage
des professionnels de santé sont motivées, en ordre décrois-
sant, par l’absence du respect de l’AMM, la critique de la
méthodologie des essais cliniques cités dans la publicité et l’ab-
sence de conformité avec les avis de la Commission de la trans-
parence. Le droit français a organisé le contrôle de la publicité
sur le modèle centralisateur de l’administration, et ce système
présente de nombreux défauts. Or, ces trois grands types de
motifs d’interdiction pourraient très bien être détectés dans un
autre système de contrôle, organisé à l’anglo-saxonne. Il serait
possible de s’inspirer du modèle britannique, qui confie à l’As-
sociation des firmes pharmaceutiques le soin d’organiser un
autocontrôle professionnel indépendant, sous le regard vigilant
de l’administration. Cette évolution du droit nous semble la
seule envisageable si l’on veut réformer le contrôle de la publi-
cité pour les médicaments en France.
■
58
La Lettre du Pharmacologue - Volume 18 - n° 2 - avril-mai-juin 2004
P
U B L I C I T É
1
/
5
100%