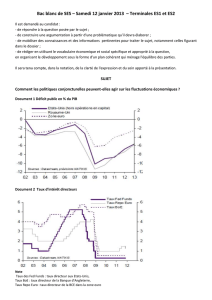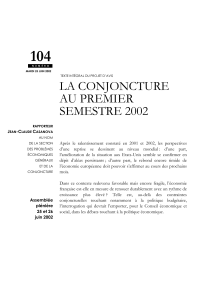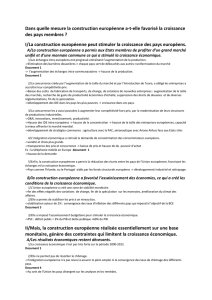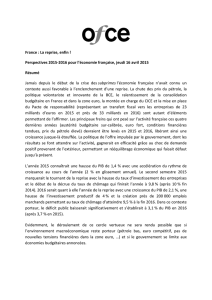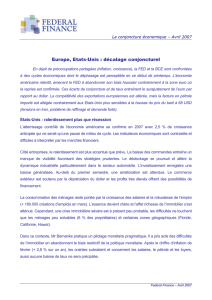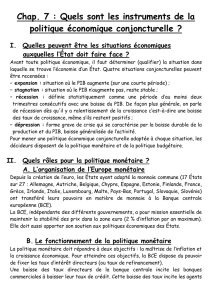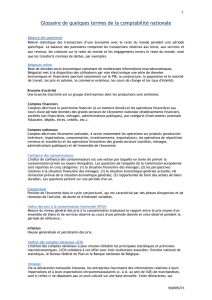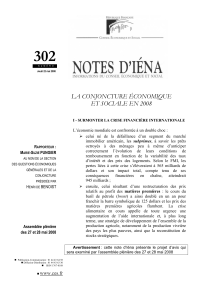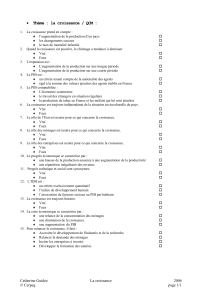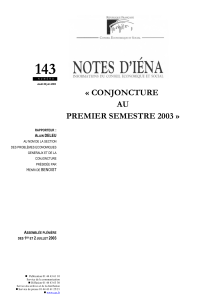AVIS adopté par le Conseil économique et social

III
SOMMAIRE
Pages
AVIS adopté par le Conseil économique et social
au cours de sa séance du 23 juin 1999..................... I - 1
INTRODUCTION...............................................................................................5
CHAPITRE I - L’ÉCONOMIE MONDIALE SOUS LE CHOC DES
CRISES FINANCIÈRES .........................................................7
I - DE LA CRISE ASIATIQUE À LA CRISE BRÉSILIENNE...........7
A - LA PROPAGATION DE LA CRISE ASIATIQUE AUX
AUTRES PAYS ÉMERGENTS ..........................................................7
1. Retour sur la crise financière en Asie ...............................................7
2. La crise russe de l’été 1998 et son impact ......................................10
3. Les difficultés de l’Amérique latine................................................11
B - UNE CROISSANCE RESTÉE DYNAMIQUE EN AMÉRIQUE
DU NORD ET EN EUROPE .............................................................14
1. Les effets contradictoires de la crise des pays émergents...............14
2. Les zones de croissance les plus dynamiques de la planète............16
II - DES PERSPECTIVES INCERTAINES POUR L’ÉCONOMIE
MONDIALE......................................................................................18
A - LA CONFIRMATION D’UN RALENTISSEMENT........................18
1. Une sortie de crise longue et difficile pour la plupart des pays
émergents .......................................................................................19
2. Le Japon, élément décisif de la reprise mondiale ...........................21
3. Une interrogation majeure : les perspectives de croissance aux
Etats-Unis.......................................................................................22
4. Une situation conjoncturelle en demi-teinte pour l’Union
européenne.....................................................................................23
B - LES RÉFLEXIONS EN COURS SUR LA RÉGULATION DE
L’ÉCONOMIE MONDIALE.............................................................24
1. Le nouveau rôle des actionnaires dans le « gouvernement » des
entreprises et ses conséquences......................................................25
2. La gestion des crises financières et la nécessité de la prévention ...26
CHAPITRE II - UNE CROISSANCE AUX RESSORTS DISTENDUS ......31
I - 1998 : UNE AMÉLIORATION DE L’ACTIVITÉ ET DE
L’EMPLOI........................................................................................31
A - VUE D’ENSEMBLE DE L’ANNÉE : UNE CROISSANCE
SOUTENUE ET VERTUEUSE.........................................................31
1. Une demande intérieure particulièrement dynamique.....................32

IV
2. Des créations d’emplois importantes autorisant la poursuite de la
baisse du chômage .........................................................................41
3. Une « inflation zéro » et une baisse des prix à la production..........46
4. Le maintien d’un excédent extérieur élevé .....................................48
5. Une transition technique réussie vers l’euro...................................52
B - UNE INFLEXION DEPUIS L’ÉTÉ ..................................................53
1. Une moindre croissance du PIB, un plafonnement de la
production industrielle et un secteur tertiaire toujours
dynamique......................................................................................53
2. Un essoufflement de la demande intérieure....................................55
3. Un tassement du marché de l’emploi..............................................57
II - 1999 : UNE CROISSANCE RALENTIE........................................58
A - LES PERSPECTIVES GOUVERNEMENTALES ...........................58
B - UNE PRÉVISION SOUMISE À DE NOMBREUX ALÉAS............60
1. Les aléas liés à l’environnement international................................61
2. Les aléas d’ordre interne.................................................................62
3. Quelles conséquences pour les finances publiques ? ......................67
CHAPITRE III - LA COMPATIBILITÉ DE LA GESTION MACRO-
ÉCONOMIQUE AVEC LA NOUVELLE DONNE
EUROPÉENNE ......................................................................69
I - LA POLITIQUE MONÉTAIRE ET LES EFFORTS DE
CONVERGENCE DANS LE CADRE DE L’UEM.......................69
A - LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES................................70
B - LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE LA BCE...................................71
C - LES « GRANDES ORIENTATIONS » DÉFINIES PAR LA
COMMISSION ..................................................................................74
II - L’ARTICULATION DES CHOIX DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE NATIONALE EN FAVEUR DE LA
CROISSANCE ET DE L’EMPLOI................................................77
A - LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE......................................................77
1. L’exécution du budget de l’Etat pour 1998 ....................................78
2. Le budget de l’Etat pour 1999 ........................................................78
3. La loi de programmation budgétaire 2000-2002 et le projet de
loi de finances pour 2000...............................................................82
B - LES RÉFLEXIONS EN FAVEUR D’UN RENFORCEMENT DE
L’EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ..............................86
CONCLUSION..................................................................................................89
ANNEXE A L’AVIS..........................................................................................91
SCRUTIN............................................................................................................91

1
AVIS
adopté par le Conseil économique et social
au cours de sa séance du 23 juin 1999

2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
1
/
117
100%