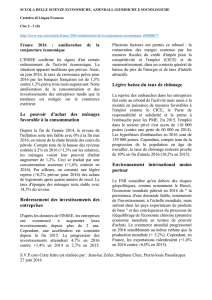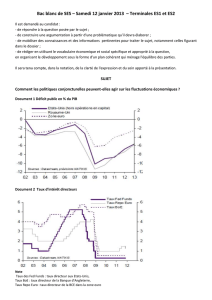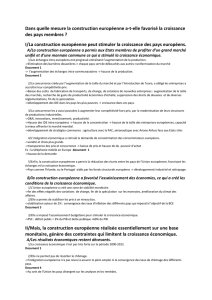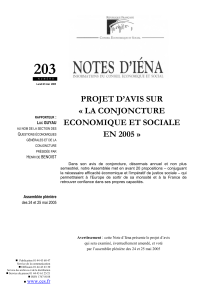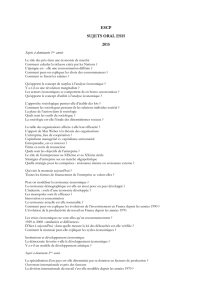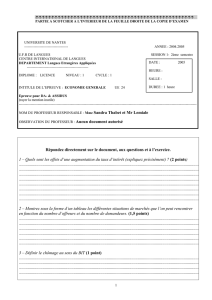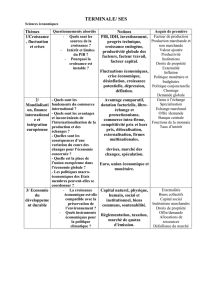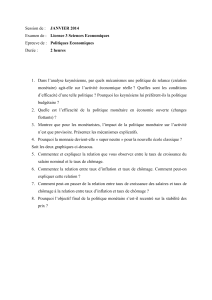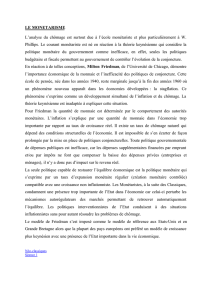AVIS adopté par le Conseil économique et social au

III
SOMMAIRE
Pages
AVIS adopté par le Conseil économique et social au
cours de sa séance du 15 décembre 1999................. I - 2
INTRODUCTION...............................................................................................5
CHAPITRE I - LA CROISSANCE EST DE RETOUR ................................9
I - LE RETOUR DE LA CROISSANCE NE RÉSULTE PAS
D’UN MIRACLE................................................................................9
A - UN CHANGEMENT DE CAP DE 180° POUR LA POLITIQUE
MONÉTAIRE ......................................................................................9
1. Les faits ............................................................................................9
2. Pourquoi cette révolution ?.............................................................10
3. Quelles conséquences ? ..................................................................11
B - L’ABANDON IMPLICITE DU DOGME DE LA MONNAIE
FORTE : « UNE BÉNÉDICTION CACHÉE »...................................12
C - L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT DES
MÉNAGES.........................................................................................14
D - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE A FAVORISÉ LE
REDÉMARRAGE DE LA CROISSANCE PUIS A PERMIS
D’EMPÊCHER SON ASPHYXIE PAR LES CONSÉQUENCES
DE LA CRISE FINANCIÈRE DE L’ÉTÉ 1998 ................................15
II - FORTE EN 1999, LA CROISSANCE VA S’ACCÉLÉRER EN
2000....................................................................................................19
A - LARGE CONSENSUS SUR LES PRÉVISIONS QUANT AU
TAUX DE CROISSANCE DU PIB...................................................19
B - TOUS LES FACTEURS DE LA CROISSANCE SONT BIEN
ORIENTÉS.........................................................................................20
1. La reprise industrielle est enclenchée.............................................20
2. Les créations d’emplois sont importantes.......................................21
3. La consommation des ménages est en forte accélération ...............21
4. Le rebond relatif de l’investissement des entreprises n’a été que
très faiblement affecté par la crise asiatique ..................................22
5. L’investissement dans le logement des ménages est au plus haut
depuis dix ans.................................................................................23
6. Les exportations sont reparties .......................................................23
C - AUCUNE CONTRAINTE PROPRE A L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE......................................................................................25
1. Non seulement il n’y a pas d’inflation, mais il n’y aucun risque
inflationniste à l’horizon ................................................................25

IV
2. La réduction des déficits publics se poursuit..................................25
3. La contrainte extérieure a été desserrée..........................................26
III - LA CROISSANCE N’EST TOUTEFOIS PAS À L’ABRI
D’UN CHOC EXTÉRIEUR ............................................................28
A - LES INCERTITUDES AMÉRICAINES...........................................28
1. Le déficit extérieur américain atteint des montants considérables
et sans précédent ............................................................................28
2. La Bourse américaine semble dangereusement surévaluée............28
B - LA SURÉVALUATION DU YEN EST DANGEREUSE ................30
C - L’ÉVOLUTION DU PRIX DU PÉTROLE PEUT CRÉER DES
RISQUES ...........................................................................................31
D - L’AMÉRIQUE LATINE CONNAÎT DE PROFONDS
DÉSÉQUILIBRES .............................................................................32
E - LA CHINE ET LA ZONE ASIATIQUE ...........................................33
1. La Chine : la dévaluation du yuan est un risque sérieux.................33
2. L’Asie du sud-est : un retournement fragile ...................................33
CHAPITRE II - QUELLE POLITIQUE EUROPÉENNE POUR
SOUTENIR LA CROISSANCE ET LUTTER CONTRE
LE CHÔMAGE ?...................................................................35
I - REVENIR A UNE POLITIQUE MONÉTAIRE
ACCOMMODANTE : ARRÊTER DE POURSUIVRE LE
« FANTÔME » DE L’INFLATION ................................................35
II - NE PAS INCITER À LA SURÉVALUATION DE L’EURO .......37
III - DONNER UN CONTENU ET UNE RÉALITÉ AU PACTE
EUROPÉEN POUR L’EMPLOI ....................................................38
A - MOBILISER TOUS LES DOMAINES DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE POUR LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE..........38
B - DES ACTIONS STRUCTURELLES EUROPÉENNES EN
FAVEUR DE LA CROISSANCE À LONG TERME .......................39
C - LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
EUROPÉENNES EST INDISPENSABLE POUR FAIRE FACE
AUX ÉVOLUTIONS ASYMÉTRIQUES .........................................39
IV - L’EUROPE SOCIALE NE DOIT PAS RESTER AU STADE
DE L’INCANTATION.....................................................................40
A - RÉPONDRE AUX DÉFIS.................................................................40
B - LES AVENIRS SOUHAITABLES DE L’EUROPE SOCIALE.......41
V - LA FRANCE ET L’EUROPE DOIVENT AGIR AU NIVEAU
MONDIAL ........................................................................................42

V
A - UNE RÉFORME DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL
EST URGENTE .................................................................................42
1. Le détournement des aides publiques internationales par des
groupes maffieux ...........................................................................42
2. L’utilisation des aides du FMI pour maintenir les distorsions de
concurrence destructrices d’emplois en France .............................43
3. Le rôle des spéculateurs dans les crises financières
internationales................................................................................43
B - DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE L’EUROPE DANS LA
NÉGOCIATION DU CYCLE DU MILLÉNAIRE............................44
CHAPITRE III - LES GRANDS AXES D’ACTION DANS LE
DOMAINE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EN FRANCE..45
I - LE RETOUR AU PLEIN EMPLOI EST UNE IMPÉRIEUSE
NÉCESSITÉ .....................................................................................45
A - UNE RÉDUCTION DU CHÔMAGE TRÈS NETTE MAIS
ENCORE INSUFFISANTE ...............................................................45
1. L’importance des créations d’emplois depuis 1997…....................45
2. …a permis une réduction sensible du chômage….........................47
3. …mais sans parvenir à enrayer le développement de la précarité .48
B - LE NIVEAU DU CHÔMAGE DANS LES DÉPARTEMENTS
D’OUTRE-MER EST DRAMATIQUE.............................................50
C - L’EFFET A TERME DES 35 HEURES EST ENCORE
INDÉTERMINABLE.........................................................................51
D - SEULE UNE CROISSANCE FORTE PERMETTRA DE
VAINCRE CE CANCER DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES
QU’EST LE CHÔMAGE...................................................................53
II - LES DÉPENSES PUBLIQUES ET LES DÉPENSES
FISCALES DOIVENT ÊTRE MAÎTRISÉES...............................55
A - IL SERAIT ABSURDE DE « DIABOLISER » LA DÉPENSE
PUBLIQUE ........................................................................................55
B - NÉANMOINS, LA FRANCE DOIT PROFITER DU
CONTEXTE CONJONCTUREL ACTUEL POUR RÉDUIRE SA
DETTE PUBLIQUE GRÂCE À UNE MAÎTRISE DE SES
DÉPENSES PUBLIQUES .................................................................56
1. La part des dépenses publiques et de la dette publique dans le
PIB n’a cessé de croître depuis trente ans......................................56
2. Cette situation présente plusieurs inconvénients de type différent.57
3. Les moyens à mettre en œuvre .......................................................59
III - LA POURSUITE DE LA PROGRESSION DU POUVOIR
D’ACHAT DES MÉNAGES ...........................................................60
IV - LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS SOCIALES RESTE
D’UNE BRÛLANTE ACTUALITÉ................................................62

VI
A - LE RETOUR DE LA CROISSANCE NE RÉDUIRA PAS
SPONTANÉMENT LES INÉGALITÉS............................................62
B - ENTRE 1970 ET 1996, LES INÉGALITÉS DE REVENUS ONT
PROGRESSIVEMENT CESSÉ DE BAISSER .................................63
1. Parmi les ménages de salariés, les inégalités ont baissé jusqu’en
1990, mais augmentent depuis.......................................................63
2. Parmi les ménages de retraités, les inégalités auraient cessé de
baisser depuis 1984........................................................................63
3. Les salariés payés au voisinage du SMIC ont des niveaux de vie
très disparates.................................................................................64
4. Pas de changements notables concernant les revenus du
patrimoine entre 1991 et 1997 .......................................................64
C - DES INÉGALITÉS DE PATRIMOINE ACCENTUÉES .................64
1. Le patrimoine croît fortement avec le revenu.................................64
2. Les valeurs mobilières représentent une part importante des gros
patrimoines.....................................................................................65
V - LES RÉGIMES SOCIAUX DOIVENT ÊTRE PRÉSERVÉS......66
A - L’AMÉLIORATION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE...........................................................................................66
1. Une réalité due essentiellement à une amélioration des recettes ....66
2. Les efforts pour améliorer la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé devraient être amplifiés....................................................68
B - L’AVENIR DES SYSTÈMES DE RETRAITE EN DÉBAT............68
VI - LE DIALOGUE SOCIAL DOIT ÊTRE ENRICHI.......................68
A - UN BILAN CONTRASTÉ EN 1998.................................................68
B - UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À CONFIRMER........................71
CONCLUSION..................................................................................................72
ANNEXE A L’AVIS ..........................................................................................74
SCRUTIN............................................................................................................74
DÉCLARATIONS DES GROUPES...................................................................76
LISTE DES ILLUSTRATIONS.......................................................................94
NOTES DE BAS DE PAGE .............................................................................95

AVIS
adopté par le Conseil économique et social
au cours de sa séance du 15 décembre 1999
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
1
/
99
100%