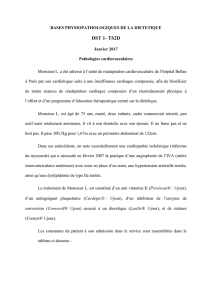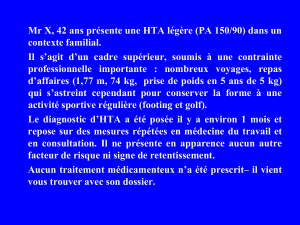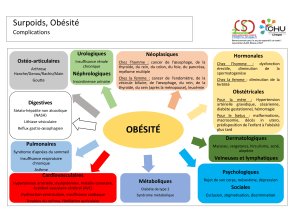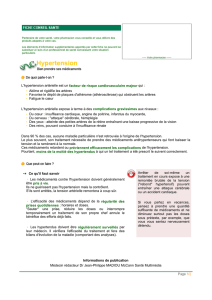VA-HIT : protection par la hausse du HDL, non par la

139
VA-HIT : protection par la
hausse du HDL, non par la
baisse des TG
Les résultats précédemment publiés
de VA-HIT avaient montré une diminution
de 22 % des risques cardiovasculaires
chez des hommes coronariens américains
grâce au gemfibrozil 1 200 mg par jour,
en parallèle à une augmentation de 6 % du
HDL et à une diminution de 30 à 50 % des
TG. Le point important de cette étude était
qu’à l’entrée, les patients avaient un LDL-C
moyen de 1,11 g/l, donc proche de la cible
des recommandations américaines en pré-
vention secondaire, des TG peu élevées,
en moyenne à 1,62 g/l, et un HDL-C bas,
en moyenne à 0,32 g/l. Aucune modifica-
tion du taux de LDL-C n’avait été induite
par le traitement. Restait à savoir la part
relative de l’augmentation du HDL et de
la baisse des TG dans cette diminution du
risque cardiovasculaire. Dans cette publi-
cation, des analyses statistiques concluent
qu’une augmentation du HDL de 0,05 g/l
permet une diminution de 11 % du risque
cardiovasculaire. La baisse des TG n’est
pas statistiquement associée à l’effet
bénéfique observé. Par ailleurs, la hausse
du HDL n’explique que 23 % de l’effet
protecteur du gemfibrozil : cela suggère
l’implication d’effets pléiotropes de la
molécule, notamment via la stimulation
de récepteurs nucléaires, les PPAR, dépas-
sant la simple hausse du HDL. Les résul-
tats de cette étude ont certaines limites : la
population est exclusivement masculine,
les résultats ne peuvent donc pas être
extrapolés aux femmes. Une forte propor-
tion de la population était diabétique ou
intolérante aux hydrates de carbone à
l’entrée (environ 40 %), conférant aux
patients un profil de risque particulière-
ment élevé. Enfin, les patients dont les TG
excédaient 3 g/l à l’entrée ont été exclus,
ce qui correspond environ à 15 % des
patients en prévention secondaire.
Néanmoins, cette étude est la première à
démontrer qu’une intervention sur le HDL
sans modification du LDL diminue le
risque cardiovasculaire et confirme donc
la place des fibrates en prévention secon-
daire, lorsque le patient associe LDL peu
élevé et HDL bas. Reste à savoir si une
intervention portant uniquement sur le
HDL, sans baisse des TG, dans une popu-
lation de patients à HDL bas isolé, donne-
rait le même type de résultats. Il n’existe
pas pour l’instant de molécule agissant
spécifiquement sur le taux de HDL.
– Robins S et al. Relation of gemfibrozil treat-
ment and lipid levels with major coronary
events. JAMA 2001 ; 285 : 1585-91. S.G.
Les effets tensionnels de la
gestion du stress chez
l’hypertendu
Lorsque survient une hypertension
artérielle, le premier coupable désigné par
les patients et souvent leurs médecins
pour expliquer leur état est le “stress”. Si
certaines données de la littérature indi-
quent une relation entre le stress de la vie
professionnelle mesuré par des échelles
adéquates et le niveau de la pression arté-
rielle, d’autres études ne retrouvent soit
pas de relation soit même une relation
négative entre le stress de la vie quoti-
dienne et le niveau tensionnel. De plus, les
études qui ont évalué les effets sur la baisse
tensionnelle d’une intervention de type
“gestion du stress” n’ont le plus souvent
pas montré une efficacité supérieure à
celle du groupe contrôle. Ainsi, dans les
recommandations du JNC 6, il est précisé
que les données de la littérature ne sont
pas en faveur de l’utilisation des tech-
niques de relaxation pour traiter l’hyper-
tension artérielle permanente ou pour pré-
venir l’apparition d’une hypertension
artérielle. Le travail mené par une équipe
de psychologue de Vancouver offre la
possibilité d’une étude de très bonne qua-
lité méthodologique pour répondre à la
question des bénéfices des techniques de
gestion du stress chez l’hypertendu. Un
groupe de 60 hypertendus sélectionnés sur
les données d’une MAPA des 24 heures
supérieure en moyenne à 140/90 mmHg
ont été randomisés pour bénéficier d’une
prise en charge psychologique complète
d’une heure par semaine sur 10 semaines
comprenant : une thérapie cognitive et de
biofeedback, une gestion de l’anxiété et une
lutte contre les comportements de type A.
Cette thérapeutique était proposée à tous les
patients soit immédiatement après la rando-
misation, soit secondairement après une
période d’abstention de 10 semaines. La
MAPA était réalisée avant, puis après l’in-
tervention. Alors que certains critères de
la psychologie du patient se sont modifiés
avec la prise en charge, il est aussi obser-
vé une baisse tensionnelle entre les deux
groupes. Alors que la baisse est compa-
rable dans les deux groupes lorsqu’elle est
évaluée à la consultation, une différence
significative est notée sur l’évaluation de
la pression artérielle par la MAPA. La
baisse tensionnelle est plus importante
lorsque les patients bénéficient de la prise
en charge psychologique. L’amplitude de
la PAS/PAD sur la moyenne de 24 heures
est de - 6,1/- 4,3 dans le groupe actif et de
0,9 à 0,0 dans le groupe contrôle. Une cor-
rélation significative est retrouvée entre la
baisse de la PAS et un indicateur de stress
psychologique.
Commentaire : La sélection de patients
hypertendus et l’utilisation de la MAPA
permet de conclure à l’action hypotensive
d’une prise en charge comportementale
spécialisée dans la gestion du stress.
L’amplitude de cette effet reste toutefois
quantitativement modeste et devrait conduire
àne réserver cette (lourde) prise en charge
thérapeutique qu’aux patients chez qui une
faible baisse tensionnelle sera suffisante
pour atteindre l’objectif tensionnel.
– Linden W et al. Individualized stress mana-
gement for primary hypertension: a randomi-
zed trial. Arch Intern Med 2001 ; 161 : 1071-
81. X.G.
revue de presse
Sophie Gonbert, Xavier Girerd
Revue de presse

revue de presse
Revue de presse
Quelle dose d’alcool
favorise la survenue
d’une hypertension ?
S’il est démontré que la consomma-
tion d’alcool favorise l’hypertension arté-
rielle, la quantité à partir de laquelle le
risque d’une hypertension artérielle existe
n’est pas bien connue. L’étude ARIC, qui
a suivi pendant six années 8 334 sujets
initialement non hypertendus, a évalué les
conséquences de la consommation d’al-
cool sur la survenue d’une hypertension
artérielle. L’élévation de la pression arté-
rielle est observée lorsque la consomma-
tion est supérieure à 210 g d’éthanol par
semaine, soit environ trois verres par jour.
Le risque attribuable de voir apparaître
une hypertension artérielle dans les six
ans est de 19 %, et ce risque persiste après
ajustement sur le BMI, l’âge, l’éducation,
la pratique du sport, et le diabète. Chez les
hommes de race noire, le risque est plus
important pour une quantité identique
d’alcool. Pour des quantités inférieures à
trois verres, il n’a pas été démontré de rôle
défavorable sur le niveau tensionnel.
Commentaire : Cette étude nous conforte
dans nos certitudes, de moins en moins
françaises, qu’un peu d’alcool est bon
pour la santé. Si, plus exactement deux
verres par jour ne favorisent pas la surve-
nue d’une hypertension artérielle, l’inéga-
lité des effets de l’alcool en fonction de la
race, avec ses effets plus néfastes chez les
sujets de race noire, doit faire recomman-
der une plus grande tempérance chez les
hypertendus noirs qui sont le plus souvent
ceux dont la pression artérielle est la plus
sévère et la plus difficile à traiter.
– Fuchs FD et al. Alcohol consumption and the
incidence of hypertension. The ARIC study.
Hypertension 2001 ; 37 : 1242-50. X.G.
L’importance des facteurs
de risque varie en fonction
de l’âge
Lorsque l’hypertension artérielle est
dépistée, la recherche d’autres facteurs de
risque est indispensable à l’évaluation du
risque cardiovasculaire. Les études de
population menées en France indiquent
que seulement 13 % des hommes présen-
tent une hypertension sans autres facteurs
de risque alors que 20 % des femmes se
trouvent dans cette situation d’hyperten-
sion artérielle isolée. Lorsque plusieurs
facteurs de risque sont présents, leur
influence respective sur la survenue d’une
complication cardiovasculaire n’est pas
bien connue. La cohorte française des
hommes suivis aux IPC a été analysée
dans l’optique de comprendre l’importan-
ce des facteurs de risque sur la survenue
des complications en fonction de l’âge du
sujet. Par comparaison à un normotendu
de même âge, le risque d’une complication
cardiovasculaire mortelle associée à une
hypertension artérielle isolée est augmenté
de 15 % chez un homme de 30 ans et de
234 % chez un homme de 80 ans. La pré-
sence de deux autres facteurs de risque a
augmenté la probabilité d’une mort cardio-
vasculaire de 4,5 fois chez l’homme de
30 ans alors qu’elle n’a augmenté que de
1,3 fois chez celui de 80 ans. Le rôle défa-
vorable d’une association de l’hypertension
artérielle avec une hypercholestérolémie ou
un tabagisme est plus important chez l’hom-
me de 30 ans alors que c’est l’obésité asso-
ciée à l’hypertension artérielle qui a le rôle
défavorable chez l’homme de 80 ans.
Commentaire : Cette étude montre que
l’influence des facteurs de risque n’est pas
la même selon l’âge. Chez l’hypertendu
jeune, il faut prendre en charge les autres
facteurs de risque pour prévenir les com-
plications cardiovasculaires, alors que
chez l’hypertendu âgé c’est le contrôle de
la pression artérielle qui est l’action de
prévention la plus importante à considé-
rer. Ce résultat devrait aider à individuali-
ser nos décisions thérapeutiques chez les
patients avec plusieurs facteurs de risque.
– Thomas F et al. Cardiovascular mortality in
hypertensive men according to presence of
associated risk factors. Hypertension 2001 ;
37 : 1256-61. X.G.
140
Act. Méd. Int. - Hypertension (13), n° 6, juin 2001
1
/
2
100%