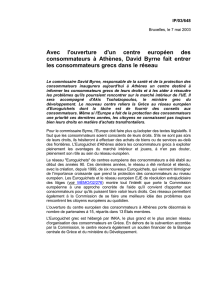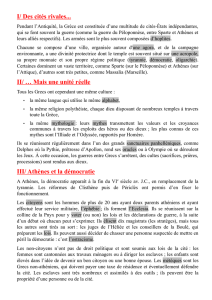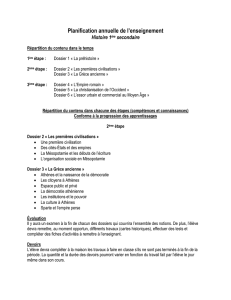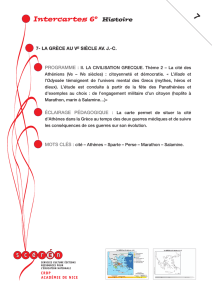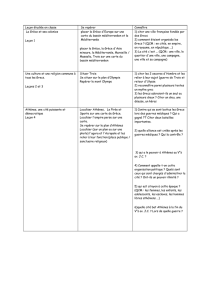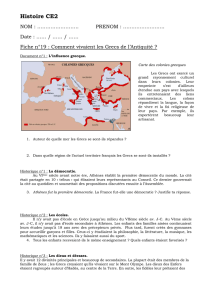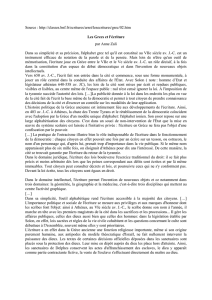orient et grice - Espace Charles Morazé

PREMIERE
PARTIE
ORIENT
ET
GRICE


CHAPITRE
III
L’GGYPTE,
CADEAU
DU
NIL
))
1.
-
DESCRIPTION
DE
L’fiOiYPTE
Z’egypte est situé6 dans le Nord-Est de l’Afrique, en pleine
zone désertique.
Un soleil de feu
y
brille
:
le climat y est un
u
été perpétuel
D.
Les pluies sont très rares
:
plusieurs années peuvent s’écouler sans
qu’il tombe une goutte d’eau. Sans eau, pas de culture possible.
Heureusement, i’figypte est parcourue par le Nil.
Le Nil est le second fleuve du monde
:
il mesure
6500
kilomètres
de long, soit plus de six fois la distance
Q
vol d’oiseau
de
Nice
b
Dunkerque. Lorsqu’il entre en egypte, il a déjh parcouru plus de
5000
kilomètres. Il chemine dans un long couloir bordé de falaises
au-del8 desquelles commence le désert. Puis la vallée s’ouvre comme
un éventail, et le fleuve s’achève par un large delta.
Tous les ans, de juin
h
octobre, le Nil
se
gonfle d’une énorme
masse
d’eau
:
elle envahit toute
la
vallée,
ne laissant
émerger
que
les hauteurs, sur lesquellm les villages sont comme autant de petits
îlots; elle charrie des alluvions fertiles, qui la dorent en rouge, et
se
déposent peu
à
peu. Lorsque le fleuve est rentré dans mn lit,
les paysans font saiis peine, sur cette terre humide et molle, plu-
sieurs récoltes dans l’année. Ainsi les inondations, qui dans
no6
régions sont des catastrophes, fournissent ici l’eau et le
sol
:
deux
richesses, si l’on sait
les
utiliser.
Sans le Nil, il
n’y
aurait pas d’ggypte,
mais
un désert; grâce
A
hi, elle
est
((un paradis d’eau,
de
fruits,
de
fleura, entre
deux
déserts
torrides
D
(A.
MORBT).
Aussi lm anci6ns hgyptiens disaient
-1
’1
s
que
leur paya était un
N
cadeau du
Nil
1).
Ils ne s’expliquaient d’ailleurs
pas ces inondatisns, qui
ge
produisaient réguliiàrernsnt,
et
en
l’absence de toute pluie visible; ils considéraient le
Nil
comme
un
dieu. Nous-mêmes ne
connaiesona
que depuis
peu
leur cawe
:
les
pluies abondantes qui tombent en
été
bien au Sud de l’agypte,

22
bRI&NT
ïI.
-
COMMENT
CONNAISSONS-NOUS
L’ÉGYPTE
ANCIENNE
?
Les voyageurs admirent en Égypte de nombreux monuments
anciens. En creusant le sol, des savants ont retrouvé les ruines de
villes entières; ces fouilles fournissent aussi des poteries, des armes,
etc., fabriquées avec une grande habileté. Ce sont autant de témoi-
gnages de l’existence en figypte,
à
une époque reculée, d’hommes
civilisés.
A
quand remonte cette époque
?
Quelle est l’histoire de ces
hommes?
11
y a un peu plus de cent ans, on ne pouvait encore répondre
à
ces questions. Les monuments égyptiens sont couverts de signes,
que des Grecs anciens, ne sachant les lire, avaient pris pour des
gravures religieuses
(hiéroglyphes,
en grec). Pendant l’expédition de
Bonaparte en Égypte, un soldat découvrit une pierre, sur laquelle
était gravée,
à
la suite d’un texte égyptien, sa traduction en grec
:
c’est la pierre de Rosette. Après plusieurs années d’efforts,
un
savant français de génie, Champollion, aidé par la similitude entre
la langue copte moderne et l’ancien égyptien, reconstitua grâce
A
ce
texte l’écriture
et
le vocabulaire antiques
(1822).
Voici pourquoi il eut tant de peine. L’écriture des figyptiens se
composa d’abord de dessins
:
pour écrire
a
le soleil
14
ils traçaient un
cercle;
((
la lune
D,
un croissant.
Il
était plus dificile de représenter
des choses qu’on ne peut
voir
ni dessiner, comme les sentiments.
Les Êgyptiens perfectionnèrent leur écriture en indiquant par des
signes, non plus les objets eux-mêmes, mais les sons qui les expri-
maient.
Prenons un exemple
:
le signe
3
représentait le hoyau,
instrument agricole fait de deux bâtons liés (signe
figuratif)
;
puis
on l’utilisa pour exprimer l’idée du lien entre deux personnes, de
l’amitié (signe d’idée)
;
enfin, hoyau se disant et prononçant
((
mer
»,
ce signe désigna le son
K
mer
1)
dans tous les mots
où
il se retrou-
vait (signe de
son).
Comme les Égyptiens continuaient
à
employer
ces trois systèmes, le même caractère peut avoir plusieurs sens
différents,
Lorsqu’on eut reconstitué l’écriture et le Vocabulaire égyptiens,
on
découvrit peu
A
peu l’histoire de 1’Êgypte ancienne.

LE
CHEIKH
EL
BELED
(Ve
dynastie).
LE
PRINCE
RAHOTEP
ET
SON
ÉPOUSE
NEFERT
(Ive
dynastie).
Ces statues en bois, conservées au Musée
m
du Caire, représentent des types égyptiens
ancaens; décrivez-les. Celle du Cheikh a
perdu sa couche de peinture, qui appara%t
encore, noire sur le corps de Rahotep,
bistre sur celui de Nefert. Les yeux sont en
cristal de roche, incrustés dans
le
bois.
CAXTOUCIIES
DE
PTOLÉMÉE
ET
DE
CLÉOPATRÉ’.
Dans
les
ovales, ou
a
cartouches
n,
sont
contenus
les
signes représmtant les noms
de Ptolémée et de
Cléopdtre.
Numérotés ci-
contre, on reconnalt
un
lion
(4),
un
aigle
(g),
une chouette
(9,
une
main
(IO),
une bowhe
(II),
un
escabeau
(8),
etc.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
1
/
150
100%