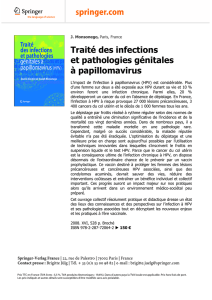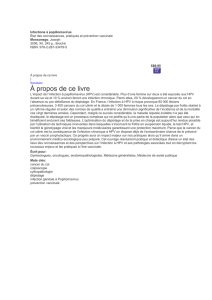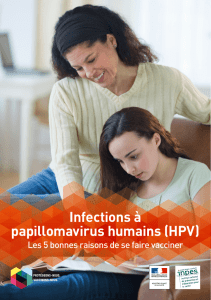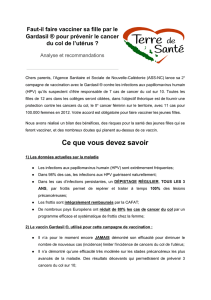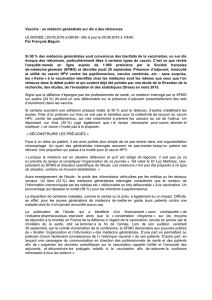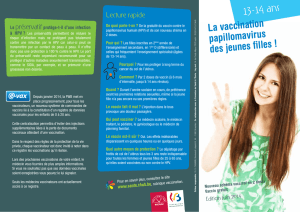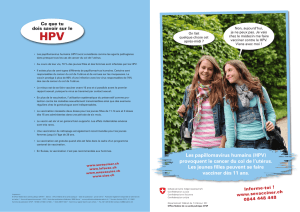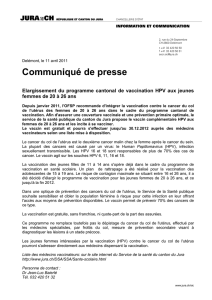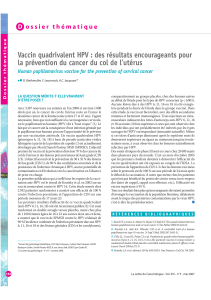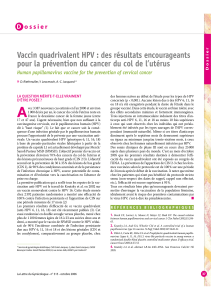L La vaccination au service enfin des résultats pour une application

La Lettre du Cancérologue - Suppl. n°1 Les Actualités au vol. XV - n° 3 - juillet 2006
Éditorial
3
L
e cancer du col utérin est le deuxième cancer le plus fréquent au monde et touche généralement
des femmes plus jeunes par rapport aux autres cancers. L’infection persistante par les plus
oncogènes des virus HPV (Human papillomavirus) demeure la principale cause de la carcinogenèse
cervicale. Plus de 70 % des femmes ayant une activité sexuelle sont susceptibles d’être infectées au cours
de leur vie par ce virus, et 470 000 nouveaux cas d’infection par an sont actuellement décrits.
Plus de 100 génotypes de HPV, dont une quarantaine ont un tropisme muqueux, ont été définis.
On distingue ceux qui sont classés comme les génotypes à haut risque (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 59,
68) et ceux considérés à bas risque (6, 11, 26, 34, 40, 42 à 44, 62, 66, etc.), sachant que la prévalence
de ces génotypes dans le cancer du col utérin varie selon les régions géographiques, HPV 16 étant le
génotype le plus fréquent. Le lien existant entre HPV et le cancer du col utérin (mais aussi avec les lésions
précancéreuses) est tellement fort que la perspective d’une vaccination anti-HPV s’impose (1).
En effet, HPV 16 et 18 sont responsables d’environ 70 % des cancers du col utérin et des lésions
prénéoplasiques de haut grade (CIN3). Deux types de stratégies de vaccination sont possibles.
Une première approche portant sur des vaccins thérapeutiques a été de traiter l’infection par HPV
en induisant la production d’anticorps spécifiques de la capside, mais le niveau d’expression
de ces protéines au niveau des kératinocytes ou des cellules transformées reste faible.
Alors, les deux autres protéines oncogéniques cibles des programmes de vaccination ont été les protéines
E6 et E7 et de nombreux programmes de vaccination thérapeutique sont en cours et ont été évalués,
en particulier avec E7, dont les résultats restent encourageants chez l’animal et, nous l’espérons,
chez l’être humain. L’autre stratégie (qui fait l’objet de cet éditorial), dont les résultats ont contribué
probablement de manière la plus importante au domaine de la vaccination, repose sur l’utilisation
de vaccins prophylactiques, dont deux études ont été publiées récemment et dont l’application
en clinique (autorisation de mise sur le marché en cours) serait prévue d’ici la fin de l’année 2006 ou
début 2007. Ainsi, bien que le dépistage ait été un des grands précurseurs de la diminution de l’incidence
du cancer du col dans les pays développés – et non dans les pays en voie de développement –,
le cancer du col utérin reste un sérieux problème de santé publique, et une vaccination efficace
anti-HPV devrait permettre de diminuer de façon significative l’incidence des stades précurseurs
du cancer du col et peut-être d’ici quelques années, celle du carcinome invasif lui-même.
La vaccination anti-HPV prophylactique
Deux vaccins ont fait récemment l’objet d’importantes publications. Il s’agit, pour le premier, d’un vaccin
quadrivalent prophylactique dirigé contre HPV 6, 11, 16, 18 (Gardasil®, sanofi-Pasteur-MSD) produit
par Saccharomyces cerevisiae. L’étude pivot, publiée dans Lancet Oncology il y a un an (2) rapporte
les résultats d’une étude de phase II randomisée comparant l’efficacité de ce vaccin (quadrivalent HPV 6,
11, 16, 18-L1 virus-like particle vaccine) administré par voie I.M. à 277 jeunes femmes (âgées de plus
de 18 ans) à celle du placebo, administré à 275 autres jeunes femmes. Cette étude n’excluait pas
La vaccination au service
de la prévention du cancer du col utérin :
enfin des résultats pour une application
clinique dans un avenir très proche

La Lettre du Cancérologue - Suppl. n°1 Les Actualités au vol. XV - n° 3 - juillet 2006
Éditorial
4
les femmes ayant déjà une infection par HPV. L’objectif principal était soit l’identification d’une infection
persistante par HPV 6, 11, 16 ou 18, ou la survenue d’une maladie génitale causée par ces génotypes
d’HPV. Après un suivi de 30 mois à partir du début de la vaccination, l’incidence combinée d’une infection
par HPV 6, 11, 16 ou 18 ou la survenue d’une maladie génitale associée a été réduite significativement
de 90 % chez les femmes ayant reçu le vaccin par rapport à celles ayant reçu le placebo. De plus, quelle
que soit la dose de vaccin reçue, le niveau d’immunogénicité est resté excellent et les anticorps induits par
le vaccin avaient un titre significativement plus élevé que celui enregistré chez les femmes déjà infectées
par HPV et ayant reçu le placebo. Quant à la tolérance, elle reste acceptable, sachant que les effets
secondaires ont été davantage rapportés dans le bras “vaccin” que dans le bras placebo.
Les plus fréquents des effets secondaires rapportés ont été des douleurs au point d’injection et
des céphalées. Au total, cette étude a démontré pour la première fois qu’un vaccin prophylactique dirigé
contre quatre génotypes de HPV (HPV 6,11,16 et 18) pouvait non seulement être bien toléré, mais aussi
prévenir d’une infection par ces virus et, de ce fait, des complications génitales associées de manière
significative, en induisant des titres élevés d’anticorps, en tout cas à des niveaux supérieurs à ceux
constatés lors d’une immunogénicité naturelle. Une étude à plus long terme et à plus large échelle
s’impose afin de pouvoir évaluer de manière optimale la durée d’efficacité d’un tel vaccin.
Le deuxième vaccin produit à partir de trichoplusia ni est bivalent, dirigé contre les deux plus oncogènes
des génotypes, à savoir HPV 16 et HPV 18 (Cervarix®, GlaxoSmithKline). L’étude pivot publiée
en 2004 (3) vient d’être réactualisée après un suivi de 4,5 ans (suivi médian = 47,7 mois) et confirme à
long terme l’efficacité de ce vaccin (4). Cette étude pivot avait consisté à randomiser 1 113 femmes âgées
de 15 à 25 ans, qui pouvaient recevoir par voie I.M. soit trois doses du vaccin bivalent anti-HPV 16/18
(bivalent HPV 16, 18-L1 virus-like particle vaccine) soit trois doses du placebo. L’objectif principal
de cette étude était bien entendu d’évaluer l’efficacité de ce vaccin en matière de prévention contre
l’infection par HPV 16 et/ou 18 chez des jeunes filles initialement négatives à la fois par ELISA et PCR.
Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’efficacité de ce vaccin sur la persistance d’une infection
par HPV 16 et/ou 18 à long terme, mais aussi sur la prévention de lésions prénéoplasiques
(CIN 1 à 3), atypiques (ASCUS), ou invasives liées à HPV (carcinome épidermoïde ou adénocarcinome).
Les autres objectifs concernaient l’immunogénicité de ce vaccin, sa tolérance et ses paramètres
de sécurité. L’étude à 27 mois de suivi annonçait que l’efficacité significative de ce vaccin était évaluée
à 91,6 % contre le risque d’infection et à 100 % contre le risque d’infection persistante, associée
à une bonne tolérance, une bonne sécurité et une excellente immunogénicité ; l’étude récente à 4,5 ans
vient confirmer ces résultats à long terme.
Plus de 98 % des femmes restent séropositives pour HPV 16/18 après vaccination. L’efficacité
significative contre HPV 16 et/ou 18 se maintient à 96,9 % sur le risque d’infection et à 100 %
sur le risque d’infection persistante à 12 mois. Après une analyse combinée entre les résultats initiaux
et actualisés, ce vaccin reste efficace à 100 % contre le risque de survenue de lésions cervicales
prénéoplasiques associées à HPV 16 et/ou 18, mais semble aussi assurer une protection croisée
contre d’autres génotypes tels que HPV 45 et HPV 31. Quant à la tolérance, même à long terme,
elle garde un bon profil, et l’immunogénicité de ce vaccin (HPV 16/18-L1 virus-like particle AS04)
reste tout aussi excellente.
Au total, ces vaccins hautement protecteurs contre certains génotypes de HPV pourraient parfaitement
être recommandés en première intention pour des préadolescentes, que l’on pourrait ainsi vacciner
à l’occasion d’autres vaccins habituellement conseillés, mais aussi chez des adolescentes, voire des
jeunes femmes de plus de 18 ans, pour lesquelles un rattrapage est encore possible. Ces programmes
de vaccination resteront bien entendu totalement complémentaires du dépistage, d’autant qu’un grand
effort d’information sur cette infection et les pathologies qui lui sont associées est actuellement
à prévoir. En effet, de nombreuses femmes, et même certains membres du corps médical, méconnais-
sent l’infection par HPV, qui est pour le moins une infection sexuellement transmissible.
Du fond du handicap,
sauver le champ du désir d’être
La vaccination au service de la prévention du cancer du col utérin :
enfin des résultats pour une application clinique dans un futur très proche

Une grande campagne d’information s’impose aussi sur le risque de lésions prénéoplasiques
ou néoplasiques associées à HPV. Durant les prochains mois, un effort certain de communication
va se mettre en place. Il permettra, nous l’espérons, un bon accueil et une bonne application
de ces deux nouveaux vaccins, premiers du genre contre un fléau à l’échelon mondial :
le cancer du col lié à l’infection par HPV. ■
Jean-Philippe Spano, département d’oncologie médicale,
groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
Références bibliographiques
1. Spano JP, Marcelin AG, Carcelin G et al. HPV and Cancer. Bull Cancer 2005;92(1): 59-64.
2. Villa LL et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women:
a randomized double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol 2005;6:271-8.
3. Harper DM, Franco EL, Wheeler C et al. Efficacy of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of infection with human papillomavi-
rus types 16 and 18 in young women: a randomized controlled trial. Lancet 2004;364:1757-65.
4. Harper DM, Franco EL, Wheeler C et al. Sustained efficacy up to 4.5 years of of a bivalent L1 virus-like particle vaccine in prevention of
infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: a randomized controlled trial. Lancet 2006; 367: 1247-55.
La Lettre du Cancérologue - Suppl. n°1 Les Actualités au vol. XV - n° 3 - juillet 2006 5
Gardasil® homologué aux États-Unis
Premier vaccin au monde pour prévenir le cancer du col de l’utérus
Gardasil® (vaccin quadrivalent contre les papillomavirus humains de types 6, 11, 16 et 18) a été approuvé le 8 juin 2006
par la Food and Drug Administration (FDA) pour la prévention des cancers malpighiens et des adénocarcinomes du col de
l’utérus, pour la prévention des lésions précancéreuses du col, de la vulve et du vagin, dus aux papillomavirus humains
ciblés par le vaccin. Il est également indiqué dans la prévention des lésions de bas grade et des verrues génitales dues à
ces papillomavirus humains ciblés. Ces indications de Gardasil® reposent sur les résultats des études de phases II et III
incluant plus de 27 000 sujets dans 33 pays à travers le monde. Lors des essais cliniques, Gardasil® a montré une effica-
cité de 100 % dans la prévention des lésions précurseurs du cancer invasif du col de l’utérus et des lésions précurseurs
des cancers de la vulve et du vagin dues aux papillomavirus humains de types 16 et 18. Le vaccin a également montré
une efficacité de 100 % dans la prévention des lésions précoces du col de l’utérus et des lésions génitales externes
précoces, incluant les lésions de la vulve et du vagin et les verrues génitales, dues aux papillomavirus de types 6, 11, 16
et 18. En Europe, le vaccin a fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l’Agence
européenne du médicament (EMEA) en décembre 2005. ■
Données actualisées sur Cervarix® (juin 2006)
Les principaux résultats issus des études d’efficacité menées à ce jour avec Cervarix®, le vaccin L1 VLP HPV-16/18 ASO4
de GlaxoSmithkline, ont été publiés dans le Lancet en 2004 et en 2006. Ces résultats, qui concernent une population
de 1 113 jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, séronégatives pour HPV16 et HPV18 et ADN-négatives pour les HPV à
haut risque, montrent que le vaccin L1 VLP HPV16/18 ASO4 est efficace 4,5 ans après vaccination, pour prévenir la
survenue des infections persistantes, ainsi que des anomalies cytologiques et des lésions histologiques liées à HPV16 et
HPV-18, les deux types d’HPV le plus souvent en cause dans la survenue du cancer du col de l’utérus. Ce vaccin a, par
ailleurs, démontré qu’il était efficace à l’égard d’autres types que les types 16 et 18, les types HPV45 et HPV31, lui
conférant ainsi une protection contre plus de 80 % des HPV à haut risque à l’origine du cancer du col.
Plus récemment, les résultats d’une étude de phase III menée chez des femmes âgées de 26 à 55 ans ont été présentés. Il
s’agit d’une étude dont l’objectif est d’évaluer l’immunogénicité et la tolérance du vaccin L1 VLP HPV16/18 ASO4
chez 666 sujets de sexe féminin, quel que soit leur statut sérologique à l’inclusion vis-à-vis des types HPV16 et HPV18.
Les résultats à douze mois montrent que les taux d’anticorps mesurés chez les 26-55 ans sont comparables à ceux
observés chez les femmes de 15-25 ans, chez lesquelles l’efficacité du vaccin a été étudiée. Le vaccin s’est montré
sûr et bien toléré. Il s’agit-là de la première étude clinique menée chez des femmes au-delà de 26 ans. ■
>> Données actualisées <<
1
/
3
100%