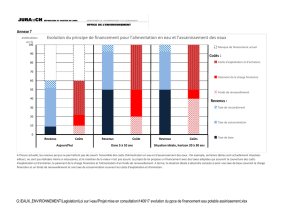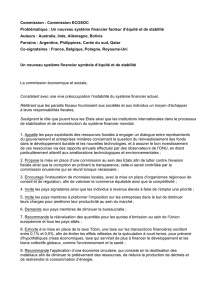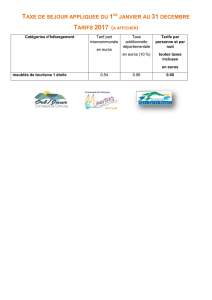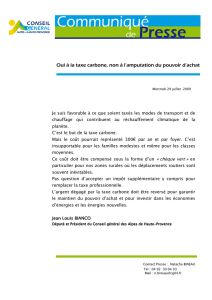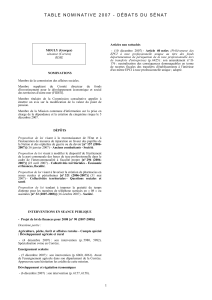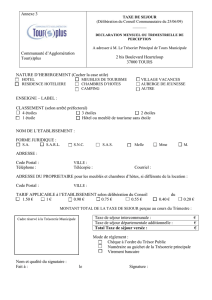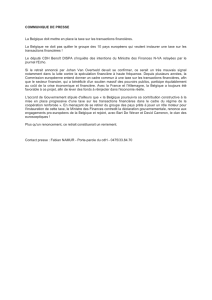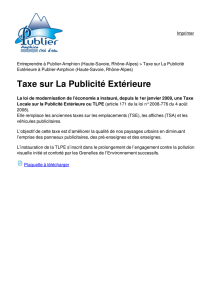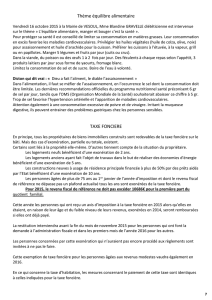Le mur virtuel de Trump, Kenneth Rogoff, Professor of Economics

Le mur virtuel de Trump, Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at
Harvard University and… Project Syndicate
Kenneth Rogoff, Professor of Economics and Public Policy at Harvard University and recipient
of the 2011 Deutsche Bank Prize in Financial Economics, was the chief economist of the
International Monetary Fund from 2001 to 2003. The co-author of This Time is Different: Eight
Centuries of Financial Fol… read more. MAR 8, 2017. Traduit de l’anglais par Martin Morel
CAMBRIDGE – À de nombreux égards, le projet du Parti républicain visant à appliquer une « taxe
d’ajustement frontalier » aux États-Unis apparaît comme le complément virtuel du mur bien réel
que le président Donald Trump entend construire à la frontière mexicaine. Bien que la question
d’une taxe d’ajustement aux frontières ne soit pas ancrée dans la conscience du public aussi
profondément que la question du mur physique envisagé par Trump, cette taxe pourrait bien
impacter l’Américain moyen dans une mesure beaucoup plus importante – et pas nécessairement
favorable.
En surface, l’idée de base consiste à imposer une taxe d’environ 20 % sur les importations, ainsi
qu’à accorder, dans une mesure équivalente, un certain nombre d’allégements d’impôts du côté des
exportations. Réaction instinctive, la plupart des partisans populistes y voient une très bonne
nouvelle pour les emplois américains, puisqu’il s’agit d’encourager les exportations et de dissuader
les importations. Seulement voilà, comme le soulignent de nombreux observateurs, cette logique
néglige un important écueil : les États-Unis appliquent un système de taux de change flottants.
Un dollar plus fort – conséquence probable d’une taxe d’ajustement aux frontières – permet aux
Américains de payer moins cher leur importations (puisqu’un dollar équivaut à davantage en
devise étrangère) et rend réciproquement les exportations américaines plus coûteuses pour les pays
étrangers. L’hypothèse scolaire mise en avant consiste à affirmer que l’effet de change
contrebalancera intégralement la taxe, et que la balance commerciale demeurera inchangée. Si
vous pensez que la proposition des Républicains est une supercherie, vous avez sans doute raison,
mais nous y reviendrons.
Plusieurs économistes universitaires largement reconnus se disent favorables à l’idée d’un
ajustement frontalier, mais pour des raisons tout à fait différentes. Ils considèrent comme acquis
que le taux de change augmentera effectivement jusqu’à neutraliser les effets commerciaux d’une
taxe d’ajustement aux frontières, et cela ne leur pose pas de problème.
Pour commencer, les États-Unis importent bien davantage qu’ils n’exportent, et enregistrent par
conséquent un important déficit commercial, avec un déficit de « balance courante » (plus large
mesure) aux alentours de 2,5 % du PIB. Bien que ce chiffre se soit considérablement amélioré par
rapport aux déficits de 6 % du PIB observés aux États-Unis il y a dix ans, le pays importe encore
beaucoup plus qu’il n’exporte, ce qui signifie que le gouvernement peut espérer tirer bien
davantage de recettes de sa taxe de 20 % sur les importations que ce qu’il lui faudrait concéder aux
exportateurs en termes d’allégements fiscaux. En effet, le programme de taxe/subventions
pourrait, du moins sur le papier, lui rapporter chaque année près de 90 milliards $.
Et la magie ne s’arrête pas là. Bien que cela puisse surprendre ceux qui ont pour habitude de
considérer les importations et exportations comme un strict phénomène du « nous contre eux »,
près de la moitié de l’ensemble des échanges commerciaux sont en réalité des échanges intra-
entreprise – c’est-à-dire des transactions entre divisions étrangère et américaines d’une seule et
même société. Et dans la mesure où l’impôt sur les sociétés américaines compte parmi les plus
élevés au monde, les entreprises s’efforcent d’attribuer à leurs filiales situées à l’étranger autant de
valeur que possible, et un minimum de valeur à celles qui sont basées aux États-Unis.

L’une des manières d’y parvenir consiste à inscrire des frais de comptabilité artificiellement élevés
pour les importations, et artificiellement faibles du côté des exportations. La sous-facturation et la
surfacturation sont un moyen bien connu de contourner l’impôt et les contrôles. Lorsqu’une
transaction s’effectue entièrement « en interne », elle ne nécessite pour l’essentiel qu’un tour de
passe-passe comptable consistant à enregistrer les bénéfices au sein de juridictions à moindre
fiscalité.
Comme l’a souligné en premier lieu Alan Auerbach, de l’Université de Californie de Berkeley, la
taxe d’ajustement aux frontières est un moyen de lutter contre la sous-facturation et la
surfacturation dans une juridiction à fiscalité élevée comme les États-Unis. En somme, même si
cette taxe ne rend pas les marchandises américaines directement plus compétitives, elle constitue
un moyen efficace pour augmenter les recettes, avec la possibilité éventuelle d’autres réductions
d’impôts.
Quel est alors le problème avec cette idée technocratiquement saine ? Premièrement, elle repose
sur des hypothèses pour le moins aventureuses – par exemple l’hypothèse selon laquelle personne
ne pourrait facilement se jouer de ce système labyrinthique, ou selon laquelle les gouvernements
étrangers feraient preuve de retenue dans leurs représailles. Deuxièmement, elle ignore un
ensemble de difficultés en termes de transition.
Pour commencer, l’immense majorité des importations américaines est libellée en dollar, et pas en
devises étrangères. Par conséquent, même si ces devises étrangères deviennent moins coûteuses,
les importateurs pris au piège de contrats en dollar n’en tireront pas nécessairement parti. Leurs
coûts seront simplement supérieurs de 20 % en raison de la taxe à l’importation. Et en dépit du
subventionnement fiscal, certains exportateurs pourraient se retrouver perdants, dans la mesure
où, comme le souligne une récente note de la banque de Réserve fédérale de New York, ces
exportateurs recourent à des marchandises intermédiaires importées pour fabriquer leurs produits.
Autre difficulté, un dollar plus fort signifierait une importante perte de richesse pour les
Américains, puisque la valeur de nombreux actifs étrangers diminuerait, comme l’ont évoqué mes
collègues Emmanuel Farhi, Gita Gopinath et Oleg Itskhoki. Mais le plus sérieux problème réside
dans l’hypothèse insouciante selon laquelle le taux de change du dollar évoluerait de manière
précise jusqu’à compenser le programme de taxe/subventions.
S’il est une chose que nous ont enseignée les recherches menées depuis 40 ans autour des taux de
change, c’est que de tels taux peuvent très largement s’éloigner de leurs fondamentaux pendant de
nombreuses années consécutives. Il est tout à fait irréaliste de présupposer que la taxe frontalière
conduira à un équilibrage net et rapide des fluctuations du dollar. Ce processus pourrait prendre de
nombreuses années, et les effets à courts terme se révéler défavorables du côté des emplois
américains.
Oui, la hausse des taxes aux frontières pourrait permettre de dynamiser l’emploi aux États-Unis. Ce
programme nécessiterait un renforcement considérable des effectifs douaniers, et conduirait
probablement à une importante expansion de l’économie sous-terraine à mesure d’un
accroissement de l’évasion fiscale. Mais est-ce vraiment le type d’emplois que les partisans de la
taxe frontalière ont en tête lorsqu’ils parlent d’en créer de nouveaux ?
1
/
2
100%