Techniques de gastroplastie par

40-380
Techniques
de
gastroplastie
par
anneau
modulable
laparoscopique
M.
Robert,
G.
Poncet,
C.
Gouillat
La
gastroplastie
par
anneau
modulable
laparoscopique
est
une
technique
restrictive,
peu
invasive
et
réversible.
Procédure
reine
dans
les
années
2000
en
France,
elle
reste
à
l’heure
actuelle
une
des
trois
techniques
les
plus
réalisées
en
chirurgie
bariatrique,
notamment
du
fait
de
sa
relative
simplicité
et
de
sa
faible
morbimortalité.
La
procédure,
parfaitement
standardisée
et
reproductible,
est
de
courte
durée
et
nécessite
une
hospitalisation
brève.
Elle
permet
une
perte
pondérale
progressive
chez
les
patients
bien
sélectionnés,
pouvant
atteindre
plus
de
60
%
de
perte
d’excès
de
poids
à
deux
ans.
L’ajustement
de
l’anneau
(«resserrage
»)
permet
d’optimiser
la
perte
pondérale
chez
des
patients
ne
présentant
pas
de
symptômes
obstructifs
hauts
ni
de
reflux
gastro-œsophagien.
Les
complications
principales
qui
sont
le
glissement
de
l’anneau
et
la
migration
intragastrique
ont
nettement
diminué
avec
l’évolution
vers
la
technique
pars
flaccida
et
l’apparition
des
anneaux
de
deuxième
génération.
©
2014
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
Mots-clés
:
Gastroplastie
;
Anneau
gastrique
;
Laparoscopie
;
Obésité
;
Pars
flaccida
;
Restriction
Plan
■Introduction
1
■Bilan
préopératoire
et
préparation
du
patient
1
Indications
de
la
gastroplastie
par
anneau
modulable
1
Évaluation
pluridisciplinaire
2
Examens
paracliniques
prérequis
2
Régime
préopératoire
2
■Technique
de
gastroplastie
par
anneau
modulable
2
Rappels
anatomiques
2
Principe
de
fonctionnement
de
la
gastroplastie
par
anneau
modulable
3
Types
d’anneau
3
Évolution
de
la
technique
3
Matériel
utilisé
3
Installation
et
conditionnement
du
patient
3
Insufflation
et
position
des
trocarts
3
Différents
temps
de
dissection
4
Positionnement
et
verrouillage
de
l’anneau
5
Fixation
de
l’anneau
6
Connexion
du
cathéter
et
positionnement
du
boîtier
6
Variantes
de
la
technique
7
Lithiase
associée
:
place
de
la
cholécystectomie
8
■Soins
postopératoires
8
Anticoagulation
8
Réalimentation
8
Contrôle
radiologique
8
Ajustement
du
dispositif
8
Suivi
et
règles
hygiénodiététiques
9
Grossesse
et
gastroplastie
par
anneau
modulable
9
Anesthésie
générale
et
gastroplastie
par
anneau
modulable
9
■Conclusion
9
Introduction
La
gastroplastie
par
anneau
modulable
(GPAM)
est
une
tech-
nique
restrictive
qui
s’est
largement
développée
depuis
le
début
des
années
1990 [1] en
parallèle
avec
l’avènement
de
la
cœliosco-
pie [2].
Cette
technique
est
fondée
sur
une
calibration
gastrique
qui
provoque
une
sensation
de
satiété
précoce
et
diminue
ainsi
l’ingestion
alimentaire.
Cette
procédure
a
l’intérêt
d’être
peu
invasive
et
réversible,
avec
un
taux
de
complications
faible
(5–17
%) [3,
4] et
s’est
donc
substituée
à
la
gastroplastie
verticale
calibrée
(GVC)
dont
l’efficacité
est
comparable
mais
qui
est
plus
invasive
et
non
réversible.
Les
bons
résultats
obtenus
en
termes
de
perte
de
poids
(de
18
à
60
%
de
perte
d’excès
de
poids
à
trois
ans) [4–6] et
d’amélioration
des
comorbidités
ont
contribué
à
faire
de
la
GPAM
la
technique
la
plus
pratiquée
en
Europe
et
la
procédure
reine
au
début
des
années
2000.
Alors
que
la
GPAM
représentait
63,7
%
des
actes
de
chirurgie
bariatrique
en
2003 [7],
elle
ne
représentait
plus
que
25
%
des
procédures
en
2011
en
France.
Un
phénomène
inverse
est
observé
aux
États-Unis
:
le
nombre
de
réalisations
de
court-circuit
gastrique
a
diminué
au
profit
de
la
pose
d’anneau
gastrique [8],
à
la
suite
de
l’autorisation
en
2001
de
la
Food
and
Drug
Admi-
nistration
pour
la
mise
sur
le
marché
du
système
Lap-Band®,
la
pose
d’anneau
gastrique
restant
donc
ainsi
une
des
techniques
majoritaires
dans
le
monde.
Bilan
préopératoire
et
préparation
du
patient
Indications
de
la
gastroplastie
par
anneau
modulable
La
GPAM
est
une
technique
restrictive
dont
le
principal
avantage
est
la
réversibilité.
C’est
également
une
procédure
peu
invasive,
courte
et
relativement
facile
techniquement
en
EMC
-
Techniques
chirurgicales
-
Appareil
digestif 1
Volume
9
>
n◦2
>
mai
2014
http://dx.doi.org/10.1016/S0246-0424(13)58341-5
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2014 par UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS - SCD - (6574)

40-380 Techniques
de
gastroplastie
par
anneau
modulable
laparoscopique
comparaison
de
la
sleeve
gastrectomy
et
du
bypass
gastrique
qui
sont
les
deux
autres
techniques
les
plus
pratiquées
en
France
actuelle-
ment.
La
GPAM
est
indiquée
chez
les
obèses
morbides
(indice
de
masse
corporelle
[IMC]
≥
40
kg/m2)
ou
obèses
sévères
(IMC
≥
35
kg/m2)
avec
comorbidités [9],
à
comportement
hyperphage
et
sans
grigno-
tages.
Les
résultats
en
termes
de
perte
pondérale,
bien
qu’inférieurs
à
ceux
de
la
sleeve
gastrectomy
et
du
bypass
gastrique,
peuvent
être
optimisés
par
une
meilleure
sélection
des
patients,
permet-
tant
ainsi
d’obtenir
jusqu’à
60
à
70
%
de
perte
d’excès
de
poids
à
trois
et
cinq
ans
dans
les
meilleures
séries [5,
6,
10].
Cependant,
la
plupart
des
auteurs
rapportent
une
stabilisation
pondérale
avec
un
taux
d’échec
ou
de
complications
allant
jusqu’à
40
à
50
%
à
cinq
ans [11].
Ainsi,
la
sélection
rigoureuse
des
patients
candidats
à
une
GPAM
est
une
étape
indispensable
pour
obtenir
de
bons
résultats
en
termes
de
perte
pondérale.
Chevalier
et
al. [12] ont
publié
des
fac-
teurs
prédictifs
de
succès
à
deux
ans
de
la
GPAM
qui
sont
:
l’âge
inférieur
à
40
ans,
un
IMC
initial
inférieur
à
50
kg/m2,
la
capacité
à
changer
ses
habitudes
alimentaires
et
à
augmenter
son
acti-
vité
physique,
et
une
prise
en
charge
par
une
équipe
spécialisée
réalisant
plus
de
deux
interventions
de
chirurgie
bariatrique
par
semaine.
Il
a
été
également
montré
que
la
qualité
du
suivi
était
un
facteur
influenc¸ant
positivement
la
perte
de
poids [6].
Évaluation
pluridisciplinaire
Le
patient
obèse
passe
par
un
parcours
de
soin
obligatoire
néces-
sitant
plusieurs
avis
spécialisés.
Cette
évaluation
pluridisciplinaire
vise
à
orienter
le
patient
vers
la
procédure
bariatrique
la
plus
adap-
tée
et
dépister
des
facteurs
de
risque
d’échec
d’une
procédure,
voire
une
éventuelle
contre-indication.
Cette
évaluation
comprend
:
•
une
anamnèse
rapportant
l’histoire
pondérale
et
un
examen
clinique
;
•
une
enquête
diététique
afin
d’analyser
le
comportement
ali-
mentaire
du
patient.
L’activité
physique
est
évaluée.
Elle
vise
à
mettre
en
place
des
règles
hygiénodiététiques
indispensables
à
la
perte
de
poids
et
à
son
maintien
à
long
terme.
En
effet,
la
pose
d’un
anneau
gastrique
ne
s’envisage
que
chez
un
patient
s’astreignant
à
trois
repas
par
jour,
ayant
supprimé
les
gri-
gnotages
et
l’ingestion
de
boissons
sucrées
(sodas)
ainsi
que
l’alimentation
émotionnelle,
et
qui
s’astreint
à
une
activité
phy-
sique
plurihebdomadaire
;
•
une
évaluation
du
psychiatre
validant
la
capacité
du
patient
à
s’adapter
et
à
accepter
une
modification
de
sa
silhouette
sans
décompenser
un
éventuel
trouble
psychiatrique
sous-jacent
;
•un
dépistage
des
comorbidités
par
un
bilan
endocrinologique,
métabolique
et
nutritionnel
;
•
une
évaluation
anesthésique
pouvant
nécessiter
des
complé-
ments
d’investigations
cardiovasculaires
et
pulmonaires.
Ainsi,
l’indication
de
GPAM
ne
peut
être
validée
qu’après
une
évaluation
pluridisciplinaire
du
patient
obèse
et
ne
peut
être
rete-
nue
sur
la
seule
décision
du
chirurgien.
Examens
paracliniques
prérequis
Avant
la
GPAM,
sont
réalisés
systématiquement
:
•
un
bilan
biologique
avec
dosage
de
la
glycémie
à
jeun,
hémoglobine
glyquée
(HbA1c),
albuminémie,
créatininémie,
ionogramme,
numération
formule
sanguine
(NFS),
thyroid-
stimulating
hormone
(TSH),
bilan
lipidique,
transaminases,
uricémie
;
•
un
dosage
des
beta-human
chorionic
gonadotrophin
(bêta-HCG)
recommandé
chez
la
femme
en
âge
de
procréer
pour
s’assurer
de
l’absence
de
grossesse
en
cours
avant
la
pose
de
l’anneau
;
•une
gastroscopie
pour
éliminer
une
lésion
gastrique,
des
signes
d’hypertension
portale
en
cas
de
stéatose
hépatique
sévère
(non
alcoholic
steato
hepatitis).
Elle
est
systématiquement
associée
à
des
biopsies
afin
d’identifier
une
infestation
par
Helicobacter
pylori
(à
éradiquer
en
préopératoire)
;
•
une
échographie
abdominale
permettant
d’évaluer
la
taille
du
lobe
gauche
du
foie
(pouvant
gêner
l’exposition
du
cardia)
et
rechercher
une
lithiase
vésiculaire.
Parmi
les
contre-indications
relatives
à
la
GPAM,
on
retient
la
présence
d’un
reflux
gastro-œsophagien
sévère
et/ou
d’une
hernie
hiatale
dont
la
symptomatologie
peut
être
majorée
par
le
dispo-
sitif.
Les
troubles
moteurs
de
l’œsophage
de
type
achalasie
sont
également
une
contre-indication
à
l’anneau
du
fait
des
risques
d’aggravation
de
la
dysphagie
:
une
manométrie
œsophagienne
préopératoire
peut
être
utile
en
cas
de
doute
diagnostique
mais
n’est
pas
systématique.
Régime
préopératoire
Il
est
conseillé
d’imposer
un
régime
préopératoire
sévère-
ment
hypocalorique
aux
patients
superobèses,
avec
une
obésité
androïde
et/ou
un
tour
de
taille
supérieur
à
130
cm,
et/ou
un
volumineux
lobe
gauche
hépatique
avec
stéatose
importante.
Ce
régime
permettrait
de
faciliter
l’exposition
du
cardia,
notamment
en
faisant
régresser
rapidement
la
taille
du
foie.
En
effet,
plusieurs
études
ont
rapporté
une
diminution
de
15
%
du
volume
du
foie
gauche
et
une
régression
de
40
%
de
la
stéatose
hépatique
après
15
jours
de
«régime
yaourt
»[13,
14].
Différents
régimes
sont
pres-
crits
:
à
base
de
yaourts
à
0
%
ou
des
régimes
hypocaloriques
riches
en
protéines
et
pauvres
en
graisses,
pendant
les
dix
à
15
jours
qui
précèdent
l’intervention.
D’autres
auteurs
rapportent
également
une
accélération
de
la
perte
pondérale
chez
les
patients
ayant
suivi
un
régime
préopératoire [15].
Le
régime
peut
être
associé
à
la
pres-
cription
d’acides
gras
polyinsaturés
(oméga
3)
qui
permettraient
également
de
faciliter
la
régression
de
la
stéatose
hépatique [16].
“
Point
fort
•La
pose
d’un
anneau
gastrique
ne
peut
s’envisager
qu’après
une
évaluation
pluridisciplinaire
de
l’obésité.
•Une
enquête
diététique
permet
de
dépister
des
gri-
gnotages,
un
sweet
eating
(alimentation
sucrée)
ou
des
compulsions
alimentaires
qui
sont
sources
d’échec
de
la
GPAM.
•Une
évaluation
psychiatrique
est
indispensable
pour
éliminer
un
trouble
psychiatrique
sous-jacent,
parfois
décompensé
par
la
chirurgie
bariatrique.
•Une
gastroscopie
doit
être
réalisée
avant
la
GPAM
afin
d’éliminer
une
lésion
gastrique
ou
des
signes
d’hypertension
portale.
•Un
RGO
sévère
et
la
présence
de
troubles
moteurs
de
l’œsophage
sont
une
contre-indication
à
la
GPAM.
Technique
de
gastroplastie
par
anneau
modulable
Rappels
anatomiques
L’anneau
gastrique
se
pose
autour
de
l’estomac,
dans
la
région
du
cardia.
La
technique
de
pose
nécessite
d’identifier
les
dif-
férentes
structures
anatomiques
concernées
:
les
piliers
droit
et
gauche
du
diaphragme
délimitant
le
hiatus
œsophagien,
le
liga-
ment
gastrophrénique,
la
pars
flaccida
du
petit
épiploon,
l’angle
de
His,
la
graisse
périgastrique
antérieure.
Les
pièges
possibles
sont
les
suivants
:
•
l’abord
de
cette
région
est
souvent
gêné
par
un
volumineux
lobe
gauche
hépatique
qu’il
est
nécessaire
de
récliner
à
l’aide
d’un
rétracteur.
Une
manipulation
prudente
est
recommandée
pour
éviter
les
plaies
fréquentes
dont
l’hémostase
est
parfois
difficile
sur
les
foies
stéatosiques
;
2EMC
-
Techniques
chirurgicales
-
Appareil
digestif
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2014 par UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS - SCD - (6574)

Techniques
de
gastroplastie
par
anneau
modulable
laparoscopique 40-380
•
une
artère
hépatique
gauche
est
décrite
dans
environ
10
à
15
%
des
cas,
elle
chemine
à
la
partie
haute
du
petit
épiploon
(pars
condensa).
Il
est
préférable
de
la
conserver,
surtout
si
elle
est
de
gros
calibre,
même
si
cette
artère
a
rarement
un
rôle
majeur
dans
la
vascularisation
du
foie
;
•
l’identification
du
pilier
diaphragmatique
droit
est
parfois
dif-
ficile,
notamment
chez
les
patients
à
l’obésité
essentiellement
abdominale
et
en
cas
de
volumineux
lobe
gauche
hépatique
qui
rendent
l’exposition
difficile.
Il
est
alors
essentiel
d’ouvrir
largement
vers
le
haut
le
petit
épiploon
et
de
bien
récliner
la
petite
courbure
gastrique.
Principe
de
fonctionnement
de
la
gastroplastie
par
anneau
modulable
Les
anneaux
de
gastroplastie
sont
constitués
d’une
bande
sili-
conée
présentant
un
système
de
ballonnet
interne
relié
à
une
chambre
implantable
en
titane
par
un
cathéter
siliconé.
Cette
prothèse
est
positionnée
à
quelques
centimètres
sous
la
jonc-
tion
œsogastrique
dans
le
but
de
calibrer
une
poche
gastrique
d’environ
20
ml.
À
l’arrivée
du
bol
alimentaire,
cette
poche
est
distendue
créant
ainsi
la
restriction
alimentaire.
D’autres
phéno-
mènes
physiologiques
entrent
en
jeu
dans
la
sensation
de
satiété
précoce
et
durable,
notamment
par
le
biais
de
stretch
récepteurs
activant
par
la
voie
du
nerf
vague
la
région
hypothalamique.
L’injection
de
sérum
physiologique
par
ponction
transcutanée
du
boîtier
via
une
aiguille
de
Huber
permet
de
resserrer
l’anneau.
La
variation
du
diamètre
de
l’anneau
régule
ainsi
la
taille
de
la
lumière
gastrique
et
la
vitesse
d’évacuation
des
aliments.
La
vidange
gastrique
ralentie
stimule
la
sécrétion
de
cholécystoki-
nine
jouant
également
un
rôle
dans
la
satiété [17].
Types
d’anneau
Le
matériel
a
évolué,
passant
de
la
première
génération
d’anneau
(à
haute
pression
et
bas
volumes)
à
la
deuxième
géné-
ration
constituée
d’anneaux
plus
souples
et
plus
larges,
à
basse
pression
et
de
plus
gros
volumes.
L’évolution
du
matériel
n’a
pas
seulement
permis
de
faciliter
la
pose
mais
elle
a
également
permis
de
diminuer
les
complications
liées
à
l’anneau,
et
notamment
le
taux
de
glissement
et
de
migrations
intragastriques.
Actuellement,
cinq
types
d’anneaux
sont
disponibles
sur
le
marché,
approuvés
par
la
Haute
Autorité
de
santé
(HAS)
et
remboursés
par
la
Sécurité
sociale
:
l’anneau
américain
Lap-
Band®,
l’anneau
suédois
SAGB®,
l’anneau
Heliogast®,
l’anneau
MIDband®et
l’anneau
Bioring®.
Tous
donnent
des
résultats
comparables
en
termes
de
perte
de
poids.
Ils
diffèrent
essentiellement
par
leur
largeur,
le
volume
du
ballonnet,
leur
souplesse
et
leur
caractère
éventuellement
préformé
(circulaire,
facilitant
la
pose,
notamment
SAGB®,
Lap-
Band®),
certains
ayant
deux
tailles
disponibles
(Lap-Band®).
Évolution
de
la
technique
Alors
que
les
premiers
anneaux
étaient
positionnés
en
péri-
gastrique,
réalisant
un
cerclage
passant
dans
l’arrière-cavité
des
épiploons,
la
procédure
a
évolué.
La
technique
utilisée
à
l’heure
actuelle
est
celle
dite
de
la
«
pars
flaccida
»
ou
l’anneau
est
posi-
tionné
dans
un
tunnel
rétrogastrique,
au
sein
du
mésogastre
postérieur,
limitant
ainsi
les
glissements
postérieurs
d’anneau.
La
zone
de
dissection
englobe
le
cercle
artériel
de
la
petite
cour-
bure
gastrique,
ce
qui
réduirait
également
les
risques
de
migration
intragastrique
d’anneau.
La
voie
cœlioscopique,
initiée
en
1993
par
Belachew [18] qui
a
posé
le
premier
anneau
laparoscopique,
a
supplanté
totalement
la
laparotomie.
Le
taux
de
conversion
en
laparotomie
est
d’ailleurs
faible
(<
0,5
%)
pour
cette
procédure
qui
reste
relativement
simple.
Matériel
utilisé
La
pose
de
l’anneau
par
voie
cœlioscopique
nécessite
quatre
à
cinq
trocarts
:
un
trocart
de
11
mm
pour
l’optique
;
deux
à
trois
trocarts
de
5
mm
pour
le
rétracteur
hépatique,
le
crochet
dissecteur
et
les
pinces
à
préhension
;
puis
un
trocart
de
12
ou
15
mm
pour
l’introduction
de
l’anneau
gastrique
et
du
porte-aiguille.
Deux
pinces
à
préhension
atraumatiques
sont
nécessaires
:
des
pinces
fenêtrées
permettent
de
mieux
visualiser
les
gestes.
Le
cro-
chet
monopolaire
permet
la
dissection,
une
pince
bipolaire
est
parfois
utile
pour
compléter
l’hémostase.
Un
rétracteur
pour
le
lobe
gauche
du
foie
est
le
plus
souvent
nécessaire
en
cas
de
volumineux
lobe
gauche.
Il
peut
être
main-
tenu
à
l’aide
d’un
système
autostatique
de
type
«
bras
de
Martin
»,
se
substituant
ainsi
à
une
aide
opératoire.
Un
Goldfinger
est
également
conseillé
pour
la
confection
du
tunnel
rétrogastrique
:
sa
pointe
mousse
évite
les
traumatismes
de
la
paroi
gastrique
postérieure
(risque
de
perforation
mécon-
nue
et
de
péritonite
postopératoire)
et
son
articulation
(pointe
incurvable)
facilite
le
passage
en
avant
du
pilier
diaphragmatique
gauche.
Une
sonde
de
calibration
de
36
French
contenant
un
ballon-
net
sur
sa
face
antérieure
remplace
la
sonde
nasogastrique
(SNG)
au
moment
de
la
fixation
de
l’anneau
:
elle
permet
de
calibrer
la
poche
gastrique
jusqu’à
25
ml
et
de
positionner
correctement
l’anneau
avant
de
le
fixer.
L’utilisation
d’une
optique
à
30◦facilite
la
vision
et
est
préférée
à
l’optique
à
0◦.
Installation
et
conditionnement
du
patient
Il
est
hautement
recommandé
d’installer
le
patient
sur
une
table
spécialement
dédiée
à
la
chirurgie
bariatrique,
conc¸ue
le
plus
souvent
pour
supporter
plus
de
200
kg
en
position
assise.
Le
patient
est
installé
en
position
demi-assise
(45◦),
ce
qui
permet
une
meilleure
exposition
de
l’étage
susmésocolique.
La
position
assise
est
atteinte
par
paliers
progressifs
pour
éviter
les
hypo-
tensions
orthostatiques
fréquentes.
La
tête
est
maintenue
par
une
têtière
et
doit
rester
accessible
pour
permettre
les
manipu-
lations
de
la
SNG
et
de
la
sonde
de
calibration
gastrique
par
l’équipe
d’anesthésie.
Les
jambes
sont
idéalement
maintenues
dans
des
«
bottes
»,
en
position
écartée,
permettant
ainsi
un
bon
maintien
en
évitant
le
glissement
du
patient.
L’utilisation
de
gels
au
niveau
des
points
d’appui
est
indispensable
pour
évi-
ter
les
syndromes
de
compression
nerveuse
et/ou
musculaire.
Il
est
également
souhaitable
d’utiliser
la
compression
pneumatique
intermittente
des
jambes,
notamment
pour
les
procédures
poten-
tiellement
longues
et
chez
les
patients
superobèses,
plus
à
risque
d’accidents
thromboemboliques.
Les
bras
sont
positionnés
le
long
du
corps
sur
des
appuis-bras,
en
évitant
les
positions
trop
déclives
et
les
hyperextensions
sources
de
paralysie
des
plexus
brachiaux.
Les
seins
hypertrophiques
peuvent
être
fixés
vers
le
haut
à
l’aide
de
bandes
collantes
ce
qui
facilite
la
mise
en
place
des
trocarts
abdominaux.
L’opérateur
se
place
entre
les
jambes
du
patient,
l’aide
tenant
la
caméra
se
place
à
droite
et
l’instrumentiste
à
gauche.
Un
bras
de
Martin
fixé
à
droite
permet
de
maintenir
le
rétracteur
du
foie.
La
colonne
de
cœlioscopie
est
placée
à
droite
du
patient
(Fig.
1).
L’équipe
d’anesthésie
met
en
place
une
SNG
avant
l’insufflation,
sonde
qui
permet
également
une
vidange
de
l’estomac.
Une
antibioprophylaxie
peropératoire
à
base
de
céfazoline
2
g
est
réalisée.
Insufflation
et
position
des
trocarts
La
création
du
pneumopéritoine
peut
se
faire
soit
par
le
biais
d’une
«
open-cœlioscopie
»
avec
mise
en
place
d’un
trocart
à
bal-
lonnet
permettant
une
bonne
étanchéité,
soit
par
le
biais
d’une
aiguille
de
Veress.
L’open-cœlioscopie
se
fait
sur
la
ligne
médiane,
à
mi-distance
entre
ombilic
et
xyphoïde.
Il
faut
se
méfier
du
trocart
placé
trop
haut
notamment
en
cas
de
volumineux
lobe
gauche
du
foie,
et
du
trocart
placé
trop
bas
chez
les
patients
grands
à
l’obésité
abdominale
massive
car
on
a
alors
du
mal
à
visualiser
le
hia-
tus
diaphragmatique.
Des
instruments
permettant
d’écarter
en
profondeur
(exemple
des
écarteurs
de
Richardson)
sont
utiles
à
l’exposition
de
l’aponévrose
au
niveau
de
la
ligne
blanche
du
fait
EMC
-
Techniques
chirurgicales
-
Appareil
digestif 3
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2014 par UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS - SCD - (6574)

40-380 Techniques
de
gastroplastie
par
anneau
modulable
laparoscopique
A
1
2
3
4
B
Figure
1.
Installation
du
patient.
A.
Installation
du
patient
sur
la
table
d’obésité
:
position
demi-assise,
jambes
dans
des
bottes.
B.
Position
de
l’opérateur
et
de
ses
aides.
1.
Colonne
de
cœlioscopie
;
2.
aide
opératoire
;
3.
chirurgien
;
4.
instrumentiste.
d’un
important
panicule
adipeux.
Cette
technique
est
à
privilégier
chez
les
patients
aux
antécédents
de
chirurgie
abdominale
faisant
suspecter
des
adhérences
intrapéritonéales.
La
ponction
à
l’aiguille
de
Veress
se
fait
sous
les
côtes,
dans
l’hypochondre
gauche
(Fig.
2A).
Le
passage
du
péritoine
est
res-
senti
par
une
résistance
plus
importante
et
par
la
survenue
d’un
«
clic
»
facilement
audible.
Si
l’eau
de
la
seringue
en
verre
descend
spontanément
dans
l’abdomen,
cela
signifie
que
l’eau
coule
dans
la
cavité
péritonéale,
ce
qui
autorise
alors
l’insufflation.
Il
est
conseillé
d’insuffler
à
une
pression
de
15
mm
de
mercure
si
le
patient
le
tolère
bien
sur
le
plan
respiratoire
afin
d’avoir
un
volume
et
un
espace
de
travail
satisfaisant.
Le
patient
doit
être
correctement
curarisé
pour
permettre
l’obtention
d’un
pneumo-
péritoine
satisfaisant.
Les
trocarts
sont
positionnés
comme
suit
(Fig.
2B)
:
•un
trocart
de
11
mm
sus-ombilical
et
médian
pour
introduire
l’optique
(ou
un
trocart
d’open-cœlioscopie)
;
•
un
trocart
de
5
mm
sous-costal
et
latéral
droit
pour
le
rétracteur
du
foie
;
•
un
trocart
de
5
mm
transrectal
droit
pour
une
pince
à
préhen-
sion
et
le
Goldfinger
;
•
un
trocart
de
12
mm
(ou
15
mm)
transrectal
gauche
pour
intro-
duire
l’anneau
et
manipuler
une
pince
à
préhension
;
•
en
cas
de
dissection
difficile,
pour
faciliter
l’exposition
par
l’utilisation
d’une
pince
à
préhension
supplémentaire,
un
tro-
cart
de
5
mm
sous-costal
et
latéral
gauche.
Les
pièges
possibles
sont
les
suivants
:
•
ne
pas
trop
rapprocher
les
trocarts
qui
sont
à
éloigner
les
uns
des
autres
afin
de
permettre
la
meilleure
triangulation
possible
et
faciliter
les
gestes
;
•
éviter
les
trajets
obliques
intrapariétaux
des
trocarts
respon-
sables
de
difficultés
de
manipulation
des
pinces
par
contraintes
pariétales
excessives
;
•
attention
à
ne
pas
mettre
le
trocart
de
5
mm
transrectal
droit
dans
le
ligament
rond,
ce
qui
est
souvent
source
d’hémorragie.
Différents
temps
de
dissection
Premier
temps
:
dissection
du
pilier
gauche
(Fig.
3)
La
rétraction
du
lobe
gauche
du
foie
permet
l’exposition
du
hiatus
diaphragmatique.
On
repère
alors
le
pilier
gauche
du
dia-
phragme
et
on
ouvre
le
péritoine
en
avant,
à
l’aide
du
crochet
monopolaire.
La
dissection
se
fait
au
niveau
de
l’angle
de
His
et
permet
de
délimiter
l’orifice
de
sortie
du
trajet
rétrogastrique
du
Goldfinger.
Deuxième
temps
:
ouverture
de
la
pars
flaccida
et
dissection
du
pilier
droit
du
diaphragme
(Fig.
4)
L’ouverture
de
la
pars
flaccida
du
petit
épiploon
permet
d’exposer
le
pilier
droit
du
diaphragme.
Il
faut
rechercher
une
artère
hépatique
gauche
cheminant
dans
le
ligament
gastrohé-
patique
dans
10
%
des
cas,
artère
qu’il
est
conseillé
de
préserver.
Chez
le
sujet
superobèse
et
masculin,
il
est
parfois
difficile
de
repérer
le
pilier
droit,
dissimulé
par
la
masse
graisseuse
de
la
petite
courbure
gastrique
:
une
traction
vers
la
gauche
de
ce
tissu
adipeux
excédentaire
par
une
pince
supplémentaire
d’un
cin-
quième
trocart
est
alors
utile.
Il
faut
ensuite
ouvrir
le
péritoine
en
avant
du
pilier
droit,
au
niveau
de
sa
portion
tiers
moyen–tiers
inférieur,
à
l’aide
du
crochet
monopolaire,
ce
qui
permet
d’amorcer
la
dissection
du
trajet
rétrogastrique
à
l’aide
d’une
pince
atraumatique.
Troisième
temps
:
confection
du
tunnel
rétrogastrique
(Fig.
5)
Il
est
conseillé
d’utiliser
un
Goldfinger
à
bout
mousse,
atrauma-
tique
et
incurvable
pour
mieux
franchir
le
passage
en
avant
du
pilier
diaphragmatique
gauche.
À
défaut,
une
pince
fenêtrée
peut
également
être
utilisée.
L’instrument
est
introduit
par
le
trocart
de
5
mm
transrectal
droit
et
est
manipulé
par
la
main
gauche
du
4EMC
-
Techniques
chirurgicales
-
Appareil
digestif
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2014 par UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS - SCD - (6574)

Techniques
de
gastroplastie
par
anneau
modulable
laparoscopique 40-380
A
1
23
45
B
Figure
2.
Insufflation
et
position
des
trocarts.
A.
Insufflation
à
l’aiguille
de
Veress
dans
l’hypochondre
gauche.
B.
Position
des
trocarts.
1.
Trocart
de
11
ou
12
mm
pour
l’optique
;
2.
trocart
de
5
mm
pour
le
rétracteur
hépatique
;
3.
trocart
de
5
mm
pour
une
pince
à
préhension
et
le
Goldfinger
;
4.
trocart
de
12
mm
pour
une
pince
et
pour
l’introduction
de
l’anneau
;
5.
trocart
de
5
mm
facultatif
pour
une
pince
à
préhension.
T3
T2
T4
Figure
3.
Dissection
du
pilier
gauche
du
diaphragme
:
le
crochet
mono-
polaire
ouvre
le
péritoine
au
niveau
de
l’angle
de
His
par
le
trocart
4
(T4),
la
pince
fenêtrée
tracte
la
grosse
tubérosité
vers
la
gauche
(T2)
et
le
bas
par
le
trocart
3
(T3).
chirurgien.
Il
passe
dans
un
trajet
rétrogastrique
depuis
la
portion
inférieure
du
pilier
droit
jusqu’au
pilier
gauche
où
il
ressort
au
niveau
de
l’angle
de
His
disséqué
lors
du
premier
temps.
Les
pièges
possibles
sont
les
suivants
:
•
chez
les
patients
superobèses
à
l’obésité
androïde
massive,
il
est
possible
de
passer
non
pas
en
arrière
de
l’estomac
mais
en
avant,
au
sein
de
la
graisse
périgastrique
antérieure.
Pour
éviter
cela,
il
faut
s’assurer
de
garder
le
contact
du
Goldfinger
avec
le
pilier
droit
;
•
éviter
d’enfoncer
l’instrument
en
profondeur
dans
le
hiatus
diaphragmatique
au
risque
de
blesser
l’artère
gastrique
gauche,
l’aorte
ou
la
plèvre
gauche.
L’incurvation
du
Goldfinger
lors
de
son
passage
du
pilier
gauche
facilite
ce
geste
;
•
éviter
de
trop
disséquer
le
passage
rétrogastrique
car
les
espaces
élargis
facilitent
la
bascule
de
l’anneau
;
•
attention
à
la
plaie
gastrique
postérieure
lors
de
la
confection
du
tunnel
rétrogastrique
:
la
dissection
doit
être
douce,
sans
jamais
T3 T4
Figure
4.
Ouverture
de
la
pars
flaccida
du
petit
épiploon
pour
exposi-
tion
du
pilier
droit
du
diaphragme.
T4
:
crochet
monopolaire
main
droite
par
le
trocart
4
;
T3
:
pince
à
préhension
main
gauche
par
le
trocart
3
trac-
tant
la
graisse
de
la
petite
courbure
gastrique
vers
la
droite.
forcer.
En
cas
de
suspicion
de
plaie
gastrique,
il
faut
renoncer
à
poser
l’anneau
en
raison
du
risque
d’infection
avec
péritonite
postopératoire
grave.
À
ce
stade,
la
SNG
est
enlevée
et
remplacée
par
la
sonde
de
calibration
descendue
par
l’équipe
d’anesthésie.
Le
ballonnet
de
la
sonde
est
gonflé
avec
25
cm3d’air
dans
l’estomac,
puis
remonté
jusqu’au
cardia
où
il
se
bloque,
sous
contrôle
de
l’opérateur.
Cette
sonde
permettra
de
positionner
correctement
l’anneau
gastrique
en
calibrant
une
poche
gastrique
dans
laquelle
les
aliments
seront
emmagasinés,
l’anneau
étant
fixé
ultérieurement
au
pôle
inférieur
de
cette
poche.
Positionnement
et
verrouillage
de
l’anneau
Il
est
recommandé
de
changer
de
gants
avant
toute
manipula-
tion
de
l’anneau.
Avant
de
l’introduire
dans
la
cavité
péritonéale,
il
est
conseillé
de
tester
l’étanchéité
du
ballonnet
par
l’injection
de
quelques
millilitres
de
sérum
physiologique.
L’anneau
est
EMC
-
Techniques
chirurgicales
-
Appareil
digestif 5
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 15/05/2014 par UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS - SCD - (6574)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%
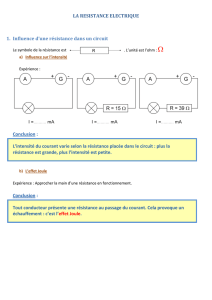
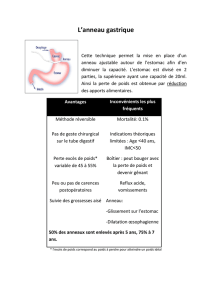


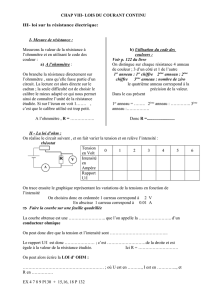






![SCIENCES PHYSIQUES : LES RESISTANCES 4ième I] Le code des](http://s1.studylibfr.com/store/data/007458512_1-ac332b15b23cb4efc89d8cf7f2b36c6b-300x300.png)