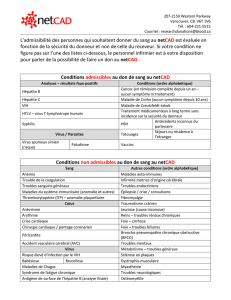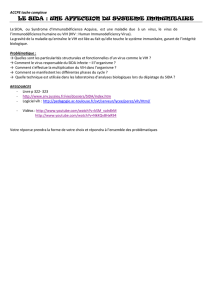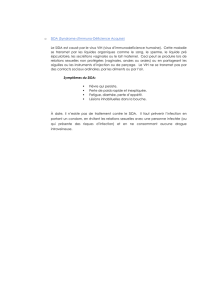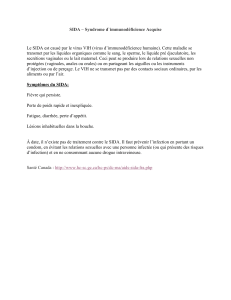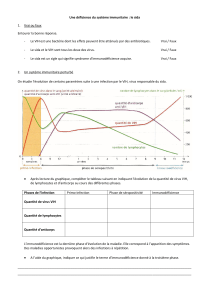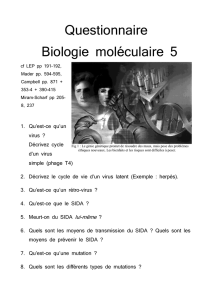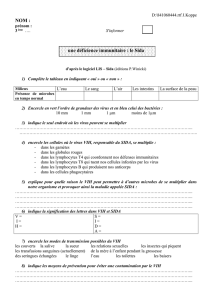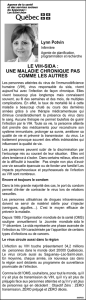La médecine toujours en éveil Virologie

partie de leur structure. Si le virus contient un
ARN, on l’appelle rétrovirus (le VIH par
exemple) qui, pour se reproduire, doit se servir
d’enzymes qui transcrivent l’ARN en ADN au
cours d’un processus appelé transcriptase in-
verse. Ce type de virus peut ensuite reprendre le
processus habituel chez les êtres vivants, qui
passe par la duplication de l’ADN.
Pour détecter les virus, les techniques utilisées
par les biologistes sont extrêmement sophisti-
quées. Parce qu’on n’arrive pas à cultiver les vi-
rus comme les bactéries, on utilise des gènes
communs à des familles de virus.
Si l’on compare le nombre de médicaments dis-
ponibles contre les bactéries et le nombre de
ceux disponibles contre les virus, ceux-ci sont
peu nombreux. Certains vaccins peuvent préve-
nir des infections virales (hépatites A et B, rou-
geole, poliomyélite, variole, etc.), d’autres n’exis-
tent pas (VIH, VHC), d’autres encore sont
partiellement efficaces (grippe). Les traitements
sont difficiles, associent souvent plusieurs médi-
caments (bithérapies, trithérapies), mais ils peu-
vent aboutir à une sélection de virus résistants.
Les virus sont parfois mutants. Ils le sont quand
ils passent d’un malade à un autre.
Aujourd’hui, on soupçonne un virus mutant
de la grippe aviaire, qui se serait modifié géné-
tiquement pour infecter l’homme, de causer ce
que l’on appelle la “pneumopathie atypique”.
Cette nouvelle infection venue d’Asie préoccupe
la planète.
Andrée-Lucie Pissondes
T
ous les organismes vivants s’associent et en-
trent en conflit pour se multiplier et trans-
mettre leurs gènes. Cette lutte pour la vie est le
sens même de leur existence et de celle des virus
en particulier. D’où l’émergence récurrente de
certaines maladies, malgré l’amélioration de
l’hygiène, des comportements et de l’alimenta-
tion, qui a éliminé nombre de risques infectieux.
En bref, pour survivre, le micro-organisme en-
treprend une stratégie visant à déclencher une
maladie. Pour cela, il doit d’abord trouver une
entrée (respiratoire, digestive, génitale, cuta-
née). Ensuite, il doit résister aux défenses de
l’organisme. Enfin, il se dissémine à l’intérieur
du corps et son potentiel d’infection va dé-
pendre de sa capacité à en sortir (toux, urines,
éruption cutanée) pour se développer chez un
autre hôte. La caractérisation des maladies in-
fectieuses repose sur l’identification d’un germe
et la mise en évidence d’un lien de causalité
entre celui-ci et une maladie.
Les virus
Les virus font partie des micro-organismes sus-
ceptibles d’infecter les êtres vivants. Ils sont
constitués d’ADN (acide désoxyribonucléique)
ou d’ARN (acide ribonucléique), et sont recou-
verts d’une enveloppe faite de protéines. S’ils
sont incapables de se reproduire par eux-mêmes,
ils trouvent les moyens de se multiplier dans les
cellules vivantes. L’ADN ou l’ARN viral contient
des enzymes appelées polymérases, qui aident à
leur reproduction, et des gènes, qui codent une
Virologie
La médecine
toujours en éveil
Le risque infectieux est inhérent à la vie.
L’apparition de nouvelles maladies infectieuses est
donc permanente. Certains risques peuvent être évités.
D’autres sont imprévisibles car liés à la stratégie
d’adaptation des micro-organismes et à la diversité
de notre écosystème. Parmi les maladies émergentes,
celles dues aux virus sont des plus redoutables.
13
Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003
Sommaire
• Les principales affections virales :
pas toujours graves,
toujours sous surveillance
• Les hépatites :
un problème de santé publique
• Évolution de l’infection par VHC :
la dépendance aux interactions
virus/hôte
• Les hépatites fulminantes :
une prise en charge spécialisée
• VIH :
mécanismes du déficit immunitaire
et évolution de l’infection
• La prise en charge du sida à l’hôpital :
recommandations nationales
de prise en charge thérapeutique
• Perturbations métaboliques :
de l’importance de la nutrition
• Après 20 ans d’épidémie :
une banalisation dangereuse
Dossier réalisé
avec la participation
de notre publication

14
taquer d’une façon brutale. La vigilance est l’élé-
ment majeur de la surveillance des maladies infec-
tieuses. Particulièrement active aux États-Unis
grâce à des registres de mortalité et des centres de
statistiques suivis, elle peut justifier, d’une certaine
façon, l’avance prise par cette nation pour faire le
lien de causalité entre un type de virus et une ma-
ladie. En France, les réseaux sont balbutiants et la
déclaration obligatoire des maladies est restreinte.
Des affections comme le sida ont bouleversé le
monde scientifique et politique. Une attention
plus grande est portée aux maladies virales qui,
sans être aussi dramatiques que le sida, n’en com-
portent pas moins des effets délétères. La polio-
myélite semble éradiquée, la variole refait parler
d’elle, la grippe suscite quelques inquiétudes et l’on
s’attend à une nouvelle pandémie...
La mononucléose infectieuse
La mononucléose infectieuse (MNI) est une ma-
ladie infectieuse aiguë due au virus d’Epstein-
Barr de la famille des Herpesvirus. Bénigne, elle
est cependant responsable d’une grande fatigue.
Elle touche préférentiellement les adolescents et
les jeunes adultes.
Une fois dans l’organisme, le virus se multiplie
dans certains globules blancs, les lymphocytes.
L’incubation est de 4 à 6 semaines. La MNI est le
plus souvent asymptomatique (ne donne aucun
signe clinique). La transmission se fait par la sa-
live, d’où le nom de “maladie du baiser”.
L’apparition est progressive, accompagnée de
signes plus ou moins intenses, évoquant un syn-
drome grippal : maux de tête, malaises, frissons,
douleurs musculaires, perte d’appétit. La fièvre,
très fréquente, est souvent assez élevée, la fatigue
importante. Une angine rouge avec inflamma-
tion buccale peut gêner la déglutition, de même
que des ganglions (ou adénopathie) dans le cou.
Plus rarement, une éruption cutanée survient,
voire une discrète jaunisse (ictère).
Dans près de la moitié des cas, il existe une aug-
mentation du volume de la rate (splénomégalie)
mais ne donnant aucun signe clinique. Il arrive
enfin que le foie soit également un peu gros
(hépatomégalie), phénomène parfois associé à
un léger ictère.
La numération formule sanguine permet de
mettre en évidence un syndrome mononucléo-
sique : il existe de nombreux lymphocytes, dont
certains sont bleutés (par la coloration sur lame) ;
les plaquettes sont abaissées dans la moitié des
cas. Les transaminases (enzymes du foie) sont
souvent élevées. Le diagnostic se fait sur l’exis-
tence d’anticorps anti-VEB dans le sang. Pour
cela, on a recours au MNI-Test : il s’agit d’un test
rapide et réalisable dès les premiers jours de la
maladie. Il existe cependant une possibilité de
faux positifs, c’est pourquoi il faut le compléter
par un autre test appelé “réaction de Paul-Bun-
nell-Davidsohn” (PBD), qui permet de confirmer
le plus souvent le diagnostic de mononucléose
infectieuse. Dans environ 20 % des cas, la PBD
reste négative ; le seul moyen de faire le dia-
gnostic est alors de rechercher les anticorps spé-
cifiques par une sérologie : la présence d’immu-
noglobulines appelées “IgM anti-VCA” permet
d’affirmer l’infection.
Le traitement consiste à se reposer au lit. Des
antalgiques et des antipyrétiques seront pres-
crits. En revanche, les antibiotiques sont le plus
souvent inutiles puisqu’il s’agit d’une maladie
virale. Ils sont nécessaires uniquement s’il existe
une surinfection bactérienne de l’angine. Ce-
pendant, la pénicilline A, ou ampicilline, est for-
mellement contre-indiquée car elle entraîne alors
des éruptions cutanées importantes. Lorsque la
gêne à la déglutition et à la respiration est très
marquée, le médecin peut être amené à prescrire
des corticoïdes pendant quelques jours, qu’il fau-
dra toujours arrêter de façon progressive. La mo-
nonucléose guérit en deux à trois semaines
environ, seule la fatigue peut persister pendant
plusieurs mois.
Le zona
Le zona est en fait une maladie infectieuse causée
par le virus Herpes zoster, responsable également
de la varicelle. Pour développer un zona, il faut
donc avoir déjà contracté cette maladie infantile.
Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003
Virologie
Les principales affections virales
Pas toujours graves, toujours sous surveillance
Les maladies infectieuses ont évolué parallèlement à la société humaine. La vie moderne,
avec ses brassages de populations qui se déplacent rapidement d’un continent à l’autre,
favorise une propagation rapide des virus.
L
a dernière infection, la pneumopathie atypique,
est là pour nous le rappeler : un virus peut at-

Après l’épisode de la varicelle, le virus chemine le
long d’un nerf sensitif pour aller se loger dans les
ganglions de la moelle épinière. Il reste là, à l’état
latent, jusqu’à ce qu’une baisse de l’immunité
permette sa réactivation (25 % des adultes qui ont
eu la varicelle développent un zona).
Le zona présente trois phases :
•Stade 1 : douleurs intenses et constantes dans
une région précise (thorax, tête, cou, bas du dos
ou membres inférieurs) et généralement unilaté-
rales ; absence de lésions cutanées ; durée de
quelques heures à quelques semaines.
•Stade 2 : apparition de rougeurs et éruption de
vésicules ou de cloques limitées à la région dou-
loureuse (le long du nerf touché) ; douleurs et
démangeaisons constantes ; risque de fatigue ;
durée de trois à quatre semaines.
•Stade 3 : disparition des lésions cutanées ;
cicatrisation.
C’est à partir de l’âge de 50 ans que les risques
augmentent. À 85 ans, plus de 50 % des hommes
et des femmes auront eu un épisode de zona. Le
virus peut être réactivé chez toute personne
dont le système immunitaire est affaibli (même
les enfants, dans de très rares cas). C’est pourquoi
le zona est très fréquent chez les cancéreux et
les sidéens.
Il ne faut pas crever les cloques, qui risqueraient
de s’infecter rapidement. Pour obtenir un soula-
gement, on applique de la calamine sur les lésions
plusieurs fois par jour ; elle a pour effet de calmer
les démangeaisons et de les dessécher. Une lotion
à base de phénol et de menthol peut être appli-
quée lorsque les cloques sont desséchées et qu’il
y a formation d’une croûte. Un antibiotique peut
être prescrit pour éviter que les lésions ne s’in-
fectent et pour accélérer la cicatrisation. La dou-
leur, ravivée par le contact de l’air, est soulagée par
la pause d’une gaze ou d’un bandage.
Le traitement du zona consiste à prescrire un an-
tiviral oral du type aciclovir, valaciclovir ou fam-
ciclovir. Ces trois médicaments ont pour effet
d’arrêter la progression du virus, de réduire la
durée de la maladie et de diminuer le risque de
névralgie postzostérienne.
L’administration d’un analgésique à base de co-
déine ou d’un corticostéroïde en comprimé
contribue à soulager les douleurs parfois très
fortes. La névralgie postzostérienne est la princi-
pale complication du zona.
L’herpès génital
Les infections herpétiques peuvent récidiver
toute la vie. L’herpès génital dû au virus HSV2
est une maladie particulièrement pénible. Sa
première manifestation (primo-infection) est ca-
ractérisée par une éruption très prurigineuse et
très douloureuse des vésicules, voire des cloques
sur le sexe. Chez la femme, on les retrouve dis-
posées en bouquets dans le vagin ou sur le pé-
rinée (peau comprise entre le vagin et l’anus).
Chez l’homme, elles se regroupent sur le pénis
ou sur les testicules. Tant chez l’homme que
chez la femme, des lésions anales sont possibles.
En quelques jours, ces lésions vont s’éroder pour
constituer des plaies encore plus douloureuses...
Ce tableau déjà pénible peut être aggravé par la
fièvre, des maux de tête, des douleurs digestives
et des courbatures.
Pourtant, dans 60 % des cas, l’infection ne se dé-
clare jamais cliniquement et reste inaperçue. A
contrario, quand elle s’est manifestée, des réci-
dives surviennent dans 85 % des cas. Cela ex-
plique pourquoi l’herpès est une maladie insi-
dieuse, pouvant facilement être méconnue et se
transmettre d’un partenaire à l’autre. Selon une
enquête Louis Harris réalisée pour le compte de
l’association Herpès, si près d’un Français sur
cinq est ainsi atteint, seuls deux sur dix se savent
contaminés. Pire, seules 34 % des personnes at-
teintes savent qu’il s’agit d’une maladie sexuelle-
ment transmissible (MST) et 59 % n’utilisent ja-
mais de préservatifs...
Aujourd’hui, l’herpès se soigne grâce aux anti-
viraux spécifiques du virus, mais il ne guérit ja-
mais. Dans les cas d’un herpès récidivant plus
de 6 fois par an, il est maintenant possible de
mettre en place une cure longue et quotidienne
d’antiviral sur une durée de 6 mois. Dans cer-
tains cas, l’herpès peut être très grave, notam-
ment chez les nouveau-nés et chez les patients
immunodéprimés.
Pour prévenir des atteintes gravissimes du nou-
veau-né, en cas de risque, outre la mise en place
d’un traitement antiviral, une césarienne sera
pratiquée pour éviter tout risque de contamina-
tion. Chez les personnes immunodéprimées, no-
tamment les malades souffrant du sida ou d’un
cancer, un traitement antiviral de longue durée
doit être institué.
Il faut savoir en effet qu’il existe deux types de vi-
rus : le HSV1 et le HSV2, et que le premier peut
être responsable d’un herpès buccal (le fameux
bouton de fièvre). L’application de corticoïdes
peut être catastrophique en favorisant la diffusion
du virus. Les prélèvements permettent d’identi-
fier le virus en cause. Cette information permet-
tra ensuite d’appliquer le traitement plus tôt si
d’autres poussées surviennent, et de prévenir ses
partenaires lors de rapports sexuels ultérieurs.
L’ herpès est constamment contaminant, même en
dehors de toute poussée, même si la contamina-
15
Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003
●●●

16
tion est maximale lors des éruptions. Les rapports
sexuels sont alors formellement déconseillés.
Faire pratiquer une sérologie chez le partenaire
est recommandé. Si les deux partenaires sont
contaminés par le même virus, il ne devient plus
nécessaire de se protéger l’un l’autre de la conta-
mination : il n’existe pas de phénomène de sur-
contamination d’un individu à l’autre.
Infections sexuellement transmissibles (IST)
d’origine virale
Les IST regroupent les maladies qui ne se trans-
mettent pratiquement que par rapports sexuels
ainsi que celles pouvant se transmettre par
d’autres voies, mais aussi par voie sexuelle. Il faut
savoir que plusieurs des symptômes affectant les
organes génitaux peuvent être attribuables à
d’autres causes qu’une IST.
Les IST se divisent en deux catégories : les IST
bactériennes et les IST virales. Ces dernières
peuvent surgir tardivement, c’est-à-dire quelques
mois ou même quelques années après des
contacts sexuels non protégés. Outre l’infection
génitale à virus Herpes simplex, dont l’incidence
est en augmentation croissante, l’IST d’origine
virale la plus fréquente est due au virus du pa-
pillome humain (VPH). Les condylomes sont de
multiples excroissances en chou-fleur sur la peau
ou les muqueuses des organes génitaux ou de
l’anus. Ils n’occasionnent généralement pas de
douleur et les personnes consultent parce qu’ils
voient ou sentent les lésions.
La variole
On la croyait éradiquée. La variole refait surface
avec les menaces de guerre bactériologique. La
maladie est due à une infection par un virus qui
appartient au groupe des Orthopoxvirus.
L’incubation (période comprise entre l’entrée du
virus dans l’organisme et l’apparition des pre-
miers symptômes) dure en moyenne 10 à
14 jours avec des extrêmes de 7 à 19 jours. La
Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003
●●●
Virologie
Lexique
•Aérobie : se dit d’un micro-organisme ayant besoin
d’air ou d’oxygène pour vivre et se développer.
•Anaérobie : se dit d’un micro-organisme n’ayant
pas besoin d’oxygène pour vivre et se développer.
•Antibiotique : médicament empêchant la crois-
sance des micro-organismes et utilisé pour combattre
les infections bactériennes. N’agit pas sur les virus.
•Asepsie : méthode ou technique de protection
contre les contaminations microbiennes (exemple : sté-
riliser un instrument chirurgical avant son utilisation).
•Bactérie : micro-organisme unicellulaire respon-
sable d’infections (bactérie pathogène) ou bien vi-
vant à l’état normal dans notre organisme (bactérie
saprophyte).
•C.CLIN : Centres interrégionaux de coordination de
la lutte contre les infections nosocomiales.
•Commensal : se dit d’une espèce naturelle vivant
des restes des repas d’une autre, mais sans lui nuire
(notre peau est normalement recouverte de germes
commensaux).
•Contaminer : transmettre une maladie, une infection.
•CTIN : Comité technique des infections noso-
comiales.
•Désinfection : destruction des germes d’un local,
de la peau, d’un instrument, etc. ;
•Entérobactérie : bactérie du tube digestif (chez
l’homme et les animaux).
•Germe : microbe, micro-organisme. On distingue les
germes pathogènes (responsables de maladies) et les
germes saprophytes (non responsables de maladies).
•Hygiène : règles et conditions de vie, soins néces-
saires pour préserver la santé (exemple : l’hygiène des
mains en milieu hospitalier repose sur le lavage des
mains et, parfois, sur le port de gants stériles).
•Immunodépresseur : substance capable de dimi-
nuer ou de supprimer les réactions immunitaires d’un
organisme (exemple : corticoïdes, ciclosporine, etc.).
•Immunodéprimé : qui n’a pas les réactions immu-
nitaires normales (exemple : les patients porteurs du vi-
rus du sida, les cancéreux ayant eu de la chimiothéra-
pie sont souvent immunodéprimés).
•Infectieux : relatif à une infection ; accompagné
d’une infection ; qui transmet une infection.
•Infection : maladie déclenchée par un micro-orga-
nisme pathogène.
•Nosocomial : qui se contracte à l’hôpital (“infection
nosocomiale”).
•Pathogène : susceptible de provoquer une maladie.
•Saprophyte : désigne les germes qui vivent sur un
hôte sans entraîner de maladie.
•Septicémie : infection générale provoquée par le
développement de germes pathogènes présents dans
le sang.
•Staphylocoque :
nom de bactéries.
•Stérile :
en médecine, lieu exempt de microbes.
•Streptocoque :
nom de bactéries.
•Virus :
agent pathogène de très faible taille (invi-
sible au microscope optique).
Source : DGS/DH.

17
Professions Santé Infirmier Infirmière - No45 - avril 2003
●●●
personne atteinte n’est pas contagieuse durant
cette phase et ne présente aucun symptôme par-
ticulier. La maladie commence par une première
phase qui dure environ 2 à 3 jours. Elle est ca-
ractérisée par une altération franche et brutale de
l’état général, une fièvre très marquée, un ma-
laise, une prostration, des douleurs dorsales.
Dans un deuxième temps apparaît la phase érup-
tive qui débute par une éruption de la muqueuse
buccale et oropharyngée ; cette éruption prédo-
mine au visage et aux bras. En une seule pous-
sée, elle gagne le tronc et les membres inférieurs.
Ces lésions évoluent ensuite en vésicules à par-
tir du troisième jour puis en pustules au cin-
quième jour qui, en se desséchant, laissent place
à des croûtes noirâtres 8 à 9 jours après le début
de l’éruption. Ces croûtes tombent en trois à
quatre semaines, laissant des cicatrices indélé-
biles. La période de contagiosité s’étend de l’ap-
parition de la fièvre jusqu’à la chute des croûtes.
La transmissibilité du virus est maximale pen-
dant les 7 à 10 premiers jours suivant l’éruption,
elle est plus rare à l’apparition des signes cli-
niques et avant la phase éruptive. Elle cesse à la
chute des croûtes. Le mode de transmission se
fait essentiellement par contact interhumain di-
rect, par l’intermédiaire des sécrétions oropha-
ryngées (salive, postillons), la concentration de
virus dans la salive étant très importante, ou par
l’échange d’objets contaminés (linge et literie) et,
plus rarement, par contact direct avec les lésions
cutanées que sont les pustules et les croûtes (où
le virus est présent).
La variole se présentait sous plusieurs formes
plus ou moins rares et plus ou moins graves,
dont la forme hémorragique, toujours fatale, et
la forme maligne, caractérisée par une éruption
sans formation de pustules, était la cause d’une
mortalité proche de 100 %. Le diagnostic de cer-
titude est obtenu par la recherche du virus dans
des prélèvements cutanés de vésicules ou de pus-
tules. Mis à part le traitement symptomatique
(prévention des surinfections bactériennes), il
n’existe pas, actuellement, de traitement curatif
ayant fait ses preuves. Administré jusqu’à 4 jours
après l’exposition au virus, le vaccin entraîne une
immunité protectrice et peut éviter l’infection ou
en diminuer la gravité.
La Direction générale de la santé a élaboré un
document permettant de sensibiliser les profes-
sionnels de la santé aux aspects cliniques de la
maladie. Ce document d’information est dispo-
nible sur le site Internet du ministère de la
Santé, dans la rubrique “Biotox” (site Internet :
http://www.sante.gouv.fr).
A.-L.P.
Les hépatites
Un problème de santé publique
Les hépatites sont des affections virales qui, comme leur nom l’indique, attaquent le
foie, de manière irréversible dans les formes les plus graves. Seules les hépatites A et B
peuvent être prévenues par le vaccin. En augmentation, l’hépatite C est préoccupante
pour les autorités sanitaires.
S
ouvent transmises par voie sexuelle ou par
injection, les hépatites peuvent aussi l’être
de façon inconnue. Dans les formes graves, les
traitements existent, mais ils sont lourds et
nécessitent souvent l’accompagnement appuyé
des soignants.
Hépatite A
L’ hépatite A peut être contractée lors de rapports
sexuels, en particulier par les hommes qui ont des
relations homosexuelles. Elle se transmet le plus
souvent par voie fécale-orale, par de l’eau ou des
aliments contaminés, ou encore lors du partage
d’objets contaminés. Elle est souvent asymptoma-
tique. Quand ils sont présents, les symptômes rap-
pellent ceux d’une grippe (fatigue, fièvre, douleurs
musculaires, perte d’appétit) avec, parfois, des
douleurs articulaires et des poussées de boutons.
Une jaunisse apparaît chez quelques malades. L’in-
fection n’évolue jamais vers la chronicité et elle est
habituellement sans séquelles. L’hépatite A fait
beaucoup de victimes, chez les jeunes notam-
ment. Elle peut être prévenue par la vaccination.
Le vaccin contre l’hépatite A est recommandé par-
ticulièrement pour les jeunes hommes gays. Il
existe par ailleurs un vaccin protégeant à la fois
contre l’hépatite A et l’hépatite B. Dans la majorité
des cas d’hépatite A, aucun traitement particulier
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%